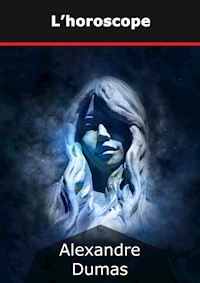
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Décembre 1559, le conseiller Dubourg est condamné à mort pour avoir remis en liberté un protestant, ce qui est interdit par le roi François II. Robert Stuart, son fils, cherche un moyen pour obtenir du roi la grâce de son père. A cette histoire politique se mêle celle du prince Louis de Condé. Épris de Charlotte de Saint-André - hôte du Louvre en compagnie du maréchal, son père - il se tient tous les soirs dans la cour du palais afin de la contempler de loin, à travers sa fenêtre. Un soir, Stuart lance un message par la fenêtre du maréchal, espérant qu'il sera remis au roi. Un remue-ménage s'en suit. Condé saisit ce prétexte pour aller s'entretenir avec Charlotte. Celle-ci se moque de lui... et, lui offrant un mouchoir pour qu'il sèche ses larmes, elle lui donne en même temps, malencontreusement, le message qui s'y cachait. Le prince découvre le mot... adressé à un autre: un rendez-vous amoureux dans une chambre du palais. Il confie le billet à un ami, l'amiral Coligny, lequel le laisse à son épouse pour qu'elle tente d'en découvrir l'auteur. Le lendemain, elle se présente au salon de la reine, où on la considère comme une bigote. Au cours de la soirée, elle laisse échapper le billet, lequel est ramassé par un courtisan. Après son départ, la reine lit à haute voix le billet et tous s'esclaffent, croyant que c'est l'amirale qui a un rendez-vous galant! On décide d'aller l'y surprendre. Condé, lui, est déjà au poste, caché sous le lit... Et voilà Stuart qui vient aussi s'y dissimuler: il vient au palais pour assassiner le roi s'il n'obtient pas la grâce du conseiller. Les deux hommes font connaissance et Condé engage Stuart à ne pas assassiner le roi, lui promettant d'intervenir auprès de lui. Enfin Charlotte arrive et se prépare à accueillir son amant... lequel n'est autre que le jeune roi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
L'horoscope
Pages de titrePremière partieDeuxième partiePage de copyrightAlexandre Dumas
L’horoscope
Première partie
I
La foire du Landi
Vers le milieu du mois de juin de l’année 1559, par une radieuse matinée de printemps, une foule, que l’on pouvait approximativement évaluer à trente ou quarante mille personnes, encombrait la place Sainte-Geneviève.
Un homme, arrivé fraîchement de sa province et tombant tout à coup au milieu de la rue Saint-Jacques, d’où il eût pu apercevoir cette foule, eût été bien embarrassé pour dire à quelle fin elle se trouvait agglomérée en si grand nombre sur ce point de la capitale.
Le temps était superbe : ce n’était donc pas la châsse de sainte Geneviève que l’on allait faire sortir, comme en 1551, pour obtenir la cessation des pluies.
Il avait plu l’avant-veille : ce n’était donc pas la châsse de sainte Geneviève que l’on promenait pour demander de la pluie, comme en 1556.
On n’avait point à déplorer une désastreuse bataille dans le genre de celle de Saint-Quentin : ce n’était donc pas, comme en 1557, la châsse de sainte Geneviève que l’on menait en procession pour obtenir la protection de Dieu.
Il était évident, néanmoins, que cet immense concours de populaire, rassemblé sur la place de la vieille abbaye, y venait célébrer quelque grande solennité.
Mais quelle solennité ?
Elle n’était pas religieuse ; car, quoique l’on aperçût çà et là dans la foule quelques robes de moines, ces robes respectables n’étaient pas en quantité suffisante pour donner à la fête un caractère religieux.
Elle n’était pas militaire ; car les hommes d’armes étaient en petit nombre dans la foule, et ceux qui y étaient n’avaient ni pertuisanes ni mousquets.
Elle n’était pas aristocratique ; car on ne voyait pas au-dessus des têtes flotter les pennons armoriés des gentilshommes et les casques empanachés des seigneurs.
Ce qui dominait dans cette multitude aux mille couleurs, où étaient confondus gentilshommes, moines, voleurs, bourgeoises, filles de joie, vieillards, bateleurs, sorciers, bohémiens, artisans, porteurs de rogatons, vendeurs de cervoise, les uns à cheval, les autres à mulet, ceux-ci à âne, ceux-là en coche (on venait justement, cette année-là, d’inventer les coches), et dont le plus grand nombre, cependant, allait, venait, poussait, grouillait, se démenait pour arriver au centre de la place ; ce qui dominait dans cette multitude, disons-nous, c’étaient les écoliers : écoliers des quatre nations, écossais, anglais, français, italiens.
En effet, c’était cela : on était au premier lundi après la Saint-Barnabé, et c’était pour aller à la foire du landi que toute cette foule était rassemblée.
Mais peut-être ces trois mots, qui appartiennent à la langue du XVIe siècle, ne disent-ils rien à nos lecteurs. Expliquons-leur donc ce que c’était que la foire du landi.
Attention, chers lecteurs ! nous allons faire de l’étymologie, ni plus ni moins qu’un membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
Le mot latin indictum signifie un jour et un lieu indiqués pour quelque assemblée du peuple.
L’i, changé d’abord en e, le fut définitivement en a. On dit donc successivement, au lieu d’indictum : l’indict, l’endit, puis l’andit, et enfin landi.
Il en résulte que ce mot signifie jour et lieu indiqués pour une assemblée.
Du temps de Charlemagne, le roi teuton qui faisait sa capitale à Aix-la-Chapelle, une fois par an, on montrait aux pèlerins les saintes reliques dans la chapelle.
Charles le Chauve transporta ces reliques d’Aix à Paris, et on les montra au peuple une fois par an, dans un champ de foire qui se tenait vers le boulevard Saint-Denis.
L’évêque de Paris, trouvant que, vu la piété croissante des fidèles, le champ de foire n’était point en harmonie avec ceux qu’il devait contenir, établit la fête du landi dans la plaine Saint-Denis.
Le clergé de Paris y apportait les reliques en procession ; l’évêque venait y prêcher et y donner la bénédiction au peuple ; mais il en était des bénédictions comme des biens du prochain ou des fruits du voisin : n’a pas le droit de les distribuer qui veut ; les clercs de Saint-Denis prétendirent qu’eux seuls avaient le droit de bénir sur leurs terres et assignèrent au parlement de Paris l’évêque, comme usurpateur.
L’affaire fut débattue avec acharnement et plaidée de part et d’autre avec une telle éloquence, que le parlement, ne sachant à qui des deux donner raison, donna tort à tous deux, et défendit, vu le trouble qu’ils causaient, aux évêques d’une part et aux abbés de l’autre, de mettre les pieds à la foire du landi.
Ce fut le recteur de l’Université qui hérita des prérogatives réclamées ; il avait le droit de se transporter tous les ans à la foire du landi, le premier lundi après la Saint-Barnabé, pour y choisir le parchemin nécessaire à tous ses collèges ; il était même défendu aux marchands siégeant à cette foire d’en débiter une seule feuille avant que monsieur le recteur eût fait toutes ses emplettes.
Cette promenade du recteur, qui durait plusieurs jours, suggéra aux écoliers la pensée de l’accompagner : ils lui en demandèrent la permission. Cette permission leur fut accordée, et, à partir de ce moment, le voyage se fit chaque année avec toute la pompe et toute la magnificence imaginables.
Les régents et les écoliers s’assemblaient, à cheval, sur la place Sainte-Geneviève, et, de là, ils marchaient en ordre jusqu’au champ où se tenait la foire. La cavalcade arrivait assez tranquillement à sa destination ; mais, une fois arrivé, le cortège trouvait, pour venir se joindre à lui, tous les bohèmes, tous les sorciers (l’on en comptait à Paris trente mille à cette époque), toutes les filles et toutes les femmes équivoques (de celles-ci, aucune statistique n’a jamais donné le nombre), en habits de garçons, toutes les demoiselles du Val-d’Amour, du Chaud-Gaillard, de la rue Froid-Mantel : une véritable armée, quelque chose comme une de ces grandes migrations du IVe siècle, avec cette différence que ces dames, au lieu d’être des barbares ou des sauvages, n’étaient que trop civilisées.
Arrivé dans la plaine Saint-Denis, chacun faisait halte, descendait de son cheval, de son âne, de sa mule, secouait simplement la poussière de ses bottes, de ses chausses, de ses souliers et de ses houseaux, s’il était venu à pied, se mêlait à l’honorable compagnie, dont il essayait de prendre ou de faire monter le diapason ; on s’asseyait, on mangeait boudins, saucissons et pâtés ; on buvait, à la prolongation des joues fleuries de ces dames, des quantités effroyables de pots de vin blanc de tous les coteaux d’alentour, Saint-Denis, La Briche, Épinay-lez-Saint-Denis, Argenteuil. Les têtes se montaient aux propos d’amour et aux propos de beuverie : alors flacons d’aller, jambons de trotter, goubèles de voler. Tus braille ; tourne Rousse à moi sans eau ; fouette-moi ce verre gualantement, mon ami ; du blanc ! du blanc ! verse tout, verse de par le diable !cent mains fault à un sommellier comme avait Briarius pour enfatigablement verser. La langue me pelle, mon compagnon, courage ! On avait mis en action le cinquième chapitre de Gargantua.
Le beau temps, ou plutôt le joyeux temps vous en conviendrez, que celui où Rabelais, curé de Meudon, écrivait Gargantua, et où Brantôme, abbé de Bourdeille, écrivait les Dames galantes !
Une fois gris, on chantait, on s’embrassait, on se querellait, on débitait des choses folles, on injuriait les passants. Il fallait bien s’amuser, que diable !
On entamait donc, avec les premiers venus qui tombaient sous la main, des propos qui, selon le caractère des gens, finissaient par des rires, des injures ou des coups.
Il fallut vingt arrêts du parlement pour remédier à ces désordres ; encore finit-on par être obligé, comme essai, de transporter la foire, de la plaine, dans la ville même de Saint-Denis.
En 1550, il fut bien décrété qu’à la foire du landi les écoliers n’assisteraient plus que par députations de douze pour chacun des quatre collèges aux Nations, comme on les appelait à cette époque, et cela y compris les régents. Mais alors, il arrivait ceci :
C’est que les écoliers non admis quittaient les habits universitaires, et, vêtus en manteaux courts, en chapeaux de couleur, en chausses chiquetées, ajoutant, en vertu de ces espèces de saturnales, l’épée, qui leur était défendue, à la dague, qu’ils s’étaient, de temps immémorial, arrogé le droit de porter, ils se rendaient à Saint-Denis, par toutes sortes de routes, en vertu du proverbe : Tout chemin conduit à Rome ; et que, comme ils échappaient, sous leurs mascarades, à la vigilance des maîtres, les désordres étaient devenus infiniment plus grands qu’avant l’ordonnance rendue pour y remédier.
On en était donc là en 1559 ; et, à voir l’ordre avec lequel le cortège commençait à se mettre en marche, on était à cent lieues de songer aux excentricités auxquelles il allait se livrer, une fois arrivé.
Cette fois, comme d’habitude, la cavalcade s’ébranla donc assez régulièrement, entra dans la grande rue Saint-Jacques sans faire trop de trouble ; poussa, en débouchant devant le Châtelet, un de ces hourras de malédiction, comme savent seules en pousser les foules de Paris (car la moitié des membres composant cette foule connaissait certainement les prisons souterraines de ce monument autrement que par ouï dire), et après cette manifestation, qui était toujours un petit soulagement, elle s’engageait dans la rue Saint-Denis.
Devançons-la, cher lecteur, et allons prendre place dans la ville abbatiale de Saint-Denis, afin d’y assister à un épisode de la fête qui se rattache à l’histoire que nous avons entrepris de vous raconter.
La fête officielle était bien dans la ville, dans la grande rue de la ville même ; c’était bien dans la ville et particulièrement dans la grande rue, que barbiers, cervoisiers, tapissiers, merciers, lingères, bourreliers, selliers, cordiers, éperonniers, marchands de cuir, mégissiers, tanneurs, chaussiers, huchiers, drapiers, changeurs, orfèvres, épiciers, taverniers surtout, étaient enfermés dans des loges de bois qu’ils avaient fait construire deux mois à l’avance.
Ceux qui ont assisté à la foire de Beaucaire, il y a une vingtaine d’années, ou plus simplement à la fête des Loges, de Saint-Germain, il y a dix ans, peuvent, en étendant à des proportions gigantesques le tableau qu’ils ont vu dans ces deux localités, se faire une idée de ce que c’était que la foire du landi.
Mais ceux qui assistaient régulièrement toutes les années à cette même foire du landi, que l’on célèbre encore de nos jours dans la sous-préfecture de la Seine, ne sauraient en aucune façon, en voyant ce qu’elle est, imaginer ce qu’elle était.
En effet, au lieu de ces sombres vêtements noirs qui, au milieu de toutes les fêtes, attristent malgré eux les moins mélancoliques, comme un souvenir de deuil, comme une espèce de protestation de la tristesse, la reine de ce pauvre monde, contre la gaieté, qui n’en semble que l’usurpatrice ; toute cette foule en habits de draps de couleurs éclatantes, d’étoffes d’or et d’argent, pourfelures, passements, bordures, plumes, cordons, cornelits, velours, taffetas barrés d’or, satins lamés d’argent ; toute cette foule étincelait au soleil et semblait lui renvoyer en éclairs ses plus ardents rayons : jamais luxe pareil n’avait été, en effet, déployé depuis le haut jusqu’au bas de la société ; et, bien que, depuis l’année 1543, d’abord le roi François Ier, ensuite le roi Henri IV, eussent publié vingt lois somptuaires, jamais ces lois n’avaient été exécutées.
L’explication de ce luxe inouï est des plus simples. La découverte du nouveau monde par Colomb et par Améric Vespuce, les expéditions de Fernand Cortez et de Pizarre dans le fameux royaume du Cathay, indiqué par Marco Polo, avaient jeté une telle quantité de numéraires dans toute l’Europe, qu’un écrivain de ce siècle se plaint du débordement du luxe, du haussement du prix des denrées, qui, dit-il, a plus que quadruplé en quatre-vingts ans.
Mais ce n’était pas toutefois dans Saint-Denis même qu’était le côté pittoresque de la fête. En effet, l’ordonnance du parlement l’avait transportée dans la ville ; mais l’ordonnance du populaire, bien autrement puissante, l’avait transportée au bord de la rivière. C’était donc dans Saint-Denis qu’était la foire, mais c’était au bord de l’eau qu’était la fête. N’ayant rien à acheter, c’est au bord de l’eau que nous allons nous transporter, au-dessous de l’île Saint-Denis, et, une fois là, nous regarderons et écouterons ce qui va se passer.
La cavalcade que nous avons vue partir de la place Sainte-Geneviève, suivre la rue Saint-Jacques, saluer d’un hourra le Châtelet et enfiler la rue Saint-Denis, avait fait son entrée dans la nécropole royale entre onze heures et onze heures et demie ; puis, comme les moutons arrivés au pré et laissés en liberté, les écoliers échappèrent aux régents et se répandirent, les uns dans les champs, les autres par la ville, les autres au bord de la Seine.
C’était, il faut l’avouer, pour les cœurs sans souci (rares cœurs, mais qui existent cependant), un délicieux spectacle que de voir étendus, çà et là au soleil, sur l’herbe au-dessus de la berge, à une lieue à la ronde, de frais écoliers de vingt ans, couchés aux pieds de belles jeunes filles au corset de satin rouge, aux joues de satin rose, au cou de satin blanc.
Les yeux de Boccace devaient transpercer le tapis azuré du ciel et regarder amoureusement ce gigantesque Décaméron.
La première partie de la journée se passa assez bien : on avait chaud, on buvait ; on avait faim, on mangeait ; on était assis, on se reposait. Puis les conversations commencèrent à devenir bruyantes, les têtes à s’échauffer. Dieu sait le nombre de pots pleins, vidés, remplis, revidés, reremplis et définitivement cassés, dont on se jeta les éclats les uns aux autres.
Aussi, vers trois heures, le bord de la rivière, couvert de pots et d’assiettes, les uns intacts, les autres brisés, de tasses pleines et de bouteilles vides, de couples s’embrassant et se roulant sur le gazon, de maris prenant des étrangères pour leurs femmes, de femmes prenant leurs amoureux pour leurs maris ; le bord de l’eau, disons-nous, vert, frais, étincelant tout à l’heure comme un village des bords de l’Arno, ressemblait maintenant à un paysage de Teniers servant de cadre à une kermesse flamande.
Tout à coup, un cri formidable s’éleva :
– À l’eau ! à l’eau ! criait-on.
Tout le monde se leva ; les cris redoublèrent.
– À l’eau l’hérétique ! à l’eau le protestant ! à l’eau le huguenot ! à l’eau le parpaillot, la vache à Colas ! à l’eau ! à l’eau ! à l’eau !
– Qu’y a-t-il ? criaient vingt voix, cent voix, mille voix.
– Il y a qu’il a blasphémé ! il y a qu’il a douté de la Providence ! il y a qu’il a dit qu’il allait pleuvoir !...
Ce fut peut-être cette accusation, au premier abord la plus innocente, qui fit cependant le plus d’effet dans la foule. La foule s’amusait et eût été furieuse de voir troubler ses amusements par un orage ; la foule avait ses habits des dimanches et eût été furieuse que ses habits des dimanches fussent gâtés par la pluie. Les vociférations, cette explication donnée, recommencèrent donc de plus belle. On se rapprocha de l’endroit d’où partaient ces cris, et, peu à peu, la foule devint si compacte sur ce point, que le vent lui-même eût eu peine à passer.
Au milieu de ce groupe, presque étouffé par lui, se débattait un jeune homme d’une vingtaine d’années, qu’il était facile de reconnaître pour un écolier déguisé ; les joues pâles, les lèvres blêmes, mais les poings serrés, il semblait attendre que des assaillants plus hardis que les autres, au lieu de se contenter de crier, portassent la main sur lui, pour abattre tout ce qui se rencontrerait sous les deux masses d’armes que formaient ses poings fermés.
C’était un grand jeune homme blond, assez maigre, assez chétif cependant, ayant l’air d’une de ces galantes demoiselles habillées en garçons dont nous parlions tout à l’heure ; ses yeux, lorsqu’ils étaient baissés, devaient indiquer la candeur la plus extraordinaire, et si l’Humilité eût pris une face humaine, elle n’eût pas choisi un autre type que celui que présentait le visage de ce jeune garçon.
Quel crime pouvait-il donc avoir commis pour que toute cette foule fût à ses trousses, pour que toute cette meute aboyât après lui, pour que tous ces bras s’étendissent dans l’intention de le jeter à l’eau.
II
Où il est expliqué pourquoi, lorsqu’il pleut le jour de la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard
Nous l’avons dit dans le chapitre précédent, il était huguenot et il avait annoncé qu’il allait pleuvoir.
Voici comment l’affaire s’était engagée ; la chose était toute simple, vous allez voir :
Le jeune homme blond, qui paraissait attendre un ami ou une amie, se promenait tout le long de la rivière. De temps en temps, il s’arrêtait, il regardait l’eau ; puis quand il avait suffisamment regardé l’eau, il regardait le gazon ; enfin, quand il avait suffisamment regardé le gazon, il levait les yeux et regardait le ciel.
On peut trouver, certes, que c’était là un exercice monotone, mais on avouera qu’il était inoffensif. Cependant, quelques-unes des personnes qui célébraient la fête du landi à leur façon, trouvèrent mauvais que ce jeune homme la célébrât à la sienne. En effet, depuis une demi-heure environ, plusieurs bourgeois, mêlés d’écoliers et d’artisans, s’étaient montrés visiblement agacés de la triple contemplation de ce jeune homme ; d’autant plus agacés, que ce même jeune homme ne semblait pas le moins du monde faire attention à eux.
– Ah ! dit une voix de femme, je ne suis pas curieuse, mais je voudrais bien savoir pourquoi ce jeune homme s’acharne à regarder successivement l’eau, la terre et le ciel.
– Tu veux le savoir, Perrette de mon cœur ? demanda un jeune bourgeois qui buvait galamment le vin dans le verre de la dame et l’amour dans ses yeux.
– Oui, Landry, et je donnerai un rude baiser à celui qui me le dira.
– Ah ! Perrette, je voudrais que, pour une si douce récompense, tu demandasses une chose plus difficile.
– Je me contenterai de celle-là.
– Fais-moi ton billet ?
– Voilà ma main.
Le jeune bourgeois baisa la main de la jeune fille, et, se levant :
– Tu vas le savoir, dit-il.
En conséquence, celui que la jeune fille avait désigné sous le nom de Landry se leva, et, allant au contemplateur solitaire et muet :
– Ah çà, jeune homme, lui dit-il, sans vous commander, pourquoi donc regardez-vous ainsi le gazon ? Est-ce que vous avez perdu quelque chose ?
Le jeune homme, s’apercevant que c’était à lui qu’on parlait, se retourna, ôta poliment son chapeau et répondit, avec la plus grande courtoisie, à son interlocuteur :
– Vous faites erreur, monsieur, je ne regardais pas le gazon, je regardais la rivière.
Et, ayant prononcé ces quelques mots, il se retourna de l’autre côté.
Maître Landry fut un peu déconcerté ; il ne s’attendait pas à une réponse si polie. Cette politesse le toucha. Il revint vers sa société en se grattant l’oreille.
– Eh bien ? lui demanda Perrette.
– Eh bien, nous nous trompions, dit assez piteusement Landry, il ne regardait pas le gazon.
– Que regardait-il donc ?
– Il regardait la rivière.
On éclata de rire au nez du messager, qui sentit le rouge de la honte lui monter au visage.
– Et vous ne lui avez pas demandé pourquoi il regardait la rivière ? dit Perrette.
– Non, répondit Landry ; il m’a paru si poli, que j’ai pensé qu’il serait indiscret de lui faire une seconde question.
– Deux baisers à qui ira lui demander pourquoi il regarde la rivière, dit Perrette.
Trois ou quatre amateurs se levèrent. Mais Landry dit que, puisque c’était lui qui avait engagé l’affaire, c’était à lui de la terminer. On reconnut la justesse de sa réclamation.
Il retourna donc vers le jeune homme blond, et, pour la seconde fois :
– Ah çà ! jeune homme, lui demanda-t-il, pourquoi donc regardez-vous ainsi la rivière ?
Le même jeu de scène se renouvela. Le jeune homme se retourna, ôta son chapeau et répondit, poliment toujours, à son interlocuteur :
– Excusez-moi, monsieur, je ne regardais pas la rivière : je regardais le ciel.
Et, ayant dit ces mots, le jeune homme salua et se retourna de l’autre côté.
Mais Landry, démonté d’abord par cette seconde réponse comme il l’avait été par la première, crut son honneur engagé, et, entendant de loin les éclats de rire de ses compagnons, il prit courage, et, saisissant l’écolier par son manteau :
– Alors, jeune homme, insista-t-il, voulez-vous me faire la grâce de me dire pourquoi vous regardez le ciel ?
– Monsieur, répondit le jeune homme, voulez-vous me faire, à moi, la faveur de me dire pourquoi vous me le demandez ?
– Eh bien, je vais m’expliquer franchement avec vous, jeune homme.
– Vous me ferez plaisir, monsieur.
– Je vous le demande, parce que les personnes de ma société sont taquinées de vous voir, depuis une heure, debout et immobile comme un pieu et faisant le même manège.
– Monsieur, répondit l’écolier, je suis immobile parce que j’attends un de mes amis ; je suis debout, parce qu’en restant debout je le verrai venir de plus loin. Puis, comme il ne vient pas, que je m’ennuie à l’attendre, et que l’ennui que j’éprouve me pousse à marcher, je regarde la terre pour ne pas déchirer mes chaussures aux éclats de pots dont le gazon est émaillé ; puis je regarde la rivière pour me reposer d’avoir regardé la terre ; puis, enfin, je regarde le ciel pour me reposer d’avoir regardé la rivière.
Le bourgeois, au lieu de prendre cette explication pour ce qu’elle était, c’est-à-dire pour la pure et simple vérité, le bourgeois se crut mystifié et devint rouge comme les coquelicots que l’on voyait éclater au loin dans les champs de luzerne et de blé.
– Et comptez-vous, jeune homme, insista le bourgeois en s’appuyant d’un air provocateur sur la hanche gauche et en renversant le haut du torse en arrière, comptez-vous vous livrer longtemps à cette malplaisante occupation ?
– Je comptais m’y livrer jusqu’au moment où mon ami m’aurait rejoint, monsieur ; mais...
Le jeune homme regarda le ciel.
– Je ne crois pas que je puisse attendre son bon plaisir...
– Et pourquoi ne l’attendrez-vous point ?
– Parce qu’il va tomber une telle pluie, monsieur, que ni vous, ni moi, ni personne ne pourra, d’ici à un quart d’heure, rester en plein champ.
– Vous dites qu’il va pleuvoir ? fit le bourgeois de l’air d’un homme qui croit qu’on se moque de lui.
– À verse, monsieur ! répondit tranquillement le jeune homme.
– Vous voulez rire, sans doute, jeune homme ?
– Je vous jure que je n’en ai pas la moindre envie, monsieur.
– Alors vous voulez vous moquer de moi ? demanda le bourgeois exaspéré.
– Monsieur, je vous donne ma parole que je n’en ai pas plus d’envie que de rire.
– Alors pourquoi me dites-vous qu’il va pleuvoir, quand il fait un temps superbe ? hurla Landry s’exaspérant de plus en plus.
– Je dis qu’il va pleuvoir, pour trois raisons.
– Pourriez-vous me les donner, ces trois raisons ?
– Certainement, si cela pouvait vous être agréable.
– Cela m’est agréable.
Le jeune homme salua poliment, et d’un air qui signifiait : « Vous êtes si aimable, monsieur, que je n’ai rien à vous refuser. »
– J’attends vos trois raisons, dit Landry, les poings crispés et les dents grinçantes.
– La première, monsieur, dit le jeune homme, c’est que, comme il n’a pas plu hier, c’est une raison pour qu’il pleuve aujourd’hui.
– Vous me persiflez, monsieur ?
– En aucune façon.
– Alors, voyons la seconde.
– La seconde, c’est que le ciel a été couvert toute la nuit passée, toute la matinée, et qu’il l’est encore en ce moment.
– Ce n’est pas une raison, parce que le temps est couvert, pour qu’il pleuve, entendez-vous ?
– C’est au moins une probabilité.
– Voyons votre troisième raison : seulement, je vous préviens que, si elle n’est pas meilleure que les deux premières, je me fâche.
– Si vous vous fâchiez, monsieur, c’est que vous auriez un caractère détestable...
– Ah ! vous dites que j’ai un détestable caractère ?
– Monsieur, je parle au conditionnel, et non au présent.
– La troisième raison, monsieur ? la troisième raison ?
Le jeune homme étendit la main.
– La troisième raison pour qu’il pleuve, monsieur, c’est qu’il pleut.
– Vous prétendez qu’il pleut ?
– Je ne le prétends pas, je l’affirme.
– Mais c’est intolérable ! dit le bourgeois hors de lui.
– Ce le sera bien plus tout à l’heure, dit le jeune homme.
– Et vous croyez que je supporterai cela ? s’écria le bourgeois écarlate de rage.
– Je crois que vous ne le supporterez pas plus que moi, dit l’écolier ; et, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de faire ce que je vais faire, c’est-à-dire de chercher un abri.
– Ah ! c’est trop fort ! hurla le bourgeois se retournant vers sa société.
Puis, s’adressant à tous ceux qui étaient à la portée de sa voix :
– Arrivez tous ici ! arrivez, vous autres !
Le bourgeois paraissait tellement furieux, que chacun accourut à son appel.
– Qu’y a-t-il ? demandèrent les femmes d’une voix aigre.
– Que se passe-t-il ? demandèrent les hommes d’une voix enrouée.
– Ce qui se passe ? dit Landry se sentant soutenu. Il se passe des choses incroyables.
– Lesquelles ?
– Il se passe que monsieur veut tout simplement me faire voir des étoiles en plein midi.
– Je vous demande pardon, monsieur, dit le jeune homme avec la plus grande douceur ; je vous ai dit, au contraire, que le temps était horriblement couvert.
– C’est une figure, monsieur l’écolier, reprit Landry, entendez-vous ? c’est une figure.
– En ce cas, c’est une mauvaise figure.
– Vous dites que j’ai une mauvaise figure ? hurla le bourgeois, qui, assourdi par son sang qui battait à ses oreilles, entendait mal ou voulait mal entendre. Ah ! c’est trop fort, messieurs ; vous voyez bien que ce drôle-là se moque de nous.
– Se moque de vous, dit une voix, ça, c’est possible.
– De moi comme de vous, comme de nous tous ; c’est un mauvais plaisant qui se divertit en pensant à mal, et en souhaitant qu’il pleuve pour nous faire niche à tous.
– Monsieur, je vous jure que je ne souhaite pas qu’il pleuve, attendu que, s’il pleut, je serai mouillé comme vous, et même sur une plus grande échelle, puisque j’ai trois ou quatre pouces de plus que vous.
– C’est-à-dire que je suis un roquet, alors ?
– Je n’ai pas dit un mot de cela, monsieur.
– Un nain !
– Ce serait une injure gratuite. Vous avez près de cinq pieds, monsieur.
– Je ne sais à quoi tient que je ne te jette à l’eau ! s’écria Landry.
– Ah ! oui, à l’eau ! à l’eau ! dirent plusieurs voix.
– Quand vous me jetteriez à l’eau, monsieur, dit le jeune homme avec sa politesse ordinaire, vous n’en seriez pas moins mouillé.
Comme le jeune homme venait de prouver par cette réponse qu’il avait à lui seul plus d’esprit que tout le monde, tout le monde se tourna contre lui. Un grand gaillard s’approcha, et, moitié gouaillant, moitié menaçant :
– Voyons, scélérat, lui dit-il, pourquoi dis-tu qu’il pleut en ce moment ?
– Parce que j’ai senti des gouttes.
– Pleuvoir à gouttes, cria Landry, ce n’est pas pleuvoir à verse, et il a dit qu’il allait pleuvoir à verse.
– Mais tu es donc de connivence avec un astrologue ? dit le grand gaillard.
– Je ne suis de connivence avec personne, monsieur, répondit le jeune homme, qui commençait à se fâcher, pas même avec vous, qui me tutoyez.
– À l’eau ! à l’eau ! crièrent plusieurs voix.
Ce fut alors que l’écolier, sentant grossir la tempête, ferma les poings et se prépara à la lutte. Le cercle commença de s’épaissir autour de lui..
– Tiens ! dit un des nouveaux venus, c’est Médard !
– Qu’est-ce que c’est que Médard ! demandèrent plusieurs voix.
– C’est le saint dont c’est aujourd’hui la fête, dit un plaisant.
– Bon ! dit celui qui avait reconnu le jeune homme, celui-là n’est pas un saint, puisque c’est un hérétique.
– Un hérétique ! cria la foule ; à l’eau l’hérétique ! à l’eau le parpaillot ! à l’eau le patarin ! à l’eau le huguenot !
Et toutes les voix répétèrent en chœur :
– À l’eau ! à l’eau ! à l’eau !
C’étaient ces cris qui venaient d’interrompre la fête que nous étions en train de décrire.
Mais, juste à ce moment, comme si la Providence voulait envoyer au jeune homme le secours dont il paraissait avoir si grand besoin, celui qu’il attendait, beau cavalier de vingt-deux à vingt-trois ans, qui, par sa haute mine, sentait le gentilhomme, et, par sa tournure, l’étranger ; celui qu’il attendait, disons-nous, arriva tout courant, et, perçant la foule, se trouva à vingt pas de son ami au moment où celui-ci, saisi par-devant, par-derrière, par les pieds, par la tête, se démenait de son mieux.
– Défends-toi, Médard ! cria le nouveau venu, défends-toi !
– Vous voyez que c’est bien Médard ! s’écria celui qui l’avait salué de ce nom.
Et, comme si porter ce nom était un crime, toute la foule cria :
– Oui, c’est Médard ! oui, c’est Médard ! à l’eau Médard ! à l’eau l’hérétique ! à l’eau le huguenot !
– Comment un hérétique a-t-il l’audace de porter le nom d’un si grand saint ! s’écria Perrette.
– À l’eau le sacrilège !
Et les gens qui avaient saisi le pauvre Médard l’entraînèrent vers la berge.
– À moi, Robert ! cria le jeune homme sentant qu’il ne pouvait résister à cette foule, et que la mort était au bout de la plaisanterie.
– À l’eau le brigand ! hurlèrent les femmes, furieuses dans la haine comme dans l’amour.
– Défends-toi, Médard ! cria pour la seconde fois l’étranger en tirant son épée, défends-toi, me voilà !
Et, frappant à droite et à gauche du plat de sa lame sur la foule, il se laissa rouler sur le talus comme une avalanche. Mais il vint un moment où la foule se trouva si épaisse, que, quelque envie que cette foule eût de s’écarter, ses efforts furent inutiles : elle recevait les coups, hurlait de douleur, mais elle ne s’écartait pas. Après avoir hurlé de douleur, elle hurla de rage.
Le nouveau venu, qu’à son accent étranger on pouvait reconnaître pour un Écossais, frappait toujours, mais n’avançait pas, ou avançait si peu, qu’on voyait bien que son ami serait à l’eau avant qu’il fût près de son ami. Une vingtaine de paysans qui étaient là et cinq ou six bateliers s’en mêlèrent. Le pauvre Médard avait beau s’accrocher des mains, ruer des pieds, mordre des dents, chaque seconde le rapprochait de la berge.
L’Écossais n’entendait plus que ses cris, et ses cris se rapprochaient sensiblement de l’eau. Lui ne criait plus, il rugissait, et, à chaque rugissement, le plat de sa lame ou le pommeau de son épée tombaient sur une tête. Tout à coup les cris redoublèrent ; puis il se fit un silence ; puis on entendit le bruit d’un corps pesant qui tombe à l’eau.
– Ah ! brigands ! ah ! meurtriers ! ah ! assassins ! hurla le jeune homme en essayant de se faire jour vers la rivière pour sauver son ami ou mourir avec lui.
Mais ce fut impossible. Autant eût valu renverser un mur de granit que cette muraille vivante. Il recula harassé, les dents grinçantes, la bouche pleine d’écume, le front ruisselant de sueur. Il recula jusqu’au sommet du talus pour voir si, par-dessus cette foule, il n’apercevrait pas la tête du pauvre Médard reparaître à la surface de l’eau. Et là, au sommet du talus, appuyé sur son épée, ne voyant rien reparaître, il abaissa les yeux sur cette populace furieuse, et regarda avec dégoût cette meute humaine.
Ainsi, posé tout seul, pâle et dans son costume noir, il semblait l’ange exterminateur se reposant un instant les ailes repliées. Mais, au bout d’un instant, la rage qui bouillonnait dans sa poitrine comme la lave dans un volcan, monta brûlante jusqu’à ses lèvres.
– Vous êtes tous des brigands, dit-il, vous êtes tous des assassins, vous êtes tous des infâmes ! Vous vous êtes mis quarante pour assassiner, jeter à l’eau, noyer un pauvre garçon qui ne vous avait pas fait de mal. Je vous offre le combat à tous. Vous êtes quarante, venez, et je vous tuerai tous les quarante les uns après les autres, comme des chiens que vous êtes !
Les paysans, les bourgeois et les écoliers à qui cette lettre d’invitation à mourir était adressée, ne parurent pas se soucier de courir les chances d’un combat à l’arme blanche avec un homme qui paraissait manier l’épée d’une si triomphante manière. Ce que voyant, l’Écossais remit dédaigneusement son épée au fourreau.
– Vous êtes aussi poltrons que vils, lâches coquins ! continua-t-il en étendant la main au-dessus de toutes les têtes ; mais je vengerai cette mort sur de moins misérables que vous, car, vous, vous n’êtes pas dignes de l’épée d’un gentilhomme. Arrière donc, manants et vilains ! et puisse la pluie et la grêle saccager vos vignes, coucher vos moissons en tombant sur vos plaines pendant autant de jours que vous vous êtes mis d’hommes pour tuer un seul homme !
Mais, comme il n’était pas juste que ce meurtre restât impuni, il décrocha de sa ceinture un grand pistolet, et, tirant sans viser au milieu de la foule :
– Au hasard de Dieu ! dit-il.
Le coup partit, la balle siffla, et un des hommes qui venait de jeter le jeune homme à l’eau poussa un cri, mit la main à sa poitrine, chancela et tomba frappé mortellement.
– Et maintenant, adieu ! dit-il. Vous entendrez parler plus d’une fois de moi. Je me nomme Robert Stuart.
Comme il disait ces mots, les nuages amoncelés au ciel depuis la veille crevèrent tout à coup, et ainsi que l’avait prédit le malheureux Médard, il tomba une de ces pluies torrentielles comme il n’en tombe jamais dans les saisons pluvieuses.
Le jeune homme se retira lentement.
Les paysans lui eussent infailliblement couru sus en voyant que ses malédictions produisaient instantanément leur effet ; mais le bruit du tonnerre, qui semblait leur annoncer le dernier jour de la création, l’eau qui tombait par torrents, les éclairs qui les aveuglaient, les préoccupèrent infiniment plus que le soin de leur vengeance, et ce fut à partir de ce moment un sauve-qui-peut général.
En un instant la berge de la rivière, couverte tout à l’heure de cinq à six mille personnes, se trouva aussi déserte que les rives d’un de ces fleuves du nouveau monde que venait de découvrir le navigateur génois.
La pluie tomba quarante jours sans discontinuer.
Et c’est pour cela, nous le croyons du moins, chers lecteurs, que, lorsqu’il pleut le jour de la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard.
III
L’auberge du « Cheval rouge »
Nous n’entreprendrons pas de dire à nos lecteurs où se réfugièrent les cinquante ou soixante mille personnes qui assistaient à la fête du landi, et qui, surprises inopinément par ce nouveau déluge, cherchèrent un abri sous les loges, dans les maisons, dans les cabarets et jusque dans la basilique royale.
À peine y avait-il à cette époque dans la ville de Saint-Denis cinq ou six auberges, qui se trouvèrent en un instant tellement encombrées, que quelques personnes commencèrent à en sortir avec plus de hâte encore qu’elles n’y étaient entrées, préférant être noyées par la pluie plutôt qu’étouffées par la chaleur.
La seule auberge qui demeurât à peu près vide, et elle devait cette faveur à sa situation isolée, était l’auberge du Cheval rouge, située sur la route, à une ou deux portées d’arquebuse de la ville de Saint-Denis.
Trois personnes habitaient momentanément la grande chambre enfumée que l’on appelait emphatiquement la salle des voyageurs, et qui, à l’exception de la cuisine et d’un grenier régnant au-dessus de ce rez-de-chaussée, et qui servait de chambre à coucher aux muletiers et aux marchands de bestiaux attardés, formait à elle seule toute l’auberge. C’était quelque chose comme un gigantesque hangar éclairé par la porte, qui montait jusqu’au toit ; le plafond était fait sur le modèle de l’arche, de solives visibles, inclinées selon la forme du toit.
Comme dans l’arche, un certain nombre d’animaux, chiens, chats, poules et canards, grouillaient sur le plancher, et, à défaut du corbeau qui devait revenir le bec vide, et de la colombe qui devait rapporter le rameau d’olivier, on voyait, autour des solives noircies par la fumée, voltiger, le jour, des hirondelles, et, la nuit, des chauves-souris. Quant aux meubles de cette salle, ils se bornaient aux ustensiles indispensables d’une auberge, c’est-à-dire à des tables boiteuses, à des chaises et à des tabourets éclopés.
Les trois personnes qui habitaient cette chambre étaient l’aubergiste, sa femme et un voyageur de trente à trente-cinq ans.
Disons comment étaient groupés ces trois personnages, et à quelle chose ils s’occupaient.
L’aubergiste, qu’en sa qualité de maître de maison nous posons le premier en scène, s’occupait à ne rien faire ; il était assis à cheval devant la porte, sur une chaise de paille, et, le menton appuyé au sommet du dossier, grommelait contre le mauvais temps.
La femme de l’aubergiste, assise un peu en arrière de son mari, de façon cependant à se trouver dans la lumière, filait au rouet, mouillant à sa bouche le fil qu’elle tordait sous ses doigts et qu’elle tirait du chanvre de sa quenouille.
Le voyageur de trente à trente-cinq ans, au lieu de chercher la lumière, était, au contraire, assis dans l’angle le plus reculé de la chambre, tournant le dos à la porte, et paraissait un consommateur, à en juger par le pot et le gobelet posés devant lui.
Cependant il ne semblait pas songer à boire : le coude sur la table, la tête dans sa main, il rêvait profondément.
– Chien de temps ! grommela l’aubergiste.
– Tu te plains ? dit la femme. C’est toi qui l’as demandé.
– C’est vrai, dit l’aubergiste ; mais j’ai eu tort.
– Alors ne te plains pas.
L’aubergiste, à cette admonestation peu consolante, mais pleine de logique, baissa la tête en poussant un soupir et se tint coi. Ce silence dura dix minutes environ ; après quoi, l’aubergiste releva la tête et répéta :
– Chien de temps !
– Tu l’as déjà dit, fit la femme.
– Eh bien, je le redis, alors.
– Quand tu le rediras jusqu’au soir, cela n’y fera rien, n’est-ce pas ?
– C’est vrai ; mais cela me fait du bien de blasphémer contre le tonnerre, la pluie et la grêle.
– Pourquoi ne blasphèmes-tu pas tout de suite contre la Providence ?
– Si je croyais que ce fût elle qui envoyât un pareil temps...
L’aubergiste s’arrêta.
– Tu blasphémerais contre elle. Voyons, avoue cela tout de suite.
– Non, parce que...
– Parce que quoi ?...
– Parce que je suis un bon chrétien, et non pas un chien d’hérétique.
À ces mots : parce que je ne suis pas un chien d’hérétique, le voyageur, pris dans l’auberge du Cheval rouge comme un chat dans un trébuchet, sortit de sa méditation, releva la tête et frappa avec son gobelet de fer-blanc un tel coup sur la table, que le pot se mit à danser et que le gobelet s’aplatit.
– Voilà ! voilà ! dit en sautant sur sa chaise, comme le pot avait sauté sur la table, l’aubergiste, croyant que son consommateur l’appelait ; voilà, mon jeune seigneur !
Le jeune homme fit tourner sa chaise sur un des pieds de derrière, et, tournant avec elle, se trouva en face de l’aubergiste, qui se tenait debout devant lui ; puis, le regardant des pieds à la tête, sans hausser la voix d’une note, mais en fronçant le sourcil :
– N’est-ce pas vous qui venez de prononcer ces deux mots : chien d’hérétique !
– C’est moi, mon jeune seigneur, balbutia en rougissant le tavernier.
– Eh bien, si c’est vous, maître drôle, reprit le consommateur, vous n’êtes qu’un âne mal appris, et vous mériteriez que l’on vous rognât les oreilles.
– Pardon, mon gentilhomme, mais j’ignorais que vous fussiez de la religion réformée, dit l’aubergiste en tremblant de tous ses membres.
– C’est ce qui vous prouve, bélître que vous êtes, continua le huguenot sans hausser la voix d’un demi-ton, qu’un aubergiste, qui a affaire à tout le monde, doit garder sa langue dans sa poche ; car il se peut que, croyant avoir affaire à un chien de catholique, il ait affaire à un honorable disciple de Luther et de Calvin.
Et, en prononçant ces deux mots, le gentilhomme leva son feutre. L’aubergiste en fit autant. Le gentilhomme haussa les épaules.
– Allons, dit-il, un autre pot de vin, et que je ne vous entende plus prononcer le mot d’hérétique, ou je vous perce le ventre comme à une vieille futaille ; vous entendez, mon ami ?
L’aubergiste se retira à reculons et s’en alla dans la cuisine chercher le pot de vin demandé.
Pendant ce temps, le gentilhomme, après avoir fait décrire un demi-tour à droite à son tabouret, se retrouva dans l’ombre, tournant de nouveau le dos à la porte, quand le tavernier revint poser son cruchon devant lui.
Alors le gentilhomme silencieux lui tendit son gobelet écrasé, pour qu’il le lui changeât contre un gobelet neuf. L’aubergiste, sans souffler une parole, fit des yeux et de la tête un signe qui signifiait : « Diable ! il paraît que, quand celui-là cogne, il cogne bien », et il revint présenter un verre intact au disciple de Calvin.
– C’est bien, dit celui-ci, voilà comme j’aime les aubergistes.
L’aubergiste sourit au gentilhomme le plus agréablement qu’il put, et s’en alla reprendre sa place à l’avant-garde.
– Eh bien, lui demanda sa femme, qui, vu la sourdine que le protestant avait mise à sa voix, n’avait point entendu un mot des paroles échangées entre son mari et son hôte, que t’a dit ce jeune seigneur ?
– Ce qu’il m’a dit ?
– Oui, je te le demande.
– Les choses les plus flatteuses, répondit celui-ci : que mon vin était excellent, que mon auberge était tenue à merveille, et qu’il s’étonnait qu’un pareil logis ne fût pas mieux achalandé.
– Et que lui as-tu répondu ?
– Que c’était ce chien de temps-là qui était la cause de notre ruine.
Au moment où, d’une façon détournée, notre homme, pour la troisième fois, blasphémait contre le temps, la Providence, comme pour lui donner un démenti, fit apparaître en même temps, quoique venant de deux côtés opposés, deux nouveaux consommateurs, l’un à pied, l’autre à cheval. Celui qui était à pied, et qui avait l’air d’un officier d’aventures, venait par la route de gauche, c’est-à-dire par la route de Paris ; celui qui était à cheval et qui portait un costume de page, venait par la route de droite, c’est-à-dire par la route de Flandre.
Mais, en franchissant le seuil de l’auberge, les pieds du piéton se trouvèrent sous ceux du cheval.
Le piéton poussa un juron et pâlit. Rien que ce juron indiquait le pays du jureur :
– Ah ! cap de Diou ! s’écria-t-il.
Le cavalier, en écuyer de première force, fit décrire un demi-tour à gauche à son cheval, qu’il enleva sur les pieds de derrière, et, sautant à terre avant que les pieds de l’animal eussent retouché le sol, il se précipita vers le blessé, et, du ton de la plus vive sollicitude :
– Oh ! mon capitaine, dit-il, je vous fais toutes mes excuses.
– Savez-vous, monsieur le page, dit le Gascon, que vous avez failli m’écraser ?
– Croyez, capitaine, reprit le jeune page, que j’en éprouve un violent chagrin.
– Eh bien, consolez-vous, mon jeune maître, riposta le capitaine en faisant une grimace, prouvant qu’il n’était pas redevenu complètement maître de sa douleur ; consolez-vous, vous venez de me rendre sans vous en douter, un énorme service, et je ne sais en vérité de quelle façon je pourrai le reconnaître.
– Un service !
– Énorme ! répéta le Gascon.
– Et comment cela, mon Dieu ? demanda le page, voyant, aux mouvements nerveux qui agitaient la face de son interlocuteur, qu’il lui fallait une grande puissance sur lui-même pour ne point sacrer au lieu de sourire.
– C’est bien simple, reprit le capitaine ; il n’y a que deux choses qui me chagrinent souverainement en ce monde : les vieilles femmes et les bottes neuves ; eh bien, depuis ce matin, je suis empêtré de bottes neuves avec lesquelles il m’a fallu venir de Paris ici. Je cherchais un moyen expéditif de les briser, et vous venez, en un tour de main, d’accomplir ce miracle à votre gloire éternelle. Je vous prie donc de faire état de moi, et, en toute occasion, de disposer de ma personne, qui se dit votre obligée.
– Monsieur, dit le page en s’inclinant, vous êtes homme d’esprit, ce qui ne m’étonne pas, ayant entendu le juron dont vous m’avez salué ; vous êtes courtois, ce qui ne m’étonne pas, devinant que vous êtes gentilhomme : j’accepte tout ce que vous m’offrez, en me mettant de mon côté bien à votre service.
– Je présume que vous comptiez vous arrêter à cette auberge ?
– Oui, monsieur, pour quelques instants, répondit le jeune homme en attachant son cheval à un anneau scellé au mur à cet effet, opération que l’aubergiste lui vit accomplir avec des yeux étincelants de joie.
– Et moi aussi, dit le capitaine. Allons, tavernier du diable, du vin, et du meilleur !
– Voilà, messeigneurs ! dit l’aubergiste se précipitant vers sa cuisine, voilà !
Cinq secondes après, il rentrait avec deux pots et deux verres, qu’il posa sur une table voisine de celle où était déjà assis le premier gentilhomme.
– Avez-vous dans votre auberge, monsieur le tavernier, demanda le jeune page avec une voix douce comme une voix de femme, avez-vous une chambre où une jeune fille puisse se reposer une heure ou deux ?
– Nous n’avons que cette salle, répondit le tavernier.
– Ah diable ! voilà qui est fâcheux.
– Vous attendez une femme, mon gaillard ? dit mystérieusement le capitaine en passant sa langue sur ses lèvres, et en attrapant le bout de sa moustache qu’il se mit à mordiller.
– Ce n’est point une femme pour moi, capitaine, répondit gravement le jeune homme ; c’est la fille de mon noble maître, M. le maréchal de Saint-André.
– Haü ! grand double et triple Diou vivant ! Seriez-vous donc au service de l’illustre maréchal de Saint-André ?
– J’ai cet honneur, monsieur.
– Et vous croyez que le maréchal va descendre ici, dans ce taudis ? Vous vous imaginez cela, mon jeune page ?... Allons donc ! fit le capitaine.
– Il le faut bien ; depuis quinze jours, monsieur le maréchal est malade au château de Villers-Cotterêts, et, comme il lui était impossible de se rendre à cheval à Paris, où il vient pour assister au tournoi du 29, qui a lieu à l’occasion des noces du roi Philippe II avec la princesse Élisabeth, et de la princesse Marguerite avec le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, M. de Guise, dont le château est voisin du château de Villers-Cotterêts...
– M. de Guise a un château dans le voisinage de Villers-Cotterêts ? interrompit le capitaine, qui voulait prouver qu’il savait sa Cour : où prenez-vous donc ce château, jeune homme ?
– À Nanteuil-le-Haudouin, capitaine ; c’est une acquisition qu’il vient de faire pour se trouver sur la route du roi quand le roi va à Villers-Cotterêts et qu’il en revient.
– Ah ! ah ! c’est assez bien joué, ce me semble.
– Oh ! dit le jeune page en riant, ce n’est pas l’adresse qui manque à ce joueur-là.
– Ni le jeu, dit le capitaine.
– Je disais donc, reprit le page, que M. de Guise a envoyé son coche au maréchal et qu’il le ramène au petit pas ; mais, si doux que soit le coche, et si doucement que le traînent les chevaux à Gonesse, monsieur le maréchal s’est senti fatigué, et Mme Charlotte de Saint-André m’a envoyé en avant chercher une auberge où son père pût prendre quelque repos.
En entendant ces paroles, qui étaient dites à la table voisine de la sienne, le premier gentilhomme, celui qui se fâchait si écarlate quand on parlait mal des huguenots, prêta l’oreille et parut prendre à la conversation un intérêt des plus directs.
– Per la crux Diou ! fit le Gascon, je vous jure, jeune homme, que, si je connaissais à deux lieues à la ronde une chambre digne de recevoir ces deux capitaines, je ne céderais à personne, fût-ce à mon père, l’honneur de les y conduire ; mais, par malheur, ajouta-t-il, je n’en connais pas.
Le gentilhomme huguenot fit un mouvement qui pouvait ressembler à un signe de mépris. Ce mouvement attira sur lui l’attention du capitaine.
– Ah ! ah ! fit-il.
Et, se levant, il salua le huguenot avec une politesse recherchée et tourna, ce devoir accompli, la tête du côté du page ; le huguenot se leva, comme avait fait le Gascon, salua poliment, mais sèchement, et tourna la tête du côté du mur. Le capitaine versa à boire au page, qui haussa son verre avant qu’il fût au tiers plein ; puis, reprenant :
– Ainsi vous disiez, jeune homme, que vous êtes au service de l’illustre maréchal de Saint-André, le héros de Cérisoles et de Renty... J’étais au siège de Boulogne, jeune homme, et je vis les efforts qu’il tenta pour se jeter dans la place. Ah ! per ma fé ! en voilà un qui n’a pas volé son titre de maréchal.
Puis, tout à coup, s’arrêtant et paraissant réfléchir :
– Cap de Diou ! dit-il ; mais j’y pense, j’arrive de Gascogne, j’ai abandonné le château de mes pères pour me mettre au service de quelque prince de renom ou de quelque illustre capitaine. Jeune homme, n’y aurait-il point dans la maison du maréchal de Saint-André quelque place que pourrait convenablement remplir un brave officier comme moi ? Je ne serai pas difficile sur les appointements, et, pourvu qu’on ne me donne ni vieilles femmes à distraire, ni bottes neuves à briser, je me fais fort de remplir, à la satisfaction de mon maître, la charge que l’on voudra bien me confier.
– Ah ! capitaine, dit le jeune page, vous me voyez tout marri, en vérité ; mais, malheureusement, la maison de monsieur le maréchal est complète, et je doute que, le voulût-il, il pût accepter votre offre obligeante.
– Morbleu ! tant pis pour lui, car je puis me vanter d’être un sujet précieux pour les personnes qui m’emploient. Maintenant, prenons que je n’aie rien dit, et buvons.
Le jeune page avait déjà levé son verre pour faire raison au capitaine, lorsque, tout à coup, faisant un mouvement et prêtant l’oreille, il reposa son verre sur la table.
– Pardon, capitaine, dit-il, mais j’entends le bruit d’un coche, et, comme les coches sont encore rares, je crois, sans trop m’avancer, pouvoir affirmer que c’est celui du duc de Guise ; je vous demande donc la permission de vous quitter pour quelques instants.
– Faites, mon jeune ami, faites, dit emphatiquement le capitaine ; le devoir avant tout.
La permission que demandait le page était de pure courtoisie, car, avant même que le capitaine lui répondit, il était sorti précipitamment de l’auberge et avait disparu à l’angle du chemin.
IV
Les voyageurs
Le capitaine profita de cette absence pour réfléchir et pour absorber, en réfléchissant, le pot de vin qu’il avait devant lui. Le premier pot de vin absorbé, il en demanda un second. Puis, comme si la matière de la réflexion lui eût manqué, ou que cette opération de l’esprit ne s’accomplît pas chez lui sans un pénible effort, à cause du peu d’habitude qu’il avait de s’y livrer, le capitaine retourna la tête du côté du huguenot, le salua avec cette politesse affectée dont il avait déjà donné des preuves et lui dit :
– Per ma fé, monsieur, il me semble que je salue un compatriote.
– Vous vous trompez, capitaine, répondit celui qu’il interpellait ; car, si je ne m’abuse, vous êtes de la Gascogne, tandis que je suis de l’Angoumois.
– Ah ! vous êtes de l’Angoumois ! s’écria le capitaine avec un air de surprise admirative ; de l’Angoumois ! Tiens ! tiens ! tiens !
– Oui, capitaine ; cela vous est-il agréable ? demanda le huguenot.
– Je le crois bien ! aussi permettez-moi de vous en faire mon compliment : pays magnifique, fertile, coupé de charmantes rivières ; les hommes y pétillent de courage, témoin feu Sa Majesté François Ier ; les femmes y pétillent d’esprit, témoin Mme Marguerite de Navarre ; enfin, je vous avoue, monsieur, que, si je n’étais pas de la Gascogne, je voudrais être de l’Angoumois.
– C’est en vérité trop d’honneur pour ma pauvre province, monsieur, dit le gentilhomme angoumois, et je ne sais quels remerciements vous faire !
– Oh ! rien n’est plus facile, monsieur, que de me prouver le peu de reconnaissance que vous voulez bien accorder à ma brutale franchise. Faites-moi l’honneur de trinquer avec moi à la gloire et à la prospérité de vos compatriotes.
– Avec le plus grand plaisir, capitaine, dit le huguenot en transportant son pot et son verre sur un des angles de la table devant laquelle était assis le Gascon, et que l’absence du page avait laissée au seul occupant.
Après la santé portée à la gloire des enfants de l’Angoumois, le gentilhomme huguenot, pour ne pas demeurer en reste de courtoisie, porta le même toast à la prospérité et à la gloire des enfants de la Gascogne.
– Puis, comme la politesse était rendue à celui qui l’avait faite, le gentilhomme angoumois reprit son pot et son verre, s’apprêtant à retourner à sa place.
– Oh ! monsieur, dit le Gascon, ce serait une connaissance trop tôt interrompue ; faites-moi donc la grâce d’achever votre pot de vin à cette table.
– Je craignais de vous incommoder, monsieur, dit civilement mais froidement le huguenot.
– M’incommoder ? Jamais ! D’ailleurs, monsieur, mon avis est que les meilleures et les plus complètes connaissances se font à table. Il est bien rare qu’il n’y ait pas la valeur de trois verres dans un pot de vin, n’est-ce pas ?
– En effet, monsieur, c’est bien rare, répondit le huguenot cherchant visiblement où son interlocuteur en voulait venir.
– Eh bien, mettons une santé à chaque verre de vin. M’accordez-vous une santé par verre ?
– Je vous l’accorde, monsieur.
– Quand on s’est entendu pour porter en même temps et du fond du cœur la santé de trois hommes, c’est qu’on est d’esprit, d’opinions et de principes pareils.
– Il y a du vrai dans ce que vous dites, monsieur.
– Du vrai ! du vrai ! vous dites qu’il y a du vrai ; par le sang-Diou ! monsieur, c’est la vérité pure.
Puis, avec son plus charmant sourire :
– Pour commencer la connaissance, monsieur, et pour faire éclater au jour la similitude de nos opinions, permettez-moi donc, comme première santé, de vous proposer celle de l’illustre connétable de Montmorency.
Le gentilhomme, qui avait déjà, de confiance, levé son verre et épanoui son visage, redevint grave et posa son verre sur la table.
– Vous m’excuserez, monsieur, dit-il ; mais, à l’endroit de cet homme, il m’est impossible de vous faire raison. M. de Montmorency est mon ennemi personnel.
– Votre ennemi personnel ?





























