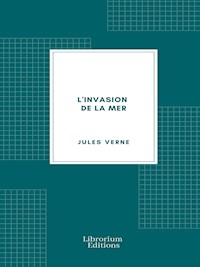
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Djemma était une Africaine de race touareg ayant dépassé sa soixantième année, grande, forte, la taille droite, l’attitude énergique. De ses yeux bleus, comme ceux des femmes de même origine, s’échappait un regard dont l’ardeur égalait la fierté. Blanche de peau, elle apparaissait jaune sous la teinture d’ocre qui recouvrait son front et ses joues. Elle était vêtue d’étoffe sombre, un ample haïk de cette laine si abondamment fournie par les troupeaux des Hammâma qui vivent aux alentours des sebkha ou chotts de la basse Tunisie. Un large capuchon recouvrait sa tête, dont l’épaisse chevelure commençait seulement à blanchir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jules Verne
L’invasion de la mer
1905
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383831396
1
L’oasis de Gabès
« Que sais-tu ?
– Je sais ce que j’ai entendu dans le port...
– On parlait du navire qui vient chercher... qui emmènera Hadjar ?...
– Oui... à Tunis, où il sera jugé...
– Et condamné ?...
– Condamné.
– Allah ne le permettra pas, Sohar !... Non ! il ne le permettra pas !...
– Silence... » dit vivement Sohar, en prêtant l’oreille comme s’il percevait un bruit de pas sur le sable.
Sans se relever, il rampa vers l’entrée du marabout abandonné où se tenait cette conversation. Le jour durait encore, mais le soleil ne tarderait pas à disparaître derrière les dunes qui bordent de ce côté le littoral de la Petite-Syrte. Au début de mars, les crépuscules ne sont pas longs sur le trente-quatrième degré de l’hémisphère septentrional. L’astre radieux ne s’y rapproche pas de l’horizon par une descente oblique : il semble qu’il tombe suivant la verticale comme un corps soumis aux lois de la pesanteur.
Sohar s’arrêta, puis fit quelques pas au-delà du seuil calciné par l’ardeur des rayons solaires. Son regard parcourut en un instant la plaine environnante.
Vers le nord, les cimes verdoyantes d’une oasis, qui s’arrondissait à la distance d’un kilomètre et demi. Au sud, l’aire interminable des grèves jaunâtres frangées d’écume au ressac de la marée montante. À l’ouest, un amoncellement de dunes se profilant sur le ciel. À l’est, un large espace de cette mer qui forme le golfe de Gabès et baigne le littoral tunisien en s’infléchissant vers les parages de la Tripolitaine.
La légère brise de l’ouest qui avait rafraîchi l’atmosphère pendant cette journée était tombée avec le soir. Aucun bruit ne vint à l’oreille de Sohar. Il avait cru entendre marcher aux environs de ce cube de vieille maçonnerie blanche, abrité d’un antique palmier, et il reconnut son erreur. Personne, ni du côté des dunes ni du côté de la grève. Il fit le tour du petit monument. Personne et aucune trace de pas sur le sable, si ce n’est celles que sa mère et lui avaient laissées devant l’entrée du marabout.
À peine s’était-il écoulé une minute depuis la sortie de Sohar, lorsque Djemma parut sur le seuil, inquiète de ne pas voir revenir son fils. Celui-ci, qui tournait alors l’angle du marabout, la rassura d’un geste.
Djemma était une Africaine de race touareg ayant dépassé sa soixantième année, grande, forte, la taille droite, l’attitude énergique. De ses yeux bleus, comme ceux des femmes de même origine, s’échappait un regard dont l’ardeur égalait la fierté. Blanche de peau, elle apparaissait jaune sous la teinture d’ocre qui recouvrait son front et ses joues. Elle était vêtue d’étoffe sombre, un ample haïk de cette laine si abondamment fournie par les troupeaux des Hammâma qui vivent aux alentours des sebkha ou chotts de la basse Tunisie. Un large capuchon recouvrait sa tête, dont l’épaisse chevelure commençait seulement à blanchir.
Djemma resta immobile à cette place jusqu’au moment où son fils vint la rejoindre. Il n’avait rien aperçu de suspect aux environs et le silence n’était troublé que par ce chant plaintif du bou-habibi, le moineau du Djerid, dont plusieurs couples voletaient du côté des dunes.
Djemma et Sohar rentrèrent dans le marabout pour attendre que la nuit leur permît de gagner Gabès sans éveiller l’attention.
L’entretien se continua en ces termes :
« Le navire a quitté la Goulette ?
– Oui, ma mère, et, ce matin, il avait doublé le cap Bon... C’est le croiseur Chanzy...
– Il arrivera cette nuit ?...
– Cette nuit... à moins qu’il ne relâche à Sfax... Mais il est plus probable qu’il viendra mouiller devant Gabès, où ton fils, mon frère, lui sera livré...
– Hadjar !... Hadjar !... » murmura la vieille mère.
Et, toute frémissante alors de colère et de douleur :
« Mon fils... mon fils ! s’écria-t-elle, ces Roumis le tueront, et je ne le verrai plus... et il ne sera plus là pour entraîner les Touareg à la guerre sainte !... Non... non ! Allah ne le permettra pas. »
Puis, comme si cette crise eût épuisé ses forces, Djemma tomba agenouillée dans l’angle de l’étroite salle et demeura silencieuse.
Sohar était revenu se poster sur le seuil, accoudé au montant de la porte, aussi immobile que s’il eût été de pierre, comme une de ces statues qui ornent parfois l’entrée des marabouts. Aucun bruit inquiétant ne le tira de son immobilité. L’ombre des dunes s’allongeait peu à peu vers l’est, à mesure que le soleil s’abaissait sur l’horizon opposé. À l’orient de la Petite-Syrte se levaient les premières constellations. La mince tranche du disque lunaire, au début de son premier quartier, venait de glisser derrière les extrêmes brumes du couchant. Une nuit tranquille se préparait, obscure aussi, car un rideau de légères vapeurs allait en cacher les étoiles.
Un peu après sept heures, Sohar retourna près de sa mère et lui dit :
« Il est temps...
– Oui, répondit Djemma, et il est temps que Hadjar soit arraché des mains de ces Roumis... Il faut qu’il soit hors de la prison de Gabès avant le lever du soleil... Demain, il serait trop tard...
– Tout est prêt, mère, affirma Sohar... Nos compagnons nous attendent... Ceux de Gabès ont préparé l’évasion... Ceux du Djerid serviront d’escorte à Hadjar, et le jour n’aura pas reparu qu’ils seront loin dans le désert...
– Et moi avec eux, déclara Djemma, car je n’abandonnerai pas mon fils...
– Et moi avec vous, ajouta Sohar. Je n’abandonnerai ni mon frère ni ma mère ! »
Djemma l’attira près d’elle, le pressa dans ses bras. Puis, rajustant le capuchon de son haïk, elle franchit le seuil.
Sohar la précédait de quelques pas, alors que tous deux se dirigeaient vers Gabès. Au lieu de suivre la lisière du littoral, le long du relais d’herbes marines laissées par la dernière marée sur la grève, ils suivaient la base des dunes, espérant être moins aperçus pendant ce trajet d’un kilomètre et demi. Là où était l’oasis, la masse des arbres, presque confondue dans l’ombre croissante, ne se présentait plus que confusément au regard. Aucune lumière ne brillait à travers l’obscurité. Dans ces maisons arabes, dépourvues de fenêtres, le jour ne se prend que sur les cours intérieures, et, lorsque la nuit est venue, aucune clarté ne s’échappe au-dehors.
Cependant, un point lumineux ne tarda pas à apparaître au-dessus des contours vaguement entrevus de la ville. Le rayon, assez intense d’ailleurs, devait jaillir de la partie haute de Gabès, peut-être du minaret d’une mosquée, peut-être du château qui la dominait.
Sohar ne s’y trompa pas, et, montrant du doigt cette lueur :
« Le bordj... dit-il.
– Et c’est là, Sohar ?...
– Là... qu’ils l’ont enfermé, ma mère ! »
La vieille femme s’était arrêtée. Il semblait que cette lumière eût établi une sorte de communication entre son fils et elle. Assurément, si ce n’était pas du cachot où il devait être emprisonné que partait cette lumière, c’était du moins du fort où Hadjar avait été conduit. Depuis que le redoutable chef était tombé entre les mains des soldats français, Djemma n’avait plus revu son fils, et elle ne le reverrait jamais, à moins que, cette nuit même, il n’échappât par la fuite au sort que lui réservait la justice militaire. Elle restait donc comme immobilisée à cette place, et il fallut que Sohar lui répétât par deux fois :
« Venez, ma mère, venez ! »
Le cheminement continua au pied des dunes qui s’arrondissaient en gagnant l’oasis de Gabès, l’ensemble de bourgades, de maisons, le plus considérable qui occupe la rive continentale de la Petite-Syrte. Sohar se dirigeait vers le groupe que les soldats appellent Coquinville. C’est une agglomération de huttes de bois où réside toute une population de mercantis, ce qui lui a valu ce nom assez justifié. La bourgade est située près de l’entrée de l’oued, ruisseau qui serpente capricieusement à travers l’oasis sous l’ombrage des palmiers. Là, s’élève le bordj, ou Fort-Neuf, d’où Hadjar ne sortirait que pour être transféré à la prison de Tunis.
C’était de ce bordj que ses compagnons, toutes précautions prises, tous préparatifs faits en vue d’une évasion, espéraient l’enlever cette nuit même. Réunis dans une des huttes de Coquinville, ils y attendaient Djemma et son fils. Mais une extrême prudence s’imposait, et mieux valait ne point être rencontré aux approches de la bourgade.
Et, d’ailleurs, avec quelle inquiétude leurs regards se portaient du côté de la mer ! Ce qu’ils craignaient, c’était l’arrivée, ce soir même, du croiseur, et le transfèrement du prisonnier à bord de ce navire, avant que l’évasion eût pu s’accomplir. Ils cherchaient à voir si quelque feu blanc apparaissait dans le golfe de la Petite-Syrte, à entendre les hennissements de vapeur, les gémissements stridents de sirène qui signalent un bâtiment venant au mouillage. Non, seuls les fanaux des bateaux de pêche se reflétaient dans les eaux tunisiennes, et aucun sifflement ne déchirait l’air.
Il n’était pas huit heures, lorsque Djemma et son fils atteignirent la rive de l’oued. Encore dix minutes et ils seraient au rendez-vous.
À l’instant où tous les deux allaient s’engager sur la rive droite, un homme, tapi derrière les cactus de la berge, se dressa à demi et prononça ce nom :
« Sohar ?...
– C’est toi, Ahmet ?...
– Oui... et ta mère ?...
– Elle me suit.
– Et nous te suivons, dit Djemma.
– Quelles nouvelles ?... demanda Sohar.
– Aucune... répondit Ahmet.
– Nos compagnons sont là ?...
– Ils vous attendent.
– Personne n’a eu l’éveil au bordj ?...
– Personne.
– Hadjar est prêt ?...
– Oui.
– Et comment l’a-t-on vu ?...
– Par Harrig, mis en liberté ce matin, et qui se trouve maintenant avec les compagnons...
– Allons », dit la vieille femme.
Et tous trois remontèrent la rive de l’oued.
La direction qu’ils suivaient alors ne leur permettait plus d’apercevoir la sombre masse du bordj à travers les épaisses frondaisons. Ce n’est vraiment qu’une vaste palmeraie, cette oasis de Gabès.
Ahmet ne pouvait s’égarer et marchait d’un pas sûr. Il y aurait tout d’abord lieu de traverser Djara qui occupe les deux rives de l’oued. C’est dans ce bourg, autrefois fortifié, qui fut successivement carthaginois, romain, byzantin, arabe, que se tient le principal marché de Gabès. À cette heure, la population ne serait pas rentrée, et peut-être Djemma, son fils auraient-ils quelque peine à passer sans éveiller l’attention. Il est vrai, les rues des oasis tunisiennes n’étaient pas encore éclairées à l’électricité ni même au gaz, et, sauf à la hauteur de quelques cafés, elles seraient plongées dans une obscurité profonde.
Cependant, très prudent, très circonspect, Ahmet ne cessait de dire à Sohar qu’on ne saurait prendre trop de précautions. Il n’était pas impossible que la mère du prisonnier fût connue à Gabès, où sa présence aurait pu provoquer un redoublement de vigilance autour du fort. L’évasion ne présentait déjà que trop de difficultés, bien qu’elle eût été préparée de longue main, et il importait que les gardiens ne fussent point mis en éveil. Aussi Ahmet choisissait-il de préférence les chemins qui conduisaient aux environs du bordj.
Du reste, la partie centrale de l’oasis, pendant cette soirée, ne laissait pas d’être assez animée. C’était un dimanche qui allait finir. Ce dernier jour de la semaine est généralement fêté dans toutes les villes qui possèdent garnison et surtout garnison française, en Afrique comme en Europe. Les soldats obtiennent des permissions, ils s’attablent dans les cafés, ils ne rentrent que tard à la caserne. Les indigènes s’associent à cette animation, principalement dans le quartier des mercantis très mêlés d’Italiens et de Juifs. Le tumulte se prolonge jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Il se pouvait – cela vient d’être dit – que Djemma ne fût pas inconnue des autorités de Gabès. En effet, depuis la capture de son fils, elle s’était plus d’une fois risquée autour du bordj. Risque, assurément, et pour sa liberté et peut-être même pour sa vie. On n’ignorait pas l’influence qu’elle avait eue sur Hadjar, cette influence de la mère, si puissante chez la race touareg. Ne la savait-on pas capable, après l’avoir poussé à la révolte, de provoquer une nouvelle rébellion, soit pour délivrer le prisonnier, soit pour le venger, si le conseil de guerre l’envoyait à la mort ?... Oui ! on devait le craindre, toutes les tribus se dresseraient à sa voix et la suivraient sur le chemin de la guerre sainte. En vain des recherches avaient-elles été entreprises pour s’emparer de sa personne. En vain les expéditions s’étaient-elles multipliées à travers ce pays des sebkha et des chotts. Protégée par le dévouement public, Djemma avait échappé jusqu’ici à toutes les tentatives faites pour capturer la mère après le fils !...
Et, pourtant, voici qu’elle était venue au milieu de cette oasis, où tant de dangers la menaçaient. Elle avait voulu se joindre à ses compagnons que l’œuvre de l’évasion réunissait alors à Gabès. Si Hadjar arrivait à déjouer la surveillance de ses gardiens, s’il pouvait franchir les murs du bordj, sa mère reprendrait avec lui la route du marabout, et, à un kilomètre de là, au plus épais d’un bois de palmiers, le fugitif trouverait les chevaux préparés pour sa fuite. Ce serait la liberté reconquise, et, qui sait, quelque nouvelle tentative de soulèvement contre la domination française.
Le cheminement s’était poursuivi dans ces conditions. Au milieu des groupes de Français et d’Arabes qui se rencontraient parfois, nul n’avait pu deviner la mère de Hadjar sous le haïk qui la recouvrait. Du reste, Ahmet s’ingéniait à les avertir, et tous trois se blottissaient en quelque coin obscur, derrière une hutte isolée, sous le couvert des arbres et ils reprenaient leur marche, après que les passants s’étaient éloignés.
Enfin, ils n’étaient plus qu’à trois ou quatre pas du lieu de rendez-vous, lorsqu’un Targui, qui semblait guetter leur passage, se précipita devant eux.
La rue ou plutôt le chemin qui obliquait vers le bordj était désert en ce moment, et, en le suivant pendant quelques minutes, il suffirait de remonter une étroite ruelle latérale pour gagner le gourbi où se rendaient Djemma et ses compagnons.
L’homme avait été droit à Ahmet ; puis, joignant le geste à la parole, il l’avait arrêté en disant :
« Ne va pas plus loin...
– Qu’y a-t-il, Horeb ?... demanda Ahmet qui venait de reconnaître un des Touareg de sa tribu.
– Nos compagnons ne sont plus au gourbi. »
La vieille mère avait suspendu sa marche et, interrogeant Horeb d’une voix à la fois pleine d’inquiétude et de colère :
« Est-ce que ces chiens de Roumis ont l’éveil ?... demanda-t-elle.
– Non... Djemma, répondit Horeb, et les gardiens du bordj n’ont aucun soupçon...
– Alors pourquoi nos compagnons ne sont-ils plus au gourbi ?... reprit Djemma.
– Parce que des soldats en permission sont venus y demander à boire, et nous n’avons pas voulu rester avec eux... Il y avait là le sous-officier de spahis Nicol, qui vous connaît, Djemma...
– Oui, murmura celle-ci... Il m’a vue là-bas... dans le douar... lorsque mon fils est tombé entre les mains de son capitaine... Ah ! ce capitaine, si jamais !... »
Et ce fut comme un rugissement de fauve qui s’échappa de la poitrine de cette femme, la mère du prisonnier Hadjar !
« Où rejoindre nos compagnons ?... demanda Ahmet.
– Venez », répondit Horeb.
Et, prenant la tête, il se glissa à travers une petite palmeraie en direction du fort.
Ce bois, désert à cette heure, ne s’animait que les jours où se tenait le grand marché de Gabès. Il y avait donc probabilité qu’on ne rencontrerait plus personne aux approches du bordj, dans lequel il serait d’ailleurs impossible de pénétrer. De ce que la garnison jouissait des permissions de ce dimanche, il n’aurait pas fallu conclure que le poste de service eût été abandonné.
Est-ce qu’une surveillance plus sévère ne s’imposait pas tant que le rebelle Hadjar serait prisonnier dans le fort, tant qu’il n’aurait pas été transféré à bord du croiseur pour être livré à la justice militaire ?...
La petite troupe marchait donc sous le couvert des arbres et atteignit la lisière de la palmeraie.
En cet endroit s’aggloméraient une vingtaine de huttes, et quelques lumières filtraient à travers leurs étroites ouvertures. Il n’y avait plus qu’une portée de fusil à franchir pour atteindre le lieu du rendez-vous.
Mais à peine Horeb s’était-il engagé dans une tortueuse ruelle qu’un bruit de pas et de voix le contraignit de s’arrêter. Une douzaine de soldats, des spahis, venaient de leur côté, chantant et criant, sous l’influence de libations peut-être un peu trop prolongées dans les cabarets du voisinage.
Ahmet trouva prudent d’éviter leur rencontre et, pour leur livrer passage, se rejeta avec Djemma, Sohar et Horeb au fond d’un obscur enfoncement non loin de l’école franco-arabe.
Là se creusait un puits dont l’orifice était surmonté d’une armature de bois qui supportait le treuil auquel s’enroulait la chaîne des seaux.
En un instant, tous se furent réfugiés derrière ce puits dont la margelle assez haute les cacherait entièrement.
Le groupe s’avançait, et voici qu’il s’arrêta, et l’un de ces soldats de s’écrier :
« Nom d’un diable ! qu’il fait soif !...
– Eh bien, bois !... Voici un puits, lui répondit le maréchal des logis-chef Nicol.
– Quoi ! de l’eau... marchef ?... se récria le brigadier Pistache.
– Invoque Mahomet, peut-être changera-t-il cette eau en vin...
– Ah ! si j’en étais sûr !...
– Tu te ferais mahométan ?...
– Non, marchef, non... et d’ailleurs, puisque Allah défend le vin à ses fidèles, jamais il ne consentirait à faire ce miracle-là pour des mécréants...
– Bien raisonné, Pistache, déclara le sous-officier, qui ajouta : En route pour le poste ! »
Mais, au moment où ses soldats allaient le suivre, il les arrêta.
Deux hommes remontaient la rue, et le sous-officier reconnut en eux un capitaine et un lieutenant de son régiment.
« Halte !... commanda-t-il à ses hommes qui portèrent la main à leur chéchia.
– Eh ! fit le capitaine, c’est ce brave Nicol !...
– Le capitaine Hardigan ?... répondit le marchef, d’un ton qui dénotait une certaine surprise.
– Moi-même !...
– Et nous arrivons à l’instant de Tunis, ajouta le lieutenant Villette.
– En attendant de repartir pour une expédition dont tu seras, Nicol...
– À vos ordres, mon capitaine, répondit le sous-officier, et prêt à vous suivre partout où vous irez...
– Entendu... entendu !... dit le capitaine Hardigan. Et ton vieux frère, comment se porte-t-il ?...
– Parfaitement... sur ses quatre jambes que j’ai soin de ne point laisser se rouiller...
– Bien, Nicol !... Et aussi Coupe-à-cœur ?... Toujours l’ami du vieux frère ?...
– Toujours, mon capitaine, et je ne m’étonnerais point qu’ils fussent jumeaux.
– Ce serait drôle... un chien et un cheval !... riposta en riant l’officier... Sois tranquille, Nicol, nous ne les séparerons pas, quand on partira !...
– Pour sûr, ils en mourraient, mon capitaine. »
À ce moment, une détonation retentit du côté de la mer.
« Qu’est-ce, cela ?... demanda le lieutenant Villette.
– Probablement le coup de canon du croiseur qui mouille dans le golfe...
– Et qui vient chercher ce coquin de Hadjar... ajouta le sous-officier. Une fameuse capture que vous avez faite là, mon capitaine...
– Tu peux dire que nous avons faite ensemble, reprit le capitaine Hardigan.
– Oui... et aussi le vieux frère... et aussi Coupe-à-cœur », déclara le marchef.
Puis les deux officiers reprirent leur route en remontant vers le bordj, tandis que le marchef Nicol et ses hommes redescendaient vers les bas quartiers de Gabès.
2
Hadjar
Les Touareg, de race berbère, habitaient l’Ixham, pays compris entre le Touat, cette vaste oasis saharienne située à cinq cents kilomètres au sud-est du Maroc, Tombouctou au midi, le Niger à l’ouest et le Fezzan à l’est. Mais, à l’époque où se passe cette histoire, ils avaient dû se déplacer vers les régions plus orientales du Sahara. Au commencement du XXe siècle, leurs nombreuses tribus, les unes presque sédentaires, les autres absolument nomades, se rencontraient alors au milieu de ces plaines, plates et sablonneuses, désignées par le nom d’« outtâ » en langue arabe, au Soudan et jusque dans les contrées où le désert algérien confine au désert tunisien.
Or, depuis un certain nombre d’années, après l’abandon des travaux de la mer intérieure dans ce pays de l’Arad, qui s’étend à l’ouest de Gabès, et dont le capitaine Roudaire avait étudié la création, le résident général et le bey de Tunis avaient amené des Touareg à venir se cantonner dans les oasis autour des chotts. On avait conçu l’espoir que, grâce à leurs qualités guerrières, ils deviendraient peut-être comme les gendarmes du désert. Vain espoir, les Imohagh avaient continué à mériter leur sobriquet injurieux de « Touareg », c’est-à-dire « brigands de nuit », sous lequel ils avaient été craints et redoutés dans tout le Soudan et, au surplus, si la création de la mer Saharienne venait à être reprise, il n’était pas douteux qu’ils ne se missent à la tête des tribus absolument hostiles à l’inondation des chotts.
D’ailleurs, si, ouvertement du moins, le Targui (singulier de Touareg) faisait le métier de conducteur pour les caravanes, et même de protecteur, pillard par instinct, pirate par nature, sa réputation était trop fâcheusement établie pour ne pas inspirer toute défiance. Est-ce que, voilà bien des années déjà, le major Paing, alors qu’il parcourait ces dangereuses contrées du pays noir, ne risqua pas d’être massacré dans une attaque de ces redoutables indigènes ? En 1881, pendant cette expédition partie de Ouargla sous les ordres du commandant Flatters, ce courageux officier et ses compagnons ne périrent-ils pas à Bir el-Gharama ? Les autorités militaires de l’Algérie et de la Tunisie devaient se tenir constamment sur la défensive et refouler sans relâche ces tribus qui formaient une population assez nombreuse.
Parmi les tribus touareg, celle des Ahaggar passait justement pour être l’une des plus guerrières. On en retrouvait les principaux chefs dans tous les soulèvements partiels qui rendent si difficile le maintien de l’influence française sur ces longues limites du désert. Le gouverneur de l’Algérie et le résident général de la Tunisie, toujours sur le qui-vive, avaient plus particulièrement à observer la région des chotts ou sebkha. Aussi comprendra-t-on l’importance d’un projet dont l’exécution touchait à son terme, l’invasion de la mer intérieure, qui fait l’objet de ce récit. Ce projet devait nuire singulièrement aux tribus touareg, les priver d’une grande partie de leurs bénéfices en réduisant le trajet des caravanes, et surtout rendre plus rares, en permettant de les réprimer plus facilement, ces agressions qui ajoutaient encore tant de noms à la nécrologie africaine.
C’est à cette tribu des Ahaggar qu’appartenait précisément la famille des Hadjar. Elle comptait parmi les plus influentes. Entreprenant, hardi, impitoyable, le fils de Djemma avait toujours été signalé comme l’un des plus redoutables chefs de ces bandes dans toute la partie qui s’étend au sud des monts Aurès. Pendant ces dernières années, maintes attaques, soit contre des caravanes, soit contre des détachements isolés, furent conduites par lui, et son renom grandit au milieu des tribus qui refluaient peu à peu vers l’est du Sahara, mot qui s’applique à l’immense plaine sans végétation de cette portion du continent africain. La rapidité de ses mouvements était déconcertante, et, bien que les autorités eussent donné mission aux chefs militaires de s’emparer à tout prix de sa personne, il avait toujours su dépister les expéditions lancées à sa poursuite. Alors qu’on le signalait aux approches d’une oasis, il apparaissait soudain dans le voisinage d’une autre. À la tête d’une bande de Touareg non moins farouches que leur chef, il battait tout le pays compris entre les chotts algériens et le golfe de la Petite-Syrte. Les kafila n’osaient plus s’engager à travers le désert ou du moins ne s’y risquaient que sous la protection d’une escorte nombreuse. Aussi le trafic si important qui s’effectuait jusque sur les marchés de la Tripolitaine souffrait-il beaucoup de cet état de choses.
Et, cependant, les postes militaires ne manquaient point, ni à Nefta, ni à Gafsa, ni à Tozeur, qui est le chef-lieu politique de cette région. Mais les expéditions organisées contre Hadjar et sa bande n’avaient jamais réussi, et l’aventureux guerrier était parvenu à leur échapper jusqu’au jour – quelques semaines avant – où il tomba entre les mains d’un détachement français.
Cette partie de l’Afrique septentrionale avait été le théâtre d’une de ces catastrophes qui ne sont malheureusement pas rares sur le continent noir. On sait avec quelle passion, quel dévouement, quelle intrépidité les explorateurs, depuis tant d’années, les successeurs des Burton, des Speke, des Livingstone, des Stanley, se sont lancés à travers ce vaste champ de découvertes. On les compterait par centaines, et combien s’ajouteront encore à cette liste jusqu’au jour, très éloigné sans doute, où cette troisième partie de l’Ancien Monde aura livré ses derniers secrets ! Mais aussi combien de ces expéditions pleines de périls se sont terminées en désastres !
Le plus récent concernait celle d’un courageux Belge, qui s’était aventuré au milieu des régions les moins fréquentées et les moins connues du Touat.
Après avoir organisé une caravane à Constantine, Carl Steinx quitta cette ville en se dirigeant vers le sud. Caravane peu nombreuse, en vérité, un personnel d’une dizaine d’hommes en tout, des Arabes recrutés dans la région. Chevaux et méharis leur servaient de montures et aussi de bêtes de trait pour les deux chariots qui composaient le matériel de l’expédition.
En premier lieu, Carl Steinx avait gagné Ouargla par Biskra, Tougourt, Negoussia, où il lui fut facile de se ravitailler. En ces villes résidaient d’ailleurs des autorités françaises qui s’empressèrent de venir en aide à cet explorateur.
À Ouargla, il se trouvait pour ainsi dire au cœur du Sahara, sur cette latitude du trente-deuxième parallèle.
Jusqu’alors l’expédition n’avait pas été très éprouvée : des fatigues, et de sérieuses, oui, mais de sérieux dangers, non. Il est vrai, l’influence française se faisait sentir en ces contrées déjà lointaines. Les Touareg, ouvertement du moins, s’y montraient soumis, et les caravanes pouvaient, sans trop de risques, se prêter à tous les besoins du commerce intérieur.
Pendant son séjour à Ouargla, Carl Steinx eut à modifier la composition de son personnel. Quelques-uns des Arabes qui l’accompagnaient se refusèrent à continuer le voyage au-delà. Il fallut régler leur compte, et cela ne se fit pas sans difficultés, réclamations insolentes, mauvaises chicanes. Mieux valait se débarrasser de ces gens-là qui montraient une évidente mauvaise volonté et qu’il eût été dangereux de conserver dans l’escorte.
D’autre part, le voyageur n’aurait pu se remettre en route sans avoir remplacé les manquants, et, dans ces conditions, on le conçoit, il n’avait pas le choix. Il crut cependant s’être tiré d’embarras en acceptant les services de plusieurs Touareg, qui s’offrirent, moyennant fortes rémunérations, et s’engagèrent à le suivre jusqu’au terme de son expédition soit à la côte occidentale, soit à la côte orientale du continent africain.
Comment, tout en gardant certaines défiances contre les gens de race touareg, Carl Steinx se fût-il douté qu’il introduisait des traîtres dans sa caravane, que celle-ci était guettée depuis son départ de Biskra par la bande de Hadjar, que ce redoutable chef n’attendait que l’occasion de l’attaquer ?... Et, maintenant, ses partisans mêlés au personnel, acceptés précisément comme guides à travers ces régions inconnues, allaient pouvoir entraîner l’explorateur là où l’attendait Hadjar...
C’est ce qui arriva. En quittant Ouargla, la caravane descendit vers le sud, franchit la ligne du tropique, atteignit le pays des Ahaggar d’où, en obliquant au sud-est, elle comptait se diriger vers le lac Tchad. Mais, à dater du quinzième jour après son départ, on n’eut plus aucune nouvelle ni de Carl Steinx ni de ses compagnons. Que s’était-il passé ? La kafila avait-elle pu gagner la région du Tchad, et suivait-elle les routes du retour par l’est ou par l’ouest ?...
Or, l’expédition de Carl Steinx avait excité le plus vif intérêt parmi les nombreuses Sociétés de Géographie qui s’occupaient plus spécialement des voyages à l’intérieur de l’Afrique. Jusqu’à Ouargla, elles avaient été tenues au courant de l’itinéraire. Pendant une centaine de kilomètres au-delà, plusieurs nouvelles parvinrent encore, apportées par les nomades du désert et transmises aux autorités françaises. On pensait donc que, dans quelques semaines, l’arrivée de Carl Steinx aux environs du lac Tchad se serait effectuée dans des circonstances favorables.
Or, non seulement des semaines, mais des mois s’écoulèrent, et aucune information relative à l’audacieux explorateur belge ne put être recueillie. Des émissaires furent envoyés jusque dans l’extrême sud. Les postes français prêtèrent la main aux recherches qui s’étendirent au-delà même en diverses directions. Ces tentatives ne donnèrent aucun résultat, et il eut lieu de craindre que la caravane n’eût péri tout entière, soit dans une attaque des nomades du Touat, soit par la fatigue ou la maladie, au milieu des immenses solitudes sahariennes.
Le monde des géographes ne savait donc que supposer, et commençait à perdre l’espoir, non seulement de revoir Carl Steinx, mais aussi de recueillir quelque bruit le concernant, lorsque, trois mois plus tard, l’arrivée d’un Arabe à Ouargla vint éclaircir le mystère qui entourait cette malheureuse expédition.
Cet Arabe, qui appartenait précisément au personnel de la caravane, avait pu s’échapper. On sut par lui que les Touareg entrés au service de l’explorateur l’avaient trahi. Carl Steinx, égaré par eux, s’était vu attaquer par une bande de Touareg, qui opérait sous la conduite de ce chef de tribus, Hadjar, déjà célèbre par ces agressions dont plusieurs kafila avaient été victimes. Carl Steinx s’était courageusement défendu avec les fidèles de son escorte. Pendant quarante-huit heures, retranché dans une kouba abandonnée, il avait pu tenir tête aux assaillants. Mais l’infériorité numérique de sa petite troupe ne lui permit pas de résister davantage, et il tomba entre les mains des Touareg, qui le massacrèrent avec ses compagnons.
On comprend quelle émotion provoqua cette nouvelle. Il n’y eut qu’un cri : venger la mort du hardi explorateur, et la venger sur cet impitoyable chef touareg, dont le nom fut voué à l’exécration publique. Et, d’ailleurs, combien d’autres attentats contre les caravanes lui étaient attribués non sans raison ! Aussi les autorités françaises décidèrent-elles d’organiser une expédition pour s’emparer de sa personne, le châtier de tant de crimes, anéantir en même temps la funeste influence qu’il exerçait sur les tribus. On ne l’ignorait pas, ces tribus gagnaient peu à peu vers l’est du continent africain, leur habitat tendait à s’établir dans les régions méridionales de la Tunisie et de la Tripolitaine. Le considérable commerce qui se faisait à travers ces contrées risquerait d’être troublé, détruit même, si l’on ne réduisait pas les Touareg à un état absolu de soumission. Une expédition fut donc ordonnée et le gouverneur général de l’Algérie comme le résident général en Tunisie donnèrent des ordres pour qu’elle reçût appui dans les villes du pays des chotts et des sebkha où s’étaient établis des postes militaires. Ce fut un escadron de spahis, commandé par le capitaine Hardigan, que le ministre de la Guerre désigna pour cette difficile campagne dont on attendait de si importants résultats.
Un détachement d’une soixantaine d’hommes fut amené au port de Sfax par le Chanzy. Quelques jours après le débarquement, avec ses vivres, ses tentes à dos de chameaux, sous la conduite de guides arabes, il quitta le littoral et prit la direction de l’ouest. Il devait trouver à se ravitailler dans les villes et bourgades de l’intérieur, Tozeur, Gafsa et autres, et les oasis ne manquent point dans la région du Djerid.
Le capitaine avait sous ses ordres un capitaine en second, deux lieutenants et plusieurs sous-officiers, parmi lesquels le maréchal des logis-chef Nicol.
Or, dès l’instant que le marchef faisait partie de l’expédition, c’est que son vieux frère Va-d’l’avant et le fidèle Coupe-à-cœur en étaient aussi.
L’expédition, réglant ses étapes avec une régularité qui devait assurer la réussite du voyage, traversa tout le Sahel tunisien. Après avoir dépassé Dar el-Mehalla et El-Quittar, elle vint prendre quarante-huit heures de repos à Gafsa, en pleine région de l’Henmara.
Gafsa est bâtie dans le coude principal que forme l’oued Bayœh. Cette ville en occupe une terrasse encadrée de collines auxquelles succède un formidable étage de montagnes à quelques kilomètres de là. Entre les diverses cités de la Tunisie méridionale, elle possède le plus grand nombre d’habitants, groupés dans une agglomération de maisons et de cabanes. La Kasbah qui la domine, et où veillaient autrefois des soldats tunisiens, est présentement confiée à la garde de soldats français et indigènes. Gafsa se vante aussi d’être un centre lettré et diverses écoles y fonctionnent au profit des langues arabe et française. En même temps, l’industrie y est fort prospère, tissage des étoffes, fabrication des haïks de soie, couvertures et burnous dont la laine est fournie par les nombreux moutons des Hammâmma. On y voit encore les Termil, bassins construits à l’époque romaine, et des sources thermales dont la température va de vingt-neuf à trente-deux degrés centigrades.
Dans cette ville, le capitaine Hardigan obtint des nouvelles plus précises concernant Hadjar : la bande de Touareg avait été signalée aux environs de Farkane, à cent trente kilomètres dans l’ouest de Gafsa. La distance à parcourir était grande, mais des spahis ne comptent avec la fatigue pas plus qu’avec le danger.
Et, lorsque le détachement apprit ce que ses chefs attendaient de son énergie et de son endurance, il ne demanda qu’à se mettre en route. « D’ailleurs, ainsi que le déclara le marchef Nicol, j’ai consulté le vieux frère qui est prêt à doubler les étapes s’il le faut !... et Coupe-à-cœur, qui ne demande qu’à prendre les devants ! »
Le capitaine, bien réapprovisionné, partit avec ses hommes. Il fallut d’abord, au sud-ouest de la ville, traverser une forêt qui ne compte pas moins de cent mille palmiers et qui en abrite une seconde uniquement composée d’arbres fruitiers.
Une seule bourgade importante se rencontrait sur ce parcours entre Gafsa et la frontière algéro-tunisienne. C’est Chebika où furent confirmées les informations relatives à la présence du chef touareg. Il opérait alors au très grand dommage des caravanes qui fréquentaient ces extrêmes régions de la province de Constantine, et son dossier, si chargé déjà, s’accroissait sans cesse de nouveaux attentats contre les propriétés et les personnes.
À quelques étapes de là, lorsque le commandant eut franchi la frontière, il fit extrême diligence pour atteindre la bourgade de Négrine, sur les rives de l’oued Sokhna.





























