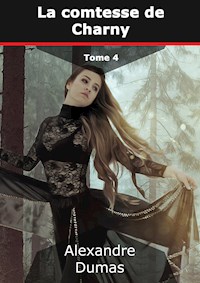
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tout semblait destiner au bonheur la belle Andrée de Taverny avant que le destin ne fit d'elle la comtesse de Charny, amie, confidente et bientôt rivale puis victime de la reine Marie-Antoinette. En ces fiévreuses et fatales journées de l'été 1789 comment échapper, en effet, au furieux torrent libéré par le mystérieux Cagliostro, alias baron Zannone, alias joseph Balsamo ? La fin de l'Ancien Régime et la naissance des temps nouveaux, le cours impétueux de la Révolution qui s'avance tenant «d'une main la hache et de l'autre le drapeau tricolore », tels sont les thèmes de ce récit, l'un des plus puissants et des plus colorés dans l'oeuvre d'Alexandre Dumas. Héroïne exemplaire des temps de troubles, protagoniste et témoin de ce grand drame historique, Andrée de Charny est assurément l'une des plus étonnantes créations du Romantisme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La comtesse de Charny
Pages de titreCXLICXLIICXLIIICXLIVCXLVCXLVICXLVIICXLVIIICXLIXCLCLICLIICLIIICLIVCLVCLVICLVIICLVIIICLIXCLXCLXICLXIICLXIIICLXIVCLXVCLXVICLXVIICLXVIIICLXIXCLXXCLXXICLXXIICLXXIIICLXXIVCLXXVCLXXVICLXXVIICLXXVIIICLXXIXCLXXXCLXXXIIIIIIIIVPage de copyrightAlexandre Dumas
La comtesse de Charny
Tome 4
La série « Mémoires d’un médecin »
comprend les romans suivants :
Joseph Balsamo
Le collier de la reine
Ange Pitou
La comtesse de Charny
La comtesse de Charnyest ici présenté
en quatre volumes.
CXLI
Réaction
L’évacuation des Tuileries avait été aussi triste et aussi muette que l’envahissement en avait été bruyant et terrible.
La foule se disait, étonnée elle-même du peu de résultat de la journée : « Nous n’avons rien obtenu ; il faudra revenir. »
C’était, en effet, trop pour une menace, trop peu pour un attentat.
Ceux qui avaient vu au-delà de ce qui s’était passé avaient jugé Louis XVI sur sa réputation ; ils se rappelaient le roi fuyant à Varennes sous l’habit d’un laquais, et ils se disaient :
– Au premier bruit qu’entendra Louis XVI, il se cachera dans quelque armoire, sous quelque table, derrière quelque rideau : on y donnera un coup d’épée au hasard, et l’on en sera quitte pour dire, comme Hamlet, croyant tuer le tyran du Danemark : « Un rat ! »
Il en avait été tout autrement : jamais le roi n’avait été si calme ; disons plus : jamais il n’avait été si grand.
L’insulte avait été immense ; mais elle n’avait pas monté à la hauteur de sa résignation. Sa fermeté timide, si l’on peut parler ainsi, avait eu besoin d’être excitée, et, dans l’excitation, avait pris la roideur de l’acier ; relevé par les circonstances extrêmes au milieu desquelles il se trouvait, il avait, cinq heures durant, vu, sans pâlir, les haches flamboyer au-dessus de sa tête, les lances, les épées, les baïonnettes, reculer devant sa poitrine ; nul général n’avait couru peut-être en dix batailles, si meurtrières qu’elles eussent été, un danger pareil à celui qu’il venait d’affronter dans cette lente revue de l’émeute ! Les Théroigne, les Saint-Huruge, les Lazouski, les Fournier, les Verrière, tous ces familiers de l’assassinat étaient partis dans l’intention bien positive de le tuer, et cette majesté inattendue qui s’était révélée au milieu de la tempête leur avait fait tomber le poignard de la main. Louis XVI venait d’avoir sa passion ; le royal Ecce Homo s’était montré le front ceint du bonnet rouge, comme Jésus de sa couronne d’épines ; et, de même que Jésus, au milieu des insultes et des mauvais traitements, avait dit : « Je suis votre Christ ! » Louis XVI, au milieu des injures et des outrages, n’avait pas cessé de dire un instant : « Je suis votre roi ! »
Voilà ce qui était arrivé. L’idée révolutionnaire avait cru, en forçant la porte des Tuileries, n’y trouver que l’ombre inerte et tremblante de la royauté, et, à son grand étonnement, elle avait rencontré, debout et vivante, la foi du Moyen Âge ! Et l’on avait vu un instant deux principes face à face, l’un à son couchant, l’autre à son orient ; quelque chose de terrible comme si l’on apercevait à la fois au ciel un soleil qui se levât avant que l’autre soleil fût couché ! Seulement, il y avait autant de grandeur et d’éclat dans l’un que dans l’autre, autant de foi dans l’exigence du peuple que dans le refus de la royauté.
Les royalistes étaient ravis ; en somme, la victoire leur était restée.
Mis violemment en demeure d’obéir à l’Assemblée, le roi, au lieu de sanctionner, comme il était prêt à le faire, un des deux décrets ; le roi, sachant qu’il ne courrait pas plus de risque à en rejeter deux qu’à en repousser un seul, le roi avait apposé son veto sur les deux.
Puis la royauté, dans cette fatale journée du 20 juin, avait été si bas descendue, qu’elle semblait avoir touché le fond de l’abîme, et n’avoir plus désormais qu’à remonter.
Et en effet, la chose parut s’accomplir ainsi.
Le 21, l’Assemblée déclara qu’aucun rassemblement de citoyens armés ne serait plus admis à la barre. C’était désavouer, mieux que cela, condamner le mouvement de la veille.
Le soir du 20, Pétion était arrivé aux Tuileries comme tout allait finir.
– Sire, dit-il au roi, je viens d’apprendre seulement à cette heure la situation de Votre Majesté.
– C’est étonnant, répondit le roi. Il y a cependant assez longtemps que cela dure !
Le lendemain, les constitutionnels, les royalistes et les Feuillants demandèrent à l’Assemblée la proclamation de la loi martiale.
On sait ce que la première proclamation de cette loi avait amené, le 17 juillet précédent, au Champ-de-Mars.
Pétion courut à l’Assemblée.
On fondait cette demande sur de nouveaux rassemblements qui existaient, disait-on.
Pétion affirma que ces nouveaux rassemblements n’avaient jamais existé ; il répondit de la tranquillité de Paris. La proclamation de la loi martiale fut repoussée.
Au sortir de la séance, vers huit heures du soir, Pétion se rendit aux Tuileries pour rassurer le roi sur l’état de la capitale. Il était accompagné de Sergent – Sergent, graveur en taille-douce, et beau-frère de Marceau, était membre du Conseil municipal et l’un des administrateurs de la police. – Deux ou trois autres membres de la municipalité s’étaient joints à eux.
En traversant la cour du Carrousel, ils furent insultés par des chevaliers de Saint-Louis, des gardes constitutionnels et des gardes nationaux ; Pétion fut personnellement attaqué ; Sergent, malgré l’écharpe qu’il portait, fut frappé à la poitrine et à la figure, renversé même d’un coup de poing !
À peine introduit, Pétion comprit que c’était un combat qu’il était venu chercher.
Marie-Antoinette lui lança un de ces regards comme les seuls yeux de Marie-Thérèse savaient en décocher : deux rayons de haine et de mépris, deux éclairs terribles et fulgurants.
Le roi savait déjà ce qui s’était passé à l’Assemblée.
– Eh bien ! monsieur, dit-il à Pétion, c’est donc vous qui prétendez que le calme est rétabli dans la capitale ?
– Oui, sire, répondit Pétion, le peuple vous a fait ses représentations ; il est tranquille et satisfait.
– Avouez, monsieur, reprit le roi engageant le combat, avouez que la journée d’hier est un grand scandale, et que la municipalité n’a fait ni ce qu’elle devait ni ce qu’elle pouvait faire.
– Sire, répliqua Pétion, la municipalité a fait son devoir ; l’opinion publique la jugera.
– Dites la nation entière, monsieur.
– La municipalité ne craint pas le jugement de la nation.
– Et, dans ce moment, en quel état est Paris ?
– Calme, sire.
– Cela n’est pas vrai !
– Sire...
– Taisez-vous !
– Le magistrat du peuple n’a point à se taire, sire, quand il fait son devoir et dit la vérité.
– C’est bon, retirez-vous.
Pétion salua et sortit.
Le roi avait été si violent, sa figure portait l’expression d’une si profonde colère, que la reine, la femme emportée, l’amazone ardente, en fut épouvantée.
– Mon Dieu, dit-elle à Rœderer quand Pétion eut disparu, ne trouvez-vous pas que le roi a été bien vif, et ne craignez-vous pas que cette vivacité ne lui nuise auprès des Parisiens ?
– Madame, répondit Rœderer, personne ne trouvera étonnant que le roi impose silence à un de ses sujets qui lui manque de respect.
Le lendemain, le roi écrivit à l’Assemblée pour se plaindre de cette profanation du château, de la royauté et du roi.
Puis il fit une proclamation à son peuple.
Il y avait donc deux peuples : le peuple qui avait fait le 20 juin et le peuple auquel le roi s’en plaignait.
Le 24, le roi et la reine passèrent la revue de la garde nationale, et furent accueillis avec enthousiasme.
Le même jour, le Directoire de Paris suspendit le maire.
Qui lui donnait une pareille audace ?
Trois jours après la chose s’éclaircit.
La Fayette, parti de son camp avec un seul officier, arriva à Paris le 27, et descendit chez son ami M. de La Rochefoucauld.
Pendant la nuit, on avertit les constitutionnels, les Feuillants et les royalistes, et l’on s’occupa de faire les tribunes du lendemain.
Le lendemain, le général se présenta à l’Assemblée.
Trois salves d’applaudissements l’accueillirent ; mais chacune d’elles fut éteinte par le murmure des Girondins.
On comprit que la séance allait être terrible.
Le général La Fayette était un des hommes les plus franchement braves qui existassent ; mais la bravoure n’est pas l’audace : il est même rare qu’un homme réellement brave soit en même temps audacieux.
La Fayette comprit le danger qu’il courait ; seul contre tous, il venait jouer le reste de sa popularité : s’il la perdait, il se perdait avec elle ; s’il gagnait, il pouvait sauver le roi.
C’était d’autant plus beau de sa part, qu’il savait la répugnance du roi, la haine de la reine pour lui : « J’aime mieux périr par Pétion qu’être sauvée par La Fayette ! »
Peut-être ne venait-il aussi que pour accomplir une bravade de sous-lieutenant, que pour répondre à un défi.
Treize jours auparavant, il avait écrit à la fois au roi et à l’Assemblée : au roi, pour l’encourager à la résistance ; à l’Assemblée, pour la menacer si elle continuait d’attaquer.
– Il est bien insolent au milieu de son armée, avait dit une voix ; nous verrions s’il parlerait le même langage, seul au milieu de nous.
Ces paroles avaient été rapportées à La Fayette à son camp de Maubeuge.
Peut-être ces paroles furent-elles la vraie cause de son voyage à Paris.
Il monta à la tribune au milieu des applaudissements des uns, mais aussi au milieu des grondements et des menaces des autres.
– Messieurs, dit-il, on m’a reproché d’avoir écrit ma lettre du 16 juin au milieu de mon camp ; il était de mon devoir de protester contre cette imputation de timidité, de sortir de cet honorable rempart que l’affection des troupes formait autour de moi, et de me présenter seul devant vous. Puis un motif plus puissant encore m’appelait. Les violences du 20 juin ont soulevé l’indignation de tous les bons citoyens et surtout de l’armée. Les officiers, sous-officiers et soldats ne font qu’un. J’ai reçu de tous les corps des adresses pleines de dévouement à la Constitution et de haine contre les factieux. J’ai arrêté ces manifestations. Je me suis chargé d’exprimer seul les sentiments de tous. C’est comme citoyen que je vous parle. Il est temps de garantir la Constitution, d’assurer la liberté de l’Assemblée nationale, celle du roi, sa dignité. Je supplie l’Assemblée d’ordonner que les excès du 20 juin seront poursuivis comme des crimes de lèse-nation ; de prendre des mesures efficaces pour faire respecter toutes les autorités constituées, et particulièrement la vôtre et celle du roi, et de donner à l’armée l’assurance que la Constitution ne recevra aucune atteinte à l’intérieur, tandis que les braves Français prodiguent leur sang pour la défense de la frontière.
Guadet s’était levé lentement et au fur et à mesure qu’il avait senti La Fayette approcher de sa péroraison ; au milieu des applaudissements qui l’accueillaient, l’acerbe orateur de la Gironde étendit la main en signe qu’il demandait à répondre. Quand la Gironde voulait lancer la flèche de l’ironie, c’était à Guadet qu’elle remettait l’arc, et Guadet n’avait qu’à prendre au hasard une flèche dans son carquois.
À peine le bruit du dernier applaudissement s’était-il éteint, que le bruit de sa parole vibrante lui succédait.
– Au moment où j’ai vu M. La Fayette, s’écria-t-il, une idée bien consolante s’est offerte à mon esprit : « Ainsi, me suis-je dit, nous n’avons plus d’ennemis extérieurs ; ainsi, me suis-je dit, les Autrichiens sont vaincus ; voici M. La Fayette qui vient nous annoncer la nouvelle de sa victoire et de leur destruction ! » L’illusion n’a pas duré longtemps : nos ennemis sont toujours les mêmes ; nos dangers extérieurs n’ont pas changé ; et, cependant, M. La Fayette est à Paris ! Il se constitue l’organe des honnêtes gens et de l’armée ! Ces honnêtes gens, qui sont-ils ? Cette armée, comment a-t-elle pu délibérer ? Mais, d’abord que M. La Fayette nous montre son congé !
À ces mots, la Gironde comprend que le vent va tourner à elle : et, en effet, à peine sont-ils prononcés, qu’un tonnerre d’applaudissements les accueille.
Un député se lève alors, et, de sa place :
– Messieurs, dit-il, vous oubliez à qui vous parlez, et de qui il est question ; vous oubliez qui est La Fayette surtout ! La Fayette est le fils aîné de la liberté française ; La Fayette a sacrifié à la Révolution sa fortune, sa noblesse, sa vie !
– Ah çà ! crie une voix, c’est son éloge funèbre que vous faites là !
– Messieurs, dit Ducos, la liberté de discussion est opprimée par la présence dans cette enceinte d’un général étranger à l’Assemblée.
– Ce n’est pas le tout ! crie Vergniaud : ce général a quitté son poste devant l’ennemi ; c’est à lui, et non à un simple maréchal de camp qu’il a laissé à sa place, que le corps d’armée qu’il commande a été confié. Sachons s’il a quitté l’armée sans congé, et, s’il l’a quittée sans congé, qu’on l’arrête et qu’on le juge comme déserteur.
– C’est là le but de ma question, dit Guadet, et j’appuie la proposition de Vergniaud.
– Appuyé ! appuyé ! crie toute la Gironde.
– L’appel nominal ! dit Gensonné.
L’appel nominal donne une majorité de dix voix aux amis de La Fayette.
Comme le peuple au 20 juin, La Fayette a osé trop ou trop peu ; c’est une de ces victoires dans le genre de celles dont se plaignait Pyrrhus, veuf de la moitié de son armée : « Encore une victoire comme celle-là, et je suis perdu ! » disait-il.
Ainsi que Pétion, La Fayette, en sortant de l’Assemblée, se rendit chez le roi.
Il y fut reçu avec un visage plus doux, mais avec un cœur non moins ulcéré.
La Fayette venait de sacrifier au roi et à la reine plus que sa vie : il venait de leur sacrifier sa popularité.
C’était la troisième fois qu’il faisait ce don, plus précieux qu’aucun de ceux que les rois puissent faire : la première fois, à Versailles, le 6 octobre ; la seconde fois, au Champ-de-Mars, le 17 juillet ; la troisième fois, ce jour-là même.
La Fayette avait un dernier espoir ; c’était de cet espoir qu’il venait faire part à ses souverains : le lendemain, il passerait une revue de la garde nationale avec le roi ; il n’y avait point à douter de l’enthousiasme qu’inspirerait la présence du roi et de l’ancien commandant général ; La Fayette profiterait de cette influence, marcherait sur l’Assemblée, mettrait la main sur la Gironde : pendant le tumulte, le roi partirait et gagnerait le camp de Maubeuge.
C’était un coup hardi, mais, dans la situation des esprits, il était à peu près sûr.
Par malheur, Danton, à trois heures du matin, entrait chez Pétion pour le prévenir du complot.
Au point du jour, Pétion contremandait la revue.
Qui donc avait trahi le roi et La Fayette ?
La reine !
N’avait-elle pas dit qu’elle préférait périr par un autre plutôt que d’être sauvée par La Fayette ?
Elle avait eu la main juste : elle allait périr par Danton !
À l’heure où la revue eût dû avoir lieu, La Fayette quitta Paris, et retourna à son armée.
Et, cependant, il n’avait pas encore perdu tout espoir de sauver le roi.
CXLII
Vergniaud parlera
La victoire de La Fayette, victoire douteuse suivie d’une retraite, avait eu un singulier résultat.
Elle avait abattu les royalistes, tandis que la prétendue défaite des Girondins les avait relevés ; elle les avait relevés en leur faisant voir l’abîme où ils avaient failli tomber.
Supposez moins de haine dans le cœur de Marie-Antoinette, et peut-être, à cette heure, la Gironde était-elle détruite.
Il ne fallait pas laisser à la cour le temps de réparer la faute qu’elle venait de commettre.
Il fallait rendre sa force et sa direction au courant révolutionnaire, qui un instant venait de rebrousser chemin, et de remonter vers sa source.
Chacun cherchait, chacun croyait avoir trouvé un moyen ; puis, le moyen proposé, on voyait son inefficacité, et l’on y renonçait.
Mme Roland, l’âme du parti, voulait arriver par une grande commotion dans l’Assemblée. Cette commotion, qui pouvait la produire ? Ce coup, qui pouvait le porter ? – Vergniaud.
Mais que faisait cet Achille sous sa tente, ou plutôt ce Renaud perdu dans les jardins d’Armide ? – Il aimait.
Il est si difficile de haïr quand on aime !
Il aimait la belle Mme Simon Candeille, actrice poète, musicienne ; ses amis le cherchaient parfois deux ou trois jours sans le rencontrer ; puis, enfin, ils le trouvaient couché aux pieds de la charmante femme, une main étendue sur ses genoux, l’autre effleurant distraitement les cordes de sa harpe.
Puis, chaque soir, à l’orchestre du théâtre, il allait applaudir celle qu’il adorait tout le jour.
Un soir, deux députés sortirent désespérés de l’Assemblée : cette inaction de Vergniaud les épouvantait pour la France.
C’étaient Grangeneuve et Chabot.
Grangeneuve, l’avocat de Bordeaux, l’ami, le rival de Vergniaud, et, comme lui, député de la Gironde.
Chabot, le capucin défroqué, l’auteur ou l’un des auteurs du Catéchisme des Sans-Culottes, qui répandait sur la royauté et la religion le fiel amassé dans le cloître.
Grangeneuve, sombre et pensif, marchait près de Chabot.
Celui-ci le regardait, et il lui semblait voir passer sur le front de son collègue l’ombre de ses pensées.
– À quoi songes-tu ? lui demanda Chabot.
– Je songe, répondit celui-ci, que toutes ces lenteurs énervent la patrie, et tuent la Révolution.
– Ah ! tu penses cela, reprit Chabot avec ce rire amer qui lui était habituel.
– Je songe, continua Grangeneuve, que, si le peuple donne du temps à la royauté, le peuple est perdu !
Chabot fit entendre son rire strident.
– Je songe, acheva Grangeneuve, qu’il n’y a qu’une heure pour les révolutions : que ceux qui la laissent échapper ne la retrouvent pas, et en doivent compte plus tard à Dieu et à la postérité.
– Et tu crois que Dieu et la postérité nous demanderont compte de notre paresse et de notre inaction ?
– J’en ai peur !
Puis, après un silence :
– Tiens, Chabot, reprit Grangeneuve, j’ai une conviction : c’est que le peuple est las de son dernier échec ; c’est qu’il ne se lèvera plus sans quelque puissant levier, sans quelque sanglant mobile ; il lui faut un accès de rage ou de terreur où il puise un redoublement d’énergie.
– Comment le lui donner, cet accès de rage ou de terreur ? demanda Chabot.
– C’est à quoi je pense, dit Grangeneuve, et je crois que j’en ai trouvé le secret.
Chabot se rapprocha de lui ; à l’intonation de la voix de son compagnon, il avait compris que celui-ci allait lui proposer quelque chose de terrible.
– Mais, continua Grangeneuve, trouverai-je également un homme capable de la résolution nécessaire à un pareil acte ?
– Parle, dit Chabot avec un accent de fermeté qui ne devait pas laisser de doute à son collègue ; je suis capable de tout pour détruire ce que je hais, et je hais les rois et les prêtres !
– Eh bien ! dit Grangeneuve en jetant les yeux sur le passé, j’ai vu qu’il y avait du sang pur au berceau de toutes les révolutions, depuis celui de Lucrèce jusqu’à celui de Sidney. Pour les hommes d’État, les révolutions sont une théorie ; pour les peuples, les révolutions sont une vengeance ; or, si l’on veut pousser la multitude à la vengeance, il faut lui montrer une victime : cette victime, la Cour nous la refuse ; eh bien ! donnons-la nous-mêmes à notre cause !
– Je ne comprends pas, dit Chabot.
– Eh bien ! il faut qu’un de nous – un des plus connus, un des plus acharnés, un des plus purs – tombe sous les coups des aristocrates.
– Continue.
– Il faut que celui qui tombera fasse partie de l’Assemblée nationale, afin que l’Assemblée prenne la vengeance en main ; il faut enfin que, cette victime, ce soit moi !
– Mais les aristocrates ne te frapperont pas, Grangeneuve : ils s’en garderont bien !
– Je le sais ; voilà pourquoi je disais qu’il faudrait trouver un homme de résolution...
– Pour quoi faire ?
– Pour me frapper.
Chabot recula d’un pas ; mais Grangeneuve le saisit par le bras.
– Chabot, lui dit-il, tout à l’heure tu prétendais que tu étais capable de tout pour détruire ce que tu haïssais : es-tu capable de m’assassiner ?
Le moine resta muet. Grangeneuve continua :
– Ma parole est nulle ; ma vie est inutile à la liberté, tandis qu’au contraire, ma mort lui profitera. Mon cadavre sera l’étendard de l’insurrection, et, je te le dis...
Grangeneuve, d’un geste véhément, étendit la main vers les Tuileries.
– Il faut que ce château et ceux qu’il renferme disparaissent dans une tempête !
Chabot regardait Grangeneuve en frémissant d’admiration.
– Eh bien ? insista Grangeneuve.
– Eh bien ! sublime Diogène, dit Chabot, éteins ta lanterne : l’homme est trouvé !
– Alors, arrêtons tout, dit Grangeneuve, et que ce soit terminé ce soir même. Cette nuit, je me promènerai seul ici (on était en face des guichets du Louvre), dans l’endroit le plus désert et le plus sombre... Si tu crains que la main ne te faille, préviens deux autres patriotes : je ferai ce signe pour qu’ils me reconnaissent.
Grangeneuve leva ses deux bras en l’air.
– Ils me frapperont, et, je te le promets, je tomberai sans pousser un cri.
Chabot passa son mouchoir sur son front.
– Au jour, continua Grangeneuve, on trouvera mon cadavre ; tu accuseras la Cour ; la vengeance du peuple fera le reste.
– C’est bien, dit Chabot ; à cette nuit !
Et les deux étranges conjurés se serrèrent la main, et se quittèrent.
Grangeneuve rentra chez lui et fit son testament, qu’il data de Bordeaux et d’un an en arrière.
Chabot s’en alla dîner au Palais-Royal.
Après le dîner, il entra chez un coutelier, et acheta un couteau.
En sortant de chez le coutelier, ses regards tombèrent sur les affiches des théâtres.
Mlle Candeille jouait : le moine savait où trouver Vergniaud.
Il alla à la Comédie-Française, monta à la loge de la belle comédienne, et trouva chez elle sa cour ordinaire : Vergniaud, Talma, Chénier, Dugazon.
Elle jouait dans deux pièces.
Chabot resta jusqu’à la fin du spectacle.
Puis, quand le spectacle fut fini, la belle actrice déshabillée, et que Vergniaud s’apprêta à la reconduire rue de Richelieu, où elle demeurait, il monta, derrière son collègue, dans la voiture.
– Vous avez quelque chose à me dire, Chabot ? demanda Vergniaud, qui comprenait que le capucin avait affaire à lui.
– Oui... mais soyez tranquille, ce ne sera pas long.
– Dites tout de suite, alors.
Chabot tira sa montre.
– Il n’est pas l’heure, dit-il.
– Et quand sera-t-il l’heure ?
– À minuit.
La belle Candeille tremblait à ce dialogue mystérieux.
– Oh ! monsieur ! murmura-t-elle.
– Rassurez-vous, dit Chabot, Vergniaud n’a rien à craindre, seulement, la patrie a besoin de lui.
La voiture roula vers la demeure de l’actrice.
La femme et les deux hommes restèrent silencieux. À la porte de Mlle Candeille :
– Montez-vous ? demanda Vergniaud.
– Non, vous allez venir avec moi.
– Mais où l’emmenez-vous, mon Dieu ? demanda l’actrice.
– À deux cents pas d’ici ; dans un quart d’heure, il sera libre, je vous le promets.
Vergniaud serra la main de sa belle maîtresse, lui fit un signe pour la rassurer, et s’éloigna avec Chabot par la rue Traversière.
Ils franchirent la rue Saint-Honoré, et prirent la rue de l’Échelle.
Au coin de cette rue, le moine pesa d’une main sur l’épaule de Vergniaud, et, de l’autre, lui montra un homme qui se promenait le long des murailles désertes du Louvre.
– Vois-tu ? demanda-t-il à Vergniaud.
– Quoi ?
– Cet homme ?
– Oui, répondit le Girondin.
– Eh bien ! c’est notre collègue Grangeneuve.
– Que fait-il là ?
– Il attend.
– Qu’attend-il ?
– Qu’on le tue.
– Qu’on le tue ?
– Oui.
– Et qui doit le tuer ?
– Moi !
Vergniaud regarda Chabot comme on regarde un fou.
– Rappelle-toi Sparte, rappelle-toi Rome, dit Chabot, et écoute.
Alors, il lui raconta tout.
À mesure que le moine parlait, Vergniaud courbait la tête.
Il comprenait combien il y avait loin de lui, tribun efféminé, lion amoureux, à ce républicain terrible qui, comme Decius, ne demandait qu’un gouffre où se précipiter, pour que sa mort sauvât la patrie.
– C’est bien, dit-il, je demande trois jours pour préparer mon discours.
– Et dans trois jours...
– Sois tranquille, dit Vergniaud, dans trois jours, je me briserai contre l’idole, ou je la renverserai !
– J’ai ta parole, Vergniaud.
– Oui.
– C’est celle d’un homme ?
– C’est celle d’un républicain !
– Alors, je n’ai plus besoin de toi ; va rassurer ta maîtresse.
Vergniaud reprit le chemin de la rue de Richelieu.
Chabot s’avança vers Grangeneuve.
Celui-ci, voyant un homme venir à lui, se retira dans l’endroit le plus sombre.
Chabot l’y suivit.
Grangeneuve s’arrêta au pied de la muraille, ne pouvant pas aller plus loin.
Chabot s’approcha de lui.
Grangeneuve fit le signe convenu en levant les bras.
Puis, comme Chabot restait immobile :
– Eh bien ! dit Grangeneuve, qui t’arrête ? Frappe donc !
– C’est inutile, dit Chabot, Vergniaud parlera.
– Soit ! dit Grangeneuve avec un soupir ; mais je crois que l’autre moyen valait mieux !
Que vouliez-vous que fît la royauté contre de pareils hommes ?
CXLIII
Vergniaud parle
Il était temps que Vergniaud se décidât.
Le danger croissait au-dehors, au-dedans.
Au-dehors, à Ratisbonne, le Conseil des ambassadeurs avait unanimement refusé de recevoir le ministre de France.
L’Angleterre, qui s’intitulait notre amie, préparait un armement immense.
Les princes de l’Empire, qui vantaient tout haut leur neutralité, introduisaient nuitamment l’ennemi dans leurs places.
Le duc de Bade avait mis des Autrichiens dans Kehl, à une lieue de Strasbourg.
En Flandre, c’était pis encore, Luckner, un vieux soudard imbécile, qui contrecarrait tous les plans de Dumouriez, le seul homme, sinon de génie, du moins de tête que nous eussions en face de l’ennemi.
La Fayette était à la Cour, et sa dernière démarche avait bien prouvé que l’Assemblée, c’est-à-dire la France, ne devait pas compter sur lui.
Enfin, Biron, brave et de bonne foi, découragé par nos premiers revers, ne comprenait qu’une guerre défensive.
Voilà pour le dehors.
Au-dedans, l’Alsace demandait à grands cris des armes ; mais le ministre de la Guerre, tout à la Cour, n’avait garde de lui en envoyer.
Dans le Midi, un lieutenant-général des princes, gouverneur du bas Languedoc et des Cévennes, faisait vérifier ses pouvoirs par la noblesse.
À l’ouest, un simple paysan, Allan Redeler, publie, à l’issue de la messe, que rendez-vous en armes est donné aux amis du roi près d’une chapelle voisine.
Cinq cents paysans s’y réunissent du premier coup. La chouannerie était plantée en Vendée et en Bretagne : il ne lui restait plus qu’à pousser.
Enfin, de presque tous les Directoires départementaux arrivaient des adresses contre-révolutionnaires.
Le danger était grand, menaçant, terrible ; si grand, que ce n’étaient plus les hommes qu’il menaçait : c’était la patrie.
Aussi, sans avoir été proclamés tout haut, ces mots couraient tout bas : « La patrie est en danger ! »
Au reste, l’Assemblée attendait.
Chabot et Grangeneuve avaient dit : « Dans trois jours, Vergniaud parlera. »
Et l’on comptait les heures qui s’écoulaient.
Ni le premier ni le second jour Vergniaud ne parut à l’Assemblée.
Le troisième jour, chacun arriva en frémissant.
Pas un député ne manquait à son banc ; les tribunes étaient combles.
Le dernier de tous, Vergniaud entra.
Un murmure de satisfaction courut dans l’Assemblée : les tribunes applaudirent comme fait le parterre à l’entrée d’un acteur aimé.
Vergniaud releva la tête pour chercher des yeux qui l’on applaudissait : les applaudissements, en redoublant, lui apprirent que c’était lui.
Vergniaud avait alors trente-trois ans à peine ; son caractère était méditatif et paresseux ; son génie indolent se plaisait aux nonchalances ; ardent seulement au plaisir, on eût dit qu’il se hâtait de cueillir à pleines mains les fleurs d’une jeunesse qui devait avoir un si court printemps ! Il se couchait tard, et ne se levait guère avant midi ; quand il devait parler, trois ou quatre jours à l’avance, il préparait son discours, le polissait, le fourbissait, l’aiguisait, ainsi qu’un soldat, la veille d’une bataille, aiguise, fourbit et polit ses armes. C’était, comme orateur, ce qu’on appelle dans une salle d’escrime un beau tireur ; le coup ne lui paraissait bon que s’il était brillamment porté et fortement applaudi ; il fallait réserver sa parole pour les moments de danger, pour les instants suprêmes.
Ce n’était pas l’homme de toutes les heures, a dit un poète ; c’était l’homme des grandes journées.
Quant au physique, Vergniaud était plutôt petit que grand ; seulement, il était d’une taille robuste, et qui sent l’athlète. Ses cheveux étaient longs et flottants ; dans ses mouvements oratoires, il les secouait comme un lion fait de sa crinière ; au-dessous de son front large, ombragés par d’épais sourcils, brillaient deux yeux noirs pleins de douceur ou de flammes ; le nez était court, un peu large, fièrement relevé aux ailes ; les lèvres étaient grosses, et, comme de l’ouverture d’une source jaillit l’eau abondante et sonore, les paroles tombaient de sa bouche en cascades puissantes, jetant l’écume et le bruit. Toute marquée de petite vérole, sa peau semblait diamantée comme le marbre, non pas encore poli par le ciseau du statuaire, mais seulement dégrossi par le marteau du praticien ; son teint pâle ou se colorait de pourpre, ou devenait livide, selon que le sang lui montait au visage ou se retirait vers le cœur. Dans le repos et dans la foule, c’était un homme ordinaire sur lequel l’œil de l’historien, si perçant qu’il fût, n’eût eu aucune raison pour s’arrêter ; mais, quand la flamme de la passion faisait bouillonner son sang, quand les muscles de son visage palpitaient, quand son bras étendu commandait le silence et dominait la foule, l’homme devenait dieu, l’orateur se transfigurait, la tribune était son Thabor !
Tel était l’homme qui arrivait, la main fermée encore, mais toute chargée d’éclairs.
Aux applaudissements qui éclatèrent à sa vue, il devina ce que l’on attendait de lui.
Il ne demanda point la parole ; il marcha droit à la tribune ; il y monta, et, au milieu d’un silence plein de frissonnements, il commença son discours.
Ses premières paroles furent dites avec l’accent triste, profond, concentré, d’un homme abattu ; il semblait fatigué dès le début comme on l’est d’ordinaire à la fin : c’est que, depuis trois jours, il luttait avec le génie de l’éloquence ; c’est qu’il savait, comme Samson, que, dans l’effort suprême qu’il allait tenter, il renverserait infailliblement le temple, et qu’étant monté à la tribune au milieu de ses colonnes encore debout, de sa voûte encore suspendue, il en descendrait en enjambant par-dessus les ruines de la royauté.
Comme le génie de Vergniaud est tout entier dans ce discours, nous le citerons tout entier ; nous croyons qu’on éprouvera, en le lisant, la même curiosité qu’on éprouverait, en visitant un arsenal, devant une de ces machines de guerre historiques qui auraient renversé les murailles de Sagonte, de Rome ou de Carthage.
– Citoyens, dit Vergniaud d’une voix à peine intelligible d’abord, mais qui devint bientôt grave, sonore, grondante ; citoyens, je viens à vous, et je vous demande : Quelle est donc l’étrange situation où se trouve l’Assemblée nationale ? Quelle fatalité nous poursuit et signale chaque journée par des événements qui, portant le désordre dans nos travaux, nous rejettent sans cesse dans l’agitation tumultueuse des inquiétudes, des espérances, des passions ? Quelle destinée prépare à la France cette terrible effervescence au sein de laquelle on serait tenté de douter si la Révolution rétrograde ou si elle avance vers son terme ?
» Au moment où nos armées du Nord paraissent faire des progrès dans la Belgique, nous les voyons tout à coup se replier devant l’ennemi ; on ramène la guerre sur notre territoire. Il ne restera de nous chez les malheureux Belges que le souvenir des incendies qui auront éclairé notre retraite. Du côté du Rhin, les Prussiens s’accumulent incessamment sur nos frontières découvertes. Comment se fait-il que ce soit précisément au moment d’une crise si décisive pour l’existence de la nation, que l’on suspende le mouvement de nos armées, et que, par une désorganisation subite du ministère, on rompe les liens de la confiance, et on livre au hasard et à des mains inexpérimentées le salut de l’empire ? Serait-il vrai qu’on redoute nos triomphes ? Est-ce du sang de l’armée de Coblentz ou du nôtre qu’on est avare ? Si le fanatisme des prêtres menace de nous livrer à la fois aux déchirements de la guerre civile et à l’invasion, quelle est donc l’intention de ceux qui font rejeter, avec une invincible opiniâtreté, la sanction de nos décrets ? Veulent-ils régner sur des villes abandonnées, sur des champs dévastés ? Quelle est au juste la quantité de larmes, de misères, de sang, de morts, qui suffit à leur vengeance ? Où en sommes-nous enfin ? Et vous, messieurs, dont les ennemis de la Constitution se flattent d’avoir ébranlé le courage, vous dont ils tentent chaque jour d’alarmer les consciences et la probité, en qualifiant votre amour de la liberté d’esprit de faction – comme si vous aviez oublié qu’une cour despotique et les lâches héros de l’aristocratie ont donné ce nom de factieux aux représentants qui allèrent prêter serment au Jeu de Paume, aux vainqueurs de la Bastille, à tous ceux qui ont fait et soutenu la Révolution ! – vous qu’on ne calomnie que parce que vous êtes étrangers à la caste que la Constitution a renversée dans la poussière, et que les hommes dégradés qui regrettent l’infâme honneur de ramper devant elle n’espèrent pas de trouver en vous des complices ; vous qu’on voudrait aliéner du peuple parce qu’on sait que le peuple est votre appui, et que si, par une coupable désertion de sa cause, vous méritiez d’être abandonnés de lui, il serait aisé de vous dissoudre ; vous qu’on a voulu diviser, mais qui ajournerez après la guerre vos divisions et vos querelles, et qui ne trouvez pas si doux de vous haïr, que vous préfériez cette infernale jouissance au salut de la patrie ; vous qu’on a voulu épouvanter par des pétitions armées, comme si vous ne saviez pas qu’au commencement de la Révolution, le sanctuaire de la liberté fut environné des satellites du despotisme, Paris assiégé par l’armée de la Cour, et que ces jours de danger furent les jours de gloire de notre première Assemblée ; je vais appeler enfin votre attention sur l’état de crise où nous sommes.
» Ces troubles intérieurs ont deux causes : manœuvres aristocratiques, manœuvres sacerdotales. Toutes tendent au même but : la contre-révolution.
» Le roi a refusé sa sanction à votre décret sur les troubles religieux. Je ne sais pas si le sombre génie de Médicis et du cardinal de Lorraine erre encore sous les voûtes du palais des Tuileries, et si le cœur du roi est troublé par les idées fantastiques qu’on lui suggère ; mais il n’est pas permis de croire, sans lui faire injure et sans l’accuser d’être l’ennemi le plus dangereux de la Révolution, qu’il veuille encourager par l’impunité les tentatives criminelles de l’ambition sacerdotale, et rendre aux orgueilleux suppôts de la tiare la puissance dont ils ont également opprimé les peuples et les rois. Il n’est pas permis de croire, sans lui faire injure, et sans le déclarer le plus cruel ennemi de l’empire, qu’il se complaise à perpétuer les séditions, à éterniser les désordres qui le précipiteraient par la guerre civile vers sa ruine. J’en conclus que, s’il résiste à vos décrets, c’est qu’il se juge assez puissant, sans les moyens que vous lui offrez pour maintenir la paix publique. Si donc il arrive que la paix publique n’est pas maintenue, que la torche du fanatisme menace encore d’incendier le royaume, que les violences religieuses désolent toujours les départements, c’est que les agents de l’autorité royale sont eux-mêmes la cause de tous nos maux. Eh bien ! qu’ils répondent sur leur tête de tous les troubles dont la religion sera le prétexte ! Montrez, dans cette responsabilité terrible, le terme de votre patience et des inquiétudes de la nation !
» Votre sollicitude pour la sûreté extérieure de l’empire vous a fait décréter un camp sous Paris ; tous les fédérés de la France devaient y venir, le 14 juillet, répéter le serment de vivre libres ou de mourir. Le souffle empoisonné de la calomnie a flétri ce projet. Le roi a refusé sa sanction. Je respecte trop l’exercice d’un droit constitutionnel pour vous proposer de rendre les ministres responsables de ce refus ; mais s’il arrive qu’avant le rassemblement des bataillons le sol de la liberté soit profané, vous devez les traiter comme des traîtres, il faudra les jeter eux-mêmes dans l’abîme que leur incurie ou leur malveillance aura creusé sous les pas de la liberté ! Déchirons enfin le bandeau que l’intrigue et l’adulation ont mis sous les yeux du roi, et montrons-lui le terme où des amis perfides s’efforcent de le conduire.
» C’est au nom du roi que les princes français soulèvent contre nous les cours de l’Europe ; c’est pour venger la dignité du roi que s’est conclu le Traité de Pilnitz ; c’est pour défendre le roi qu’on voit accourir en Allemagne sous le drapeau de la rébellion les anciennes compagnies des gardes du corps ; c’est pour venir au secours du roi que les émigrés s’enrôlent dans les armées autrichiennes, et s’apprêtent à déchirer le sein de la patrie ; c’est pour se joindre à ces preux chevaliers de la prérogative royale que d’autres abandonnent leur poste en présence de l’ennemi, trahissent leurs serments, volent les caisses, corrompent les soldats, et placent ainsi leur honneur dans la lâcheté, le parjure, l’insubordination, le vol et les assassinats. Enfin le nom du roi est dans tous les désastres ! Or, je lis dans la Constitution :
« Si le roi se met à la tête d’une armée, et en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel, à une telle entreprise exécutée en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté. »
» C’est en vain que le roi répondrait :
« Il est vrai que les ennemis de la nation prétendent n’agir que pour relever ma puissance ; mais j’ai prouvé que je n’étais pas leur complice : j’ai obéi à la Constitution, j’ai mis des troupes en campagne. Il est vrai que ces armées étaient trop faibles ; mais la Constitution ne désigne pas le degré de force que je devais leur donner. Il est vrai que je les ai rassemblées trop tard ; mais la Constitution ne désigne pas le temps auquel je devais les rassembler. Il est vrai que des camps de réserve auraient pu les soutenir ; mais la Constitution ne m’oblige pas à former des camps de réserve. Il est vrai que lorsque les généraux s’avançaient sans résistance sur le territoire ennemi, je leur ai ordonné de reculer ; mais la Constitution ne me commande pas de remporter la victoire. Il est vrai que mes ministres ont trompé l’Assemblée nationale sur le nombre, la disposition des troupes et leurs approvisionnements ; mais la Constitution me donne le droit de choisir mes ministres, elle ne m’ordonne nulle part d’accorder ma confiance aux patriotes et de chasser les contre-révolutionnaires. Il est vrai que l’Assemblée nationale a rendu des décrets nécessaires à la défense de la patrie, et que j’ai refusé de les sanctionner ; mais la Constitution me garantit cette faculté. Il est vrai enfin que la contre-révolution s’opère, que le despotisme va remettre entre mes mains son sceptre de fer, que je vous en écraserai, que vous allez ramper, que je vous punirai d’avoir eu l’insolence de vouloir être libres ; mais tout cela se fait constitutionnellement. Il n’est émané de moi aucun acte que la Constitution condamne. Il n’est donc pas permis de douter de ma fidélité envers elle et de mon zèle pour sa défense. »
» S’il était possible, messieurs, que dans les calamités d’une guerre funeste, dans les désordres d’un bouleversement contre-révolutionnaire, le roi des Français tînt ce langage dérisoire ; s’il était possible qu’il leur parlât de son amour pour la Constitution avec une ironie aussi insultante, ne serions-nous pas en droit de lui répondre :
« Ô roi ! qui, sans doute, avez cru, avec le tyran Lysandre, que la vérité ne valait pas mieux que le mensonge, et qu’il fallait amuser les hommes par des serments comme on amuse les enfants avec des osselets ; qui n’avez feint d’aimer les lois que pour conserver la puissance qui vous servirait à les braver, la Constitution que pour qu’elle ne vous précipitât pas du trône où vous aviez besoin de rester pour la détruire, la nation que pour assurer le succès de vos perfidies en lui inspirant de la confiance, pensez-vous nous abuser aujourd’hui avec d’hypocrites protestations ? Pensez-vous nous donner le change sur la cause de nos malheurs par l’artifice de vos excuses et l’audace de vos sophismes ? Était-ce nous défendre que d’opposer aux soldats étrangers des forces dont l’infériorité ne laissait pas même d’incertitude sur leur défaite ? Était-ce nous défendre que d’écarter les projets tendant à fortifier l’intérieur du royaume, ou de faire des préparatifs de résistance pour l’époque où nous serions déjà devenus la proie des tyrans ? Était-ce nous défendre que de ne pas réprimer un général qui violait la Constitution et d’enchaîner le courage de ceux qui la servaient ? Était-ce nous défendre que de paralyser sans cesse le gouvernement par la désorganisation continuelle du ministère ? La Constitution vous laissa-t-elle le choix des ministres pour notre bonheur ou notre ruine ? Vous fit-elle chef de l’armée pour notre gloire ou notre honte ? Vous donna-t-elle enfin le droit de sanction, une liste civile et tant de grandes prérogatives, pour perdre constitutionnellement la Constitution et l’empire ? Non, non, homme que la générosité des Français n’a pu émouvoir, homme que le seul amour du despotisme a pu rendre sensible, vous n’avez pas rempli le vœu de la Constitution ! Elle peut être renversée, mais vous ne recueillerez pas le fruit de votre parjure ! Vous ne vous êtes point opposé par un acte formel aux victoires qui se remportaient en votre nom sur la liberté ; mais vous ne recueillerez point le fruit de ces indignes triomphes ! Vous n’êtes plus rien pour cette Constitution que vous avez si indignement violée, pour ce peuple que vous avez si lâchement trahi ! »
» Comme les faits que je viens de rappeler ne sont pas dénués de rapports très frappants avec plusieurs actes du roi ; comme il est certain que les faux amis qui l’environnent sont vendus aux conjurés de Coblentz, et qu’ils brûlent de perdre le roi pour transporter la couronne sur la tête de quelqu’un des chefs de leurs complots ; comme il importe à sa sûreté personnelle autant qu’à la sûreté de l’empire que sa conduite ne soit plus environnée de soupçons, je proposerai une adresse qui lui rappelle les vérités que je viens de faire entendre, et où on lui démontrera que la neutralité qu’il garde entre la patrie et Coblentz serait une trahison envers la France.
» Je demande, de plus, que vous déclariez que la patrie est en danger. Vous verrez à ce cri d’alarme tous les citoyens se rallier, la terre se couvrir de soldats, et se renouveler les prodiges qui ont couvert de gloire les peuples de l’Antiquité. Les Français régénérés de 89 sont-ils déchus de ce patriotisme ? Le jour n’est-il pas venu de réunir ceux qui sont dans Rome et ceux qui sont sur le Mont-Aventin ? Attendez-vous que, las des fatigues de la Révolution, ou corrompus par l’habitude de parader autour d’un château, des hommes faibles s’accoutument à parler de liberté sans enthousiasme et d’esclavage sans horreur ? Que nous prépare-t-on ? Est-ce le gouvernement militaire que l’on veut établir ? On soupçonne la Cour de projets perfides ; elle fait parler de mouvements militaires, de loi martiale ; on familiarise l’imagination avec le sang du peuple. Le palais du roi des Français s’est tout à coup changé en château fort. Où sont cependant ses ennemis ? Contre qui se pointent ces canons et ces baïonnettes ? Les amis de la Constitution ont été repoussés du ministère. Les rênes de l’empire demeurent flottantes au hasard, à l’instant où, pour les soutenir, il fallait autant de vigueur que de patriotisme. Partout on fomente la discorde. Le fanatisme triomphe. La connivence du gouvernement accroît l’audace des puissances étrangères, qui vomissent contre nous des armées et des fers, et refroidit la sympathie des peuples, qui font des vœux secrets pour le triomphe de la liberté. Les cohortes ennemies s’ébranlent. L’intrigue et la perfidie trament des trahisons. Le corps législatif oppose à ces complots des décrets rigoureux, mais nécessaires ; la main du roi les déchire. Appelez, il en est temps, appelez tous les Français pour sauver la patrie ! Montrez-leur le gouffre dans toute son immensité. Ce n’est que par un effort extraordinaire qu’ils pourront le franchir. C’est à vous de les y préparer par un mouvement électrique qui fasse prendre l’élan à tout l’empire. Imitez vous-mêmes les Spartiates des Thermopyles, ou ces vieillards vénérables du sénat romain qui allèrent attendre, sur le seuil de leur porte, la mort que de farouches vainqueurs apportaient à leur patrie. Non, vous n’aurez pas besoin de faire des vœux pour qu’il naisse des vengeurs de vos cendres. Le jour où votre sang rougira la terre, la tyrannie, son orgueil, ses palais, ses protecteurs s’évanouiront à jamais devant la toute-puissance nationale et devant la colère du peuple.
Il y avait dans ce discours terrible une force ascendante, une gradation croissante, un crescendo de tempêtes, qui allait battant l’air d’une aile immense et pareille à celle de l’ouragan.
Aussi l’effet fut-il celui d’une trombe : l’Assemblée tout entière, Feuillants, royalistes, constitutionnels, républicains, députés, spectateurs, bancs, tribunes, tout fut enveloppé, entraîné, enlevé par le puissant tourbillon ; tous poussèrent des cris d’enthousiasme.
Le même soir, Barbaroux écrivait à son ami Rebecqui, resté à Marseille : « Envoie-moi cinq cents hommes qui sachent mourir. »
CXLIV
Le troisième anniversaire de la prise de la Bastille
Le 11 juillet, l’Assemblée déclara que la patrie était en danger.
Mais, pour promulguer la déclaration, il fallait l’autorisation du roi.
Le roi ne la donna que le 21 au soir.
Et, en effet, proclamer que la patrie était en danger, c’était un aveu que l’autorité faisait de son impuissance ; c’était un appel à la nation de se sauver elle-même, puisque le roi n’y pouvait ou n’y voulait plus rien.
Dans l’intervalle du 11 au 21 juillet, une grande terreur avait agité le château.
La Cour s’attendait pour le 14 juillet à un complot contre la vie du roi.
Une adresse des Jacobins l’avait affermie dans cette croyance : elle était rédigée par Robespierre ; il est facile de le reconnaître à son double tranchant.
Elle était adressée aux fédérés qui venaient à Paris pour cette fête du 14 juillet, si cruellement ensanglantée l’année précédente.
« Salut aux Français des quatre-vingt-trois départements ! disait l’Incorruptible ; salut aux Marseillais ! Salut à la patrie puissante, invincible, qui rassemble ses enfants autour d’elle au jour de ses dangers et de ses fêtes ! Ouvrons nos maisons à nos frères !
» Citoyens, n’êtes-vous accourus que pour une vaine cérémonie de fédération, et pour des serments superflus ? Non, non, vous accourez au cri de la nation qui vous appelle, menacée dehors, trahie dedans ! Nos chefs perfides mènent nos armées aux pièges. Nos généraux respectent le territoire du tyran autrichien et brûlent les villes de nos frères belges. Un autre monstre, La Fayette, est venu insulter en face l’Assemblée nationale. Avilie, menacée, outragée, existe-t-elle encore ? Tant d’attentats réveillent enfin la nation, et vous êtes accourus. Les endormeurs du peuple vont essayer de vous séduire. Fuyez leurs caresses, fuyez leurs tables, où l’on boit le modérantisme et l’oubli du devoir. Gardez vos soupçons dans vos cœurs. L’heure fatale va sonner !
» Voilà l’autel de la patrie. Souffrirez-vous que de lâches idoles viennent s’y placer entre la liberté et vous, pour usurper le culte qui lui est dû ? Ne prêtons serment qu’à la patrie, entre les mains immortelles de la nature. Tout nous rappelle, à ce Champ-de-Mars, les parjures de nos ennemis. Nous ne pouvons y fouler un seul endroit qui ne soit souillé du sang innocent qu’ils y ont versé ! Purifiez ce sol, vengez ce sang, et ne sortez de cette enceinte qu’après avoir décidé le salut de la patrie ! »
Il était difficile de s’expliquer plus catégoriquement ; jamais conseil d’assassinat n’a été donné en termes plus positifs ; jamais représailles sanglantes n’ont été prêchées d’une voix plus claire et plus pressante.
Et c’était Robespierre, remarquez bien, le cauteleux tribun, le filandreux orateur, qui, de sa voix doucereuse, disait aux députés des quatre-vingt-trois départements : « Mes amis, si vous m’en croyez, il faut tuer le roi ! »
On eut grand-peur aux Tuileries, le roi surtout ; on était convaincu que le 20 juin n’avait eu d’autre but que l’assassinat du roi au milieu d’une bagarre, et que, si le crime n’avait pas été commis, cela avait tout simplement tenu au courage du roi, qui avait imposé à ses assassins.
Il y avait bien quelque chose de vrai dans tout cela.
Or, disaient tout ce qui restait de courtisans à ces deux condamnés que l’on appelait le roi et la reine, le crime qui vient d’échouer au 20 juin a été remis au 14 juillet.
On en était tellement persuadé, que l’on supplia le roi de mettre un plastron, afin que, le premier coup de couteau ou la première balle s’émoussant sur sa poitrine, ses amis eussent le temps d’arriver à son secours.
Hélas ! la reine n’avait plus là Andrée pour l’aider, comme la première fois, dans sa besogne nocturne, et pour aller, à minuit, essayer d’une main tremblante, dans un coin reculé des Tuileries, ainsi qu’elle l’avait fait à Versailles, la solidité de la cuirasse de soie.
Heureusement, on avait conservé le plastron que le roi, lors de son premier voyage à Paris, avait essayé pour faire plaisir à la reine, puis avait refusé de mettre.
Seulement, le roi était surveillé de si près, que l’on ne trouvait pas un instant pour le lui faire revêtir une seconde fois, et corriger les défauts qu’il pouvait avoir ; Mme Campan le porta trois jours sous sa robe.
Enfin, un matin qu’elle était dans la chambre de la reine, la reine étant couchée encore, le roi entra, ôta vivement son habit, tandis que Mme Campan fermait les portes, et essaya le plastron.
Le plastron essayé, le roi tira Mme Campan à lui ; puis, tout bas :
– C’est pour contenter la reine, dit-il, que je fais ce que je fais ; ils ne m’assassineront pas, Campan, soyez tranquille ; leur plan est changé, et je dois m’attendre à un autre genre de mort. En tout cas, venez chez moi en sortant de chez la reine ; j’ai quelque chose à vous confier.
Le roi sortit.
La reine avait vu l’aparté sans l’entendre ; elle suivit le roi d’un regard inquiet, et, quand la porte se fut refermée derrière lui :
– Campan, demanda-t-elle, que vous disait donc le roi ?
Mme Campan, tout éplorée, se jeta à genoux devant le lit de la reine, qui lui tendit les deux mains, et elle répéta tout haut ce que le roi avait dit tout bas.
La reine secoua tristement la tête.
– Oui, dit-elle, c’est l’opinion du roi, et je commence à me ranger de son avis ; le roi prétend que tout ce qui se passe en France est une imitation de ce qui s’est passé en Angleterre pendant le siècle dernier ; il lit sans cesse l’histoire du malheureux Charles, pour se conduire mieux que n’a fait le roi d’Angleterre... Oui, oui, j’en suis à redouter un procès pour le roi, ma chère Campan ! Quant à moi, je suis étrangère, et ils m’assassineront... Hélas ! que deviendront mes pauvres enfants ?
La reine ne put aller plus loin : sa force l’abandonna ; elle éclata en sanglots.
Alors, Mme Campan se leva, et se hâta de préparer un verre d’eau sucrée avec de l’éther ; mais la reine lui fit un signe de la main.
– Les maux de nerfs, ma pauvre Campan, dit-elle, sont les maladies des femmes heureuses ; mais tous les médicaments du monde ne peuvent rien contre les maladies de l’âme ! Depuis mes malheurs, je ne sens plus mon corps ; je ne sens que ma destinée... Ne dites rien de cela au roi, et allez le trouver.
Mme Campan hésitait à obéir.
– Eh bien ! qu’avez-vous ? demanda la reine.
– Oh ! madame, s’écria Mme Campan, j’ai à vous dire que j’ai fait pour Votre Majesté un corset pareil au plastron du roi, et qu’à genoux je supplie Votre Majesté de le mettre.
– Merci, ma chère Campan, dit Marie-Antoinette.
– Ah ! Votre Majesté l’accepte donc ? s’écria la femme de chambre toute joyeuse.
– Je l’accepte comme un remerciement de votre intention dévouée ; mais je me garderai bien de le mettre.
Puis, lui prenant la main, et à voix basse, elle ajouta :
– Je serai trop heureuse s’ils m’assassinent ! Mon Dieu ! ils auront fait plus que vous n’avez fait en me donnant la vie : ils m’en auront délivrée... Va, Campan ! va !
Mme Campan sortit.
Il était temps : elle étouffait.
Dans le corridor, elle rencontra le roi, qui venait au-devant d’elle ; en la voyant, il s’arrêta et lui tendit la main. Mme Campan saisit la main royale, et voulut la baiser ; mais le roi, l’attirant à lui, l’embrassa sur les deux joues.
Puis, avant qu’elle fût revenue de son étonnement :
– Venez ! dit-il.
Alors, le roi marcha devant elle, et, s’arrêtant dans le corridor intérieur qui conduisait de sa chambre à celle du dauphin, il chercha de la main un ressort, et ouvrit une armoire parfaitement dissimulée dans la muraille, en ce que l’ouverture en était perdue au milieu des rainures brunes qui formaient la partie ombrée de ces pierres peintes.
C’était l’armoire de fer qu’il avait creusée et fermée avec l’aide de Gamain.
Un grand portefeuille plein de papiers était dans cette armoire, dont une des planches supportait quelques milliers de louis.
– Tenez, Campan, dit le roi, prenez ce portefeuille, et emportez-le chez vous.
Mme Campan essaya de soulever le portefeuille, mais il était trop lourd.
– Sire, dit-elle, je ne puis.
– Attendez, attendez, dit le roi.
Et, ayant refermé l’armoire, qui, une fois refermée, redevenait parfaitement invisible, il prit le portefeuille, et le porta jusque dans le cabinet de Mme Campan.
– Là ! dit-il en s’essuyant le front.
– Sire, demanda Mme Campan, que dois-je faire de ce portefeuille ?
– La reine vous le dira, en même temps qu’elle vous apprendra ce qu’il contient.
Et le roi sortit.
Pour qu’on ne vît pas le portefeuille, Mme Campan, avec effort, le glissa entre deux matelas de son lit, et, entrant chez la reine :
– Madame, dit-elle, j’ai chez moi un portefeuille que le roi vient d’y apporter ; il m’a dit que Votre Majesté m’apprendrait et ce qu’il contient et ce que je dois en faire.
Alors, la reine posa sa main sur celle de Mme Campan, qui, debout devant son lit, attendait sa réponse.
– Campan, dit-elle, ce sont des pièces qui seraient mortelles au roi si on allait, ce qu’à Dieu ne plaise, jusqu’à lui faire un procès ; mais, en même temps, et c’est sans doute cela qu’il veut que je vous dise, il y a dans ce portefeuille le compte rendu d’une séance du Conseil dans laquelle le roi a donné son avis contre la guerre ; il l’a fait signer par tous les ministres, et, dans le cas même de ce procès, il compte qu’autant les autres pièces lui seraient nuisibles, autant celle-là lui serait utile.
– Mais, madame, demanda la femme de chambre presque effrayée, qu’en faut-il faire ?
– Ce que vous voudrez, Campan, pourvu qu’il soit en sûreté ; vous en êtes seule responsable ; seulement, vous ne vous éloignerez pas de moi, même quand vous ne serez pas de service : les circonstances sont telles, que, d’un moment à l’autre, je puis avoir besoin de vous. En ce cas, Campan, comme vous êtes une de ces amies sur lesquelles on peut compter, je désire vous avoir sous la main...
La fête du 14 juillet arriva.
Il s’agissait pour la Révolution, non pas d’assassiner Louis XVI – il est probable qu’on n’en eut pas même l’idée – mais de proclamer le triomphe de Pétion sur le roi.
Nous avons dit qu’à la suite du 20 juin, Pétion avait été suspendu par le Directoire de Paris.
Ce n’eût rien été sans l’adhésion du roi ; mais cette suspension avait été confirmée par une proclamation royale envoyée à l’Assemblée.
Le 13, c’est-à-dire la veille de la fête anniversaire de la prise de la Bastille, l’Assemblée, de son autorité privée, avait levé cette suspension.
Le 14, à onze heures du matin, le roi descendit le grand escalier avec la reine et ses enfants ; trois ou quatre mille hommes de troupes indécises escortaient la famille royale ; la reine cherchait en vain sur les visages des soldats et des gardes nationaux quelque marque de sympathie : les plus dévoués détournaient la tête et évitaient son regard.
Quant au peuple, il n’y avait pas à se tromper sur ses sentiments ; les cris de « Vive Pétion ! » retentissaient de tous côtés ; puis, comme pour donner à cette ovation quelque chose de plus durable que l’enthousiasme du moment, sur tous les chapeaux le roi et la reine pouvaient lire ces deux mots, qui constataient à la fois et leur défaite et le triomphe de leur ennemi : « Vive Pétion ! »
La reine était pâle et tremblante ; convaincue, malgré ce qu’elle avait dit à Mme Campan, qu’un complot existait contre les jours du roi, elle tressaillait à chaque instant, croyant voir s’allonger une main armée d’un couteau, s’abaisser un bras armé d’un pistolet.
Arrivé au Champ-de-Mars, le roi descendit de voiture, prit place à la gauche du président de l’Assemblée, et s’avança avec lui vers l’autel de la Patrie.
Là, la reine dut se séparer du roi pour monter avec ses enfants à la tribune qui lui était réservée.
Elle s’arrêta, refusant de monter avant qu’il fût arrivé, et le suivant des yeux.
Au pied de l’autel de la Patrie, il y eut une de ces houles subites telles qu’en font les multitudes.
Le roi disparut comme submergé.
La reine jeta un cri, et voulut s’élancer vers lui.
Mais il reparut, montant les degrés de l’autel de la Patrie.
Parmi les symboles ordinaires qui figurent dans les fêtes solennelles, tels que la Justice, la Force, la Liberté, il y en avait un qu’on voyait briller, mystérieux et redoutable, sous un voile de crêpe, et que portait un homme vêtu de noir et couronné de cyprès.
Ce symbole terrible attirait particulièrement les yeux de la reine.
Elle était comme clouée à sa place, et, à peu près rassurée sur le roi, qui avait atteint le sommet de l’autel de la Patrie, elle ne pouvait détacher les yeux de la sombre apparition.
Enfin, faisant un effort pour délier les chaînes de sa langue :
– Quel est cet homme vêtu de noir et couronné de cyprès ? demanda-t-elle sans s’adresser à personne.
Une voix qui la fit tressaillir répondit :
– Le bourreau !
– Et que tient-il à la main, sous ce crêpe ? continua la reine.
– La hache de Charles Ier.
La reine se retourna pâlissant ; il lui semblait avoir déjà entendu le son de cette voix.
Elle ne se trompait pas : celui qui venait de parler, c’était l’homme du château de Taverney, du pont de Sèvres, du retour de Varennes ; c’était Cagliostro enfin.
Elle jeta un cri, et tomba évanouie dans les bras de Madame Élisabeth.
CXLV
La patrie est en danger
Le 22 juillet, à six heures du matin, huit jours après la fête du Champ-de-Mars, Paris tout entier tressaillit au bruit d’une pièce de canon de gros calibre tirée sur le Pont-Neuf.
Un canon de l’Arsenal lui répondit, faisant écho.
D’heure en heure, et pendant toute la journée, le bruissement terrible devait se renouveler.
Les six légions de la garde nationale, conduites par leurs six commandants, étaient réunies, dès le point du jour, à l’Hôtel de Ville.
On y organisa deux cortèges pour porter, dans les rues de Paris, et dans les faubourgs, la proclamation du danger de la patrie.
C’était Danton qui avait eu l’idée de la terrible fête, et il en avait demandé le programme à Sergent.
Sergent, artiste médiocre comme graveur, mais immense metteur en scène ; Sergent, dont les outrages qui l’avaient assailli aux Tuileries avaient redoublé la haine ; Sergent avait déployé dans tout le programme de cette journée cet appareil grandiose dont il donna le dernier mot après le 10 août.
Chacun des deux cortèges, l’un qui devait descendre Paris, l’autre le remonter, partit de l’Hôtel de Ville à six heures du matin.
D’abord s’avançait un détachement de cavalerie avec musique en tête ; l’air que jouait cette musique, composé pour la circonstance, était sombre, et semblait une marche funèbre.
Derrière le détachement de cavalerie venaient six pièces de canon marchant de front là où les quais ou les rues étaient assez larges, marchant deux à deux dans les rues étroites.
Puis quatre huissiers à cheval, portant quatre enseignes, sur chacune desquelles était écrit un de ces quatre mots : « Liberté – Égalité – Constitution – Patrie. »
Puis, douze officiers municipaux en écharpe et le sabre au côté.
Puis, seul, isolé comme la France, un garde national à cheval, tenant une grande bannière tricolore sur laquelle étaient écrits ces mots : « Citoyens, la patrie est en danger ! »
Puis, dans le même ordre que les premières, suivaient six pièces de canon au retentissement profond, aux lourds soubresauts.
Puis, un détachement de la garde nationale.
Puis, un second détachement de cavalerie fermant la marche.
À chaque place, à chaque pont, à chaque carrefour, le cortège s’arrêtait.
On commandait le silence par un roulement de tambours.
Puis on agitait les bannières, et, quand aucun bruit ne se faisait plus entendre, quand le souffle haletant de dix mille spectateurs était rentré captif dans leur poitrine, s’élevait la voix grave de l’officier municipal qui lisait l’acte du corps législatif, et qui ajoutait :
– La patrie est en danger !
Ce dernier cri était terrible, et vibrait dans tous les cœurs.
C’était le cri de la nation, de la patrie, de la France !
C’était une mère à l’agonie qui criait : « À moi, mes enfants ! »





























