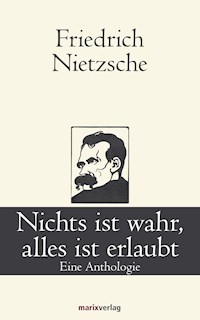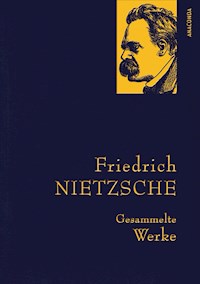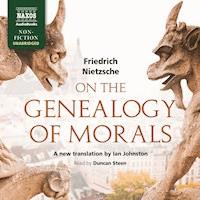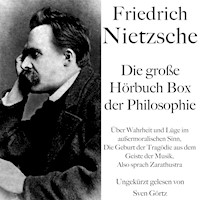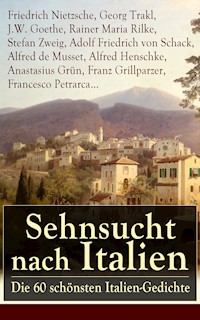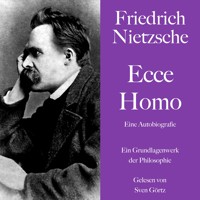1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Nous aurons fait un grand pas en ce qui concerne la science esthétique, quand nous en serons arrivés non seulement à l’induction logique, mais encore à la certitude immédiate de cette pensée : que l’évolution progressive de l’art est le résultat du double caractère de l’esprit apollinien et de l’esprit dionysien, de la même manière que la dualité des sexes engendre la vie au milieu de luttes perpétuelles et par des rapprochements seulement périodiques. Ces noms, nous les empruntons aux Grecs qui ont rendu intelligible au penseur le sens occulte et profond de leur conception de l’art, non pas au moyen de notions, mais à l’aide des figures nettement significatives du monde de leurs dieux. C’est à leurs deux divinités des arts, Apollon et Dionysos, que se rattache notre conscience de l’extraordinaire antagonisme, tant d’origine que de fins, qui exista dans le monde grec entre l’art plastique apollinien et l’art dénué de formes, la musique, l’art de Dionysos. Nietzsche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La naissance de la tragédie
Friedrich Nietzsche
Traduction parJean Marnold
Traduction parJacques Morland
Table des matières
Friedrich Nietzsche
La naissance de la tragédie (1872)
Essai d’une critique de soi-même
Préface à Richard Wagner
L’Origine de la Tragédie
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Notes
À propos de l’auteur
couverture
La naissance de la tragédie (1872)
Traduction de J. Marnold et J. Morland (1906)
Friedrich Nietzsche
Essai d’une critique de soi-même
1
Certes, la cause déterminante de ce livre discutable dut être un problème de premier ordre et de grand attrait, et en outre une profonde préoccupation personnelle ; — ce qui en témoigne, c’est l’époque où ce livre fut conçu, malgré laquelle il fut conçu, l’époque troublante de la guerre de 1870-71. Pendant que le tonnerre des canons de Wœrth remplissait l’Europe de ses échos, le chercheur subtil, ami des énigmes, qui devait enfanter cet ouvrage, s’était retiré dans quelque coin des Alpes, l’esprit saturé de subtilité et de mystère, donc très soucieux et insoucieux à la fois. Il notait ses réflexions sur les Grecs, — noyau de ce livre étrange et difficile auquel est consacrée cette tardive préface (ou postface). Quelques semaines après, il se trouvait lui-même sous les murs de Metz 1, sans avoir réussi encore à répondre aux questions qu’il s’était posées en face de la prétendue « sérénité » des Grecs et de l’art grec ; jusqu’à ce qu’enfin, dans ce mois de profonde angoisse, alors qu’à Versailles on délibérait de la paix, il sentît aussi la paix descendre sur lui ; et, tandis qu’il guérissait lentement d’une maladie prise pendant la campagne, il eut la perception définitive de cette pensée, « que la tragédie naquit du génie de la musique ». —
L’origine de la tragédie dans la musique ? Musique et tragédie ? Grecs et musique de tragédie ? Les Grecs et l’œuvre d’art du pessimisme ? De toutes les races d’hommes, la plus accomplie, la plus belle, la plus justement enviée, la plus séduisante, la plus entraînante vers la vie, les Grecs, — comment ? justement ceux-ci eurent besoin de la tragédie ? Plus encore — de l’art ? Et pourquoi — cet art grec ?…
On devine à quelle place se dressait alors le grand point d’interrogation de la valeur de l’existence. Le pessimisme est-il nécessairement le signe du déclin, de la décadence, de la faillite des instincts lassés et affaiblis ? — comme ce fut le cas pour les Hindous ; comme il semble, selon toute apparence, que cela soit pour nous autres, hommes « modernes » et Européens ? Y a-t-il un pessimisme de la force ? une prédilection intellectuelle pour l’âpreté, l’horreur, la cruauté, l’incertitude de l’existence due à la belle santé, à la surabondance de force vitale, à un trop-plein de vie ? Cette plénitude excessive elle-même ne comporte-t-elle pas peut-être une souffrance ?
L’œil le plus perçant n’est-il pas possédé d’une irrésistible témérité, qui recherche le terrible, comme l’ennemi, le digne adversaire contre qui elle veut éprouver sa force ? dont elle veut apprendre ce que c’est que « la peur » ? Que signifie le mythe tragique, précisément chez les Grecs de l’époque la plus parfaite, la plus forte, la plus vaillante ? Et ce prodigieux phénomène de l’esprit dionysien ? Que signifie la tragédie, née de lui ? — Et, en revanche, ce dont mourut la tragédie, le socratisme de la morale, la dialectique, la pondération et la sérénité de l’homme théorique, — quoi ? ce socratisme ne pourrait-il pas être justement le signe de la décadence, de la lassitude, de l’épuisement, de l’anarchisme dissolvant des instincts ? La « sérénité hellénique » des derniers Grecs ne serait-elle pas un crépuscule ? l’effort épicurien contre le pessimisme, seulement une précaution de malade ? Et la science elle-même, notre science, — oui, envisagée comme symptôme de vie, que signifie, au fond, toute science ? Quel est le but, pis encore, l’origine — de toute science ? Quoi ? L’esprit scientifique n’est-il peut-être qu’une crainte et une diversion en face du pessimisme ? un ingénieux expédient contre — la vérité ? et, pour parler moralement, quelque chose comme de la peur et de l’hypocrisie ? et immoralement : de la ruse ? Ô Socrate, Socrate, était-ce là peut-être ton secret ? Ô mystérieux ironiste, était-ce là ton — ironie ?
2
Ce qu’il me fut alors donné de concevoir, quelque chose de terrible et de périlleux, un problème aux cornes menaçantes, pas absolument un taureau sauvage, en tout cas un problème nouveau, je dirais aujourd’hui que ce fut le problème de la science elle-même — de la science considérée pour la première fois comme problématique, discutable. Mais le livre où j’épanchai alors la défiance et la fougue de ma jeunesse, — quel livre impossible dut naître d’une tâche aussi anti-juvénile ! — construit seulement à l’aide de sensations personnelles précoces et hâtives, effleurant l’extrême limite de ce qui peut s’exprimer, appuyé par ses fondations sur le terrain de l’art, — car le problème de la science ne peut être résolu sur le terrain de la science ; — un livre s’adressant peut-être à des artistes possédant par surcroît des aptitudes spéciales pour l’analyse et la comparaison (c’est-à-dire à une espèce exceptionnelle d’artistes, qu’il faut chercher et qu’on ne voudrait même pas chercher…), bourré d’innovations psychologiques et de mystérieux secrets d’artiste, avec, au fond du tableau, une métaphysique d’artiste ; une œuvre de jeunesse, pleine d’ardeur et de mélancolie juvéniles, indépendante, obstinément intransigeante, même si elle semble céder à une autorité ou à une déférence particulière, en un mot une œuvre de début, voire dans le sens fâcheux de l’expression ; entachée, en dépit des allures séniles du problème, de tous les défauts de la jeunesse, avant tout, de ses longueurs excessives, de ses élans tumultueux et de ses violences. D’autre part, en considération du succès qu’il obtint (particulièrement auprès du grand artiste auquel il s’adressait comme une manière de colloque, Richard Wagner), un vrai livre, je veux dire un livre qui, en tous cas, a donné satisfaction aux « meilleurs de son temps ». Cette seule raison lui mériterait quelque déférence et certains égards ; cependant je ne veux pas dissimuler tout à fait l’impression désagréable qu’il me produit aujourd’hui : combien, après seize années, il se présente comme un étranger — à mes yeux plus expérimentés, cent fois plus sévères, bien qu’aucunement refroidis, et nullement enclins à se détourner de cette même tâche à laquelle ce livre téméraire osa le premier se mesurer, à savoir — de considérer la science sous l’optique de l’artiste et l’art sous l’optique de la vie…
3
Encore une fois, ce livre me paraît aujourd’hui un livre impossible, — je le trouve mal écrit, lourd, pénible, hérissé d’images forcenées et incohérentes, sentimental, édulcoré çà et là jusqu’à l’effémination, mal équilibré, dépourvu d’effort vers la pure logique, très convaincu et, à cause de cela, se dispensant de fournir des preuves, doutant même qu’il lui convienne de prouver, en tant que livre d’initiés, « musique » pour ceux-là, dont la musique fut le baptême, et qui, depuis l’origine des choses, sont unis par le lien commun des connaissances artistiques rares, bannière de ralliement pour des frères de même sang in artibus, — un livre hautain et exalté, dirigé de prime abord plus encore contre le profanum vulgus des « intellectuels » que contre le « peuple », mais qui, par son influence, a prouvé et prouve encore qu’il s’entend assez bien à découvrir ses enthousiastes et à les entraîner à travers le labyrinthe de chemins ignorés jusqu’à de joyeuses arènes. En tout cas, — on dut l’avouer avec étonnement et impatience, — ici parlait une voix étrangère, l’apôtre « d’un dieu encore inconnu », affublé provisoirement de la barrette du savant, caché sous la pesanteur et la morosité dialectique de l’Allemand aggravées du mauvais ton du wagnérien ; il y avait là un esprit rempli d’exigences nouvelles et encore innommées, une mémoire gonflée d’interrogations, d’observations, d’obscurités, auxquelles venait s’ajouter, comme un problème de plus, le nom de Dionysos ; ici parlait, — on le remarqua avec défiance, — quelque chose comme une âme mystique, presque une âme de ménade, qui, tourmentée et capricieuse, et quasi irrésolue, si elle doit se livrer ou se dérober, balbutie en quelque sorte une langue étrangère. Elle aurait dû chanter, cette « âme nouvelle », — et non parler ! Quel dommage que je n’aie pas osé exprimer en poète ce que j’avais à dire alors : peut-être bien que cela m’eût été possible ! Tout au moins aurais-je pu m’exprimer en philologue : car, pour les philologues, dans ce domaine, il reste encore aujourd’hui à peu près tout à découvrir et à mettre en lumière ! Avant tout, ce problème, qu’il y a ici un problème, — et qu’il sera toujours absolument impossible de comprendre et de se représenter les Grecs, aussi longtemps qu’on n’aura pas répondu à cette question : « Qu’est-ce que l’esprit dionysien ?… »
4
Oui, qu’est-ce que l’esprit dionysien ? — On trouvera dans ce livre une réponse à cette interrogation, — c’est un « initié » qui parle ici, l’adepte élu, l’apôtre de son dieu. Peut-être serais-je aujourd’hui plus circonspect, moins absolu en présence d’un problème psychologique aussi compliqué que la recherche des origines de la tragédie chez les Grecs. Un point fondamental est la mesure de subjectivité du Grec en face de la souffrance, son degré de sensibilité, — ce degré n’a-t-il jamais varié ? ou bien le rapport fut-il renversé ? — cette question de savoir si son toujours grandissant désir de beauté, de fêtes, de réjouissances, de cultes nouveaux, n’est pas fait de détresse, de misère, de mélancolie, de douleur ? Et en supposant que ce fût vrai — et Périclès (ou Thucydide) le donne à entendre dans la grande oraison funèbre — : d’où viendrait alors la tendance contraire et chronologiquement antérieure, le besoin de l’horrible, la sincère et âpre inclination des premiers Hellènes pour le pessimisme, le mythe tragique, la représentation de tout ce qu’il y a de terreur, de cruauté, de mystère, de néant, de fatalité au fond des choses de la vie, — d’où viendrait alors la tragédie ? Peut-être de la joie, de la force, de la santé exubérante, de l’excès de vitalité ? Et quelle signification prend alors, physiologiquement parlant, ce délire particulier, qui fut la source de l’art tragique aussi bien que de l’art comique, le délire dionysiaque ? Quoi ? Le délire ne serait-il peut-être pas inévitablement le symptôme de la dégénérescence, de la décadence, de la civilisation suravancée ? Y a-t-il peut-être — question pour les médecins aliénistes — une névrose de la santé ? de la jeunesse des peuples, de leur adolescence ? Que nous indique cette synthèse d’un dieu et d’un bouc dans le satyre ? Quelle expérience, quelle impulsion irrésistible amenèrent le Grec à représenter par un satyre le rêveur dionysien, l’homme primitif ? Et pour ce qui regarde l’origine du chœur, dans ces siècles où florissait la force physique du Grec, où l’âme grecque débordait de vie, y eut-il peut-être des enthousiasmes endémiques ? des visions et des hallucinations se manifestant à des cités entières, à des foules entières assemblées dans les temples ? Quoi ? Si pourtant les Grecs, précisément dans la splendeur première de leur jeunesse, avaient eu le besoin du tragique et avaient été pessimistes ? Si, pour employer une parole de Platon, le délire avait été justement, pour Hellas, le plus grand des bienfaits ? Et si, d’un autre côté et au contraire, les Grecs, à l’époque même de leur dissolution et de leur déclin, étaient devenus toujours plus optimistes, plus superficiels, plus cabotins, et aussi plus passionnés pour la logique, plus ardents à concevoir la vie logiquement, c’est-à-dire à la fois plus « sereins » et plus « scientifiques » ! Comment ? en dépit de toutes les « idées modernes » et des préjugés du goût démocratique, la victoire de l’optimisme, la raison, dès lors prédominante, le pratique et théorique utilitarisme, aussi bien que la démocratie elle-même, dont il est contemporain, — tout cela ne pourrait-il pas être le symptôme du déclin de la force, de l’approche de la vieillesse et de la lassitude physiologique ? Et non — le pessimisme ? L’optimiste Épicure ne fut-il pas précisément — un malade ? — On le voit, c’est d’un véritable fardeau de graves problèmes que s’est chargé ce livre, — ajoutons encore le plus grave de tous ! Que signifie, considérée au point de la vue de la Vie — la morale ?…
5
Déjà, dans la préface à Richard Wagner, c’est l’art, — et non la morale, — qui est présenté comme l’activité essentiellement métaphysique de l’homme ; au cours de ce livre se reproduit à différentes reprises cette singulière proposition, que l’existence du monde ne peut se justifier que comme phénomène esthétique. En effet, ce livre ne reconnaît, au fond de tout ce qui fut, qu’une pensée et arrière-pensée d’artiste, — un « Dieu », si l’on veut, mais, à coup sûr, un Dieu purement artiste, absolument dénué de scrupule et de morale, pour qui la création ou la destruction, le bien ou le mal sont des manifestations de son caprice indifférent et de sa toute-puissance ; qui se débarrasse, en fabriquant des mondes, du tourment de sa plénitude et de sa pléthore, qui se délivre de la souffrance des contrastes accumulés en lui-même. Le monde, l’objectivation libératrice de Dieu, perpétuellement et à tout instant consommée, en tant que vision éternellement changeante, éternellement nouvelle de celui qui porte en soi les plus grandes souffrances, les plus irréductibles conflits, les plus extrêmes contrastes, et qui ne peut s’en affranchir et se libérer que dans l’apparence ; toute cette métaphysique d’artiste peut être traitée d’arbitraire, de vaine, de fantaisiste, — l’essentiel est qu’elle trahit dès l’abord un esprit qui, à tout événement, décida de se mettre en garde contre l’interprétation et la portée morales de l’existence. Ici est proclamé, pour la première fois peut-être, un pessimisme « par delà le bien et le mal » ; ici cette « perversité du sentiment », contre laquelle Schopenhauer ne se lassa pas de lancer à l’avance ses imprécations et ses foudres, trouve son langage et sa formule, — une philosophie qui ose classer la morale elle-même dans le monde des apparences, qui ose la déclasser, et cela non seulement parmi les « apparences » (dans le sens de l’idéaliste terminus technicus), mais encore parmi les « illusions », comme simulacre, conjecture, préjugé, interprétation, parure, art. Peut-être la profondeur de cette tendance anti-morale peut-elle se mesurer le mieux au silence circonspect et hostile que l’on constate dans tout ce livre à l’égard du christianisme, — du christianisme, comme la plus extravagante variation sur le thème moral qu’il ait été donné à l’humanité d’entendre jusqu’à présent. En vérité, rien n’est plus complètement opposé à l’interprétation, à la justification purement esthétique du monde exposée ici, que la doctrine chrétienne, qui n’est et ne veut être que morale, et, avec ses principes absolus, par exemple avec sa véracité de Dieu, relègue l’art, tout art, dans l’empire du mensonge, c’est-à-dire le nie, le condamne, le maudit. Derrière une semblable façon de penser et d’apprécier qui, pour peu qu’elle soit sincère et logique, doit être fatalement hostile à l’art, je perçus aussi de tout temps l’hostilité à la vie, la répugnance rageuse et vindicative pour la vie même : car toute vie repose sur apparence, art, illusion, optique, nécessité de perspective et d’erreur. Le christianisme fut, dès l’origine, essentiellement et radicalement, satiété et dégoût de la vie pour la vie, qui se dissimulent, se déguisent seulement sous le travesti de la foi en une « autre » vie, en une vie « meilleure ». La haine du « monde », l’anathème aux passions, la peur de la beauté et de la volupté, un au-delà futur inventé pour mieux dénigrer le présent, au fond un désir de néant, de mort, de repos, jusqu’au « sabbat des sabbats », — tout cela, aussi bien que la prétention absolue du christianisme à ne tenir compte que des valeurs morales, me parut toujours la forme la plus dangereuse, la plus inquiétante d’une « volonté d’anéantissement », tout au moins un signe de lassitude morbide, de découragement profond, d’épuisement, d’appauvrissement de la vie, — car, au nom de la morale (en particulier de la morale chrétienne, c’est-à-dire absolue), nous devons toujours et inéluctablement donner tort à la vie, parce que la vie est quelque chose d’essentiellement immoral, — nous devons enfin étouffer la vie sous le poids du mépris et de l’éternelle négation, comme indigne d’être désirée et dénuée en soi de la valeur d’être vécue. La morale elle-même — quoi ? la morale ne serait-elle pas une « volonté de négation de la vie », un secret instinct d’anéantissement, un principe de ruine, de déchéance, de dénigrement, un commencement de fin ? et par conséquent le danger des dangers ?… C’est contre la morale que, dans ce livre, mon instinct se reconnut comme défenseur de la vie, et qu’il se créa une doctrine et une théorie de la vie absolument contraires, une conception purement artistique, anti-chrétienne. Comment la nommer ? Comme philologue et ouvrier dans l’art d’exprimer, je la baptisai, non sans quelque liberté, — qui pourrait dire le vrai nom de l’Antéchrist ? — du nom d’un dieu grec : je la nommai dionysienne.
6
On comprend à quel problème j’osai désormais m’attaquer dans ce livre ?… Combien je regrette maintenant de n’avoir pas eu le courage (ou l’immodestie) d’employer, pour des idées aussi personnelles et audacieuses, un langage personnel, — d’avoir péniblement cherché à exprimer, à l’aide de formules kantiennes et schopenhaueriennes, des opinions nouvelles et insolites qui étaient radicalement opposées à l’esprit comme au sentiment de Kant et de Schopenhauer ? Que pensait Schopenhauer de la tragédie ? « Ce qui donne au tragique un essor particulier vers le sublime — dit-il (Monde comme Volonté et comme Représentation, II, 495), — c’est la révélation de cette pensée, que le monde, la vie, ne peut nous satisfaire complètement, et par conséquent n’est pas digne que nous lui soyons attachés : c’est en cela que consiste l’esprit tragique, — il nous amène ainsi à la résignation. » Oh ! quel autre langage me tenait Dionysos ! Oh ! comme ce « résignationisme » était alors loin de moi ! — Mais il y a dans ce livre quelque chose de pire encore, et que je regrette beaucoup plus que d’avoir obscurci et défiguré par des formules schopenhaueriennes mes visions dionysiennes : c’est de m’être, en un mot, gâté le grandiose problème grec, tel qu’il s’était révélé à moi, par l’intrusion des choses modernes ! de m’être attaché à des espérances, là où il n’y avait rien à espérer, où tout indiquait trop clairement une fin ! d’avoir, à propos de la plus récente musique allemande, commencé à divaguer sur « l’âme allemande », comme si elle était justement sur le point de se découvrir et de se retrouver, — et cela à une époque où l’esprit allemand, qui, il y a peu de temps encore, avait possédé la volonté de dominer l’Europe, la force de diriger l’Europe, en arrivait, en guise de conclusion testamentaire, à l’abdication, et, sous le pompeux prétexte d’une fondation d’empire, évoluait vers la médiocrité, la démocratie et les « idées modernes » ! En effet, j’ai appris depuis à juger sans espoir et sans pitié cette « âme allemande », et avec elle l’actuelle musique allemande, comme étant d’outre en outre pur romantisme et la plus antihellénique de toutes les formes d’art imaginables : mais, par surcroît, une machine à détraquer les nerfs de premier ordre, deux fois dangereuses pour un peuple qui aime la boisson et honore l’obscurité comme une vertu, à cause de sa double propriété de narcotique qui produit l’ivresse et enveloppe l’esprit de nébuleuses vapeurs. — En laissant naturellement de côté toutes les espérances prématurées et les inopportunes applications aux choses actuelles, qui gâtèrent alors mon premier livre, le grand point d’interrogation dionysien, même en ce qui concerne la musique, reste toujours où je l’avais placé : que devrait être une musique dont le principe originel serait, non pas le romantisme, à l’exemple de la musique allemande, — mais l’esprit dionysien ?…
7
– Mais, cher monsieur, qu’a-t-on jamais entendu par romantisme si votre livre n’est pas romantique ? Est-il possible de pousser plus loin la haine du « temps présent », de la « réalité » et des « idées modernes » que vous ne l’avez fait dans votre métaphysique d’artiste — qui préfère croire au néant et même au diable plutôt qu’au « présent » ? Au-dessous de la polyphonie contrapuntique dont vous tentez de séduire nos oreilles ne gronde-t-il pas une basse fondamentale de colère et de destruction joyeuses ? une farouche résolution contre tout ce qui est « actuel », une volonté qui n’est certes pas très éloignée du nihilisme pratique, et qui semble dire : « Que rien ne soit vrai, plutôt que vous ayez raison, plutôt que triomphe votre vérité ! » Écoutez vous-même avec attention, monsieur le pessimiste adorateur de l’art, un seul passage, choisi dans votre livre, ce passage, nullement dénué d’éloquence, le « tueur de dragons », qui semble comme un piège insidieusement tendu aux jeunes esprits et aux jeunes cœurs. Quoi ? N’est-ce pas l’authentique et véritable profession de foi du romantisme de 1830, sous le masque du pessimisme de 1850 ? et derrière cette profession de foi n’entend-on pas préluder le finale consacré, en usage chez les romantiques, — rupture, écroulement, retour, et enfin prosternation à deux genoux devant une vieille foi, devant le Dieu ancien ?… Quoi ? votre livre de pessimiste n’est-il pas lui-même une œuvre de romantisme et d’antihellénisme, quelque chose « qui, à la fois, produit l’ivresse et obscurcit l’esprit » en tout cas, un narcotique, un morceau de musique, voire de musique allemande ? Mais qu’on en juge :
Figurons-nous une génération grandissant avec cette intrépidité du regard, avec cette impulsion héroïque vers le monstrueux, l’extraordinaire ; imaginons l’allure hardie de ce tueur de dragons, l’orgueilleuse témérité avec laquelle ces êtres tournent le dos aux enseignements débiles de l’optimisme, pour « vivre résolument » d’une vie pleine et complète : ne devait-il pas arriver nécessairement que l’expérience volontaire de l’énergie et de la terreur amenât l’homme tragique de cette civilisation à souhaiter un art nouveau, l’art de la consolation métaphysique, la tragédie, comme une Hélène à laquelle il avait droit, et à s’écrier avec Faust :
Et ne devais-je pas, avec une violence passionnée,
Faire naître à la vie la forme la plus divine ? »
« Cela ne devait-il pas arriver nécessairement ? »… Non, trois fois non ! Ô jeunes romantiques : cela ne devait pas arriver nécessairement ! Mais il est très vraisemblable que cela se termine ainsi, que vous finissez ainsi, c’est-à-dire « consolés », comme cela est écrit, en dépit de tous vos efforts pour connaître par vous-mêmes l’énergie et la terreur, « métaphysiquement consolés, » bref, ainsi que finissent les romantiques, chrétiennement… Non ! Il vous faudrait d’abord apprendre la consolation de ce côté-ci, — il vous faudrait apprendre à rire, mes jeunes amis, si toutefois vous vouliez absolument rester pessimistes ; peut-être bien qu’alors, sachant rire, vous jetteriez un jour au diable toutes les consolations métaphysiques, — et pour commencer la métaphysique elle-même ! Ou, pour employer le langage de ce monstre dionysien, qui a nom Zarathoustra :
« Élevez vos cœurs, mes frères, haut, plus haut ! Et n’oubliez pas non plus vos jambes ! Élevez aussi vos jambes, bons danseurs, et mieux que cela : vous vous tiendrez aussi sur la tête !
“Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : c’est moi-même qui me la suis mise sur la tête, j’ai canonisé moi-même mon rire. Je n’ai trouvé personne d’assez fort pour cela aujourd’hui.
‘Zarathoustra le danseur, Zarathoustra le léger, celui qui agite ses ailes, prêt au vol, faisant signe à tous les oiseaux, prêt et agile, divinement léger.
‘Zarathoustra le devin, Zarathoustra le rieur, ni impatient, ni intolérant, quelqu’un qui aime les sauts et les écarts ; je me suis moi-même placé cette couronne sur la tête !
‘Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : à vous, mes frères, je jette cette couronne ! J’ai canonisé le rire ; hommes supérieurs, apprenez donc — à rire !’
(Ainsi parlait Zarathoustra, IV, pp. 429-431.)
Sils-Maria, Haute-Engadine, août 1886.
1Comme volontaire dans le service des ambulances. H. A.
Préface à Richard Wagner
Pour écarter de ma pensée toutes les critiques, toutes les colères, tous les malentendus, dont les idées exposées dans cet ouvrage fourniront le prétexte à nos publicistes, étant donné le singulier caractère de l’esthétique contemporaine, et aussi pour écrire ces paroles d’introduction avec une félicité contemplative égale à celle dont chacune de ces pages porte l’empreinte, comme la cristallisation d’instants de bonheur et d’enthousiasme, je me représente par la pensée, mon ami hautement vénéré, le moment où vous recevrez cet écrit. Je vous vois, peut-être au retour d’une promenade du soir dans la neige d’hiver, considérer sur la première feuille de ce livre le Prométhée délivré 1, lire mon nom, et je sais qu’aussitôt vous êtes pénétré de cette conviction que, quel que puisse être le contenu de cet ouvrage, celui qui l’a fait avait à exprimer des choses graves et significatives ; et qu’aussi, en tout ce qu’il imagina, il se sentit en communication avec vous comme avec quelqu’un de réellement présent, et qu’il ne lui fut possible d’écrire que quelque chose qui répondît à cette présence réelle. Vous vous souviendrez, en outre, que c’est au moment même de l’apparition de l’écrit admirable consacré par vous à la mémoire de Beethoven que ces réflexions me préoccupèrent ; c’est-à-dire pendant les angoisses et les enthousiasmes de la guerre qui venait d’éclater. Cependant, ceux-là seraient dans l’erreur, qui songeraient, à propos de cet ouvrage à opposer l’exaltation patriotique à une sorte de libertinage esthétique, une vaillante énergie à une distraction insouciante. Bien plus, à la lecture de ce livre, il se pourrait qu’ils reconnussent avec surprise combien profondément allemand est le problème dont il est ici question, et combien il est légitime de le placer au milieu de nos espoirs allemands, dont il est l’axe et le pivot. Mais peut-être seront-ils plutôt scandalisés de ce qu’une aussi sérieuse attention soit accordée à un problème esthétique, s’ils sont vraiment incapables d’avoir de l’art une conception autre que celle d’un passe-temps agréable, d’un bruit de grelots dont se passerait volontiers « la gravité de l’existence » ; comme si personne ne savait ce qu’il faut entendre dans cette comparaison, par une « gravité de l’existence » de cette espèce. Pour la gouverne de ces personnes graves, je déclare que, d’après ma conviction profonde, l’art est la tâche la plus haute et l’activité essentiellement métaphysique de cette vie, selon la pensée de l’homme à qui je veux que cet ouvrage soit dédié, comme à mon noble compagnon d’armes et précurseur dans cette voie.
Bâle, fin 1871.
1Il nous a semblé inutile de reproduire ici cette petite vignette, d’ailleurs de fort mauvais goût — H. A.
L’Origine de la Tragédie
1
Nous aurons fait un grand pas en ce qui concerne la science esthétique, quand nous en serons arrivés non seulement à l’induction logique, mais encore à la certitude immédiate de cette pensée : que l’évolution progressive de l’art est le résultat du double caractère de l’esprit apollinien et de l’esprit dionysien, de la même manière que la dualité des sexes engendre la vie au milieu de luttes perpétuelles et par des rapprochements seulement périodiques. Ces noms, nous les empruntons aux Grecs qui ont rendu intelligible au penseur le sens occulte et profond de leur conception de l’art, non pas au moyen de notions, mais à l’aide des figures nettement significatives du monde de leurs dieux. C’est à leurs deux divinités des arts, Apollon et Dionysos, que se rattache notre conscience de l’extraordinaire antagonisme, tant d’origine que de fins, qui exista dans le monde grec entre l’art plastique apollinien et l’art dénué de formes, la musique, l’art de Dionysos. Ces deux instincts impulsifs s’en vont côte à côte, en guerre ouverte le plus souvent, et s’excitant mutuellement à des créations nouvelles, toujours plus robustes, pour perpétuer par elles le conflit de cet antagonisme que l’appellation « art », qui leur est commune, ne fait que masquer, jusqu’à ce qu’enfin, par un miracle métaphysique de la « Volonté » hellénique, ils apparaissent accouplés, et que, dans cet accouplement, ils engendrent alors l’œuvre à la fois dionysienne et apollinienne de la tragédie attique.
Figurons-nous tout d’abord, pour les mieux comprendre, ces deux instincts comme les mondes esthétiques différents du rêve et de l’ivresse, phénomènes physiologiques entre lesquels on remarque un contraste analogue à celui qui distingue l’un de l’autre l’esprit apollinien et l’esprit dionysien. C’est dans le rêve que, suivant l’expression de Lucrèce, les splendides images des dieux se manifestèrent pour la première fois à l’âme des hommes, c’est dans le rêve que le grand sculpteur perçut les proportions divines de créatures surhumaines, et le poète hellène, interrogé sur les secrets créateurs de son art, eût évoqué lui aussi le souvenir du rêve et répondu comme Hans Sachs dans les Maîtres Chanteurs :
Ami, l’ouvrage véritable du poète
Est de noter et de traduire ses rêves.
Croyez-moi, l’illusion la plus sûre de l’homme,
S’épanouit pour lui dans le rêve :
Tout l’art des vers et du poète
N’est que l’expression de la vérité du rêve.
L’apparence pleine de beauté des mondes du rêve, dans la production desquels tout homme est un artiste complet, est la condition préalable de tout art plastique, et certainement aussi, comme nous le verrons, d’une partie essentielle de la poésie. Nous éprouvons de la jouissance à la compréhension immédiate de la forme, toutes les formes nous parlent, nulle n’est indifférente, aucune n’est inutile. Et pourtant la vie la plus intense de cette réalité de rêve nous laisse encore le sentiment confus qu’elle n’est qu’une apparence. C’est du moins le résultat de ma propre expérience et je pourrais citer maints témoignages et aussi les déclarations des poètes pour montrer combien cette impression est normale et répandue. L’homme doué d’un esprit philosophique à même le pressentiment que, derrière la réalité dans laquelle nous existons et vivons, il s’en cache une autre toute différente, et que, par conséquent, la première n’est, elle aussi, qu’une apparence ; et Schopenhauer définit formellement, comme étant le signe distinctif de l’aptitude philosophique, la faculté pour certains de se représenter parfois les hommes et toutes les choses comme de purs fantômes, des images de rêve. Eh bien, l’homme doué d’une sensibilité artistique se comporte à l’égard de la réalité du rêve de la même manière que le philosophe en face de la réalité de l’existence ; il l’examine minutieusement et volontiers ; car, dans ces tableaux, il découvre une interprétation de la vie ; à l’aide de ces exemples, il s’exerce pour la vie. Ce ne sont pas seulement, comme on pourrait croire, les images agréables et plaisantes qu’il retrouve en soi-même avec cette absolue lucidité : le sévère, le sombre, le triste, le sinistre, les obstacles soudains, les railleries du hasard, les attentes angoissées, en un mot toute la Divine Comédie de la vie, avec son Inferno, se déroule aussi devant lui, non pas seulement comme un spectacle de fantômes, d’ombres, — car, ces scènes, il les vit et les souffre, — et cependant sans qu’il puisse écarter tout à fait cette impression fugitive qu’elles ne sont qu’une apparence. Et peut-être quelques-uns se souviendront comme moi de s’être écrié, en se rassurant au milieu des périls et des terreurs d’un rêve : « C’est un rêve ! Je ne veux pas qu’il cesse ! Je veux le rêver encore ! » J’ai entendu dire aussi que certaines personnes possédaient la faculté de prolonger la causalité d’un seul et même rêve pendant trois nuits successives et plus. Ces faits attestent avec évidence que notre nature la plus intime, l’arrière-fond commun de nous tous, trouve dans le rêve un plaisir profond et une joie nécessaire.
De même les Grecs ont représenté sous la figure de leur Apollon ce désir joyeux du rêve : Apollon, en tant que dieu de toutes les facultés créatrices de formes, est en même temps le dieu divinateur. Lui qui, d’après son origine, est « l’apparence » rayonnante, la divinité de la lumière, il règne aussi sur l’apparence pleine de beauté du monde intérieur de l’imagination. La vérité plus haute, la perfection de ce monde, opposées à la réalité imparfaitement intelligible de tous les jours, enfin la conscience profonde de la réparatrice et salutaire nature du sommeil et du rêve, sont symboliquement l’analogue, à la fois, de l’aptitude à la divination, et des arts en général, par lesquels la vie est rendue possible et digne d’être vécue. Mais elle ne doit pas manquer à l’image d’Apollon, cette ligne délicate que la vision perçue dans le rêve ne saurait franchir sans que son effet ne devienne pathologique, et qu’alors l’apparence ne nous donne l’illusion d’une grossière réalité ; je veux dire cette pondération, cette libre aisance dans les émotions les plus violentes, cette sereine sagesse du dieu de la forme. Conformément à son origine, son regard doit être « rayonnant comme le soleil » ; même alors qu’il exprime le souci ou la colère, le reflet sacré de la vision de beauté n’en doit pas disparaître. Et l’on pourrait ainsi appliquer à Apollon, dans un sens excentrique, les paroles de Schopenhauer sur l’homme enveloppé du voile de Maïa (Monde comme Volonté et comme Représentation, I, 416) : « Comme un pêcheur dans un esquif, tranquille et plein de confiance en sa frêle embarcation, au milieu d’une mer démontée qui, sans bornes et sans obstacles, soulève et abat en mugissant des montagnes de flots écumants, l’homme individuel, au milieu d’un monde de douleurs, demeure impassible et serein, appuyé avec confiance sur le principium individuationis ». Oui, on pourrait dire que l’inébranlable confiance en ce principe et la calme sécurité de celui qui en est pénétré ont trouvé dans Apollon leur expression la plus sublime, et on pourrait même reconnaître en Apollon l’image divine et splendide du principe d’individuation, par les gestes et les regards de laquelle nous parlent toute la joie et la sagesse de « l’apparence », en même temps que sa beauté.
À la même page, Schopenhauer nous a dépeint l’épouvantable horreur qui saisit l’homme, dérouté soudain par les formes apparentes des phénomènes, alors que le principe de causalité, dans une de ses manifestations quelconques, semble souffrir une exception. Si, outre cette horreur, nous considérons l’extase transportée qui, devant cet effondrement du principe d’individuation, s’élève du plus profond de l’homme, du plus profond de la nature elle-même, alors nous commençons à entrevoir en quoi consiste l’état dionysiaque, que nous comprendrons mieux encore par l’analogie de l’ivresse. C’est par la puissance du breuvage narcotique que tous les hommes et tous les peuples primitifs ont chanté dans leurs hymnes, ou bien par la force despotique du renouveau printanier pénétrant joyeusement la nature entière, que s’éveille cette exaltation dionysienne qui entraîne dans son essor l’individu subjectif jusqu’à l’anéantir en un complet oubli de soi-même. Encore pendant le moyen âge allemand, des multitudes toujours plus nombreuses tournoyèrent sous le souffle de cette même puissance dionysiaque, chantant et dansant, de place en place : dans ces danseurs de la Saint-Jean et de la Saint-Guy nous reconnaissons les chœurs bachiques des Grecs, dont l’origine se perd, à travers l’Asie Mineure, jusqu’à Babylone et jusqu’aux orgies sacéennes. Il est des gens qui, par ignorance ou étroitesse d’esprit, se détournent de semblables phénomènes, comme ils s’écarteraient de « maladies contagieuses », et, dans la sûre conscience de leur propre santé, les raillent ou les prennent en pitié. Les malheureux ne se doutent pas de la pâleur cadavérique et de l’air de spectre de leur « santé », lorsque passe devant eux l’ouragan de vie ardente des rêveurs dionysiens.
Ce n’est pas seulement l’alliance de l’homme avec l’homme qui est scellée de nouveau sous le charme de l’enchantement dionysien : la nature aliénée, ennemie ou asservie, célèbre elle aussi sa réconciliation avec son enfant prodigue, l’homme. Spontanément, la terre offre ses dons, et les fauves des rochers et du désert s’approchent pacifiques. Le char de Dionysos disparaît sous les fleurs et les couronnes : des panthères et des tigres s’avancent sous son joug. Que l’on métamorphose en tableau l’hymne à la « joie » de Beethoven, et, donnant carrière à son imagination, que l’on contemple les millions d’êtres prosternés frémissants dans la poussière : à ce moment l’ivresse dionysienne sera proche. Alors l’esclave est libre, alors se brisent toutes les barrières rigides et hostiles que la misère, l’arbitraire ou la « mode insolente » ont établies entre les hommes. Maintenant, par l’évangile de l’harmonie universelle, chacun se sent, avec son prochain, non seulement réuni, réconcilié, fondu, mais encore identique en soi, comme si s’était déchiré le voile de Maïa, et comme s’il n’en flottait plus que des lambeaux devant le mystérieux Un-primordial. Chantant et dansant, l’homme se manifeste comme membre d’une communauté supérieure : il a désappris de marcher et de parler, et est sur le point de s’envoler à travers les airs, en dansant. Ses gestes décèlent une enchanteresse béatitude. De même que maintenant les animaux parlent, et que la terre produit du lait et du miel, la voix de l’homme, elle aussi, résonne comme quelque chose de surnaturel : il se sent Dieu ; maintenant son allure est aussi noble et pleine d’extase que celle des dieux qu’il a vus dans ses rêves. L’homme n’est plus artiste, il est devenu œuvre d’art : la puissance esthétique de la nature entière, pour la plus haute béatitude et la plus noble satisfaction de l’Un-primordial, se révèle ici sous le frémissement de l’ivresse. La plus noble argile, le marbre le plus précieux, l’homme, est ici pétri et façonné ; et, aux coups du ciseau de l’artiste des mondes dionysiens, répond le cri des Mystères d’Éleusis : « Vous tombez prosternés à genoux, millions d’êtres ? Monde, pressens-tu le Créateur ? 1 »
2
Nous avons jusqu’à présent considéré l’esprit apollinien et son contraire, l’esprit dionysien, comme des forces artistiques qui jaillissent du sein de la nature elle-même, sans l’intermédiaire de l’artiste humain, des forces par lesquelles les instincts d’art de la nature s’assouvissent tout d’abord et directement : d’une part, comme le monde d’images du rêve, dont la perfection ne dépend aucunement de la valeur intellectuelle ou de la culture artistique de l’individu, d’autre part, comme une réalité pleine d’ivresse qui, à son tour, ne se préoccupe pas de l’individu, poursuit même l’anéantissement de l’individu et sa dissolution libératrice par un sentiment d’identification mystique. Par rapport à ces phénomènes artistiques immédiats de la nature, tout artiste est un « imitateur », c’est-à-dire soit l’artiste du rêve apollinien, soit l’artiste de l’ivresse dionysienne, ou enfin, — par exemple dans la tragédie grecque, — à la fois l’artiste de l’ivresse et l’artiste du rêve. C’est comme tel que nous devons le considérer, quand, exalté par l’ivresse dionysiaque jusqu’au mystique renoncement de soi-même, il s’affaisse solitaire, à l’écart des chœurs en délire, et qu’alors, par la puissance du rêve apollinien, son propre état, c’est-à-dire son unité, son identification avec les forces primordiales les plus essentielles du monde, lui est révélé dans une vision symbolique.
Après ces prémisses et ces considérations générales, cherchons à reconnaître à quel degré et dans quelle mesure ces instincts d’art de la nature ont été développés chez les Grecs : nous nous trouverons par là en état de comprendre et d’apprécier plus profondément le rapport de l’artiste grec avec ses modèles primordiaux, ou, suivant l’expression d’Aristote, « l’imitation de la nature ». On ne peut guère émettre que des hypothèses au sujet des rêves des Grecs, malgré toute la littérature spéciale et les nombreuses anecdotes qui s’y rapportent ; cependant on peut le faire avec une certaine sécurité : en présence de la précision et de la sûreté de leur vision plastique, unies à leur évidente et sincère passion de la couleur, on ne pourra se défendre, à la confusion de tous ceux qui naquirent plus tard, de supposer pour leurs rêves aussi une causalité logique des lignes et des contours, des couleurs et des groupes, un enchaînement des scènes rappelant leurs meilleurs bas-reliefs, dont la perfection et l’incomparable beauté nous autoriseraient certainement, si une comparaison était possible, à qualifier d’Homères les Grecs rêvant, et de Grec rêvant, Homère lui-même : et cela avec une signification plus profonde que si l’homme moderne osait, à propos de ses rêves, se comparer à Shakespeare.
En revanche, nous n’avons plus besoin de former des conjectures pour dévoiler l’immense abîme qui sépare les Grecs dionysiens des barbares dionysiens. De tous les confins du vieux monde, — pour ne pas parler ici du nouveau, — de Rome jusqu’à Babylone, nous viennent les témoignages de l’existence de fêtes dionysiennes, dont les spécimens les plus élevés sont, au regard des fêtes dionysiennes grecques, ce que le satyre barbu empruntant au bouc son nom et ses attributs est à Dionysos lui-même. Presque partout l’objet de ces réjouissances est une licence sexuelle effrénée, dont le flot exubérant brise les barrières de la consanguinité et submerge les lois vénérables de la famille : c’est vraiment la plus sauvage bestialité de la nature qui se déchaîne ici, en un mélange horrible de jouissance et de cruauté, qui m’est toujours apparu comme le véritable « philtre de Circé ». Contre la fièvre et la frénésie de ces fêtes qui pénétrèrent jusqu’à eux par tous les chemins de la terre et des eaux, les Grecs semblent avoir été défendus et victorieusement protégés pendant quelque temps par l’orgueilleuse image d’Apollon, à laquelle la tête de Méduse était incapable d’opposer une force plus dangereuse que cette grotesque et brutale violence dionysienne. C’est dans l’art dorique que s’est éternisée cette attitude de majesté dédaigneuse d’Apollon. Mais lorsqu’enfin des racines les plus profondes de l’hellénisme se déchaînèrent de semblables instincts, la résistance devint plus difficile, et même impossible. L’action du dieu de Delphes se borna alors à arracher des mains de son redoutable ennemi, par une alliance opportune, ses armes meurtrières. Cette alliance est le moment le plus important de l’histoire du culte grec : de quelque côté que l’on regarde, on constate les bouleversements produits par cet événement. Ce fut la réconciliation de deux adversaires, avec la rigoureuse délimitation des lignes frontières que chacun, dorénavant, ne devait plus dépasser, et avec des échanges périodiques et solennels de présents ; au fond, l’abîme ne fut pas comblé. Mais si nous examinons comment, sous l’influence de cette paix finale, se manifesta la puissance dionysienne, nous reconnaîtrons dans les orgies dionysiaques des Grecs, en les comparant à la déchéance de l’homme au tigre et au singe des Sakhées babyloniennes, la signification de fêtes de rédemption libératrice du monde et de jours de transfiguration. Avec elles, pour la première fois, le joyeux délire de l’art envahit la nature ; pour la première fois, par elles, la destruction du principe d’individuation devient un phénomène artistique. L’exécrable philtre de jouissance et de cruauté devint impuissant : seul le singulier mélange qui forme le double caractère des émotions des rêveurs dionysiens en évoque le souvenir, — comme un baume salutaire rappelle le poison meurtrier, — je veux dire ce phénomène de la souffrance suscitant le plaisir, de l’allégresse arrachant des accents douloureux. De la plus haute joie jaillit le cri de l’horreur ou la plainte brûlante d’une perte irréparable. À travers ces fêtes grecques passe comme un soupir sentimental de la nature gémissant sur son morcellement en individus. Le chant et la mimique de ces rêveurs à l’âme hybride étaient pour le monde grec homérique quelque chose de nouveau et d’inouï : et en particulier, la musique dionysienne faisait naître en eux l’effroi et le frisson. Si la musique, en apparence, était déjà connue comme art apollinien, à y regarder de près, elle ne possédait cependant ce caractère qu’en qualité de battement cadencé des ondes du rythme, dont la puissance plastique eût été développée jusqu’à la représentation d’impressions apolliniennes. La musique d’Apollon était une architectonique sonore d’ordre dorique, mais dont les sons étaient fixés par avance, tels ceux des cordes de la cithare. Comme non apollinien, en fut soigneusement écarté cet élément qui est l’essence même de la musique dionysienne et de toute musique, la violence émouvante du son, le torrent unanime du mélos et le monde incomparable de l’harmonie. Dans le dithyrambe dionysien, l’homme est entraîné à l’exaltation la plus haute de toutes ses facultés symboliques ; il ressent et veut exprimer des sentiments qu’il n’a jamais éprouvés jusqu’alors : le voile de Maïa s’est déchiré devant ses yeux ; comme génie tutélaire de l’espèce, de la nature elle-même, il est devenu l’Un-absolu. Désormais, l’essence de la nature doit s’exprimer symboliquement ; un nouveau monde de symboles est nécessaire, toute la symbolique corporelle enfin ; non seulement la symbolique des lèvres, du visage, de la parole, mais encore toutes les attitudes et les gestes de la danse, rythmant les mouvements de tous les membres. Alors, avec une véhémence soudaine, les autres forces symboliques, celles de la musique, s’accroissent en rythme, dynamique et harmonie. Pour comprendre ce déchaînement simultané de toutes les forces symboliques, l’homme doit avoir atteint déjà ce haut degré de renoncement qui veut se proclamer symboliquement dans ces forces : l’adepte dithyrambique de Dionysos n’est plus alors compris que de ses pairs ! Avec quelle stupéfaction dut le considérer le Grec apollinien ! Avec une stupéfaction qui fut d’autant plus profonde qu’un frisson s’y mêlait à cette pensée, que tout cela n’était cependant pas si étranger à sa propre nature ; oui, que sa conscience apollinienne n’était qu’un voile qui lui cachait ce monde dionysien.
3
Pour comprendre cela, il nous faut démolir en quelque sorte pierre à pierre le merveilleux édifice de la culture apollinienne, jusqu’à ce que nous apercevions les fondations sur lesquelles il est établi. Nous apercevons tout d’abord, dressées sur le fronton de ce temple, les figures majestueuses des dieux olympiens, dont les exploits, rayonnant au loin dans leurs reliefs de marbre, font l’ornement de ses frises. Que l’image d’Apollon se rencontre parmi les autres, comme une divinité au milieu de divinités égales, et qui ne prétend point au rang suprême, ceci ne doit pas nous égarer. Le même instinct qui se personnifia dans Apollon engendra aussi en réalité tout ce monde olympien, dont, en ce sens, Apollon peut être considéré comme le père. Quel besoin inouï, quelle imprescriptible nécessité fit naître ce monde lumineux de créatures olympiennes ?
Quiconque, ayant au cœur une autre religion, approche de ces Olympiens, en quête d’élévation morale, de sainteté, d’immatérielle spiritualité, et cherche en leurs regards l’amour et la pitié, devra bientôt se détourner d’eux, irrité et déçu. Ici, rien ne rappelle l’ascétisme, l’immatérialité ou le devoir : c’est une vie exubérante, triomphante, dans laquelle tout, le bien comme le mal, est également divinisé. Et devant ce fantastique débordement de vitalité, l’observateur demeure interdit et se demande à quel philtre enchanté ces hommes follement joyeux ont pu puiser cette vivifiante ivresse, pour que, de quelque côté qu’ils regardent, leur apparaisse Hélène au doux sourire « planant comme le voluptueux symbole », l’image idéale de leur propre existence. Cependant, nous devons crier à ce contemplateur désenchanté : « Ne t’éloigne pas ; mais écoute d’abord ce que raconte la sagesse populaire des Grecs au sujet de cette vie même, qui se déroule devant toi avec une aussi inexplicable sérénité. D’après l’antique légende, le roi Midas poursuivit longtemps dans la forêt le vieux Silène, compagnon de Dionysos, sans pouvoir l’atteindre. Lorsqu’il eut enfin réussi à s’en emparer, le roi lui demanda quelle était la chose que l’homme devrait préférer à toute autre et estimer au-dessus de tout. Immobile et obstiné, le démon restait muet, jusqu’à ce qu’enfin, contraint par son vainqueur, il éclata de rire et laissa échapper ces paroles : « Race éphémère et misérable, enfant du hasard et de la peine, pourquoi me forces-tu à te révéler ce qu’il vaudrait mieux pour toi ne jamais connaître ? Ce que tu dois préférer à tout, c’est pour toi l’impossible : c’est de n’être pas né, de ne pas être, d’être néant. Mais, après cela, ce que tu peux désirer de mieux, — c’est de mourir bientôt. »
Qu’est le monde des dieux olympiens au regard de cette sagesse populaire ? C’est la vision pleine d’extase du martyr torturé, opposée à ses supplices.
Maintenant la montagne enchantée de l’Olympe s’entr’ouvre devant nos yeux, et nous en découvrons les assises. Le Grec connut et ressentit les angoisses et les horreurs de l’existence : pour qu’il lui fût possible de vivre, il lui fallut l’évocation de cette protectrice et éblouissante splendeur du rêve olympien. Ce trouble extraordinaire en face des puissances titaniques de la nature, cette Moire trônant sans pitié au-dessus de toute connaissance, ce vautour du grand ami de l’humanité, Prométhée, cet horrible destin du sage Œdipe, cette malédiction de la race des Atrides, qui contraint Oreste au meurtre de sa mère, en un mot toute cette philosophie du dieu des forêts avec les mythes qui s’y rattachent, cette philosophie dont périrent les sombres Étrusques, — tout cela fut, perpétuellement et sans trêve, terrassé, vaincu par les Grecs, tout au moins voilé et écarté de leur regard, à l’aide de ce monde intermédiaire et esthétique des dieux olympiens. Pour pouvoir vivre, il fallut que les Grecs, poussés par la plus impérieuse des nécessités, créassent ces dieux ; et nous pouvons nous représenter cette évolution par le spectacle de la primitive théogonie titanique de l’effroi, se transformant sous l’impulsion de cet instinct de beauté apollinienne, et devenant, par d’insensibles transitions, la théogonie de la joie olympienne, — ainsi que d’un buisson d’épines naissent des roses. Comment ce peuple aux émotions si délicates, aux désirs si impétueux, ce peuple si exceptionnellement idoine à la douleur, aurait-il pu supporter l’existence, s’il n’en avait contemplé dans ses dieux l’image plus pure et radieuse. Ce même instinct, qui réclame l’art dans la vie, comme l’ornement, le couronnement de l’existence, comme le charme qui nous entraîne à continuer de vivre, engendra aussi le monde olympien, qui fut pour la « Volonté » hellénique le miroir où sa propre image se reflétait transfigurée. Ainsi les dieux, en la vivant eux-mêmes, justifient la vie humaine, — unique théodicée satisfaisante ! Au clair soleil de ces dieux de lumière, l’existence apparaît comme digne en soi de l’effort de la vivre, et la véritable douleur des hommes homériques est alors d’être privés de cette existence et, avant tout, de penser à la mort prochaine ; de sorte qu’on peut dire maintenant, en renversant la sentence de Silène, que, « pour eux, la pire des choses est une mort rapide et, en second lieu, de devoir mourir un jour ». Après que, pour la première fois, la plainte a retenti, elle jaillit de nouveau des lèvres d’Achille aux brèves années, elle s’élève de la multitude errante des races humaines semblables aux feuilles dispersées au gré du vent, son écho remplit le déclin de l’âge héroïque. Il n’est pas indigne des plus grands héros de désirer conserver la vie, même au prix d’un travail d’esclave. Sous l’influence apollinienne, la « Volonté » désire si violemment cette existence, l’homme homérique s’identifie si complètement avec elle, que sa plainte elle-même se transforme en un hymne à la vie.