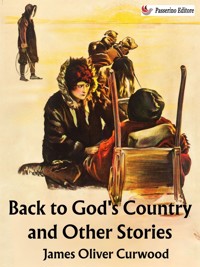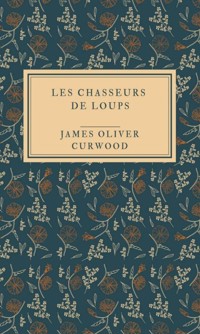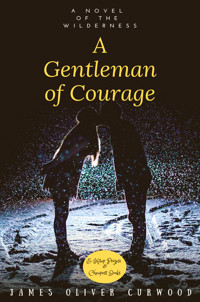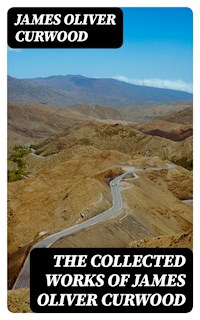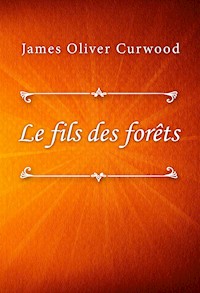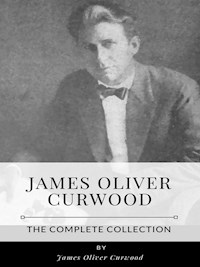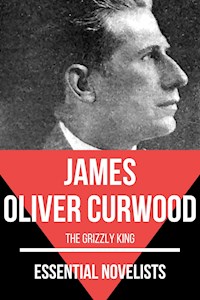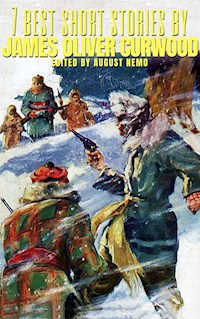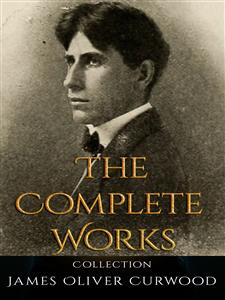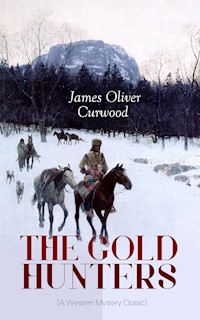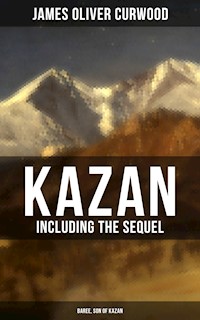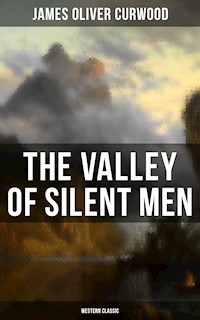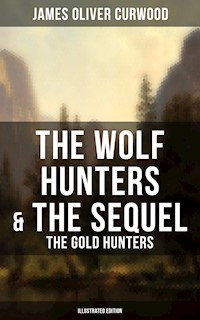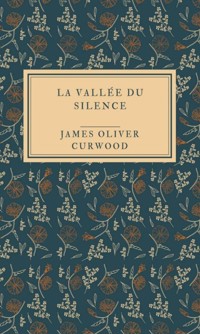
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il ne restait plus l'ombre d'un doute dans la pensée de James Grenfell Kent : il savait qu'il était perdu. Son ami, le médecin Cardigan, en qui il avait toute confiance, lui avait dit que le temps qui lui restait à vivre pouvait être mesuré en heures, ou en minutes, ou même en secondes. Son cas était peu banal, ne lui laissant qu'une chance sur cinquante de vivre deux ou trois jours, mais sûrement pas davantage. La science chirurgicale et médicale se prononçait ainsi d'après des cas similaires. Pourtant Kent n'avait pas la sensation d'une mort prochaine. Sa vue et ses idées étaient claires. Il ne souffrait pas. Sauf à de rares instants, sa température demeurait normale. Sa voix était particulièrement naturelle et calme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA VALLÉE DU SILENCE
(The Valley of silent Men)
PARJAMES-OLIVER CURWOOD
TEXTE FRANÇAIS DE LOUIS POSTIF
LA VALLÉE DU SILENCE
CHAPITRE II L’AMI O’CONNOR
CHAPITRE IV LE PRÉSENT ET LE PASSÉ
CHAPITRE V LA VISITEUSE
CHAPITRE VII L’AMOUR DE LA VIE
CHAPITRE VIII KENT REPREND DES FORCES
CHAPITRE IX LA FUITE INTERROMPUE
CHAPITRE X L’IRONIE DU SORT
CHAPITRE XI « DOIGTS-SALES »
CHAPITRE XII LE RETOUR DE MARETTE
CHAPITRE XIV CE QUE FEMME VEUT
CHAPITRE XVII LE COMBAT DE L’HONNEUR
CHAPITRE XX KENT ET MAC TRIGGER
CHAPITRE XXI DE LA COUPE AUX LÈVRES
CHAPITRE XXIV A TRAVERS LE PAYS DU SOUFRE
CHAPITRE XXVI LA VENGEANCE DE DONALD
CHAPITRE XXVII A LA LUEUR DES ÉTOILES
LA VALLÉE DU SILENCE
PROLOGUE
Avant que les minces rubans d’acier du chemin de fer eussent frayé leur route à travers les solitudes, le port d’Athabasca était le seuil pittoresque sur lequel devait poser le pied quiconque entrait dans le mystère de l’aventure du Grand Nord Blanc. On l’appelle encore Iskwatam, la « porte », porte qui s’ouvre vers les sources de l’Athabasca, l’Esclave et le Mackenzie. Il est très difficile de trouver Iskwatam sur la carte. Il y figure cependant. On ne pourrait l’oublier, car son histoire marque dans la vie des hommes une période de plus de cent quarante ans de romans tragiques et d’aventures.
Il est situé sur la vieille piste, à environ cent cinquante milles au nord d’Edmonton. La voie ferrée l’a rapprochée de ce centre de civilisation ; mais, derrière lui, les terres sauvages hurlent encore comme elles ont hurlé pendant mille ans et les eaux du continent roulent vers le nord pour se jeter dans l’océan Arctique. Il est possible que les beaux rêves des spéculateurs en terrains deviennent des réalités, car les plus avides de tous les aventuriers du monde, les assoiffés d’or, y sont venus, avec machines à écrire et sténographes, par le chemin de fer trépidant aux luxueux wagons-lits ; ils y sont venus pratiquer l’art de la réclame imprimée et la loi de l’Or, vendant les parcelles de terre à des acquéreurs pleins d’espoir qui habitent à plusieurs milliers de milles de là. « Refaites les autres comme ils vous referaient », telle est leur devise.
Avec la voie ferrée se sont introduites les légitimes affaires du troc et du commerce comprenant les trésors de ce Nord immense qui va des grands rapides de l’Athabasca jusqu’aux côtes de la mer Polaire. Mais plus belle encore que les rêves de fortunes réalisés en quelques semaines, règne, au fond des forêts, la croyance superstitieuse voulant que les esprits des malheureux qui ont péri dans les solitudes fuient à mesure que l’acier et la vapeur s’avancent. Les spectres de Pierre et de Jacqueline se seraient péniblement levés de leur tombeaux à Athabasca Landing[1] à la recherche d’une terre paisible encore plus au Nord.
[1] Autrement dit « Débarcadère de l’Athabasca ».
Ainsi les mains de Pierre et de Jacqueline, d’Henri et de Marie, de Jacques et de sa femme, ces mains brunies qui ont œuvré dans la contrée sauvage, gouvernent encore cette contrée au nord, à plusieurs milliers de milles d’Athabasca Landing, tandis qu’au sud les machines soufflantes traînent sur terre les marchandises qui, voilà quelques mois seulement, arrivaient par bateaux.
C’est sur le seuil d’Athabasca que les yeux sombres de Pierre et de Jacqueline, d’Henri et de Marie, de Jacques et de sa femme plongent dans les yeux bleus et gris, et humides parfois, d’une civilisation dévastatrice. C’est là aussi que le cri strident d’une locomotive folle de vitesse vient troubler les chansons séculaires du fleuve ; la fumée du charbon, flotte au-dessus de la forêt ; le phonographe grésille une réponse au violon ; et Pierre et Henri et Jacques ne se sentent plus les maîtres du monde quand ils arrivent des contrées lointaines avec leurs précieuses cargaisons de fourrures. Ils ne racontent plus, d’un air important et à voix vibrante, leurs aventures ; ils ne chantent plus leurs chansons sauvages avec le même entrain qu’autrefois, car maintenant il y a des rues à Athabasca Landing, des hôtels, des écoles, des lois et des règlements d’un nouveau genre, insupportables aux vieux voyageurs intrépides.
Oui, hier encore, le chemin de fer n’y était pas : un vaste monde désert s’étendait entre le Landing et la limite supérieure de la civilisation. Lorsque, pour la première fois, on raconta qu’une chose à vapeur perçait son chemin pas à pas à travers la forêt et le marécage infranchissables, cette nouvelle se transmit en amont et en aval des cours d’eaux sur une étendue de deux mille milles, comme une farce prodigieuse, une drôlerie stupéfiante, la fantaisie la plus cocasse que Pierre et Henri eussent jamais entendue. Au reste, quand Jacques voulait alors signifier à Pierre qu’il n’ajoutait pas foi à une de ses affirmations, il avait coutume d’employer ce dicton :
— Cela arrivera, M’sieu, quand la chose à vapeur viendra au Landing, quand les vaches paîtront avec l’élan, quand on récoltera le pain sur ces marais, là-bas.
Et la chose à vapeur fit son apparition, et les vaches broutèrent où avaient pâturé les élans, et l’on cultiva le blé au bord des grands marécages. C’est ainsi que la civilisation pénétra dans l’Athabasca Landing.
Le domaine des riverains s’étendait à deux milles au-delà du Port ; et le Landing, qui possédait seulement deux cent vingt-sept âmes avant l’installation du chemin de fer, devint la chambre de compensation, c’est-à-dire le centre d’échanges, de toute la contrée sauvage. Là venaient du Sud les marchandises que réclamait le Nord ; sur les rives plates du Landing on construisait de grandes péniches qui devaient transporter les marchandises au bout de la terre. De ce port partait pour de longues aventures la plus importante des flottes fluviales, et l’année suivante revenaient de petites péniches et de grandes pirogues chargées de fourrures.
C’est ainsi que, durant près d’un siècle et demi, de grands navires, filant à toute vitesse avec leurs équipages bruyants, descendaient le fleuve vers l’océan Arctique, tandis que de légères embarcations, emmenant des équipages non moins tapageurs, remontaient vers la civilisation le cours du fleuve Athabasca. Le cours supérieur de ce fleuve géant se perd dans les montagnes de la Colombie britannique, et l’on sait que les explorateurs Baptiste et Mac Leod moururent en voulant essayer de découvrir sa source. Après avoir passé le Landing, il s’en va lentement et majestueusement tout droit vers la mer Polaire. C’est sur l’Athabasca que s’engagent les flottes fluviales. Pour Pierre, Henri et Jacques, jusqu’à l’autre monde.
Où finit l’Athabasca commence l’Esclave qui se jette dans le grand lac de l’Esclave et, de la bande étroite de ce lac, le Mackenzie poursuit sa route jusqu’à la mer sur une distance de plus de mille kilomètres.
Sur cette longue piste d’eau, on voit et on entend beaucoup de choses. C’est la vie. C’est l’aventure. C’est le mystère, le romanesque et le hasard. Ces histoires sont si nombreuses qu’elles ne pourraient être contenues dans une bibliothèque. Elles sont écrites sur le visage des hommes et des femmes. Elles sont enfouies dans des tombes si vieilles que les arbres de la forêt ont poussé dessus. Épopées tragiques, contes d’amour, drames de la lutte pour la vie. Et plus on avance vers le nord, plus variées sont ces histoires.
Car le monde est inconstant, les climats aussi, et de même les races des hommes. Au Landing, au mois de juillet, il y a dix-sept heures de jour ; à Fort-Chippewyan, on en compte dix-huit ; à Fort-Résolution, Fort-Simpson et Fort-Providence, dix-neuf ; au Grand-Ours, vingt et une et à Fort-Mac-Pherson, tout près de la mer Polaire, de vingt et une à vingt-trois. Et en décembre, il y a autant d’heures d’obscurité.
Avec la lumière et les ténèbres, les hommes, les femmes et la vie changent. Mais Pierre, Henri et Jacques s’habituent à ces changements ; ils restent toujours les mêmes, chantant leurs anciennes romances, gardant au fond d’eux-mêmes les mêmes amours, caressant les mêmes rêves et adorant les mêmes dieux. Ils affrontent des milliers de périls et leurs yeux brillent toujours d’amour pour l’aventure.
Le tonnerre des cataractes et les grondements de l’orage ne les effrayent pas. Ils ne craignent pas la mort. Ils la saisissent à bras le corps, luttent joyeusement avec elle et sont fiers de l’avoir vaincue. Leur sang rouge est riche ; leur cœur est grand. Leur âme s’exalte vers le ciel. Cependant ils sont naïfs comme des enfants, et n’ont peur que des mêmes choses que redoutent les enfants. Dans leurs veines coule souvent un sang royal, car beaucoup de princes, de fils de princes et de nobles Français furent les premiers gentilshommes aventuriers qui vinrent avec des manchettes aux poignets et la rapière au côté, il y a de cela deux cent cinquante ans, pour chercher des fourrures qui valaient plusieurs fois leur pesant d’or. C’est de ceux-là que descendent la plupart des Pierre, Henri et Jacques avec leurs Marie, Jeanne et Jacqueline.
Leurs voix répètent beaucoup d’histoires. Parfois, elles les chuchotent doucement comme des brises ; car il y a des faits sinistres et étranges qui doivent être prononcés à voix basse.
Ces histoires ne noircissent pas les pages de livres. Les arbres les écoutent auprès des feux des camps, à la veillée. Les amoureux les racontent quand brille le soleil. Quelques-unes sont chantées. D’autres, glorieuses épopées du Wild, ont été transmises d’une génération à l’autre. Et chaque année on entend de nouvelles histoires de bouche en bouche, d’une case à l’autre, des confins méridionaux du Mackenzie jusqu’à l’extrême bord du monde au port d’Athabasca. Car les Trois Fleuves engendrent toujours du romanesque, de la tragédie et de l’aventure.
On se souviendra toujours de l’histoire de Follette et de Ladouceur, qui firent le pari insensé de nager à la Chute de la Mort, au péril de leur vie, pour l’amour d’une jeune fille qui les attendait au bas. Jamais on n’oubliera non plus Campbell O’Doone, le géant à la tête rouge du Fort-Résolution, qui lutta contre toute une brigade pour fuir avec la fille d’un capitaine de petit bateau.
Et la brigade aimait O’Doone, bien que battue par lui, car ces vigoureux hommes du Nord estiment le courage et l’audace.
L’épopée du bateau perdu — certains disaient l’avoir vu disparaître sous leurs yeux, puis flotter un instant à la surface et s’envoler à toute vitesse dans les cieux — fut racontée maintes et maintes fois par des gars au visage rude, et dont la prunelle couve dans sa profondeur la flamme d’une superstition qui ne veut pas s’éteindre. Ces mêmes hommes frissonnent en répétant, sans se lasser, l’étrange et increvable légende de Hartshope, l’Anglais aristocrate qui débarqua, le monocle à l’œil, avec un luxe inouï de bagages, prit part à une guerre de tribus, devint le chef de la tribu des Côtes-de-Chiens et épousa une petite beauté indienne, aux yeux sombres et aux cheveux lisses.
Mais les plus intéressantes et les plus effarantes des histoires qu’on raconte là-bas sont celles du long bras de la Loi — ce bras qui s’étend à deux milliers de milles du port d’Athabasca jusqu’à la mer Polaire, le bras de la police montée du Nord-Ouest.
Parmi ces histoires, c’est celle de Kent que nous allons faire revivre, de Jim Kent et de Marette, cette merveilleuse petite déesse de la Vallée du Silence, cette charmeuse dont les veines charriaient le sang d’hommes combatifs et d’anciennes reines.
Cette histoire se passait avant l’apparition du chemin de fer.
CHAPITRE PREMIERL’INCROYABLE AVEU
Il ne restait plus l’ombre d’un doute dans la pensée de James Grenfell Kent : il savait qu’il était perdu. Son ami, le médecin Cardigan, en qui il avait toute confiance, lui avait dit que le temps qui lui restait à vivre pouvait être mesuré en heures, ou en minutes, ou même en secondes. Son cas était peu banal, ne lui laissant qu’une chance sur cinquante de vivre deux ou trois jours, mais sûrement pas davantage. La science chirurgicale et médicale se prononçait ainsi d’après des cas similaires.
Pourtant Kent n’avait pas la sensation d’une mort prochaine. Sa vue et ses idées étaient claires. Il ne souffrait pas. Sauf à de rares instants, sa température demeurait normale. Sa voix était particulièrement naturelle et calme.
Tout d’abord il avait souri d’incrédulité lorsque Cardigan lui dévoila la vérité. Deux semaines auparavant un métis ivre lui avait envoyé une balle qui l’avait atteint à l’arc de l’aorte. Cardigan diagnostiquait un anévrisme. Kent ignorait aussi bien ce que signifiaient les termes « aorte » et « anévrisme » que ceux de « péricarde » ou d’« artère stylo-mastoïdienne », mais dans sa passion de tout connaître par le détail, passion qui du reste avait fait sa réputation de meilleur chasseur d’hommes de tout le service du Nord, il avait insisté pour que son ami le chirurgien lui expliquât son cas. Il apprit alors que l’aorte est le principal vaisseau sortant du cœur. La balle, en l’éraflant, en avait affaibli la paroi extérieure au point qu’elle formait poche tout comme une chambre à air d’automobile qui tend à sortir de l’enveloppe endommagée.
— Et quand le sac crèvera, vous vous en irez comme cela ! lui avait dit Cardigan en faisant claquer son pouce et son index pour mieux exprimer le fait brutal.
Après une telle explication, croire la vérité était uniquement affaire de bon sens. Certain qu’il allait mourir, Kent se décida à agir. Il révéla ce qu’il avait à dire.
Il avait toujours envisagé la vie plus ou moins comme une plaisanterie — une très sérieuse plaisanterie, mais tout de même une plaisanterie, une farce capricieuse jouée par le Grand Arbitre aux dépens de l’humanité entière : et le dernier compte de sa propre vie qui se réglait solennellement et tragiquement, était la plus grande de toutes les plaisanteries. Les gens qui se trouvaient autour de lui l’écoutaient avec horreur ou incrédulité, les yeux fixes, les lèvres pincées.
Kent leur parlait sans se départir de son calme ; devant la mort sa voix conservait son même timbre. Le fait d’avoir à renoncer à l’habitude de respirer ne l’avait épouvanté à aucun moment de ses trente-six années de vie. Il avait passé dans les contrées ingrates un nombre suffisant de ces années pour contracter une sage philosophie et acquérir une parfaite connaissance de lui-même dont il ne faisait point montre. Il croyait que la vie était la chose la moins chère sur la surface de la terre. Toutes les autres choses de prix étaient limitées ; elles pouvaient être mesurées, inventoriées, cataloguées ; mais non point la vie. « En un temps donné, avait-il coutume de dire, une simple paire d’humains peut repeupler tout le globe. » La vie étant donc ce qu’il y a de moins cher au monde, on doit, en bonne logique, la considérer comme de très peu de valeur et s’en détacher facilement quand cela devient nécessaire.
Kent n’avait pas toujours raisonné ainsi. Aucun homme n’aima la vie plus que lui ; il fut un amoureux du soleil et des étoiles, un adorateur de la forêt et de la montagne. Il avait ardemment combattu pour vivre ; et cependant il était prêt à partir sans trop de regret puisque le sort l’exigeait.
Par les paroles qu’il venait de dire à ses compagnons, il s’était révélé comme un véritable démon. Pourtant à le voir, appuyé sur ses coussins, il n’en paraissait rien. Son mal ne l’avait pas amaigri. Le bronze de sa figure aux traits minces et anguleux avait un peu disparu, mais non les traces du vent, du soleil et des feux de campement. On ne lui aurait pas donné trente-six ans, malgré la mèche grise qui rayait ses cheveux blonds sur une tempe, mèche qu’il avait héritée de sa mère défunte.
Comment avait-il pu commettre le crime qu’il avouait et qui dépassait les limites du pardon et de la sympathie des hommes ?
De sa chaise longue, il apercevait par la fenêtre les flots étincelants du fleuve Athabasca qui se dirigeait lentement vers l’océan Arctique. Le soleil brillait. Il vit les masses froides et serrées des forêts de cèdres et de sapins, les ondulations des sommets moutonnants du Désert Blanc ; et il respira les doux effluves qu’amenait, par la fenêtre, le vent des forêts, de ces forêts qu’il avait tant aimées.
« Elles ont été mes meilleures amies, avait-il dit à Cardigan ; et quand cette gentille petite chose que vous promettez arrivera, je veux, mon vieux, m’en aller avec les yeux sur elles. »
C’est pourquoi on avait étendu sa chaise-longue près de la fenêtre.
Cardigan, assis près de lui, s’était montré plus incrédule que les autres. Kedsty, l’inspecteur de la police montée royale du Nord-Ouest, commandant la Division N pendant un congé illimité du chef, était encore plus pâle que la jeune fille, qui, d’un doigt nerveux, consignait les paroles de Kent et les interruptions de l’assistance. Le sergent-major O’Connor demeurait abasourdi ; et le petit missionnaire catholique, à la figure lisse, dont Kent avait réclamé la présence comme témoin, écoutait silencieusement, ses doigts minces étroitement serrés ; la tragédie qu’il entendait était bien la plus étrange parmi toutes celles que Wild lui avait fait connaître.
Tous ces gens avaient été les amis de Kent, ses amis intimes, à l’exception de la jeune fille que l’inspecteur avait priée de venir pour la circonstance. Avec le petit missionnaire, Kent avait passé maintes nuits à échanger de mutuelles confidences sur les étranges et mystérieuses aventures des forêts profondes et du grand Nord au des forêts.
L’amitié d’O’Connor était un sentiment fraternel, né et entretenu sur les pistes parcourues ensemble. C’était Kent et O’Connor qui avaient ramené de l’embouchure du Mackenzie les deux meurtriers esquimaux ; l’affaire leur avait pris quatorze mois. Kent aimait O’Connor avec sa trogne et sa tignasse rouges et son grand cœur. Pour Kent, la chose la plus tragique était de briser maintenant ce lien sacré.
Il éprouvait aussi, sans la trahir, une émotion intense devant l’attitude de l’inspecteur Kedsty. Ce Kedsty avait soixante ans, des cheveux gris, l’air froid, des yeux presque incolores au fond desquels on aurait vainement cherché une lueur de pardon ou de crainte. Il possédait un imperturbable sang-froid ; et il fallait bien un tel homme — un homme de fer — pour diriger conformément à la loi la Division N ; car cette Division couvrait une surface de 620 milles carrés du désert nord-américain, s’étendant à plus de deux mille milles vers le nord et au delà du 57e parallèle, pénétrant, dans la limite extrême, à plus de trois degrés à l’intérieur du Cercle Arctique. Exercer la police sur cette étendue, veut dire faire respecter la loi dans un pays quatorze fois plus vaste que l’État d’Ohio. Kedsty était l’homme qui avait accompli cet effort ; un seul autre, avant lui, y avait réussi.
Or, parmi les cinq personnes qui entouraient Kent, l’inspecteur Kedsty se montrait le plus tourmenté. Sa figure était devenue gris cendre, et on aurait pu discerner plusieurs fois dans sa voix des notes brisées. Lui, qui ne transpirait jamais, dut s’éponger le front. Il n’était plus le légendaire minisak, le « rocher », comme on l’avait baptisé, le plus craint des inquisiteurs dans le service. Kent aperçut qu’il luttait pour essayer de se ressaisir.
— Naturellement, tu sais ce que cela signifie d’après le règlement, dit-il d’une voix dure et basse. Ça veut dire…
— Déshonneur, répliqua Kent. Je sais. Cela signifie une tache sur l’écusson si brillant de la Division N. Mais on ne peut rien y changer. J’ai tué Barkley. L’homme que vous tenez dans le corps de garde pour le pendre « jusqu’à ce que mort s’ensuive », est innocent. Oui, je comprends, ce n’est guère honorable de savoir qu’un sergent de la police montée de Sa Majesté est un vulgaire assassin. Mais…
— Pas un meurtrier ordinaire, interrompit Kedsty. Ton crime était prémédité. Il est horrible dans ses moindres détails. Il n’a pas d’excuse. Tu étais donc poussé par une folle passion. Tu as torturé ta victime. C’est inconcevable.
— Et c’est pourtant vrai, dit Kent.
Il regarda les doigts de la sténographe qui inscrivait ses paroles et celles de Kedsty. Un peu de soleil frôlait la tête baissée de la jeune fille dont les cheveux prenaient un reflet rouge.
Comme il se tournait vers O’Connor, Kedsty se pencha soudain vers lui, et lui dit d’une voix que les autres ne pouvaient entendre :
— Tu mens, Kent, tu mens !
— Non, c’est la vérité, répliqua Kent, tandis que Kedsty s’épongeait de nouveau le front. J’ai tué Barkley, et je l’ai tué comme je me l’étais promis. Je voulais le faire souffrir. La seule chose que je ne puis dire, c’est pourquoi je l’ai tué. Mais il y avait une raison suffisante.
Il vit un frisson traverser les épaules de la jeune fille.
— Et tu refuses d’avouer ton mobile ?
— Absolument ; mais j’affirme qu’il m’avait offensé d’une façon méritant la mort.
— Et tu fais cet aveu parce que tu sais que tu vas mourir ?
Kent eut un léger sourire et il vit dans les yeux d’O’Connor passer, comme un éclair, la lueur de leur vieille amitié.
— C’est juste. Le docteur Cardigan me l’a dit. Autrement j’aurais laissé pendre l’homme qui est au corps de garde. C’est simplement cette maudite balle qui, ma foi, a sauvé ma conscience.
Kedsty murmura quelques mots à la sténographe qui, durant une demi-heure, fit lecture de ses notes. Kedsty les signa et, se levant :
— Nous avons terminé, Messieurs, fit-il.
Les assistants se dirigèrent vers la porte, précédés par la jeune fille qui avait hâte de sortir de cette pièce où ses nerfs venaient d’être mis à une rude épreuve. Le commandant de la Division N était le dernier. Sans doute Cardigan aurait voulu ne point quitter encore Kent ; mais Kedsty lui fit signe de sortir.
C’est Kedsty qui ferma la porte : et comme il la tirait à lui, il s’arrêta une seconde, les yeux fixés sur Kent qui reçut son regard comme un fluide électrique. Ce regard n’était pas seulement chargé d’horreur : mais on l’aurait cru, chez un autre homme, inspiré par la peur.
Ce n’était guère le moment de sourire. Le choc passé, Kent sourit pourtant. Il savait que Kedsty allait aussitôt donner des instructions au sergent-major O’Connor pour placer une sentinelle devant sa porte. Il ne tarderait pas à quitter ce monde : mais les règlements du code criminel exigeaient cette mesure. Kedsty s’y conformait scrupuleusement.
A travers la porte. Kent perçut confusément des voix, mêlées à des bruits qui s’évanouirent. Puis, seul, se fit entendre le lourd pas des grands pieds d’O’Connor, ce pas qu’il avait toujours, même sur la piste.
Quelques instants après, la porte s’ouvrit et le Père Layonne, le petit missionnaire, entra. Kent savait qu’il en serait ainsi, car le Père Layonne ne connaissait d’autres lois que celles des hommes de cœur du Wild. Le petit missionnaire s’assit donc près de Kent dont il prit une main dans les siennes. Elles n’étaient pas molles et lisses comme celles des prêtres, mais calleuses, et cependant elles paraissaient douces de la douceur d’une grande sympathie. Hier encore il avait aimé Kent qui menait aux yeux de Dieu et des hommes une vie honorable ; il continuait à l’aimer aujourd’hui, alors que l’âme de ce malheureux était souillée par un forfait qui serait bientôt expié.
— Je me sens tout triste, petit, dit le Père Layonne.
Quelque chose qui n’était pas un flot de sang monta à la gorge de Kent dont les doigts rendirent la pression que lui donnaient les mains du pasteur.
— Il est dur de dire adieu à tout cela. Père, répondit-il en désignant, par la fenêtre, le panorama du fleuve miroitant et des forêts. Non que je craigne d’en parler. Pourquoi être triste ? Parce qu’il me reste seulement un petit moment à vivre ? Le temps vous semble-t-il si lointain où vous étiez un petit garçon, un tout petit garçon ?
— Le temps a passé rapidement, très rapidement.
— On croirait que c’est d’hier…
Le visage de Kent s’éclaira d’un sourire léger, qui depuis longtemps avait touché le cœur du missionnaire.
— C’est ma manière de voir, Père. Il y a simplement un hier, un aujourd’hui et un demain de plus dans la plus longue des existences. Contempler un passé de soixante-dix ans ne diffère pas beaucoup de regarder en arrière de trente-six… Croyez-vous qu’on relâchera Sandy Mac Trigger après ce que je viens de dire ?
— Évidemment. Vos déclarations ont été acceptées comme une confession de mourant.
Après quelques secondes de silence, le petit missionnaire reprit d’une voix un peu émue :
— Il y a certaines choses, mon enfant, dont on ne peut guère se dispenser de parler. Ne croyez-vous pas ?
— Vous voulez dire…
— Votre famille, d’abord. Je me rappelle que vous m’avez dit n’en plus avoir. Mais sûrement vous laissez un être quelque part ?
— Non, Père, dit Kent en secouant la tête. Depuis dix ans ces forêts là-bas ont été père, mère et foyer pour moi.
— Mais vous devez avoir des affaires personnelles que vous voudriez peut-être me confier ?
La figure de Kent s’éclaira ; et une fugitive lueur de gaîté brilla dans ses yeux.
— C’est comique, dit-il en ricanant. Puisque vous m’y faites songer, Père, je suis tout disposé à dicter mon testament. J’ai acheté quelques petits lopins de terre ici. Grâce à la proximité du chemin de fer, leur valeur s’est accrue. Je les ai payés sept à huit cents dollars ; ils en valent dix mille à présent. Je désire que vous les vendiez au profit de vos œuvres. N’oubliez pas les Indiens, surtout. Ils ont été bons frères pour moi. Ma signature sera vite donnée.
Les yeux du Père Layonne brillèrent doucement.
— Dieu vous bénira pour cela, Jimmy, dit-il, se servant de ce nom familier sous lequel il avait connu Kent. Et je crois qu’il vous pardonnera si vous savez l’implorer.
— Je suis tout pardonné, répliqua Kent en regardant par la fenêtre. Je le sens. Je le suis, Père.
De toute son âme, le petit missionnaire priait. Il savait que la religion de Kent n’était pas la sienne ; et sur le moment il s’abstint d’insister.
Après un instant, il se leva ; et c’est le Kent d’autrefois qui le regarda en face, le Kent à la face glabre, aux yeux gris, le Kent sans peur, souriant selon la vieille habitude.
— J’ai une grande faveur à vous demander, Père. S’il ne me reste qu’un jour à vivre, je ne veux pas que l’attitude de chacun me rappelle que je suis en train de mourir. Si je n’ai perdu aucun ami, je veux les voir tous ici pour leur parler et plaisanter avec eux. Je veux fumer ma pipe. Une boîte de cigares me ferait bien plaisir, si vous voulez me la faire apporter. Cardigan ne peut plus s’y opposer maintenant. Voulez-vous ? Ils vous écouteront sûrement. Avancez ma chaise-longue un peu plus près de la fenêtre, je vous prie, avant de vous retirer.
Le Père Layonne rendit ce service en silence. Soudain il ne put résister au désir d’attirer la miséricorde de Dieu sur cette âme :
— Mon enfant, dit-il, regrettez-vous l’acte que vous avez commis ? Vous repentez-vous d’avoir tué John Barkley ?
— Non, je ne le regrette pas. Cela devait arriver. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas les cigares, n’est-ce pas, mon Père ?
— Je ne les oublierai pas, dit le petit missionnaire, qui se retira.
Comme la porte se refermait derrière lui, une lueur joviale apparut de nouveau dans les yeux de Kent. Il ricana même en essuyant une tache de sang indiscrète sur ses lèvres. Il avait bien joué son rôle. Le comique était que personne ; sur terre, ne connaîtrait toute la vérité ; lui seul savait… et peut-être un autre.
CHAPITRE IIL’AMI O’CONNOR
Au dehors, c’était le printemps, le printemps magnifique de la terre du Nord. Kent le buvait à pleines gorgées, malgré l’étreinte de la mort prochaine. Penché à la fenêtre, ses yeux parcouraient les vastes espaces de ce monde qui avait été le sien.
Il se rappela qu’il avait lui-même choisi ce monticule dominant à la fois la colonie et le fleuve, comme le site rêvé pour y établir le bâtiment que le docteur Cardigan appelait son hôpital. C’était une construction grossière, dépourvue d’ornements et non peinte ; elle sentait délicieusement l’arome des sapins au cœur desquels avait été taillée sa charpente non rabotée. Les exhalaisons qui s’en dégageaient portaient en elles l’espoir et l’allégresse. Ses murs, argentés par endroits, dorés ou brunis par le goudron et tachetés de nœuds, parlaient joyeusement d’une vie tenace. Les pics-verts venaient les marteler comme s’ils étaient toujours une partie de la forêt ; et les écureuils rouges jouaient sur le toit et s’enfuyaient avec un léger bruit de pattes.
— Il faut être un pauvre spécimen d’homme pour se laisser mourir ici malgré ce spectacle réconfortant, avait dit Kent l’année dernière lorsqu’il choisit ce site avec Cardigan. Si on meurt en contemplant cela, c’est tout simplement qu’on doit mourir, n’est-ce pas, docteur ?
Et maintenant, c’était lui, ce pauvre spécimen regardant dehors la gloire du monde.
Son regard embrassait tout le sud, ainsi qu’une partie de l’est et de l’ouest. Dans toute cette direction, la forêt s’étendait à perte de vue comme une mer multicolore, aux vagues inégales, se levant, et s’abaissant jusqu’à ce que le ciel bleu descendît pour la rencontrer.