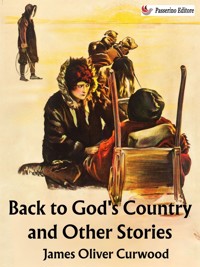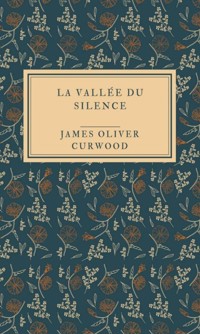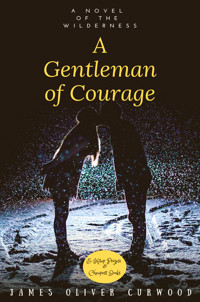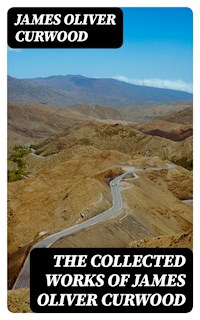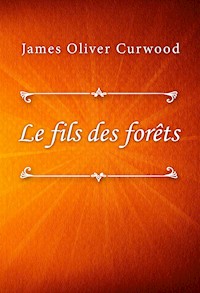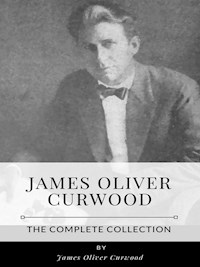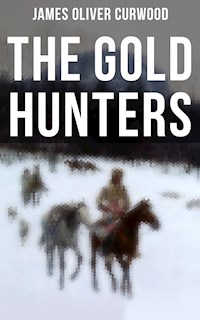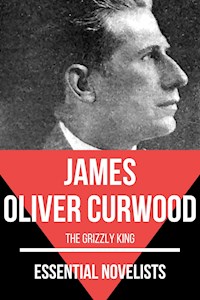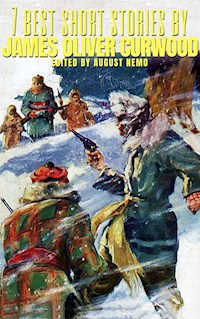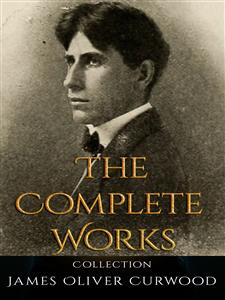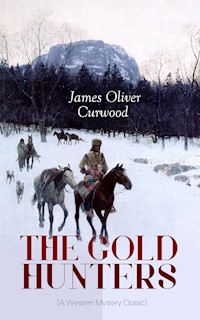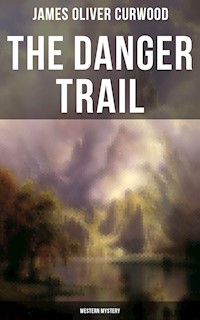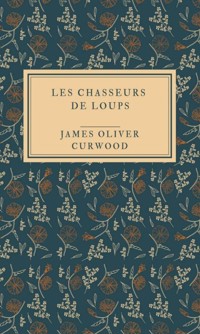
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le lourd et froid hiver étendait son premier manteau sur le Grand Désert canadien. La lune se levait, boule rouge mouvante, éclairant d'une faible lueur le vaste silence blanc. Pas un bruit n'en brisait la calme désolation. La vie diurne s'était éteinte et il était trop tôt encore pour que s'éveillassent les voix errantes des créatures nocturnes. Au premier plan s'estompait, sous la lueur lunaire et à la clarté diffuse de millions d'étoiles, un grand amphithéâtre de rochers, au fond duquel dormait un lac gelé. Sur la pente de la montagne s'élevait la forêt de sapins, noire et sinistre. Un peu plus bas, des mélèzes bordaient le lac de leur muraille, à demi courbés sous le fardeau de la neige et de la glace, qui les écrasait, dans les impénétrables ténèbres. Du côté opposé aux mélèzes, aux sapins et à la montagne, le cirque rocheux s'échancrait vers une plaine blanche infinie, découverte et sans arbres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JAMES-OLIVER CURWOOD
LES CHASSEURS DE LOUPS
LES CHASSEURS DE LOUPS
CHAPITRE PREMIER LE COMBAT DANS LES MÉLÈZES
CHAPITRE II COMMENT WABIGOON LE FILS PRIT GOUT A LA CIVILISATION
CHAPITRE III RODERICK TUE SON PREMIER OURS
CHAPITRE IV RODERICK SAUVE MINNETAKI
CHAPITRE V EN CONTACT AVEC LE DÉSERT
CHAPITRE VI MYSTÉRIEUX COUPS DE FEU DANS LE SILENCE
CHAPITRE VII LA DANSE DES CARIBOUS
CHAPITRE VIII MUKOKI DÉRANGE LES ANCIENS SQUELETTES
CHAPITRE IX CE QUE RENFERMAIT LE PETIT SAC EN PEAU DE DAIM
CHAPITRE X POURQUOI LOUP ET MUKOKI HAÏSSAIENT LES LOUPS
CHAPITRE XI COMMENT LOUP ATTIRA SES FRÈRES A LA MORT
CHAPITRE XII RODERICK EXPLORE LE MYSTÉRIEUX RAVIN
CHAPITRE XIII LE SONGE DE RODERICK
CHAPITRE XIV LE SECRET DE LA MAIN DU SQUELETTE
CHAPITRE XV SOUS L’AVALANCHE NEIGEUSE
CHAPITRE XVI LA CATASTROPHE
CHAPITRE XVIII LE RETOUR A WABINOSH-HOUSE
LES CHASSEURS DE LOUPS
A mes camarades du Grand Désert du Nord, à ces compagnons fidèles avec qui j’ai partagé les joies et les peines des longues pistes silencieuses, et spécialement à Mukoki, mon guide Peau-Rouge et ami bien-aimé, en témoignage de ma reconnaissance, je dédie ce livre.
JAMES OLIVER CURWOOD.
CHAPITRE PREMIER LE COMBAT DANS LES MÉLÈZES
Le lourd et froid hiver étendait son premier manteau sur le Grand Désert canadien. La lune se levait, boule rouge mouvante, éclairant d’une faible lueur le vaste silence blanc. Pas un bruit n’en brisait la calme désolation. La vie diurne s’était éteinte et il était trop tôt encore pour que s’éveillassent les voix errantes des créatures nocturnes.
Au premier plan s’estompait, sous la lueur lunaire et à la clarté diffuse de millions d’étoiles, un grand amphithéâtre de rochers, au fond duquel dormait un lac gelé. Sur la pente de la montagne s’élevait la forêt de sapins, noire et sinistre. Un peu plus bas, des mélèzes bordaient le lac de leur muraille, à demi courbés sous le fardeau de la neige et de la glace, qui les écrasait, dans les impénétrables ténèbres. Du côté opposé aux mélèzes, aux sapins et à la montagne, le cirque rocheux s’échancrait vers une plaine blanche infinie, découverte et sans arbres.
Un énorme hibou blanc émergea de l’obscurité, en dépliant son vol. Puis il jeta, d’une voix chevrotante, un hululement doux, qui semblait annoncer que bientôt allait s’ouvrir l’heure mystique des hôtes de la nuit.
La neige, qui avait chu en abondance durant la journée, avait cessé de tomber. Pas un souffle ne passait dans l’air et ses flocons étaient restés accrochés aux plus petites brindilles des ramures. Quoiqu’il ne fît pas de vent, le froid était intense. Un homme qui serait demeuré immobile fût, en une heure, tombé gelé sous sa morsure.
Soudain le silence se rompit. Un cri s’éleva, sonore et lugubre, quelque chose comme une plainte inexprimable, une plainte non humaine, qui, si un homme l’eût entendue, aurait fait battre plus vite le sang dans ses veines et se crisper ses doigts sur la crosse de son fusil. Le cri venait de la plaine blanche et se répercutait dans la nuit. Il se tut ensuite et le silence qui lui succéda à nouveau en parut plus profond. Le hibou blanc comme un gros flocon de neige, s’envola muettement, à tire-d’ailes, par-dessus le lac gelé.
Puis, au bout de quelques instants, le cri plaintif recommença mais plus faible. Un habitué du Grand Désert Blanc, dressant l’oreille et scrutant les ténèbres, n’eût pas hésité à reconnaître la clameur sauvage, de souffrance et d’agonie, d’une bête blessée et à demi conquise.
Lentement, en effet, avec la prudence que doit suivre l’angoisse des longues heures d’une journée de chasse, un magnifique élan mâle s’avançait dans la lumière de la lune. Sa tête superbe, pliant sous le poids de sa massive ramure, se tournait vers le bois de mélèzes qui était de l’autre côté du lac. L’animal reniflait l’air dans cette direction et ses narines se dilataient. Derrière lui, il laissait une coulée de sang. Blessé à mort sans doute et se traînant à peine sur la neige molle qui couvrait la glace, il espérait visiblement trouver dans l’abri des arbres un ultime refuge.
Comme il était près d’atteindre son but, il s’arrêta et rejeta sa tête en arrière, le museau levé vers le ciel, en pointant en avant ses longues oreilles. C’est l’attitude familière aux élans lorsqu’ils écoutent. Et leur ouïe est si fine qu’ils perçoivent, à un mille de distance, le clapotis d’une truite faisant des soubresauts dans l’eau vive. Mais aucun bruit ne troublait le silence, semblait-il, que, de temps à autre, les hululements funèbres du hibou blanc, qui ne s’était pas éloigné. Le puissant animal demeurait cependant immobile et, tandis qu’une petite mare de sang s’élargissait dans la neige, sous son poitrail, il écoutait toujours. Quels sons mystérieux, imperceptibles à l’ouïe humaine, parvenaient donc à ses oreilles effilées ? Quel danger se tenait en embuscade dans la noire forêt de sapins, qu’elles interrogeaient ? Les reniflements avaient repris. Aspirant l’ombre, ils allaient maintenant de l’est à l’ouest, mais se dirigeaient surtout vers le nord.
Ce que l’élan seul, d’abord, entendait, on ne tarda pas à le distinguer. Une lointaine rumeur, à la fois lamentable et féroce, croissait, puis s’évanouissait, puis croissait encore, se faisant de minute en minute plus précise. C’était le hurlement des loups !
Ce que le nœud coulant du bourreau est à l’assassin condamné à mort, ce que les fusils en joue sont à l’espion qui s’est fait prendre, ce cri des loups l’est à la bête blessée, dans le Grand Désert canadien. Le vieil élan rabaissa sa tête et ses larges cornes et, ranimant toutes ses forces, il se mit à trotter, au petit trot, vers la forêt de sapins. Plus éloignée de lui, mais plus dense aussi que le petit bois de mélèzes, il comprenait instinctivement, sous son crâne épais, qu’elle lui serait, s’il pouvait l’atteindre, une plus sûre retraite.
Mais alors… Oui, alors, tandis qu’il cheminait, il s’arrêta à nouveau. Si brusquement que ses pattes de devant fléchirent sous lui et qu’il s’écroula dans la neige. La détonation d’un fusil avait, cette fois, retenti !
Le coup avait dû partir à un mille au moins, à deux milles peut-être. Mais son éloignement n’enlevait rien à la crainte qui avait fait tressaillir le roi du Nord agonisant. Le matin de ce même jour, il avait entendu retentir un pareil bruit, qui lui avait apporté, dans ses parties vitales, une inconnue et profonde blessure. Tant bien que mal, il se remit debout. Il renifla au nord, à l’est, à l’ouest. Puis, retournant sur ses pas, il vint s’enfouir dans la masse glacée des mélèzes.
Après le coup de fusil, le silence était retombé. Il durait depuis dix minutes environ lorsqu’un glapissement rapide déchira l’air, plus proche cette fois. Un autre lui répondit, puis un second, puis un troisième, et ce fut bientôt un chœur à pleine gorge de toute la bande des loups.
Une silhouette d’homme, presque aussitôt, émergea du bois de mélèzes. Le teint de son visage était cuivré, comme celui d’un Indien.
Il avança de quelques yards[1]. Puis se retournant vers l’obscure muraille :
[1] Le yard vaut 0 m. 91 centimètres. (Note des Traducteurs.)
« Venez, Rod, cria-t-il. Nous sommes dans le bon chemin et le campement n’est plus loin. »
Une voix répondit : « Me voici, Wabi. »
Quelques minutes se passèrent et un autre jeune homme, de sang blanc, apparut. Il avait dix-huit ans au plus. De sa main gauche, il s’appuyait sur un gros gourdin. Son bras droit, qui semblait gravement blessé, était enveloppé dans un grand foulard, servant de bandage improvisé. Sa figure était toute égratignée et saignait. L’ensemble de sa démarche indiquait qu’il en était arrivé au dernier degré de l’épuisement.
Il fit encore quelques pas, en chancelant, respirant par saccades. Puis le gourdin glissa de ses doigts sans nerfs et il ne tenta même pas de le ramasser. Conscient de sa faiblesse, il plia les genoux et s’affaissa dans la neige.
Wabi lui tendit la main, pour l’aider à se relever.
« Croyez-vous, Rod, pouvoir continuer ? »
Le jeune homme se remit sur ses pieds.
« J’ai bien peur que non, murmura-t-il. Je suis à bout. »
Et il retomba sur le sol.
Wabi déposa son fusil et s’agenouilla vers son compagnon.
« Nous aurions pu facilement, dit-il, camper ici, en attendant le jour, s’il nous était resté plus de trois cartouches.
— Trois seulement ? interrogea Rod.
— Pas une plus. C’est de quoi abattre deux ou trois loups. Je ne pensais pas, en partant vous chercher, vous trouver si loin. »
Devant Roderick il se plia en deux, comme un couteau de poche que l’on referme.
« Passez vos bras autour de mon cou, dit-il, et tenez-moi bien. »
Wabi se releva avec son fardeau, portant Rod sur ses puissantes épaules.
Il allait se remettre en marche lorsque résonna le cri de chasse des loups, tellement près qu’il s’arrêta, hésitant.
« Ils ont découvert notre piste ! déclara-t-il. Nous ne pouvons songer à les gagner de vitesse. Avant cinq minutes ils seront ici. »
Une vision terrible traversa son cerveau, celle d’un autre adolescent mis en pièces devant ses yeux par les « outlaws » du Nord[2]. Et il frémit. Tel allait donc être le sort de son compagnon, et le sien propre… A moins que… En laissant tomber le blessé de ses épaules et en l’abandonnant, il pouvait fuir encore. A cette pensée, sa face se crispa et il eut un ricanement farouche. Abandonner Roderick ! Ce matin même, n’avaient-ils pas, en une première échauffourée avec les outlaws, fait le coup de feu côte à côte ? Près de lui Roderick n’était-il pas tombé dans la bataille, le bras déchiré ? S’ils devaient, dans un instant, affronter la mort, ce serait encore de compagnie. Ensemble ils mourraient.
[2]Outlaw, hors la loi. (Note des Traducteurs.)
Le parti de Wabi fut rapidement pris. Il regagna, portant Rod, le bois de mélèzes. La seule chance de salut qui s’offrait à eux était de se hisser sur un des arbres et d’y attendre que les loups se fussent dispersés avec le jour. Ils courraient le risque, à vrai dire, de mourir de froid durant ce temps. Ce serait, entre les loups et eux, une lutte d’endurance.
Wabi s’arrêta au pied d’un gros mélèze, dont les branches chargées de neige pendaient jusqu’à terre, et déposa Rod sur le sol. A la lumière de la lune, qui maintenant était haute dans le ciel et brillante, il regarda le jeune blanc qui, les yeux mi-clos et les membres flasques, avait à demi perdu connaissance. Sa figure était d’une pâleur mortelle, et, devant ce visage spectral, le cœur fidèle de Wabi se serra d’angoisse.
Mais, avant même qu’il eût songé comment il pourrait monter le blessé dans son refuge aérien, son oreille, exercée aux bruits du désert, avait tressailli. Les loups arrivaient !
Il les avait devinés, plus qu’il ne les avait entendus. Car, en approchant, les féroces chasseurs avaient tu leurs glapissements. Sans les attendre, témérairement, avec un grand cri, il bondit au-devant d’eux.
Ils n’étaient plus qu’à quelques pieds du bois lorsqu’il arriva pour leur barrer la route. Ils ne formaient qu’un petit groupe, l’avant-garde sans doute. Sans perdre un instant, Wabi mit en joue et tira. Un hurlement de douleur lui apprit que le coup avait porté. Il épaula, une deuxième fois, et visa si bien qu’il vit le second loup sauter en l’air, comme mû par un ressort, et retomber à plat dans la neige, sans même un cri. Les autres alors se dispersèrent, non sans emporter avec eux le cadavre du mort, pour l’aller dévorer un peu plus loin.
Revenu vers Rod, Wabi vit avec satisfaction que celui-ci, surmontant son immense faiblesse, avait repris un peu de vie. Il grimpa dans le mélèze et le tira après lui.
« C’est la seconde fois, dit Rod, que vous me sauvez. La première fois c’était d’une noyade bien réussie. Cette fois, c’est des loups. Je vous dois une fière chandelle ! »
Affectueusement il posa sa main sur l’épaule de son ami.
« Vous me l’avez bien rendu ce matin, répondit Wabi. Si vous êtes ainsi estropié, c’est pour moi. La blessure sanglante m’était destinée. Nous sommes quittes. »
Et les regards des deux jeunes gens se croisèrent en une confiance amie.
Le concert des hurlements avait recommencé. Wabi se hissa jusqu’au faîte de l’arbre pour observer. La horde sortait justement de la forêt de sapins, un peu plus haut sur la montagne, et dévalait sur ses pentes, à toute vitesse, se répandant parmi la neige en multiples points noirs pareils à des fourmis.
D’autres hurlements répondaient à ceux-ci, du côté du lac, qu’une autre bande traversait en courant. Les deux troupes voraces semblaient avoir pour objectif commun le bois de mélèzes et vouloir s’y réunir. Il y avait bien au total, près de soixante bêtes.
Wabi tira Rod, non sans peine, un peu plus haut dans l’arbre. Les deux hommes, avec l’unique cartouche qui restait, attendirent. Rod avait, dans la bagarre du matin, perdu son fusil et ses munitions.
Wabi, cependant, était remonté à son poste d’observation. Il vit bientôt que les deux bandes de loups s’étaient rejointes en effet et encerclaient le bois. Les animaux semblaient en proie à une vive exaltation. Ils venaient de rencontrer la petite mare de sang laissée par l’élan agonisant et relevaient la piste qui lui faisait suite.
« Que se passe-t-il ? » demanda Rod, à mi-voix.
Les yeux noirs de Wabi se dilatèrent et se mirent à briller d’un flamme ardente. Le sang palpitait dans ses veines et son cœur battait à se rompre.
« Ce n’est pas à nous qu’ils en veulent, répondit-il, après un moment de silence. Ils ne nous ont pas pistés, ni flairés, mais une autre proie. C’est notre chance. »
A peine avait-il parlé que les buissons et les branches craquaient à quelques pieds du mélèze et, droit au-dessous d’eux, les deux hommes purent voir une grosse masse d’ombre qui passait au triple galop. Wabi eut le temps de reconnaître un élan mâle, et il ignorait que c’était le même auquel il avait, au cours de la journée, envoyé une balle qui ne l’avait pas immédiatement abattu. Les loups serraient de près la bête, la tête au ras du sol, sur la piste empourprée, avec des cris rauques et des grognements affamés qui sortaient, par instants, de leurs mâchoires béantes.
Ce n’était pas pour Wabi un spectacle nouveau, mais il s’offrait pour la première fois aux yeux de Rod et, quoiqu’il n’eût duré que le temps d’un éclair, il y devait demeurer longtemps gravé. Longtemps Roderick devait revoir dans ses rêves la bête monstrueuse, qui se savait condamnée, fuyant dans la nuit neigeuse en jetant son lourd beuglement d’agonie, et la horde diabolique des outlaws du désert attachée à ses trousses, corps agiles et puissants, corps squelettiques, dont la peau collait sur les os, mais qui demeuraient indomptables et qu’affolaient la proximité de leur proie.
Car il était certain que l’élan succomberait, dans ce duel inégal, et que les loups se gaveraient de lui, jusqu’à la dernière parcelle.
« Et maintenant, dit tranquillement Wabi, nous pouvons redescendre à terre et continuer sans crainte notre chemin. Ils sont trop absorbés pour s’occuper de nous ! »
Il aida Rod à glisser jusqu’au sol, en lui maintenant les pieds. Puis il se courba devant lui, comme il l’avait déjà fait, et le chargea sur son dos.
Ils sortirent du bois de mélèzes et allèrent ainsi durant un mille, jusqu’à un petit torrent, dont la surface était gelée.
« Wabi, dit Rod, reposez-vous et laissez-moi marcher. Je sens que mes forces reviennent. Vous me soutiendrez seulement un peu. »
Tous deux continuèrent à cheminer. Wabi avait passé son bras autour de la taille du blessé. Ils parcoururent ainsi un autre mille.
Ils aperçurent alors, à un tournant de la vallée, une flamme qui brillait, joyeuse, près d’un boqueteau de sapins. Elle était encore distante d’un bon mille, mais il leur semblait qu’ils la touchaient de la main. Ils la saluèrent d’un cri d’allégresse. Wabi, posant son fusil et délaçant son bras de la taille de Rod, joignit ses deux mains devant sa bouche, pour s’en faire un porte-voix, et lança son signal habituel :
« Oua, ou, ou, ou, ou, ou, ou ! Oua, ou, ou, ou, ou, ou, ou ! »
L’appel s’en alla, dans la nuit tranquille, jusqu’au feu. Une forme ombreuse apparut dans la lueur de la flamme et retourna le cri.
« C’est Mukoki ! dit Wabi.
— Mukoki ! » fit Rod en riant, tout heureux de voir que la rude épreuve tirait à sa fin.
Mais, presque aussitôt, Wabi l’aperçut qui chancelait, pris de vertige. Il dut le maintenir à nouveau pour qu’il ne tombât pas dans la neige.
Si, ce soir-là, les regards des jeunes chasseurs, couchés devant le feu de leur campement, sur l’Ombakika gelé, avaient pu percer l’avenir et prévoir toutes les tragiques émotions qu’il leur réservait, alors peut-être auraient-ils reculé et, faisant route en arrière, seraient-ils revenus, sans plus, vers la civilisation. Peut-être aussi le terme heureux qui devait couronner leur longue randonnée les eût-il, en dépit de tout, entraînés en avant. Car l’amour des vibrations fortes est ancré dans le cœur de la robuste jeunesse.
Mais ils n’avaient pas à choisir entre cette double alternative, l’avenir demeurant fermé pour eux. Plus tard seulement, après bien des années écoulées, ils devaient, devant les bûches ronflantes du foyer familial, revoir dans son ensemble le tableau complet des aventures vécues par eux et, les revivant en imagination, y trouver de chers et ineffaçables souvenirs, auxquels ils n’auraient pas voulu désormais renoncer pour tout l’or du monde.
CHAPITRE II COMMENT WABIGOON LE FILS PRIT GOUT A LA CIVILISATION
Un peu moins de trente ans avant l’époque où se déroule ce récit, un jeune homme, nommé John Newsome, quittait pour le Nouveau-Monde la grande ville de Londres. Le sort lui avait été cruel. Après qu’il eut perdu père et mère, il s’était vu ruiné et, du petit héritage familial, rien ne lui était demeuré.
Il débarqua à Montréal et, comme c’était un garçon bien éduqué, actif et entreprenant, il se fit rapidement une situation. Le patron qui l’employait lui accorda sa confiance et l’expédia comme agent, ou « factor », à sa factorerie de Wabinosh-House, fort loin vers le nord, dans la région désertique du lac Nipigon, vers la Baie d’Hudson.
Un chef de factorerie est roi de fait, dans son domaine. Au cours de la seconde année de son gouvernement, John Newsome reçut la visite d’un chef Peau-Rouge, nommé Wabigoon. Il était accompagné de sa fille, Minnetaki, dont une ville devait prendre un jour le nom, en hommage à sa beauté et à sa vertu. Minnetaki était alors dans l’éclat naissant de sa jeunesse et la beauté qui brillait en elle s’était rarement vue parmi les jeunes filles indiennes.
Ce fut le coup de foudre pour John Newsome, qui s’éprit sur-le-champ de la divine princesse. Ses visites furent des lors fréquentes au village indien où commandait Wabigoon, à trente milles de Wabinosh-House, dans les profondeurs du Grand Désert Blanc.
Minnetaki ne resta pas insensible à l’amour du jeune factor. Mais leur mariage, rapidement décidé, trouva dès l’abord, devant lui, un gros obstacle.
Un jeune chef indien, nommé Woonga, s’était épris lui aussi de Minnetaki. Celle-ci le détestait dans son cœur. Mais Woonga était puissant, plus puissant que Wabigoon, qui se trouvait sous sa dépendance directe pour les territoires de chasse qu’il avait coutume de fréquenter. D’où nécessité de le ménager. Minnetaki n’osait convoler avec celui qu’elle aimait.
Une violente rivalité s’établit entre les deux soupirants. Un double attentat en résulta contre la vie de Newsome, et Woonga expédia à Wabigoon un ultimatum, lui faisant savoir qu’il eût à lui accorder sa fille. Minnetaki répondit en personne, par un net refus, à cette sommation, et le feu de la haine en devint plus fébrile dans la poitrine de Woonga.
Durant une nuit noire, à la tête d’une troupe d’hommes de sa tribu, il tomba à l’improviste sur le campement de Wabigoon. Le vieux chef fut égorgé, ainsi qu’une vingtaine de ses gens, mais le but principal de l’attaque, qui était l’enlèvement de Minnetaki, échoua. Woonga fut repoussé avant d’avoir pu s’emparer de la jeune fille.
Un messager fut expédié en toute hâte à Wabinosh-House, afin d’apporter à Newsome la nouvelle de l’assaut qui avait eu lieu et de la mort de Wabigoon. Le jeune factor, avec une douzaine d’hommes déterminés, vola au secours de sa fiancée. Une seconde attaque de Woonga tourna nettement à son désavantage et il fut reconduit dans le Désert, tambour battant, avec de lourdes pertes pour les siens.
Trois jours après, Newsome épousait Minnetaki.
A partir de ce moment s’ouvrit une ère sanglante, dont le souvenir devait demeurer longtemps vivace dans les annales de la factorerie. Haine née de l’amour, devenue haine de race, inexpiable et sans fin.
Woonga se mit délibérément hors la loi, avec sa tribu entière, et il commença à exterminer, à peu près jusqu’au dernier, tous les anciens sujets de Wabigoon. Ceux qui purent échapper abandonnèrent leur ancien territoire et vinrent se réfugier aux alentours de la factorerie. Ce fut ensuite au tour des trappeurs engagés au service du factor, d’être perpétuellement traqués, et massacrés dans des embuscades.
Haine pour haine, menace pour menace furent rendues à Woonga et aux hommes de son clan. Et bientôt tous les Indiens, quels qu’ils pussent être, furent, à Wabinosh-House, considérés comme des ennemis. On les tint pour autant d’autres Woonga et, dans la conversation courante, on ne les appela désormais que les « Woongas ». Ils furent décrétés une bonne cible pour n’importe quel fusil.
Deux enfants, cependant, avaient sanctifié l’union de Newsome et de sa belle Peau-Rouge. L’aîné était un garçon qu’en l’honneur du vieux chef, son grand-père, on baptisa Wabigoon et, par abréviation, Wabi. L’autre était une fille, de quatre ans plus jeune, que Newsome avait tenu à nommer, comme sa mère, Minnetaki.
Chose curieuse le sang indien semblait couler, presque pur, dans les veines de Wabi. L’enfant était indien d’aspect, de la semelle de ses mocassins jusqu’au sommet du crâne. Il était cuivré et musculeux, aussi souple et agile qu’un lynx, rusé comme un renard, et tout en lui criait qu’il était né pour la vie du Désert. Son intelligence cependant était grande et surprenait le factor lui-même.
Minnetaki, au contraire, à mesure qu’elle grandissait, tenait moins de la beauté sauvage de sa mère et se rapprochait davantage des allures et de la grâce de la femme blanche. Si ses cheveux étaient noirs comme du jais, et noirs ses grands yeux, elle avait la finesse de peau de la race à laquelle appartenait son père.
Ç’avait été un des meilleurs plaisirs de Newsome de s’adonner à l’éducation de sa femme sauvage. Et tous deux n’avaient qu’un but commun, élever à la mode des enfants blancs la petite Minnetaki et son frère. Ils commencèrent par fréquenter, à Wabinosh-House, l’école de la factorerie. Ils furent ensuite envoyés, deux hivers durant, à celle, plus moderne et mieux organisée, de Port-Arthur, le centre civilisé le plus proche. Les deux enfants s’y montrèrent des élèves brillants.
Wabi atteignit ainsi sa seizième année et Minnetaki sa douzième. Rien, dans leur habituel langage, ne trahissait leur part d’origine indienne. Mais ils s’étaient, sur le désir de leurs parents, familiarisés également avec le langage ancestral du vieux Wabigoon.
Vers cette époque de leur jeune existence, les Woongas se firent plus audacieux encore dans leurs déprédations et leurs crimes. Ils renoncèrent complètement à tout travail honnête et ne vécurent plus que de leurs pillages et de leurs vols. Les petits enfants mêmes avaient sucé avec le lait la haine héréditaire contre les hôtes de Wabinosh-House, haine dont maintenant Woonga était presque seul à se rappeler l’origine. Si bien que le gouvernement canadien finit par mettre à prix la tête du chef Peau-Rouge et celle de ses principaux partisans. Une expédition en règle fut organisée, qui refoula les hors-la-loi vers des territoires plus lointains, sans que Woonga lui-même pût être capturé.
Lorsque Wabi eut dix-sept ans, il fut résolu qu’il s’en irait aux États-Unis, pendant une année, dans quelque grande école. Contre ce projet, le jeune Indien (presque tous le considéraient en effet comme tel et il en était fier) lutta avec énergie, mettant en avant mille arguments. Il avait, disait-il, pour le Grand Désert Blanc toute la passion de sa race maternelle. Toute sa nature se révoltait contre la prison qu’est une grande ville, contre ses rumeurs, son tumulte et sa boue. Non, non, il ne saurait jamais se faire à cette existence.
Alors intervint sa sœur Minnetaki. Elle lui demanda, elle le supplia de partir, d’aller là-bas pour une année, pas plus. Il reviendrait ensuite et lui raconterait tout ce qu’il aurait vu, il lui apprendrait à son tour tout ce qu’il aurait appris. Wabi aimait sa gentille petite sœur plus que tout au monde. Elle fit plus pour le décider que n’avaient fait les parents, et il partit.
Il se rendit à Détroit[3], dans l’État de Michigan, et trois mois durant, il s’appliqua au travail, avec conscience. Mais chaque semaine qui s’écoulait ajoutait au chagrin de son isolement, à ses regrets languissants d’avoir perdu Minnetaki, de n’avoir plus devant lui le Grand Désert Blanc, son libre espace et ses forêts. Chaque journée était pour lui un poids pesant et sa seule consolation était d’écrire, trois fois par semaine, à sa sœur aimée. Trois fois par semaine, encore que le courrier postal ne circulât que deux fois par mois, Minnetaki lui écrivait aussi des lettres non moins longues, où elle le soutenait et l’encourageait.
[3] Détroit, capitale de l’État de Michigan, à 700 kilomètres N.-O. de Washington, est situé à la frontière du Canada et des États-Unis, sur la rivière du même nom, qui fait communiquer ensemble les lacs Huron et Érié. (Note des Traducteurs.)
C’est au cours de sa vie solitaire d’écolier que le jeune Wabigoon lia connaissance avec Roderick Drew.
Comme Newsome, Roderick était un enfant du malheur. Lorsque son père mourut, si jeune était-il encore qu’il n’en avait même pas gardé le souvenir. Sa mère l’avait élevé et le petit capital qu’ils possédaient avait fondu peu à peu. Jusqu’au dernier moment elle avait lutté contre la gêne, afin de maintenir son fils au collège. Maintenant toutes ressources étaient épuisées et Roderick se préparait à abandonner ses études au terme de la semaine en cours. La nécessité devenait son maître farouche et c’est pour vivre qu’il allait falloir travailler.
Le boy décrivit sa peine au jeune Indien, qui s’était agrippé à lui, comme le naufragé à une bouée, et était devenu son inséparable. Et, lorsque Roderick fut rentré chez lui, Wabi alla lui rendre visite.
Mistress Drew était une femme fort distinguée, qui reçut Wabi avec amitié et ne tarda pas à lui porter une affection quasi maternelle. Sous cette influence réconfortante, il trouva moins anguleuse cette odieuse civilisation et son exil lui parut moins amer. Ce changement dans son esprit se refléta dans ses lettres à Minnetaki et il lui fit de la maison amie une description enthousiaste. Mistress Drew reçut de la mère de Wabi d’affectueux remerciements et une correspondance régulière s’établit entre les deux familles.
Dès que Wabi, qui ne connut plus dès lors la solitude, avait terminé sa journée de collège, il venait retrouver son ami, qui rentrait, de son côté, de la maison de commerce où il travaillait. Durant les longues soirées d’hiver, les deux boys s’asseyaient l’un à côté de l’autre, devant le feu, et le jeune Indien commençait à narrer l’existence idéale que l’on mène dans le Grand Désert Blanc. Rod écoutait de ses deux oreilles et, peu à peu, naissait et se développait en lui un irrésistible désir de connaître cette vie. Des plans s’échafaudaient, une foule d’aventures étaient imaginées. Mistress Drew écoutait, en souriant ou en riant, et ne disait pas non à tous ces projets mirifiques. Mais un jour arrive où tout prend fin. Wabi s’en retourna au Grand Désert Blanc, près de sa mère Peau-Rouge et de sa sœur Minnetaki. Les yeux des jeunes gens s’emplirent de larmes lorsqu’ils se séparèrent et Mistress Drew pleura aussi, en voyant partir le jeune Indien.
Le temps qui suivit fut douloureux à l’extrême pour Roderick. Huit mois d’amitié avec Wabi avaient fait surgir en lui comme une seconde nature et il lui sembla, lorsque partit son camarade, que quelque chose de lui-même s’en allait. Le printemps vint, puis l’été. Chaque courrier postal apportait de Wabinosh-House un paquet de lettres pour les Drews et en remportait un de Détroit.
L’automne arriva, et les gelées de septembre commençaient à tourner à l’or et au rouge les feuillages de la Terre du Nord, quand une longue lettre de Wabi suscita, dans le petit home des Drew, une grosse émotion, mêlée à la fois de joie et d’appréhension. Elle était accompagnée d’une seconde lettre du factor en personne, d’une troisième, de la mère Peau-Rouge, et d’un petit post-scriptum de la jeune Minnetaki. Les quatre missives demandaient instamment à Roderick et à Mistress Drew de venir passer l’hiver à Wabinosh-House.
« Ne craignez pas