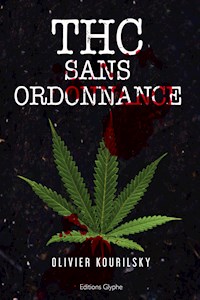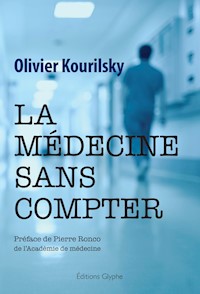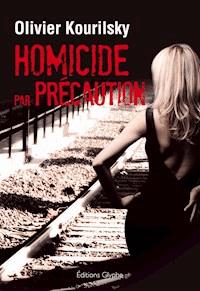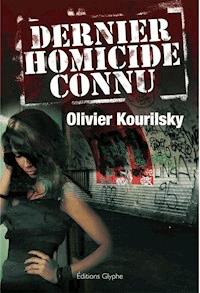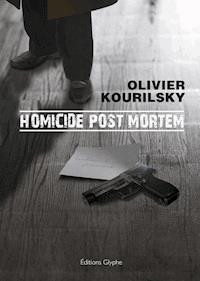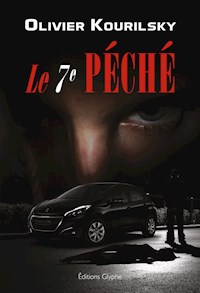
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Glyphe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Polars du DR K
- Sprache: Französisch
Une intrigue noire et haletante.
Christian Arribeau, jeune médecin ambitieux et pétri d’orgueil, a planifié sa carrière pour accéder aux plus hautes fonctions, balayant tous ses concurrents. Il vient de franchir la dernière étape avant sa nomination comme professeur de néphrologie. Mais, alors qu’il sort discrètement d'un immeuble, il renverse un clochard qui s’est jeté sous ses roues. Paniqué à l’idée des conséquences sur sa carrière et persuadé que personne ne l’a vu, il prend la fuite. Commence alors une vertigineuse descente aux enfers, orchestrée par l’obstination d’un policier et l’intervention d’un témoin mystérieux aux motivations obscures. S’agissait-il d’un banal accident ou d’une machination ? Et dans ce cas, qui tire les ficelles ? L’univers bien organisé et la belle assurance d’Arribeau vont s’écrouler comme un château de cartes.
Avec Le 7e péché, le Docteur K signe le septième roman d’une série palpitante.
EXTRAIT
Pétrifié, je n’arrivais pas à détacher mon regard de cette image. J’étais foutu. Ce que je redoutais depuis ce soir tragique se réalisait. On m’avait vu. Mais le plus glaçant était cette photo, manifestement réalisée avec un équipement spécial pour prises de vues nocturnes. La préméditation était évidente. Qu’est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi le témoin ne s’était-il pas manifesté sur le champ ? Et ce cliché envoyé sans commentaire, aucune demande d’argent ni avertissement. On voulait me faire comprendre qu’on savait. Me terroriser. C’était réussi ! Le chantage allait suivre…
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Le 7e péché, nous met en haleine. L’intrigue est bien ficelée et, comme dans tout bon roman policier, on a envie de savoir qui tire les ficelles. Le lecteur, en observateur du système de santé, y découvrira aussi et surtout l’enfer impitoyable de l’université médicale et de l’hôpital. L’ambition y règne en maître. Le professorat est le sésame pour tous les arrivistes qui veulent dominer. On sent bien qu’Olivier Kourilsky, qui en est à son septième roman policier, est à son affaire. Il connaît tous les rouages de la carrière universitaire et hospitalière. Le meurtre réel ou symbolique rôde dans les services. On s’y croirait.
- Pascal Maurel, Décision santé
L'auteur évolue avec aisance dans ce milieu qui fut le sien pendant de longues années. La description du milieu hospitalier et universitaire, avec ses jeux de pouvoir et d'influence, est rendue de manière très réaliste [...] Une vraie réussite que ce 7e péché, même capital, et un très bon moment de lecture. -
Vincent, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Olivier Kourilsky, alias le Docteur K, est médecin néphrologue, professeur honoraire au Collège de médecine des Hôpitaux de Paris ; il a dirigé le service de néphrologie du Centre Hospitalier Sud-Francilien.
Il écrit des romans policiers depuis un peu plus de dix ans et a publié six ouvrages depuis 2005, dont
Meurtre pour de bonnes raisons, prix Littré 2010.
Ses personnages évoluent souvent dans le monde hospitalier, entre les années soixante et aujourd’hui. Au fil du temps, on suit le professeur Banari, le commissaire Maupas, le commandant Chaudron, jeune policière chef de groupe à la Crim'…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éditions Glyphe
Liste des ouvrages
Du même auteur chez le même éditeur
Homicide post mortem.2013
Dernier Homicide connu.2012
Homicide par précaution.2010
Meurtre pour de bonnes raisons.2009. Prix Littré 2010 du Groupement des Écrivains Médecins.
Meurtre avec prémédication.2007
Meurtre à la morgue.2005
Chez le même éditeur (extrait)
Caroline de Costa. Cloné. 2014
Louis Raffin. Proteus. 2013
Philippe Le Douarec. Glaciales glissades. 2013
Jean-Paul Copetti. Pour le repos des morts. 2013
Chris Costantini. Lames de fond. 2012
Roger Caporal. Psychose au laboratoire.2012
© Éditions Glyphe. Paris, 2015
85, avenue Ledru-Rollin – 75012 Paris
www.editions-glyphe.com
Illustration de couverture : Aurélie Dève
ISBN 978-2-36934-009-6
À mon cher Étienne, avec toutes mes excuses pour l’horrible coïncidence !
À mon frère François, qui s’est battu pendant tant d’années avec un courage et une dignité extraordinaires.
Le scandale est souvent pire que le péché.Marguerite de Navarre
Avertissement au lecteur
Afin d’éviter les interprétations, jeprécise que le personnage principal décrit dans ce livre est fictif, inventé de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Qu’on n’aille y chercher aucune allusion à une personne existante (je n’en ai jamais rencontré de telle) : ce serait une insulte à mon imagination !
Quant au septième péché, on peut y voir un clin d’œil (mon septième ouvrage). Mais ici, il sera plutôt question du premier péché capital, à l’origine de tous les vices : l’orgueil.
Docteur K
Chapitre premier
Moi
Il y a des jours commeça.Des jours qui commencent bien et qui se terminent dans le cauchemar. Des jours où on voudrait pouvoir remonter le temps, pas beaucoup, juste de quelques secondes pour changer le cours de la vie.
Je m’appelle Christian Arribeau. Oui, comme les bonbons Haribo. Épargnez-moi les sarcasmes, j’ai eu ma dose.
Je suis médecin néphrologue. Ça veut dire spécialiste en maladies des reins. Pas le mal de dos, non, des maladies bien plus graves, qui conduisent à la dialyse et la greffe. La néphrologie est une spécialité hautement technique et prestigieuse.
Et je vais être nommé bientôt professeur. Enfin, ce matin, j’en étais certain.
*
Je suis le dernier d’une famille de trois enfants. Bien né, comme on dit. Mon père travaillait dans la finance internationale et jouissait d’une bonne situation. Il n’était pas particulièrement brillant, mais il avait trouvé le bon filon et une bonne boîte, au sein de laquelle son portefeuille s’est bien garni. Ses placements complètent une retraite déjà confortable. Ma mère était médecin du travail. Je ne pense pas qu’elle aurait pu se lancer dans une spécialité plus ardue ; elle a terminé sa médecine sans gloire. Évidemment, nous n’avons rencontré aucun problème financier pour entreprendre des études supérieures. Mais mes deux sœurs n’ont pas été bien loin. La première a épousé un banquier alors qu’elle terminait sa deuxième année de droit. De toute façon, je la voyais mal aller au bout de son cursus. La seconde a péniblement décroché un diplôme de sage-femme. Vous allez peut-être me trouver méprisant ; je suis seulement lucide.
Moi, j’ai commencé médecine avec la ferme intention d’arriver au plus haut niveau. Pour ça, j’ai étudié avec soin les filières et les débouchés, et j’ai porté mon choix sur la néphrologie. C’est une discipline astreignante, qui n’attire donc pas beaucoup les étudiants, et en ce moment, la génération née après la Deuxième Guerre mondiale part à la retraite et libère des postes. De plus, un numerus clausus mal évalué a limité le nombre des étudiants en médecine pendant des années et la relève se fait attendre. Mais être nommé professeur d’université est une sacrée course d’obstacles. Il faut ajouter aux études de médecine, longues et compliquées, une licence de sciences dès les premières années et des travaux de recherche en laboratoire ; il faut aussi effectuer des stages, assurer des gardes de nuit et publier des articles scientifiques. Il faut soutenir une thèse de sciences, puis obtenir un diplôme d’habilitation à diriger des recherches. Et enfin trouver un poste, et là, la politique s’en mêle. Il y a beaucoup de candidats pour peu d’élus, et une lutte féroce entre les disciplines au sein de chaque faculté.
J’ai passé toutes ces étapes. Après mon internat, j’ai jeté mon dévolu sur un jeune patron qui venait d’ouvrir un service dans un CHU de la proche banlieue. Nommé à la suite du décès prématuré de son principal concurrent, Hugues Fumeron n’était pas une flèche, mais il était clair qu’il obtiendrait dans les années suivantes la création d’un poste de PU-PH1, d’autant qu’il était un ami proche du doyen de la Faculté.
1 Professeur des universités – praticien hospitalier.
Je n’ai ménagé ni mon temps ni mes efforts. J’ai beaucoup de facilités et une solide formation en biologie et en statistiques qui m’a permis de faire progresser rapidement mes recherches et de publier des résultats originaux. Évidemment, j’avais sélectionné avec soin mon laboratoire, je ne voulais pas rater mon coup.
Ensuite, il m’a fallu écarter les rivaux potentiels. Me montrer plus fort. Cela n’a pas été trop difficile. J’ai de l’assurance en public, je présente bien mes topos, je parle anglais couramment, et avec très peu d’accent, ce qui est rare chez nos concitoyens. On m’a vite remarqué dans les congrès. Juste avant de prendre mon poste de chef de clinique chez Fumeron, j’ai passé un an dans un laboratoire à Sheffield, au Royaume Uni, afin de satisfaire aux conditions de mobilité exigées pour concourir. De retour en France, j’ai obtenu mon habilitation à diriger des recherches et j’ai soutenu ma thèse de sciences. Je me suis investi dans l’enseignement pour confirmer ma motivation. On ne parlait plus que de moi dans la Faculté.
J’avoue que les malades ne me préoccupaient guère. Il ne manquait heureusement pas de « petites mains » dans le service pour s’occuper des consultations, ce qui m’a toujours paru un peu secondaire. Je préfère la gloire à la reconnaissance des patients qui, au demeurant, en manifestent de moins en moins !
Dernier point, last but not least, j’ai épousé la fille du doyen. Céline Dureuil terminait des études de médecine assez médiocres, bien qu’elle eût réussi à passer l’Internat ; elle se destinait à la dermatologie. Je n’ai eu aucun mal à l’éblouir et à la séduire lorsqu’elle est passée comme interne dans le service.
Et, à peine deux ans plus tard, la commission médicale d’établissement et la commission des effectifs de la Faculté attribuaient un poste de PU-PH en tête de liste à mon patron. Le seul candidat digne de ce nom, nonobstant mon âge relativement jeune, c’était moi. Sauf à perdre toute crédibilité, il était impossible de ne pas me mettre en première position, vu ma liste de publications (je savais bien que certains membres de ces commissions ne nourrissaient pas une sympathie excessive à mon égard). La pauvre PH2 du service, comme le MCU-PH3 nommé quelques années plus tôt (et qui pensait naïvement que cette promotion serait un bon tremplin pour lui…) n’avaient aucune chance face à moi.
2 Praticien hospitalier.
3 Maître de conférences des universités – praticien hospitalier.
Le poste fut publié au Journal officiel deux mois plus tard. Aujourd’hui, c’était la dernière étape avant la validation par les ministères concernés (Enseignement supérieur et Recherche, Santé) et la nomination officielle : un exposé devant la section de néphrologie du conseil national des Universités (CNU).
Voilà pourquoi ce matin était le plus beau jour de ma vie.
Chapitre 2
La séance devant le CNU, organisée dans une salle de réunion du service de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière, s’était très bien passée. Deux heures de préparation, une heure de leçon sur un sujet que je connaissais par cœur, puis un exposé de mon projet. Rien à dire. Même Altmann, un des membres du jury qui m’appréciait peu, fut impressionné par la qualité de mon topo. Un de ses collègues qui me raccompagnait à la porte de la salle me donna une petite tape complice dans le dos. C’était gagné.
Je quittai la Pitié le cœur léger. Mes efforts et mes sacrifices de plusieurs années allaient être récompensés ! J’échafaudai aussitôt la suite de mon plan de carrière. Il était hors de question que j’en reste là. J’avais repéré un grand service dans Paris, dont le patron serait bientôt à la retraite et dont aucun des collaborateurs ne possédait à mon avis les qualités suffisantes pour prétendre lui succéder. Une fois nommé là-bas, je bénéficierais d’une unité de recherches sur place, alors que je devais actuellement m’absenter plusieurs fois par semaine pour aller travailler dans un laboratoire de l’ancienne Fac de médecine à l’Odéon.
Je passai un coup de fil à Fumeron pour apaiser ses angoisses, si tant est qu’il en avait, puis à mon épouse, Céline, pour lui annoncer la bonne nouvelle et aussi pour la prévenir que j’allais prendre un pot avec des collègues et que je rentrerais plus tard. Elle cria de joie et me félicita avec chaleur mais, comme d’habitude, elle ne me posa aucune question. Je préférais ça, car elle n’aurait pas aimé savoir où je me rendais.
Je m’installai au volant de ma 208 toute neuve, rejoignis la porte d’Italie, puis empruntai les boulevards des Maréchaux jusqu’à la porte de Vanves et tournai à droite dans la rue Baudry. Par chance, je trouvai une place juste au début. Delphine habitait au 30, dans un petit immeuble moderne. Je composai le code de la porte d’entrée, que je connaissais par cœur, appuyai sur le bouton de l’interphone – la porte s’ouvrit sans qu’on me demandât mon nom – et empruntai l’ascenseur jusqu’au deuxième étage. Je sonnai deux coups rapides, comme d’habitude. Un grincement familier m’avertit que Delphine arrivait. Elle ouvrit la porte avec énergie.
– Alors ? Comment ça s’est passé ?
Elle était assise dans son fauteuil roulant, bien droite, sa jupe longue descendant jusqu’aux chevilles. Je me penchai et déposai un chaste baiser sur ses lèvres. Elle sentait Giorgio, ce parfum qui autrefois me rendait fou. Je la soupçonnais de le porter à dessein lorsque je venais la voir. Il ne se passait plus rien entre nous, mais cette coquetterie n’était peut-être pas innocente.
– Très bien. À mon avis, c’est dans la poche. Manque plus que la signature des ministres.
– Bravo ! Entre, on va fêter ça.
Elle recula un peu, manœuvrant son fauteuil avec dextérité, puis me précéda dans la salle de séjour. Je remarquai sur la table un plateau avec deux flûtes et des coupelles remplies de cacahuètes et de noix de cajou – mes oléagineux préférés. Elle avait tout prévu.
– Peux-tu aller chercher la bouteille de Ruinart rosé dans le réfrigérateur ?
Je m’exécutai avec empressement, débouchai mon champagne favori (une autre délicate attention de mon hôtesse) et versai avec précaution le précieux liquide pétillant dans les deux flûtes. Nous trinquâmes.
– À ton succès !
Je la regardai. Ses yeux vert pâle brillaient derrière ses longs cils. Elle était magnifique.
Delphine Valleur avait été chef de clinique dans un service où j’effectuais ma dernière année d’internat. « Une valeur sûre », plaisantait son patron, qui ne reculait jamais devant un mauvais calembour. C’était une fille brillante, promise à un bel avenir dans un des plus grands services de néphrologie de Paris. Et pour ne rien gâcher, sa beauté magnétique fascinait ses interlocuteurs. Grande, bien faite, blonde aux cheveux longs, et ces yeux extraordinaires dans lesquels j’adorais me perdre. Car, très vite, j’avais jeté mon dévolu sur elle. Pour une fois sans calcul de ma part – elle ne pouvait rien pour ma carrière, c’était plutôt le contraire – mais je la désirais à un point qui m’aurait quasiment fait oublier mes ambitions. Elle représentait pour moi la femme idéale, tant sur le plan physique que sous l’angle intellectuel. Oh, je n’étais naturellement pas le seul sur les rangs, mais c’est moi qu’elle choisit. Fut-elle séduite par mon intelligence, par mon physique plus qu’honorable (je suis brun au teint mat et aux yeux bleus, un petit côté Alain Delon jeune) et émue par mon désir fiévreux que je ne pouvais dissimuler ? Elle m’avoua plus tard qu’il est parfois difficile pour une femme de résister à la passion d’un homme (et cependant, elle n’avait nul besoin d’être rassurée sur son pouvoir de séduction !).
Elle céda donc à mes avances un soir de garde où elle était en réanimation, moi aux urgences, à cette heure avancée de la nuit où l’affluence se tarit un peu, mais où les sens sont aiguisés par le manque de sommeil. Nous nous embrassâmes avec passion, échangeâmes des caresses indiscrètes et voraces, et nous fûmes heureusement dérangés avant de commettre l’irréparable dans sa chambre de garde, ce qui n’aurait pas manqué de faire jaser, car rien de ce qui se passe dans cette chambre n’échappe à l’équipe de nuit ! Mais cette lacune fut comblée dès le lendemain, dans cet appartement de la rue Baudry où je me trouvais ce soir.
Notre liaison me comblait, malgré notre différence d’âge et le fait que nous aspirions tous deux aux plus hautes fonctions dans la même spécialité. J’étais éperdument amoureux de Delphine, et pour une fois je perdais de vue toute autre considération. Enfin, presque. Mais le destin allait mettre en pièces cette belle histoire.
Un jour où Delphine m’apprenait à faire une trachéotomie en réanimation, j’eus un geste malheureux qui entraîna une grave complication. Malgré les efforts de toute l’équipe, le malade décéda quelques jours plus tard. Il s’agissait d’un patient atteint d’une pathologie grave et l’évolution fatale ne surprit personne. Mais la famille, qui avait fait le lien entre cet accident et l’aggravation de son état, ne l’entendit pas de cette oreille et porta plainte au pénal. Delphine eut une réaction admirable. Sachant que je n’avais pas contracté d’assurance professionnelle (un regrettable oubli qui illustrait mon peu d’intérêt pour les activités de soins), et afin d’éviter le risque que l’établissement hospitalier se décharge de toute responsabilité en arguant d’une faute professionnelle de ma part, elle assuma toutes les charges et fit face. La bataille se révéla difficile, car cette famille avait des relations, et la procédure judiciaire battit des records de rapidité. Mais après saisie du dossier et audition des différentes parties à l’Institut médico-légal, les experts mandatés conclurent qu’il n’y avait pas eu de faute professionnelle avérée, que la complication observée faisait partie des risques inhérents à la technique et que les soins et la surveillance ultérieurs avaient été parfaitement adaptés. Le juge décida de ne pas poursuivre l’instruction de l’affaire.
On aurait pu croire qu’on en resterait là. C’était méconnaître la vindicte du clan. J’ai toujours pensé que ces gens, non seulement avaient des appuis haut placés, mais qu’en outre ils entretenaient des liens avec la pègre. Leurs tenues voyantes, leur comportement plein d’arrogance, ces types qui les accompagnaient et qui ressemblaient à des gardes du corps, la difficulté à cerner leurs activités exactes… Je ne pouvais rien prouver, mais lorsque, quelques semaines plus tard, Delphine tomba sur la voie du métro devant une rame, je fus persuadé qu’il s’agissait d’un acte criminel.
Par miracle, elle passa entre les roues du wagon de tête et échappa à la mort, mais le choc entraîna – entre autres – une fracture du rachis au niveau de la cinquième vertèbre lombaire, avec une lésion de la moelle épinière et la paralysie des deux membres inférieurs. L’enquête conclut à un accident. C’était l’heure de pointe, trop de gens se pressaient sur le quai et on attribua sa chute à la bousculade. L’interrogatoire des témoins, l’examen attentif des images tournées par les caméras de surveillance ne révélèrent rien. Lorsque Delphine émergea de son coma, elle ne put donner aucune indication permettant d’imaginer que quelqu’un l’avait poussée volontairement.
Moi, ma conviction était faite. Je me souvenais des regards meurtriers des proches lors de l’annonce du décès et des réflexions menaçantes prononcées à mi-voix : « On ne va pas en rester là ». Mais presque personne ne voulut m’entendre. Ni la police ni la victime elle-même.
L’accident de Delphine – un choc terrible pour tout le service – mit fin à ses projets. Elle décida de changer de spécialité pour ne pas être confrontée au regard de ses anciens collègues et opta pour la Santé publique, un travail sédentaire et pas de gardes. En moins de deux ans, elle obtint un poste universitaire et fut recrutée comme conseillère au ministère de la Santé. Bien qu’elle refusât toute aide extérieure, je continuais à la voir souvent. J’étais toujours aussi amoureux. Mais très vite, elle m’enjoignit de faire ma vie ailleurs.
– Il est hors de question que je sois un fardeau pour toi, Christian. Tu dois te trouver une autre femme et l’épouser. Ce sera mieux pour ta carrière.
– Delphine…
– Non, pour moi, c’est fini. Mais je resterai ton amie, tu le sais.
Et c’est ainsi que, peu de temps après, j’épousai Céline. Néanmoins, il ne se passait pas une semaine sans que j’appelle Delphine. Bientôt, je le fis en cachette : ma femme connaissait, comme tout le monde, notre ancienne liaison ; elle manifestait quelques agacements lorsqu’elle m’entendait lui téléphoner. Heureusement, elle n’était pas trop soupçonneuse – ou ne le montrait pas.
Je racontais tout de ma vie à Delphine. Notre incroyable complicité perdurait. À dire vrai, je la désirais encore. Je n’étais pas un spécialiste de la sexualité des paraplégiques, je savais cependant qu’elle n’était ni abolie ni impossible. Mais mon amie avait tiré un tel rideau de fer sur cet aspect de sa vie que je n’osais aborder le problème. Elle réussissait à m’intimider. C’est bien la seule personne de mon entourage qui en était capable.
Bref, je l’aimais toujours.
Chapitre 3
Ce soir-là, il était près deminuit lorsque je quittai Delphine. Elle m’avait imposé l’intégralité du concerto pour piano d’Aram Khachaturian, un de ses morceaux préférés. À vrai dire, je ne suis pas fan de musique classique, qui m’ennuie plutôt, mais Delphine adore ça (c’est un de nos rares points de divergence) et elle ne perd aucune occasion de chercher à me convertir.
Je m’étais astreint à ne pas dépasser trois flûtes de champagne pour ne pas risquer l’alcootest positif. Et j’avais englouti quantité de cacahuètes, de noix de cajou et aussi les tranches de saucisse sèche qu’elle avait préparées pour moi. Je me sentais tout de même un peu éméché, ou en tout cas très euphorique : le Ruinart, le succès à ma portée immédiate, l’impression aussi que Delphine se laissait un peu aller pour la première fois depuis son accident, quelques années plus tôt. Elle m’avait laissé lui caresser la main pendant que nous écoutions Khachaturian, et ses lèvres s’étaient attardées un court instant sur les miennes au moment où je la quittais. Une seconde qui me parut une éternité et raviva des espoirs fous…
Je m’assis dans ma voiture et essayai de reprendre mes esprits. Il fallait que j’efface mon expression béate d’amoureux transi et que j’arrive à la maison avec l’air de celui qui vient de fêter sa promotion avec des amis. J’actionnai le démarreur et m’engageai dans la rue déserte.
Une fine pluie tapissait le pare-brise. Je mis les essuie-glaces en route.
*
Alors que j’arrivais près du croisement avec la rue Castagnary, un homme surgit sur ma droite, entre deux voitures en stationnement ; il titubait, incapable de retrouver son équilibre et s’effondra juste devant mon capot. Je ne roulais pas vite, mais je réagis avec une demi-seconde de retard : je n’avais allumé que les veilleuses, la rue était assez sombre, et je rêvais encore au doux baiser de Delphine.
J’écrasai la pédale de frein, dérapai sur la chaussée humide et sentis un choc sourd qui se répercuta jusque dans la colonne de direction. Je crois que je m’en souviendrai toute ma vie… Puis la roue avant droite buta sur quelque chose de mou, franchit l’obstacle et, après une grosse secousse, la voiture cala.
J’étais tétanisé, les mains crispées sur le volant, inondé d’une sueur glacée. La rue restait déserte, silencieuse. Personne ne semblait avoir entendu le bruit de l’accident.
Après un long moment, je sortis de la voiture et contournai lentement la carrosserie pour examiner le pare-chocs. Du côté droit, un bras dépassait sous la portière. Immobile. Une flaque de sang s’élargissait autour de la main du mort. Car le piéton était mort, ça ne faisait aucun doute. En m’accroupissant, je vis qu’il s’agissait d’un type en guenilles, sans doute un clochard. Mais Bon Dieu, qu’est-ce qui lui avait pris de traverser aussi brutalement à cet endroit mal éclairé ? Une forte odeur de vinasse parvint à mes narines. Il devait être bourré, ce type.
Je tremblais de tous mes membres, imaginant la suite. Je serais considéré comme responsable de l’accident. Lorsqu’un piéton est blessé, l’automobiliste est toujours en tort. J’imaginais les gros titres : « Le médecin écrase un piéton »… Ça me coûterait ma promotion. Le président de la République ne signerait jamais le décret de nomination d’un candidat impliqué dans un homicide involontaire. Les ministères concernés bloqueraient le dossier. Tous mes efforts de plusieurs années étaient réduits à néant !
À cet instant, je perdis les pédales.
Les environs paraissaient déserts. Il n’y avait aucune habitation dans cette partie de la rue : d’un côté une voie ferrée, de l’autre un transformateur haute tension de la SNCF, bordé d’un terrain de tennis en béton, en piteux état. Pas un passant. Je pouvais tenter de fuir. Pour un clochard renversé par une voiture, l’enquête n’irait pas très loin… C’était jouable. Je pris ma décision en un éclair. Après un dernier regard autour de moi, je remontai dans ma voiture et démarrai aussi doucement que possible. Je sentis un soubresaut lorsque les roues arrière passèrent sur le corps. Je m’arrêtai, ressortis de la voiture, et, tout en jetant des regards nerveux autour de moi, je fis rouler le cadavre entre deux véhicules, pour le masquer au regard des automobilistes.
Je me remis au volant et m’engageai lentement dans la rue Castagnary, qui prenait la suite de la rue Baudry après le funeste croisement. J’atteignis sans encombre le feu rouge de la place du général Moncier. Je commençais à regretter mon coup de tête et j’avais la sensation de commettre une énorme bêtise. Quelqu’un pouvait m’avoir vu : un délit de fuite serait pire que tout. Mais il était trop tard. Ma chemise trempée de sueur collait à mon siège et mes mains tremblaient toujours.
Au feu vert, je démarrai lentement lorsque, brutalement, un choc inouï et un effroyable bruit de tôles me sortirent de ma torpeur. La portière côté passager se tordit et pénétra dans la voiture, atteignant presque le levier de vitesses : l’habitacle rétrécit de moitié. L’airbag se déploya instantanément et m’emprisonna dans mon siège. La violence du choc me fit perdre connaissance.
*
– Monsieur, Monsieur, tout va bien ? Ne bougez pas, les secours arrivent.
J’ouvris les yeux. Un policier, penché vers moi, le regard inquiet, me tenait le poignet, essayant de sentir mon pouls. Une épaisse vapeur d’eau s’échappait du capot enfoncé. Deux voitures de police stationnaient tout près, leurs gyrophares balayant la scène sous une pluie battante. On entendait une sirène de pompiers se rapprocher. Les flics devaient se trouver tout près du lieu de l’accident. Je m’étais évanoui à peine quelques minutes : sur la droite, les deux occupants d’un véhicule encastré dans ma voiture se trouvaient toujours à l’intérieur, derrière le pare-brise en miettes, hagards, le visage en sang. Des policiers les surveillaient.
Voyant que j’émergeais, l’homme continua à me parler.
– Ça va aller. Ils n’iront pas plus loin, ces cinglés. Ils auraient pu vous tuer : ils ont traversé le croisement à fond la caisse au moment où vous démarriez !
– Mais qu’est-ce que vous… faisiez là ? bafouillai-je sans me rendre compte de l’étrangeté de cette question.
– On les poursuivait depuis un long moment. Ils ont refusé de s’arrêter à un contrôle de police, rue Monge, et ils ont grillé je ne sais combien de feux rouges en s’enfuyant. Des collègues prévenus par radio les attendaient près d’ici. On a eu très peur pour vous lorsqu’ils vous ont percuté ! Restez calme, surtout. Voilà les pompiers. Tout va bien se passer.
*
L’ironie du sort voulut que les pompiers m’emmènent à l’hôpital de la Pitié, que j’avais quitté quelques heures plus tôt. Je fus accueilli par le personnel des urgences avec une célérité inhabituelle : j’étais la victime innocente et les pompiers avaient aperçu mon caducée au milieu des débris de mon pare-brise. L’interne et le senior m’examinèrent avec prévenance, surtout lorsque je leur expliquai la raison pour laquelle j’étais dans les murs de l’hôpital l’après-midi. Vu les circonstances de l’accident, exposées en détail par les policiers, on oublia le contrôle de mon alcoolémie, qui aurait bien pu se trouver un peu au-dessus du seuil légal !
Par miracle, je n’avais rien de cassé, que des contusions superficielles, et pas de plaie à suturer. Mon portable n’ayant pas été endommagé par le choc, je m’isolai dès que ce fut possible pour téléphoner.
J’avais deux SMS de Delphine, qui se demandait sûrement pourquoi je ne la prévenais pas que j’étais bien rentré, comme je le faisais à chaque fois. Mais je remis leur lecture à plus tard. Il fallait que j’appelle ma femme, qui devait s’inquiéter. Elle décrocha dès la deuxième sonnerie.
– Mais où es-tu ? Je croyais que tu devais juste prendre un pot !
– Céline, j’aurais dû arriver depuis longtemps, mais j’ai eu un accident sur le chemin du retour. Une voiture a brûlé un feu rouge et m’est rentrée dedans.
– Quoi ? Tu es blessé ?
– Rassure-toi, rien de cassé. Je n’en dirai pas autant de la voiture. Elle est foutue. Mais les flics étaient là. Ils poursuivaient le véhicule qui m’a percuté. Je suis à la Pitié, aux urgences. J’espère qu’ils vont me lâcher et je rentrerai en taxi. Je te tiens au courant dès que j’en sais plus.
– Mon Dieu, quelle histoire ! Au moins, tu n’as rien. Ça s’est passé où ?
Je fus pris de court. Mais je ne pouvais pas lui mentir sur le lieu de l’accident. Elle l’apprendrait un jour ou l’autre. Je m’apprêtai donc à lui dire, mais mon hésitation ne lui avait pas échappé.
– Bon, j’ai compris… Tu sortais de chez Delphine.