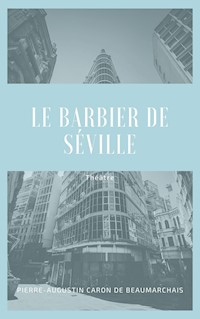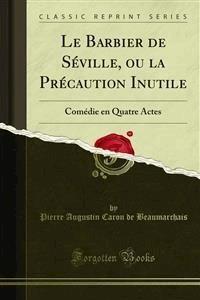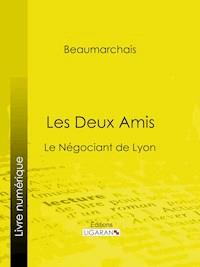Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
« Le Barbier de Séville » de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est une comédie en quatre actes qui met en scène l'ingénieux barbier Figaro et son maître, le Comte Almaviva. L'intrigue se déroule à Séville, où le Comte est tombé amoureux de la belle Rosine, pupille du vieux docteur Bartholo qui projette de l'épouser. Le Comte sollicite l'aide de Figaro pour conquérir le coeur de Rosine et déjouer les plans de Bartholo. S'ensuit une série de stratagèmes et de quiproquos hilarants. Almaviva se déguise d'abord en étudiant pauvre nommé Lindor, puis en soldat ivre, et enfin en maître de musique, tout cela pour s'introduire dans la maison de Bartholo et approcher Rosine. Figaro, véritable moteur de l'intrigue, use de son esprit vif et de sa ruse pour orchestrer les rencontres entre les amoureux et contrecarrer les soupçons de Bartholo. Il manipule habilement les situations, jouant sur les faiblesses et les travers des personnages. La pièce est ponctuée de dialogues spirituels et de scènes comiques mémorables, comme la leçon de musique ou la scène du billet. Beaumarchais y critique avec finesse les conventions sociales de son époque, notamment le mariage arrangé et l'autorité abusive des tuteurs sur leurs pupilles. « Le Barbier de Séville » est une oeuvre qui allie brillamment comédie et satire sociale. Elle marque l'avènement de Figaro, personnage emblématique qui incarne l'esprit frondeur et l'intelligence du peuple face à l'aristocratie. La pièce, avec son rythme enlevé et ses personnages hauts en couleur, reste un classique intemporel du théâtre français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PERSONNAGES
ACTE PREMIER
Scène I
Scène II
Scène III
Scène IV
Scène V
Scène VI
ACTE DEUXIÈME
Scène I
Scène II
Scène III
Scène IV
Scène V
Scène VI
Scène VII
Scène VIII
Scène IX
Scène X
Scène XI
Scène XII
Scène XIII
Scène XIV
Scène XV
Scène XVI
ACTE TROISIÈME
Scène I
Scène II
Scène III
Scène IV
Scène V
Scène VI
Scène VII
Scène VIII
Scène IX
Scène X
Scène XI
Scène XII
Scène XIII
Scène XIV
ACTE QUATRIÈME
Scène I
Scène II
Scène III
Scène IV
Scène V
Scène VI
Scène VII
Scène VIII
FIN DU BARBIER DE SÉVILLE.
(L’auteur, vêtu modestement et courbé, présentant sa pièce au lecteur.)
MONSIEUR,
J’ai l’honneur de vous offrir un nouvel opuscule de ma façon. Je souhaite vous rencontrer dans un de ces moments heureux où, dégagé de soins, content de votre santé, de vos affaires, de votre maîtresse, de votre dîner, de votre estomac, vous puissiez vous plaire un moment à la lecture de mon Barbier de Séville : car il faut tout cela pour être homme amusable et lecteur indulgent.
Mais si quelque accident a dérangé votre santé ; si votre état est compromis ; si votre belle a forfait à ses serments ; si votre dîner fut mauvais, ou votre digestion laborieuse, ah ! laissez mon Barbier ; ce n’est pas là l’instant : examinez l’état de vos dépenses, étudiez le factum de votre adversaire, relisez ce traître billet surpris à Rose, ou parcourez les chefs-d’œuvre de Tissot sur la tempérance, et faites des réflexions politiques, économiques, diététiques, philosophiques ou morales.
Ou si votre état est tel qu’il vous faille absolument l’oublier, enfoncez-vous dans une bergère, ouvrez le journal établi dans Bouillon avec encyclopédie, approbation et privilège, et dormez vite une heure ou deux.
Quel charme aurait une production légère au milieu des plus noires vapeurs ? Et que vous importe en effet si Figaro le barbier s’est bien moqué de Bartholo le médecin, en aidant un rival à lui souffler sa maîtresse ? On rit peu de la gaieté d’autrui, quand on a de l’humeur pour son propre compte.
Que vous fait encore si ce barbier espagnol, en arrivant dans Paris, essuya quelques traverses, et si la prohibition de ses exercices a donné trop d’importance aux rêveries de mon bonnet ? On ne s’intéresse guère aux affaires des autres que lorsqu’on est sans inquiétude sur les siennes.
Mais enfin tout va-t-il bien pour vous ? Avez-vous à souhait double estomac, bon cuisinier, maîtresse honnête, et repos imperturbable ? Ah ! parlons, parlons : donnez audience à mon Barbier.
Je sens trop, monsieur, que ce n’est plus le temps où, tenant mon manuscrit en réserve, et semblable à la coquette qui refuse souvent ce qu’elle brûle toujours d’accorder, j’en faisais quelque avare lecture à des gens préférés, qui croyaient devoir payer ma complaisance par un éloge pompeux de mon ouvrage.
Ô jours heureux ! Le lieu, le temps, l’auditoire à ma dévotion, et la magie d’une lecture adroite assurant mon succès, je glissais sur le morceau faible en appuyant sur les bons endroits : puis, recueillant les suffrages du coin de l’œil, avec une orgueilleuse modestie je jouissais d’un triomphe d’autant plus doux que le jeu d’un fripon d’acteur ne m’en dérobait pas les trois quarts pour son compte.
Que reste-t-il, hélas ! de toute cette gibecière ? À l’instant qu’il faudrait des miracles pour vous subjuguer, quand la verge de Moïse y suffirait à peine, je n’ai plus même la ressource du bâton de Jacob ; plus d’escamotage, de tricherie, de coquetterie, d’inflexions de voix, d’illusion théâtrale, rien. C’est ma vertu toute nue que vous allez juger.
Ne trouvez donc pas étrange, monsieur, si, mesurant mon style à ma situation, je ne fais pas comme ces écrivains qui se donnent le ton de vous appeler négligemment : lecteur, ami lecteur, cher lecteur, bénin ou benoist lecteur ou de telle autre dénomination cavalière, je dirais même indécente, par laquelle ces imprudents essayent de se mettre au pair avec leur juge, et qui ne fait bien souvent que leur en attirer l’animadversion. J’ai toujours vu que les airs ne séduisaient personne, et que le ton modeste d’un auteur pouvait seul inspirer un peu d’indulgence à son fier lecteur.
Eh ! quel écrivain en eut jamais plus besoin que moi ? Je voudrais le cacher en vain : j’eus la faiblesse autrefois, monsieur, de vous présenter, en différents temps, deux tristes drames : productions monstrueuses, comme on sait ! car, entre la tragédie et la comédie, on n’ignore plus qu’il n’existe rien ; c’est un point décidé, le maître l’a dit, l’école en retentit, et pour moi j’en suis tellement convaincu, que, si je voulais aujourd’hui mettre au théâtre une mère éplorée, une épouse trahie, une sœur éperdue, un fils déshérité ; pour les présenter décemment au public, je commencerais par leur supposer un beau royaume où ils auraient régné de leur mieux, vers l’un des archipels, ou dans tel autre coin du monde : certain après cela que l’invraisemblance du roman, l’énormité des faits, l’enflure des caractères, le gigantesque des idées et la bouffissure du langage, loin de m’être imputés à reproche, assureraient encore mon succès.
Présenter des hommes d’une condition moyenne accablés et dans le malheur ! Fi donc ! on ne doit jamais les montrer que bafoués. Les citoyens ridicules, et les rois malheureux, voilà tout le théâtre existant et possible ; et je me le tiens pour dit, c’est fait ; je ne veux plus quereller avec personne.
J’ai eu la faiblesse autrefois, monsieur, de faire des drames qui n’étaient pas du bon genre ; et je m’en repens beaucoup.
Pressé depuis par les événements, j’ai hasardé de malheureux Mémoires, que mes ennemis n’ont pas trouvés du bon style ; et j’en ai le remords cruel.
Aujourd’hui je fais glisser sous vos yeux une comédie fort gaie, que certains maîtres de goût n’estiment pas du bon ton ; et je ne m’en console point.
Peut-être un jour oserai-je affliger votre oreille d’un opéra, dont les jeunes gens d’autrefois diront que la musique n’est pas du bon français ; et j’en suis tout honteux d’avance.
Ainsi, de fautes en pardons, et d’erreurs en excuses, je passerai ma vie à mériter votre indulgence, par la bonne foi naïve avec laquelle je reconnaîtrai les unes en vous présentant les autres.
Quant au Barbier de Séville, ce n’est pas pour corrompre votre jugement que je prends ici le ton respectueux : mais on m’a fort assuré que, lorsqu’un auteur était sorti, quoiqu’échiné, vainqueur au théâtre, il ne lui manquait plus que d’être agréé par vous, monsieur, et lacéré dans quelques journaux, pour avoir obtenu tous les lauriers littéraires. Ma gloire est donc certaine, si vous daignez m’accorder le laurier de votre agrément, persuadé que plusieurs de messieurs les journalistes ne me refuseront pas celui de leur dénigrement.
Déjà l’un d’eux, établi dans Bouillon avec approbation et privilège, m’a fait l’honneur encyclopédique d’assurer à ses abonnés que ma pièce était sans plan, sans unité, sans caractères, vide d’intrigue et dénuée de comique.
Un autre plus naïf encore, à la vérité sans approbation, sans privilège, et même sans encyclopédie, après un candide exposé de mon drame, ajoute au laurier de sa critique cet éloge flatteur de ma personne : « La réputation du sieur de Beaumarchais est bien tombée ; et les honnêtes gens sont enfin convaincus que lorsqu’on lui aura arraché les plumes du paon, il ne restera plus qu’un vilain corbeau noir, avec son effronterie et sa voracité. »
Puisqu’en effet j’ai eu l’effronterie de faire la comédie du Barbier de Séville, pour remplir l’horoscope entier, je pousserai la voracité jusqu’à vous prier humblement, monsieur, de me juger vous-même, et sans égard aux critiques passés, présents et futurs ; car vous savez que, par état, les gens de feuilles sont souvent ennemis des gens de lettres ; j’aurai même la voracité de vous prévenir qu’étant saisi de mon affaire, il faut que vous soyez mon juge absolument, soit que vous le vouliez ou non, car vous êtes mon lecteur.
Et vous sentez bien, monsieur, que si, pour éviter ce tracas, ou me prouver que je raisonne mal, vous refusiez constamment de me lire, vous feriez vous-même une pétition de principe au-dessous de vos lumières : n’étant pas mon lecteur, vous ne seriez pas celui à qui s’adresse ma requête.
Que si, en dépit de la dépendance où je parais vous mettre, vous vous avisiez de jeter le livre en cet instant de votre lecture, c’est, monsieur, comme si, au milieu de tout autre jugement, vous étiez enlevé du tribunal par la mort, ou tel accident qui vous rayât du nombre des magistrats. Vous ne pouvez éviter de me juger qu’en devenant nul, négatif, anéanti : qu’en cessant d’exister en qualité de mon lecteur.
Eh ! quel tort vous fais-je en vous élevant au-dessus de moi ? Après le bonheur de commander aux hommes, le plus grand honneur, monsieur, n’est-il pas de les juger ?
Voilà donc qui est arrangé. Je ne reconnais plus d’autre juge que vous, sans excepter messieurs les spectateurs, qui, ne jugeant qu’en premier ressort, voient souvent leur sentence infirmée à votre tribunal.
L’affaire avait d’abord été plaidée devant eux au théâtre ; et ces messieurs ayant beaucoup ri, j’ai pu penser que j’avais gagné ma cause à l’audience. Point du tout ; le journaliste, établi dans Bouillon, prétend que c’est de moi qu’on a ri. Mais ce n’est là, monsieur, comme on dit en style de palais, qu’une mauvaise chicane de procureur : mon but ayant été d’amuser les spectateurs, qu’ils aient ri de ma pièce ou de moi, s’ils ont ri de bon cœur, le but est également rempli : ce que j’appelle avoir gagné ma cause à l’audience.
Le même journaliste assure encore, ou du moins laisse entendre, que j’ai voulu gagner quelques-uns de ces messieurs, en leur faisant des lectures particulières, en achetant d’avance leur suffrage par cette prédilection. Mais ce n’est encore là, monsieur, qu’une difficulté de publiciste allemand. Il est manifeste que mon intention n’a jamais été que de les instruire : c’étaient des espèces de consultations que je faisais sur le fond de l’affaire. Que si les consultants, après avoir donné leur avis, se sont mêlés parmi les juges, vous voyez bien, monsieur, que je n’y pouvais rien de ma part, et que c’était à eux de se récuser par délicatesse, s’ils se sentaient de la partialité pour mon barbier andalou.
Eh ! plût au ciel qu’ils en eussent un peu conservé pour ce jeune étranger ! nous aurions eu moins de peine à soutenir notre malheur éphémère. Tels sont les hommes : avez-vous du succès, ils vous accueillent, vous portent, vous caressent, ils s’honorent de vous ; mais gardez de broncher dans la carrière ! au moindre échec, ô mes amis, souvenez-vous qu’il n’est plus d’amis.
Et c’est précisément ce qui nous arriva le lendemain de la plus triste soirée. Vous eussiez vu les faibles amis du Barbier se disperser, se cacher le visage ou s’enfuir : les femmes, toujours si braves quand elles protègent, enfoncées dans les coqueluchons jusqu’aux panaches, et baissant des yeux confus ; les hommes courant se visiter, se faire amende honorable du bien qu’ils avaient dit de ma pièce, et rejetant sur ma maudite façon de lire les choses tout le faux plaisir qu’ils y avaient goûté. C’était une désertion totale, une vraie désolation.
Les uns lorgnaient à gauche, en me sentant passer à droite, et ne faisaient plus semblant de me voir. Ah dieux ! d’autres, plus courageux, mais s’assurant bien si personne ne les regardait, m’attiraient dans un coin pour me dire : Eh ! comment avez-vous produit en nous cette illusion ? car, il faut en convenir, mon ami, votre pièce est la plus grande platitude du monde.
— Hélas, messieurs ! j’ai lu ma platitude, en vérité, tout platement comme je l’avais faite ; mais, au nom de la bonté que vous avez de me parler encore après ma chute, et pour l’honneur de votre second jugement, ne souffrez pas qu’on redonne la pièce au théâtre : si, par malheur, on venait à la jouer comme je l’ai lue, on vous ferait peut-être une nouvelle tromperie, et vous vous en prendriez à moi de ne plus savoir quel jour vous eûtes raison ou tort : ce qu’à Dieu ne plaise !
On ne m’en crut point : on laissa rejouer la pièce, et pour le coup je fus prophète en mon pays. Ce pauvre Figaro, fessé par la cabale en faux-bourdon et presque enterré le vendredi, ne fit point comme Candide : il prit courage, et mon héros se releva le dimanche avec une vigueur que l’austérité d’un carême entier, et la fatigue de dix-sept séances publiques, n’ont pas encore altérée. Mais qui sait combien cela durera ? Je ne voudrais pas jurer qu’il en fût seulement question dans cinq ou six siècles, tant notre nation est inconstante et légère.
Les ouvrages de théâtre, monsieur, sont comme les enfants des femmes. Conçus avec volupté, menés à terme avec fatigue, enfantés avec douleur, et vivant rarement assez pour payer les parents de leurs soins, ils coûtent plus de chagrins qu’ils ne donnent de plaisirs. Suivez-les dans leur carrière ; à peine ils voient le jour, que, sous prétexte d’enflure, on leur applique les censeurs ; plusieurs en sont restés en chartre. Au lieu de jouer doucement avec eux, le cruel parterre les rudoie et les fait tomber. Souvent, en les berçant, le comédien les estropie. Les perdez-vous un instant de vue, on les retrouve, hélas ! traînants partout, mais dépenaillés, défigurés, rongés d’extraits, et couverts de critiques. Échappés à tant de maux, s’ils brillent un moment dans le monde, le plus grand de tous les atteint : le mortel oubli les tue ; ils meurent, et, replongés au néant, les voilà perdus à jamais dans l’immensité des livres.
Je demandais à quelqu’un pourquoi ces combats, cette guerre animée entre le parterre et l’auteur, à la première représentation des ouvrages, même de ceux qui devaient plaire un autre jour. Ignorez-vous, me dit-il, que Sophocle et le vieux Denys sont morts de joie d’avoir remporté le prix des vers au théâtre ? Nous aimons trop nos auteurs pour souffrir qu’un excès de joie nous prive d’eux, en les étouffant : aussi, pour les conserver, avons-nous grand soin que leur triomphe ne soit jamais si pur, qu’ils puissent en expirer de plaisir.
Quoi qu’il en soit des motifs de cette rigueur, l’enfant de mes loisirs, ce jeune, cet innocent Barbier, tant dédaigné le premier jour, loin d’abuser le surlendemain de son triomphe, ou de montrer de l’humeur à ses critiques, ne s’en est que plus empressé de les désarmer par l’enjouement de son caractère.
Exemple rare et frappant, monsieur, dans un siècle d’ergotisme où l’on calcule tout jusqu’au rire ; où la plus légère diversité d’opinions fait germer des haines éternelles ; où tous les jeux tournent en guerre ; où l’injure qui repousse l’injure est à son tour payée par l’injure, jusqu’à ce qu’une autre effaçant cette dernière en enfante une nouvelle, auteur de plusieurs autres, et propage ainsi l’aigreur à l’infini, depuis le rire jusqu’à la satiété, jusqu’au dégoût, à l’indignation même du lecteur le plus caustique.
Quant à moi, monsieur, s’il est vrai, comme on l’a dit, que tous les hommes soient frères (et c’est une belle idée), je voudrais qu’on pût engager nos frères les gens de lettres à laisser, en discutant, le ton rogue et tranchant à nos frères les libellistes qui s’en acquittent si bien, ainsi que les injures à nos frères les plaideurs… qui ne s’en acquittent pas mal non plus ! Je voudrais surtout qu’on pût engager nos frères les journalistes à renoncer à ce ton pédagogue et magistral avec lequel ils gourmandent les fils d’Apollon, et font rire la sottise aux dépens de l’esprit.
Ouvrez un journal : ne semble-t-il pas voir un dur répétiteur, la férule ou la verge levée sur des écoliers négligents, les traiter en esclaves au plus léger défaut dans le devoir ? Eh ! mes frères, il s’agit bien de devoir ici ! La littérature en est le délassement et la douce récréation.