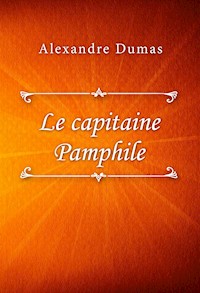
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce roman trop oublié est un chef-d’œuvre unique chez Dumas. Il aurait pu être signé de Sterne, ou de Swift c’est dans leur ton qu’il évoque la traite des noirs. Le récit est plein de gaieté et de verve, de burlesque parodique : on y trouve les grandes scènes du roman d’aventures, la prise du navire marchand, la mutinerie à bord, l’Amérique de Fenimore Cooper. Les personnages sont empruntés à la tradition comique : l’Anglais en proie au spleen, le trompeur, le gourmand, le niais, le chef indien. C’est aussi une œuvre sombre : une suite de morts, animaux massacrés, esclaves tués en route, immigrants anglais décimés par la maladie, indigènes exterminés. Le héros, Pamphile, incarne la société commerçante et pharisienne dans laquelle l’artiste est condamné à vivre. C’est le monde de Monte-Cristo sans le comte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexandre Dumas
LE CAPITAINE PAMPHILE
Copyright
First published in 1839
Copyright © 2018 Classica Libris
1
Introduction à l’aide de laquelle le lecteur fera connaissance avec les principaux personnages de cette histoire et avec l’auteur qui l’a écrite.
Je passais, en 1831, devant la porte de Chevet, lorsque j’aperçus, dans la boutique, un Anglais qui tournait et retournait en tous sens une tortue qu’il marchandait avec l’intention d’en faire, aussitôt qu’elle serait devenue sa propriété, une turtle soup.
L’air de résignation profonde avec lequel le pauvre animal se laissait examiner, sans même essayer de se soustraire en rentrant dans son écaille, au regard cruellement gastronomique de son ennemi, me toucha. Il me prit une envie soudaine de l’arracher à la marmite, dans laquelle étaient déjà plongées ses pattes de derrière ; j’entrai dans le magasin, où j’étais fort connu à cette époque, et, faisant un signe de l’œil à madame Beauvais, je lui demandai si elle m’avait conservé la tortue que j’avais retenue, la veille, en passant.
Madame Beauvais me comprit avec cette soudaineté d’intelligence qui distingue la classe marchande parisienne, et, faisant glisser poliment la bête des mains du marchandeur, elle la remit entre les miennes, en disant, avec un accent anglais très prononcé, à notre insulaire, qui la regardait la bouche béante :
– Pardon, milord, la petite tortue, il être vendue à monsieur depuis ce matin.
– Ah ! me dit en très bon français le milord improvisé, c’est à vous, monsieur, qu’appartient cette charmante bête ?
– Yes, yes, milord, répondit madame Beauvais.
– Eh bien, monsieur, continua-t-il, vous avez là un petit animal qui fera d’excellente soupe ; je n’ai qu’un regret, c’est qu’il soit le seul de son espèce que possède en ce moment madame la marchande.
– Nous have la espoir d’en recevoir d’autres demain matin, répondit madame Beauvais.
– Demain, il sera trop tard, répondit froidement l’Anglais ; j’ai arrangé toutes mes affaires pour me brûler la cervelle cette nuit, et je désirais, auparavant, manger une soupe à la tortue.
En disant ces mots, il me salua et sortit.
– Pardieu ! me dis-je après un moment de réflexion, c’est bien le moins qu’un aussi galant homme se passe un dernier caprice.
Et je m’élançai hors du magasin en criant, comme madame Beauvais :
– Milord ! milord !
Mais je ne savais pas où milord était passé ; il me fut impossible de mettre la main dessus.
Je revins chez moi tout pensif : mon humanité envers une bête était devenue une inhumanité envers un homme. La singulière machine que ce monde, où l’on ne peut faire le bien de l’un sans le mal de l’autre ! Je gagnai la rue de l’Université, je montai mes trois étages, et je déposai mon acquisition sur le tapis.
C’était tout bonnement une tortue de l’espèce la plus commune : testudo lutaria, sive aquarum dulcium ; ce qui veut dire, selon Linné chez les anciens, et selon Ray chez les modernes, tortue de marais ou tortue d’eau douce.[1]
Or, la tortue de marais ou la tortue d’eau douce tient à peu près, dans l’ordre social des chéloniens, le rang correspondant à celui que tiennent chez nous, dans l’ordre civil, les épiciers, et, dans l’ordre militaire, la garde nationale.
C’était bien, du reste, le plus singulier corps de tortue qui eût jamais passé les quatre pattes, la tête et la queue par les ouvertures d’une carapace. À peine se sentit-elle sur le plancher, qu’elle me donna une preuve de son originalité en piquant droit vers la cheminée avec une rapidité qui lui valut à l’instant même le nom de Gazelle, en faisant tous ses efforts pour passer entre les branches du garde-cendre, afin d’arriver jusqu’au feu, dont la lueur l’attirait ; enfin, voyant, au bout d’une heure, que ce qu’elle désirait était impossible, elle prit le parti de s’endormir, après avoir préalablement passé sa tête et ses pattes par l’une des ouvertures les plus rapprochées du foyer, choisissant ainsi, pour son plaisir particulier, une température de cinquante à cinquante-cinq degrés de chaleur, à peu près ; ce qui me fit croire que, soit vocation, soit fatalité, elle était destinée à être rôtie un jour ou l’autre, et que je n’avais fait que changer son mode de cuisson en la retirant du pot-au-feu de mon Anglais pour la transporter dans ma chambre. La suite de cette histoire prouvera que je ne m’étais pas trompé.
Comme j’étais obligé de sortir et que je craignais qu’il n’arrivât malheur à Gazelle, j’appelai mon domestique.
– Joseph, lui dis-je, lorsqu’il parut, vous prendrez garde à cette bête.
Il s’en approcha avec curiosité.
– Ah ! tiens, dit-il, c’est une tortue... Ça porte une voiture.
– Oui, je le sais ; mais je désire qu’il ne vous en prenne jamais l’envie d’en faire l’expérience.
– Oh ! ça ne lui ferait pas de mal, reprit Joseph, qui tenait à déployer devant moi ses connaissances en histoire naturelle ; la diligence de Laon passerait sur son dos, qu’elle ne l’écraserait pas.
Joseph citait la diligence de Laon, parce qu’il était de Soissons.
– Oui, lui dis-je, je crois bien que la grande tortue de mer, la tortue franche, testudo mydas, pourrait porter un pareil poids ; mais je doute que celle-ci, qui est de plus petite espèce...
– Ça ne veut rien dire, reprit Joseph : c’est fort comme un Turc, ces petites bêtes-là ; et, voyez-vous, une charrette de roulier passerait...
– C’est bien, c’est bien ; vous lui achèterez de la salade et des escargots.
– Tiens ! des escargots... ? Est-ce qu’elle a mal à la poitrine ? Le maître chez lequel j’étais avant d’entrer chez monsieur prenait du bouillon d’escargots parce qu’il était physique – eh bien, ça ne l’a pas empêché...
Je sortis sans écouter le reste de l’histoire ; au milieu de l’escalier, je m’aperçus que j’avais oublié mon mouchoir de poche : je remontai aussitôt. Je trouvai Joseph, qui ne m’avait pas entendu rentrer, faisant l’Apollon du Belvédère, un pied posé sur le dos de Gazelle et l’autre suspendu en l’air, afin que pas un grain des cent trente livres que le drôle pesait ne fût perdu par la pauvre bête.
– Que faites-vous là, imbécile ?
– Je vous l’avais bien dit, monsieur, répondit Joseph tout fier de m’avoir prouvé en partie ce qu’il avançait.
– Donnez-moi un mouchoir, et ne touchez jamais à cette bête.
– Voilà, monsieur, me dit Joseph en m’apportant l’objet demandé... Mais il n’y a aucune crainte à avoir pour elle... un wagon passerait dessus...
Je m’enfuis au plus vite ; mais je n’avais pas descendu vingt marches, que j’entendis Joseph qui fermait ma porte en marmottant entre ses dents :
– Pardieu ! je sais ce que je dis... Et puis, d’ailleurs, on voit bien, à la conformation de ces animaux, qu’un canon chargé à mitraille pourrait...
Heureusement, le bruit qu’on faisait dans la rue m’empêcha d’entendre la fin de la maudite phrase.
Le soir, je rentrai assez tard, comme c’est ma coutume. Aux premiers pas que je fis dans ma chambre, je sentis que quelque chose craquait sous ma botte. Je levai vitement le pied, rejetant tout le poids de mon corps sur l’autre jambe : le même craquement se fit entendre de nouveau ; je crus que je marchais sur des œufs. Je baissai ma bougie... Mon tapis était couvert d’escargots.
Joseph m’avait ponctuellement obéi : il avait acheté de la salade et des escargots, avait mis le tout dans un panier au milieu de ma chambre ; dix minutes après, soit que la température de l’appartement les eût dégourdis, soit que la peur d’être croqués se fût emparée d’eux, toute la caravane s’était mise en route, et elle avait même déjà fait passablement de chemin ; ce qui était facile à juger par les traces argentées qu’ils avaient laissées sur les tapis et sur les meubles.
Quant à Gazelle, elle était restée au fond du panier, contre les parois duquel elle n’avait pu grimper. Mais quelques coquilles vides me prouvèrent que la fuite des Israélites n’avait pas été si rapide, qu’elle n’eût mis la dent sur quelques-uns avant qu’ils eussent le temps de traverser la mer Rouge.
Je commençai aussitôt une revue exacte du bataillon qui manœuvrait dans ma chambre, et par lequel je me souciais peu d’être chargé pendant la nuit ; puis, prenant délicatement de la main droite tous les promeneurs, je les fis rentrer, les uns après les autres, dans leur corps de garde, que je tenais de la main gauche, et dont je fermai le couvercle sur eux.
Au bout de cinq minutes, je m’aperçus, que, si je laissais toute cette ménagerie dans ma chambre, je courais le risque de ne pas dormir une minute ; c’était un bruit, comme si on eût enfermé une douzaine de souris dans un sac de noix : je pris donc le parti de transporter le tout à la cuisine.
Chemin faisant, je songeai qu’au train dont allait Gazelle, je la trouverais morte d’indigestion le lendemain si je la laissais au milieu d’un magasin de vivres aussi copieux ; au même moment et comme par inspiration, j’avisai dans mon souvenir certain baquet placé dans la cour et dans lequel le restaurateur du rez-de-chaussée mettait dégorger son poisson : cela me parut une si merveilleuse hôtellerie pour une testudo aquarum dulcium, que je jugeai inutile de me casser la tête à lui en chercher une autre, et que, la tirant de son réfectoire, je la portai directement au lieu de sa destination.
Je remontai bien vite et m’endormis, persuadé que j’étais l’homme de France le plus ingénieux en expédients.
Le lendemain, Joseph me réveilla dès le matin.
– Oh ! monsieur, en voilà une farce ! me dit-il en se plantant devant mon lit.
– Quelle farce ?
– Celle que votre tortue a faite.
– Comment ?
– Eh bien, croiriez-vous qu’elle est sortie de votre appartement, ça, je ne sais pas comment... qu’elle a descendu les trois étages, et qu’elle a été se mettre au frais dans le vivier du restaurateur ?
– Imbécile ! tu n’as pas deviné que c’était moi qui l’y avais portée ?
– Ah bon... ! Vous avez fait là un beau coup, alors !
– Pourquoi cela ?
– Pourquoi ? Parce qu’elle a mangé la tanche, une tanche superbe qui pesait trois livres.
– Allez me chercher Gazelle, et apportez-moi des balances.
Pendant que Joseph exécutait cet ordre, j’allai à ma bibliothèque, j’ouvris mon Buffon à l’article tortue ; car je tenais à m’assurer si ce chélonien était ichtyophage, et je lus ce qui suit :
« Cette tortue d’eau douce, testudo aquarum dulcium (c’était bien cela), aime surtout les marais et les eaux dormantes ; lorsqu’elle est dans une rivière ou dans un étang, alors elle attaque tous les poissons indistinctement, même les plus gros : elle les mord sous le ventre, les y blesse fortement, et, lorsqu’ils sont épuisés par la perte du sang, elle les dévore avec la plus grande avidité et ne laisse guère que les arêtes, la tête des poissons, et même leur vessie natatoire, qui remonte quelquefois à la surface de l’eau. »
– Diable ! diable ! dis-je ; le restaurateur a pour lui Monsieur de Buffon : ce qu’il dit pourrait bien être vrai.
J’étais en train de méditer sur la probabilité de l’accident, lorsque Joseph rentra, tenant l’accusée d’une main et les balances de l’autre.
– Voyez-vous, me dit Joseph, ça mange beaucoup, ces sortes d’animaux, pour entretenir leurs forces, et du poisson surtout, parce que c’est très nourrissant ; est-ce que vous croyez que, sans cela, ça pourrait porter une voiture... ? Voyez, dans les ports de mer, comme les matelots sont robustes ; c’est parce qu’ils ne mangent que du poisson.
J’interrompis Joseph.
– Combien pesait la tanche ?
– Trois livres : c’est neuf francs que le garçon réclame.
– Et Gazelle l’a mangée tout entière ?
– Oh ! elle n’a laissé que l’arête, la tête et la vessie.
– C’est bien cela ! Monsieur de Buffon est un grand naturaliste. Cependant, continuai-je à demi-voix, trois livres... cela me paraît fort.[2]
Je mis Gazelle dans la balance ; elle ne pesait que deux livres et demie avec sa carapace.
Il résultait de cette expérience, non point que Gazelle fût innocente du fait dont elle était accusée, mais qu’elle devait avoir commis le crime sur un cétacé d’un plus médiocre volume.
Il paraît que ce fut aussi l’avis du garçon ; car il parut fort content de l’indemnité de cinq francs que je lui donnai.
L’aventure des limaçons et l’accident de la tanche me rendirent moins enthousiaste de ma nouvelle acquisition ; et, comme le hasard fit que je rencontrai, le même jour, un de mes amis, homme original et peintre de génie, qui faisait à cette époque une ménagerie de son atelier, je le prévins que j’augmenterais le lendemain sa collection d’un nouveau sujet, appartenant à l’estimable catégorie des chéloniens, ce qui parut le réjouir beaucoup.
Gazelle coucha cette nuit dans ma chambre, où tout se passa fort tranquillement, vu l’absence des escargots.
Le lendemain, Joseph entra chez moi, comme d’habitude, roula le tapis de pied de mon lit, ouvrit la fenêtre, et se mit à le secouer pour en extraire la poussière ; mais tout à coup il poussa un grand cri et se pencha hors de la fenêtre comme s’il eût voulu se précipiter.
– Qu’y a-t-il donc, Joseph ? dis-je à moitié éveillé.
– Ah ! monsieur, il y a que votre tortue était couchée sur le tapis, je ne l’ai pas vue...
– Et... ?
– Et, ma foi ! sans le faire exprès, je l’ai secouée par la fenêtre.
– Imbécile... !
Je sautai à bas de mon lit.
– Tiens ! dit Joseph, dont la figure et la voix reprenaient une expression de sérénité tout à fait rassurante, tiens ! elle mange un chou !
En effet, la bête, qui avait rentré par instinct tout son corps dans sa cuirasse, était tombée par hasard sur un tas d’écailles d’huîtres, dont la mobilité avait amorti le coup, et, trouvant à sa portée un légume à sa convenance, elle avait sorti tout doucement la tête hors de sa carapace, et s’occupait de son déjeuner aussi tranquillement que si elle ne venait pas de tomber d’un troisième étage.
– Je vous le disais bien, monsieur ! répétait Joseph dans la joie de son âme, je vous le disais bien, qu’à ces animaux rien ne leur faisait. – Eh bien, pendant qu’elle mange, voyez-vous, une voiture passerait dessus...
– N’importe, descendez vite et allez me la chercher.
Joseph obéit. Pendant ce temps, je m’habillai, occupation que j’eus terminée avant que Joseph reparût ; je descendis donc à sa rencontre et le trouvai pérorant au milieu d’un cercle de curieux, auxquels il expliquait l’événement qui venait d’arriver.
Je lui pris Gazelle des mains, sautai dans un cabriolet, qui me descendit faubourg Saint-Denis, n° 109 ; je montai cinq étages, et j’entrai dans l’atelier de mon ami, qui était en train de peindre.
Il y avait autour de lui un ours couché sur le dos, et jouant avec une bûche ; un singe assis sur une chaise et arrachant, les uns après les autres, les poils d’un pinceau ; et, dans un bocal, une grenouille accroupie sur la troisième traverse d’une petite échelle, à l’aide de laquelle elle pouvait monter jusqu’à la surface de l’eau.
Mon ami s’appelait Decamps, l’ours Tom, le singe Jacques Ier[3], et la grenouille mademoiselle Camargo.
2
Comment Jacques Ier voua une haine féroce à Tom, et cela à propos d’une carotte.
Mon entrée fit révolution.
Decamps leva les yeux de dessus ce merveilleux petit tableau des Chiens savants que vous connaissez tous, et qu’il achevait alors.
Tom se laissa tomber sur le nez la bûche avec laquelle il jouait, et s’enfuit en grognant dans sa niche, bâtie entre les deux fenêtres.
Jacques Ier jeta vivement son pinceau derrière lui et ramassa une paille qu’il porta innocemment à sa bouche avec sa main droite, tandis qu’il se grattait la cuisse de la main gauche et levait béatement les yeux au ciel.
Enfin, mademoiselle Camargo monta languissamment un degré de son échelle ; ce qui, dans toute autre circonstance, aurait pu être considéré comme un signe de pluie.
Et moi, je posai Gazelle à la porte de la chambre, sur le seuil de laquelle je m’étais arrêté en disant :
– Cher ami, voilà la bête. Vous voyez que je suis de parole.
Gazelle n’était pas dans un moment heureux : le mouvement du cabriolet l’avait tellement désorientée, que, pour rassembler probablement toutes ses idées et réfléchir à sa situation le long de la route, elle avait rentré toute sa personne sous sa carapace ; ce que je posais par terre avait donc l’air tout bonnement d’une écaille vide.
Néanmoins, lorsque Gazelle sentit, par la reprise de son centre de gravité, qu’elle adhérait à un terrain solide, elle se hasarda de montrer son nez à l’ouverture supérieure de son écaille ; pour plus de sûreté, cependant, cette partie de sa personne était prudemment accompagnée de ses deux pattes de devant ; en même temps, et comme si tous les membres eussent unanimement obéi à l’élasticité d’un ressort intérieur, les deux pattes de derrière et la queue parurent à l’extrémité inférieure de la carapace. Cinq minutes après, Gazelle avait mis toutes voiles dehors.
Elle resta cependant encore un instant en panne, branlant la tête à droite et à gauche comme pour s’orienter ; puis tout à coup ses yeux devinrent fixes, et elle s’avança, aussi rapidement que si elle eût disputé le prix de la course au lièvre de La Fontaine, vers une carotte gisant aux pieds de la chaise qui servait de piédestal à Jacques Ier.
Celui-ci regarda d’abord avec assez d’indifférence la nouvelle arrivée s’avancer de son côté ; mais, dès qu’il s’aperçut du but qu’elle paraissait se proposer, il donna des signes d’une inquiétude réelle, qu’il manifesta par un grognement sourd, qui dégénéra, au fur et à mesure qu’elle gagnait du terrain, en cris aigus interrompus par des craquements de dents. Enfin, lorsqu’elle ne fut plus qu’à un pied de distance du précieux légume, l’agitation de Jacques prit tout le caractère d’un désespoir réel ; il saisit, d’une main, le dossier de son siège, et, de l’autre, la traverse recouverte de paille, et, probablement dans l’espoir d’effrayer la bête parasite qui venait lui rogner son dîner, il secoua la chaise de toute la force de ses poignets, jetant ses deux pieds en arrière comme un cheval qui rue, et accompagnant ses évolutions de tous les gestes et de toutes les grimaces qu’il croyait capables de démonter l’impassibilité automatique de son ennemi. – Mais tout était inutile ; Gazelle n’en faisait pas pour cela un pas moins vite que l’autre. Jacques Ier ne savait plus à quel saint se vouer.
Heureusement pour Jacques qu’il lui arriva, en ce moment, un secours inattendu. Tom, qui s’était retiré dans sa loge à mon arrivée, avait fini par se familiariser avec ma présence, et prêtait, comme nous tous, une certaine attention à la scène qui se passait ; étonné d’abord de voir se remuer cet animal inconnu, devenu, grâce à moi, commensal de son logis, il l’avait suivi dans sa course vers la carotte avec une curiosité croissante. Or, comme Tom ne méprisait pas non plus les carottes, lorsqu’il vit Gazelle près d’atteindre le précieux légume, il fit trois pas en trottant et, levant sa grosse patte, il la posa lourdement sur le dos de la pauvre bête, qui, frappant la terre du plat de son écaille, rentra incontinent dans sa carapace et resta immobile à deux pouces de distance du comestible qui mettait en ce moment en jeu une triple ambition. Tom parut fort étonné de voir disparaître, comme par enchantement, tête, pattes et queue. Il approcha son nez de la carapace, souffla bruyamment dans les ouvertures ; enfin, et comme pour se rendre plus parfaitement compte de la singulière organisation de l’objet qu’il avait sous les yeux, il le prit, le tournant et le retournant entre ses deux pattes ; puis, comme convaincu qu’il s’était trompé en concevant l’absurde idée qu’une pareille chose fût douée de la vie et pût marcher, il la laissa négligemment retomber, prit la carotte entre ses dents, et se mit en devoir de regagner sa niche.
Ce n’était point là l’affaire de Jacques : il n’avait pas compté que le service que lui rendait son ami Tom serait gâté par un pareil trait d’égoïsme ; mais, comme il n’avait pas pour son camarade le même respect que pour l’étrangère, il sauta vivement de la chaise où il était prudemment resté pendant la scène que nous venons de décrire, et, saisissant d’une main, par sa chevelure verte, la carotte que Tom tenait par la racine, il se raidit de toutes ses forces, grimaçant, jurant, claquant des dents, tandis que, de la patte qui lui restait libre, il allongeait force soufflets sur le nez de son pacifique antagoniste, qui, sans riposter, mais aussi sans lâcher l’objet en litige, se contentait de coucher ses oreilles sur son cou, de fermer ses petits yeux noirs chaque fois que la main agile de Jacques se mettait en contact avec sa grosse figure ; enfin la victoire resta, comme la chose arrive ordinairement, non pas au plus fort, mais au plus effronté. Tom desserra les dents, et Jacques, possesseur de la bienheureuse carotte, s’élança sur une échelle, emportant le prix du combat, qu’il alla cacher derrière un plâtre de Malagutti, sur un rayon fixé à six pieds de terre ; cette opération finie, il descendit plus tranquillement, certain qu’il n’y avait ni ours ni tortue capables de l’aller dénicher là.
Arrivé au dernier échelon, et lorsqu’il s’agit de remettre pied à terre, il s’arrêta prudemment, et, jetant les yeux sur Gazelle, qu’il avait oubliée dans la chaleur de sa dispute avec Tom, il s’aperçut qu’elle se trouvait dans une position qui n’était rien moins qu’offensive.
En effet, Tom, au lieu de la replacer avec soin dans la situation où il l’avait prise, l’avait, comme nous l’avons dit, négligemment laissée tomber à tout hasard, de sorte qu’en reprenant ses sens, la malheureuse bête, au lieu de se retrouver dans sa situation normale, c’est-à-dire sur le ventre, s’était retrouvée sur le dos, position, comme chacun le sait, antipathique au suprême degré à tout individu faisant partie de la race des chéloniens.
Il fut facile de voir à l’expression de confiance avec laquelle Jacques s’approcha de Gazelle, qu’il avait jugé au premier abord que son accident la mettait hors d’état de faire aucune défense. Cependant, arrivé à un demi-pied du monstrum horrendum, il s’arrêta un instant, regarda dans l’ouverture tournée de son côté, et se mit, sous un air de négligence apparente, à en faire le tour avec précaution, l’examinant à peu près comme un général fait d’une ville qu’il veut assiéger. Cette reconnaissance achevée, il allongea la main doucement, toucha du bout du doigt l’extrémité de l’écaille ; puis aussitôt, se rejetant lestement en arrière, il se mit, sans perdre de vue l’objet qui le préoccupait, à danser joyeusement sur ses pieds et ses mains, accompagnant ce mouvement d’une espèce de chant de victoire qui lui était habituel toutes les fois que, par une difficulté vaincue ou un péril affronté, il croyait avoir à se féliciter de son habileté ou de son courage.
Cependant cette danse et ce chant s’interrompirent soudainement ; une idée nouvelle traversa le cerveau de Jacques, et parut absorber toutes ses facultés pensantes. Il regarda attentivement la tortue, à laquelle sa main, en la touchant, avait imprimé un mouvement d’oscillation que rendait plus prolongé la forme sphérique de son écaille, s’en approcha, marchant de côté comme un crabe ; puis, arrivé près d’elle, se leva sur ses pieds de derrière, l’enjamba comme fait un cavalier de son cheval, la regarda un instant se mouvoir entre ses deux jambes ; enfin, complètement rassuré, à ce qu’il paraît, par l’examen approfondi qu’il venait d’en faire, il s’assit sur ce siège mobile, et lui imprimant, sans cependant que ses pieds quittassent la terre, un mouvement rapide d’oscillation, il se balança joyeusement, se grattant le côté et clignant les yeux, gestes qui, pour ceux qui le connaissent, étaient l’expression d’une joie indéfinissable.
Tout à coup Jacques poussa un cri perçant, fit un bond perpendiculaire de trois pieds, retomba sur les reins, et, s’élançant sur son échelle, alla se réfugier derrière la tête de Malagutti. Cette révolution était causée par Gazelle, qui, fatiguée d’un jeu dans lequel le plaisir n’était évidemment pas pour elle, avait enfin donné signe de vie en éraflant de ses pattes froides et aiguës les cuisses pelées de Jacques Ier, qui fut d’autant plus bouleversé de cette agression, qu’il ne s’attendait à rien moins qu’une attaque de ce côté.
En ce moment, un acheteur entra, et Decamps me fit signe qu’il désirait rester seul. Je pris mon chapeau et ma canne, et m’éloignai.
J’étais sur le palier, lorsque Decamps me rappela.
– À propos, me dit-il, venez donc demain passer la soirée avec nous.
– Que faites-vous donc demain ?
– Nous avons souper et lecture.
– Bah !
– Oui, mademoiselle Camargo doit manger un cent de mouches, et Jadin lire un manuscrit.
3
Comment Mademoiselle Camargo tomba en la possession de Monsieur Decamps.
Malgré l’invitation verbale que Decamps m’avait faite, je reçus le lendemain une lettre imprimée. Ce double emploi avait pour but de me rappeler la tenue de rigueur, les invités ne devant être admis qu’en robe de chambre et pantoufles. Je fus exact à l’heure et fidèle à l’uniforme.
C’est une curieuse chose à voir, que l’atelier d’un peintre, lorsqu’il a coquettement pendu à ses quatre murailles, pour faire honneur aux invités, ses joyaux des grands jours, fournis par les quatre parties du monde. Vous croyez entrer dans la demeure d’un artiste, et vous vous trouvez au milieu d’un musée qui ferait honneur à plus d’une ville préfectorale de France. Ces armures, qui représentent l’Europe au Moyen Âge, datent de divers règnes et trahissent, par leur forme, l’époque de leur fabrication. Celle-ci, brunie sur les deux côtés de la poitrine, avec son arête aiguë et brillante et son crucifix gravé, aux pieds duquel est une Vierge en prière avec cette légende : Mater Dei, ora pro nobis, a été forgée en France et offerte au roi Louis XI, qui la fit appendre aux murs de son vieux château de Plessis-les-Tours. Celle-là, dont la poitrine bombée porte encore la marque des coups de masse dont elle a garanti son maître, a été bosselée dans les tournois de l’empereur Maximilien, et nous arrive d’Allemagne. Cette autre, qui représente en relief les robustes travaux d’Hercule, a peut-être été portée par le roi François Ier, et sort certainement des ateliers florentins de Benvenuto Cellini. Ce tomahawk canadien et ce couteau à scalper viennent d’Amérique : l’un a brisé des têtes françaises et l’autre enlevé des chevelures parfumées. Ces flèches et ce krid sont indiens ; le fer des unes et la lame de l’autre sont mortels, car ils ont été empoisonnés dans le suc des herbes de Java. Ce sabre recourbé a été trempé à Damas. Ce yatagan, qui porte sur sa lame autant de crans qu’il a coupé de têtes, a été arraché aux mains mourantes d’un Bédouin. Enfin, ce long fusil à la crosse et aux capucines d’argent, a été rapporté de la Casaubah par Isabey peut-être, qui l’aura troqué avec Yousouf contre un croquis de la rade d’Alger ou un dessin du fort l’Empereur.
Maintenant que nous avons examiné, les uns après les autres, ces trophées dont chacun représente un monde, jetez les yeux sur ces tables où sont épars, pêle-mêle, mille objets différents, étonnés de se trouver réunis. Voici des porcelaines du Japon, des figurines égyptiennes, des couteaux espagnols, des poignards turcs, des stylets italiens, des pantoufles algériennes, des calottes de Circassie, des idoles du Gange, des cristaux des Alpes. Regardez : il y en a pour un jour.
Sous vos pieds, ce sont des peaux de tigre, de lion, de léopard, enlevées à l’Asie et à l’Afrique ; sur vos têtes, les ailes étendues et comme douées de la vie, voilà le goéland, qui, au moment où la vague se courbe pour retomber, passe sous sa voûte comme sous une arche ; le margat, qui, lorsqu’il voit apparaître un poisson à la surface de l’eau, plie ses ailes et se laisse tomber sur lui comme une pierre ; le guillemot, qui, au moment où le fusil du chasseur se dirige contre lui, plonge, pour ne reparaître qu’à une distance qui le met hors de sa portée ; enfin le martin-pêcheur, cet alcyon des anciens, sur le plumage duquel étincellent les couleurs les plus vives de l’aigue marine et du lapis-lazuli.
Mais ce qui, un soir de réception chez un peintre, est surtout digne de fixer l’attention d’un amateur, c’est la collection hétérogène de pipes toutes bourrées qui attendent, comme l’homme de Prométhée, qu’on dérobe pour elle le feu du ciel. Car, afin que vous le sachiez, rien n’est plus fantasque et plus capricieux que l’esprit des fumeurs. L’un préfère la simple pipe de terre, à laquelle nos vieux grognards ont donné le nom expressif de brûle-gueule ; celle-là se charge tout simplement avec le tabac de la régie, dit tabac de caporal. L’autre ne peut approcher de ses lèvres délicates que le bout ambré de la chibouque arabe, et celle-là se bourre avec le tabac noir d’Alger ou le tabac vert de Tunis. Celui-ci, grave comme un chef de Cooper, tire méthodiquement du calumet pacifique des bouffées de maryland ; celui-là, plus sensuel qu’un nabab, tourne comme un serpent autour de son bras le tuyau flexible de son hucca indien, qui ne laisse arriver à sa bouche la vapeur du latakieh que refroidie et parfumée de rose et de benjoin. Il y en a qui, dans leurs habitudes, préfèrent la pipe d’écume de l’étudiant allemand, et le vigoureux cigare belge haché menu, au narghilé turc, chanté par Lamartine, et au tabac du Sinaï, dont la réputation hausse et baisse selon qu’il a été récolté sur la montagne ou dans la plaine. D’autres sont enfin qui, par originalité ou par caprice, se disloquent le cou pour maintenir dans une position perpendiculaire le gourgouri des nègres, tandis qu’un complaisant ami, monté sur une chaise, essaye, à grand renfort de braise et de souffle pulmonique, de sécher d’abord et d’allumer ensuite l’herbe glaiseuse de Madagascar.
Lorsque j’entrai chez l’amphitryon, tous les choix étaient faits et toutes les places étaient prises ; mais chacun se serra à ma vue ; et, par un mouvement qui aurait fait honneur par sa précision à une compagnie de la garde nationale, tous les tuyaux, qu’ils fussent de bois ou de terre, de corne ou d’ivoire, de jasmin ou d’ambre, se détachèrent des lèvres amoureuses qui les pressaient, et s’étendirent vers moi. Je fis, de la main, un signe de remerciement, tirai de ma poche du papier réglisse, et me mis à rouler entre mes doigts le cigarillo andalou avec toute la patience et l’habileté d’un vieil Espagnol.
Cinq minutes après, nous nagions dans une atmosphère à faire marcher un bateau à vapeur de la force de cent vingt chevaux.
Autant que cette fumée pouvait le permettre, on distinguait, outre les invités, les commensaux ordinaires de la maison, avec lesquels le lecteur a déjà fait connaissance. C’était Gazelle, qui, à dater de ce soir-là, avait été prise d’une préoccupation singulière : c’était celle de monter le long de la cheminée de marbre, afin d’aller se chauffer à la lampe, et qui se livrait avec acharnement à cet incroyable exercice. C’était Tom, dont Alexandre Decamps s’était fait un appui, à peu près comme on fait d’un coussin de divan, et qui, de temps en temps, dressait tristement sa bonne tête sous le bras de son maître, soufflait bruyamment pour repousser la fumée qui lui entrait dans les narines, puis se recouchait avec un gros soupir. C’était Jacques Ier, assis sur un tabouret à côté de son vieil ami Fau qui, à grands coups de cravache, avait mené son éducation au point de perfection où elle était parvenue, et pour lequel il avait la reconnaissance la plus grande et surtout l’obéissance la plus passive. Enfin, c’était, au milieu du cercle, et de son bocal, mademoiselle Camargo, dont les exercices gymnastiques et gastronomiques devaient plus particulièrement faire les délices de la soirée.
Il est important, arrivés au point où nous en sommes, de jeter un coup d’œil en arrière, et d’apprendre à nos lecteurs par quel concours inouï de circonstances mademoiselle Camargo, qui était née dans la plaine Saint-Denis, se trouvait réunie à Tom, qui était originaire du Canada, à Jacques, qui avait vu le jour sur les côtes d’Angola, et à Gazelle, qui avait été pêchée dans les marais de Hollande.
On sait quelle agitation se manifeste à Paris, dans les quartiers Saint-Martin et Saint-Denis, lorsque le mois de septembre ramène le retour de la chasse ; on ne rencontre alors que bourgeois revenant du canal, où ils ont été se faire la main en tirant des hirondelles, traînant chiens en laisse, portant fusil sur l’épaule, se promettant d’être cette année moins mazettes que la dernière, et arrêtant toutes leurs connaissances pour leur dire : « Aimez-vous les cailles, les perdrix ? – Oui. – Bon ! je vous en enverrai le 3 ou le 4 du mois prochain... – Merci. – À propos, j’ai tué cinq hirondelles sur huit coups. – Très bien. – C’est pas mal tiré, n’est-ce pas ? – Parfaitement. – Adieu. – Bonsoir. »
Or, vers la fin du mois d’août 1829, un de ces chasseurs entra sous la grande porte de la maison du faubourg Saint-Denis, n° 109, demanda au concierge si Decamps était chez lui, et, sur sa réponse affirmative, monta, tirant son chien, marche par marche, et cognant le canon de son fusil à tous les angles du mur, les cinq étages qui conduisent à l’atelier de notre célèbre peintre.
Il n’y trouva que son frère Alexandre.
Alexandre est un de ces hommes spirituels et originaux qu’on reconnaît pour artiste rien qu’en les regardant passer ; qui seraient bon à tout, s’ils n’étaient trop profondément paresseux pour jamais s’occuper sérieusement d’une chose ; ayant en tout l’instinct du beau et du vrai, le reconnaissant partout où ils le rencontrent, sans s’inquiéter si l’œuvre qui cause leur enthousiasme est avouée d’une coterie ou signée d’un nom ; au reste, bon garçon dans toute l’acception du mot, toujours prêt à retourner ses poches pour ses amis, et, comme tous les gens préoccupés d’une idée qui en vaut la peine, facile à entraîner non par faiblesse de caractère, mais par ennui de la discussion et par crainte de la fatigue.
Avec cette disposition d’esprit, Alexandre se laissa facilement persuader par le nouvel arrivant qu’il trouverait grand plaisir à ouvrir la chasse avec lui dans la plaine Saint-Denis, où il y avait, disait-on, cette année, des cailles par bandes, des perdrix par volées et des lièvres par troupeaux.
En conséquence de cette conversation, Alexandre commanda une veste de chasse à Chevreuil, un fusil à Lepage et des guêtres à Boivin : le tout lui coûta six cent soixante francs, sans compter le port d’armes, qui lui fut délivré à la préfecture de police, sur la présentation du certificat de bonnes vie et mœurs, que lui octroya sans conteste le commissaire de son quartier.
Le 31 août, Alexandre s’aperçut qu’il ne lui manquait qu’une chose pour être chasseur achevé : c’était un chien. Il courut aussitôt chez l’homme qui, pour le tableau des Chiens savants, avait posé, avec sa meute, devant son frère, et lui demanda s’il n’aurait pas ce qu’il lui fallait.
L’homme lui répondit qu’il avait, sous ce rapport, des bêtes d’un instinct merveilleux, et, passant de sa chambre dans le chenil, avec lequel elle communiquait de plain-pied, il ôta en un tour de main le chapeau à trois cornes et l’habit qui décoraient une espèce de briquet noir et blanc, rentra immédiatement avec lui, et le présenta à Alexandre comme un chien de pure race. Celui-ci fit observer que le chien de race avait les oreilles droites, pointues, ce qui était contraire à toutes les habitudes reçues ; mais à ceci l’homme répondit que Love était anglais, et qu’il était du suprême bon ton chez les chiens anglais de porter les oreilles ainsi. Comme, à tout prendre, la chose pouvait être vraie, Alexandre se contenta de l’explication et ramena Love chez lui.[4]
Le lendemain, à cinq heures du matin, notre chasseur vint réveiller Alexandre, qui dormait, comme un bienheureux, le tança violemment sur sa paresse, et lui reprocha un retard, grâce auquel il trouverait, en arrivant, toute la plaine brûlée.
En effet, au fur et à mesure que l’on approchait de la barrière, les détonations devenaient plus vives et plus bruyantes. Nos chasseurs doublèrent le pas, dépassèrent la douane, enfilèrent la première ruelle qui conduisait à la plaine, se jetèrent dans un carré de choux et tombèrent au milieu d’une véritable affaire d’avant-garde.
Il faut avoir vu la plaine Saint-Denis un jour d’ouverture, pour se faire une idée du spectacle insensé qu’elle présente. Pas une alouette, pas un moineau franc ne passe, qu’il ne soit salué d’un millier de coups de fusil. S’il tombe, trente carnassières s’ouvrent, trente chasseurs se disputent, trente chiens se mordent ; s’il continue son chemin, tous les yeux sont fixés sur lui ; s’il se pose, tout le monde court ; s’il se relève, tout le monde tire. Il y a bien par-ci par-là quelques grains de plomb adressés aux bêtes et qui arrivent aux gens : il n’y faut pas regarder ; d’ailleurs, il y a un vieux proverbe à l’usage des chasseurs parisiens qui dit que le plomb est l’ami de l’homme. À ce titre, j’ai pour mon compte trois amis qu’un quatrième m’a logés dans la cuisse.
L’odeur de la poudre et le bruit des coups de fusil produisirent leur effet habituel. À peine notre chasseur eut-il flairé l’une et entendu l’autre, qu’il se précipita dans la mêlée et commença immédiatement à faire sa partie dans le sabbat infernal qui venait de l’envelopper dans son cercle d’attraction.
Alexandre, moins impressionnable que lui, s’avança d’un pas plus modéré, religieusement suivi par Love, dont le nez ne quittait pas les talons de son maître. Or, chacun sait que le métier d’un chien de chasse est de battre la plaine et non de regarder s’il manque des clous à nos bottes : c’est la réflexion qui vint tout naturellement à Alexandre au bout d’une demi-heure. En conséquence, il fit un signe de la main à Love et lui dit :
– Cherche !
Love se leva aussitôt sur ses pattes de derrière et se mit à danser.
– Tiens ! dit Alexandre en posant la crosse de son fusil à terre et regardant son chien, il paraît que Love, outre son éducation universitaire, possède aussi des talents d’agrément. Je crois que j’ai fait là une excellente acquisition.
Cependant, comme il avait acheté Love pour chasser et non pour danser, il profita du moment où celui-ci venait de retomber sur ses quatre pattes pour lui faire un second signe plus expressif, et lui dire d’une voix plus forte :
– Cherche !
Love se coucha de tout son long, ferma les yeux et fit le mort.
Alexandre prit son lorgnon, regarda Love. L’intelligent animal était d’une immobilité parfaite ; pas un poil de son corps ne bougeait ; on l’eut cru trépassé depuis vingt-quatre heures.
– Ceci est très joli, reprit Alexandre ; mais, mon cher ami, ce n’est point ici le moment de nous livrer à ces sortes de plaisanteries ; nous sommes venus pour chasser, chassons. Allons, la bête, allons !
Love ne bougeait pas.
– Attends, attends ! dit Alexandre tirant de terre un échalas qui avait servi à ramer les pois, et s’avançant vers Love avec l’intention de lui en caresser les épaules, attends !
À peine Love avait-il vu le bâton dans les mains de son maître, qu’il s’était remis sur ses pattes et avait suivi tous ses mouvements avec une expression d’intelligence remarquable. Alexandre, qui s’en était aperçu, différa donc la correction, et pensant que, cette fois, il allait enfin lui obéir, il étendit l’échalas devant Love, et lui dit pour la troisième fois :
– Cherche !
Love prit son élan et sauta par-dessus l’échalas. [...]





























