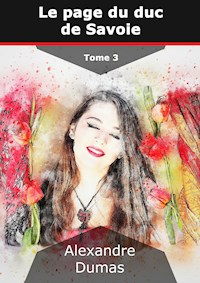
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Emmanuel Philibert, duc de Savoie sans territoires, est le commandant en chef des troupes de Charles Quint en Artois. Il est entouré de son fidèle écuyer Scianca-Fero d'une force redoutable et de son page Léone sensible et frêle auquel il semble tendrement attaché. Il faut dire que Léone est en fait une jeune fille, Léona, qui a dû changer d'identité pour survivre aux ennemis de son père. Le comte de Waldeck ayant commis des actes de pillage, Emmanuel Philibert se voit contraint de le tuer, s'attirant ainsi la haine de son fils
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le page du duc de Savoie
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXPage de copyrightAlexandre Dumas
Le page du duc de Savoie
Tome 3
Le page du duc de Savoie fait partie d’un ensemble qui constitue La Maison de Savoie, comprenant aussi La dame de volupté.
Le roman est ici présenté en trois volumes. Édition de référence : Leipzig, Alph. Durr, Libraire-Éditeur, 1860. Collection Hetzel. Nouvelle édition.
I
Un souvenir et une promesse.
Un an s’était écoulé depuis que le roi Philippe II, en se retirant de Cambrai à Bruxelles et en déclarant la campagne de 1557 terminée, avait fait pousser à vingt-cinq millions d’hommes ce cri de joie : « La France est sauvée ! »
Nous avons dit quelles misérables considérations l’avaient, selon toute probabilité, empêché de poursuivre ses conquêtes ; nous ne tarderons pas à trouver à la cour du roi Henri II un pendant fatal à cette égoïste détermination qui avait, nous l’avons vu, si fort affligé Emmanuel Philibert.
Le chagrin qu’avait éprouvé le duc de Savoie, en se voyant ainsi arrêté sur la rive droite de la Somme, avait été d’autant plus grand, qu’il ne lui avait point été difficile de soupçonner la cause de cette étrange décision, restée aussi inexplicable pour quelques historiens modernes que le fut, pour les historiens antiques, la fameuse halte d’Annibal à Capoue.
Au reste, de grands événements, au courant desquels nous sommes forcé de mettre le lecteur, s’étaient accomplis pendant cette année.
Le plus considérable, sans contredit, de ces événements avait été la reprise de Calais sur les Anglais par le duc François de Guise. Après cette fatale bataille de Crécy, qui avait mis la France presque aussi près de sa perte que celle de Saint-Quentin, Édouard III était venu attaquer Calais par mer et par terre : par mer avec une flotte de quatre-vingts voiles, et par terre avec une armée de trente mille hommes. Quoique défendue par une garnison peu nombreuse mais placée sous les ordres de Jean de Vienne, un des plus braves capitaines de son temps, Calais ne s’était rendue qu’après un an de siège et lorsque ses habitants avaient eu mangé jusqu’au dernier morceau de cuir qui se trouvait dans la ville.
Depuis ce temps, c’est-à-dire depuis deux cent dix ans, les Anglais, comme ils font aujourd’hui de Gibraltar, ne s’étaient préoccupés que d’une chose : c’était de rendre Calais imprenable, et ils croyaient y avoir si bien réussi, qu’ils avaient, vers la fin de l’autre siècle, fait graver au-dessus de la principale porte de la ville une inscription qui pouvait se traduire par les quatre vers suivants :
Calais, après trois cent quatre-vingts jours de siège,
Fut, sur Valois vaincu, prise par les Anglais.
Quand le plomb nagera sur l’eau comme le liège,
Les Valois reprendront sur les Anglais Calais !
Or, cette ville que les Anglais avaient mis trois cent quatre-vingts jours à prendre sur Philippe de Valois, et que les successeurs du vainqueur de Cassel et du vaincu de Crécy ne devaient reprendre que lorsque le plomb nagerait sur l’eau comme du liège, le duc de Guise l’avait – non pas même par un siège en règle, mais par une espèce de coup de main – emportée en huit jours.
Puis, après Calais, le duc de Guise avait repris Guines et Ham, tandis que le duc de Nevers reprenait Herbemont ; et, dans ces quatre places, Calais comprise, les Anglais et les Espagnols avaient laissé trois cents canons de fonte et deux cent quatre-vingt-dix canons de fer.
Peut-être nos lecteurs, quand nous parlons de tous ces vaillants qui combattaient de leur mieux pour réparer les échecs de l’année précédente, s’étonneront-ils de ne point entendre prononcer, nous ne dirons pas les noms du connétable et de Coligny, – on sait que tous deux étaient prisonniers, – mais celui de Dandelot, non moins illustre, non moins français surtout.
Le nom de Dandelot était le seul en effet qui pût porter ombrage à celui du duc de Guise, en rivalisant de génie et de courage avec le sien.
C’était ce qu’avait compris le cardinal de Lorraine, si préoccupé de la fortune de sa famille reposant tout entière en ce moment sur la tête de son frère, qu’il était capable de tout, même d’un crime, pour écarter un homme pouvant mettre obstacle à cette fortune.
Or, partager l’amitié du roi et la reconnaissance de la France avec le duc de Guise, c’était, selon le cardinal de Lorraine, mettre obstacle à la fortune de la hautaine maison dont les représentants allaient bientôt avoir la prétention de marcher les égaux des rois de France, et qui peut-être ne se fussent pas même contentés de cette égalité, si, trente ans plus tard, Henri III n’avait fait, sous le poignard des Quarante-Cinq, crouler cette fortune imprudemment élevée par Henri II.
Le connétable et l’amiral prisonniers, un seul homme, nous l’avons dit, inquiétait donc le cardinal de Lorraine : cet homme, c’était Dandelot ; dès lors, Dandelot devait disparaître.
Dandelot appartenait à la religion réformée ; et, comme il voulait attirer son frère, encore chancelant, à cette opinion, il lui avait envoyé à Anvers, où le roi d’Espagne le retenait prisonnier, quelques livres de Genève avec une lettre où il le pressait d’abandonner l’hérésie papale pour la lumière de Calvin.
Cette lettre de Dandelot tomba par malheur aux mains du cardinal de Lorraine.
C’était l’époque où Henri II sévissait avec la plus grande sévérité contre les protestants. Plusieurs fois déjà on lui avait dénoncé Dandelot comme entaché d’hérésie ; mais il n’avait pas cru à cette accusation ou avait feint de n’y pas croire, tant il lui en coûtait d’éloigner de lui un homme élevé dans sa maison depuis l’âge de sept ans et qui venait de payer par de si grands et de si réels services l’amitié que lui portait son roi.
Mais, à cette preuve d’hérésie, il n’y avait plus moyen de faire semblant de douter.
Cependant, Henri déclara que, sur ce point, aucune preuve, fût-elle de l’écriture de Dandelot, ne serait convaincante pour lui et qu’il ne se rapporterait qu’aux aveux mêmes de l’accusé.
En conséquence, il résolut d’interroger, en présence de toute la cour, Dandelot sur sa nouvelle croyance.
Mais, ne voulant point le prendre par surprise, il invita le cardinal de Châtillon, son frère, et François de Montmorency, son cousin, à faire venir Dandelot à la maison de plaisance de la reine, qu’il habitait alors près de Meaux, en le disposant à répondre de manière à se disculper publiquement.
Dandelot fut, en conséquence, invité par François de Montmorency et le cardinal de Châtillon à se rendre à Monceaux, – c’était le nom de cette maison de campagne de la reine, – et à préparer sa défense s’il ne jugeait point au-dessous de sa dignité de se défendre.
Le roi était à dîner lorsqu’on lui annonça que Dandelot venait d’arriver.
Le roi le reçut à merveille, commençant par l’assurer qu’il n’oublierait jamais les signalés services qu’il venait de lui rendre ; ensuite, abordant la question des bruits qui couraient sur son compte, il lui dit qu’il était accusé, non seulement de penser, mais encore de parler mal des saints mystères de notre religion. Puis, formulant encore plus nettement sa pensée :
– Dandelot, lui dit-il, je vous ordonne de dire ici votre opinion sur le saint sacrifice de la messe.
Dandelot savait d’avance quelle douleur il allait causer au roi ; et comme il avait pour Henri un grand respect, en même temps qu’une amitié profonde :
– Sire, dit-il humblement, ne pourriez-vous dispenser un sujet aussi profondément dévoué à son roi que je le suis de répondre à une question de pure croyance devant laquelle, si grand et si puissant que vous soyez, vous n’êtes qu’un homme de la taille et de la force des autres hommes ?
Mais Henri II n’en était point venu où il en était pour reculer ; il ordonna donc à Dandelot de répondre catégoriquement.
Alors, voyant qu’il n’y avait pas moyen d’éluder la question :
– Sire, répondit Dandelot, pénétré des sentiments de la plus vive reconnaissance pour tous les bienfaits dont il a plu à Votre Majesté de me combler, je suis prêt à exposer ma vie et à sacrifier mes biens pour son service ; mais, puisque vous me forcez de vous en faire l’aveu, sire, en matière de religion, je ne reconnais d’autre maître que Dieu, et ma conscience ne me permet pas de vous déguiser mes sentiments. En conséquence, sire, je ne crains pas de proclamer que la messe est, non seulement une chose qui n’est recommandée ni par notre Seigneur Jésus, ni par ses apôtres, mais encore une détestable invention des hommes.
À cet horrible blasphème que les huguenots rigides regardaient comme une vérité que l’on ne pouvait confesser trop haut, le roi tressaillit d’étonnement et, passant de l’étonnement à la colère :
– Dandelot ! s’écria-t-il, jusqu’à présent je vous ai défendu contre ceux qui vous attaquaient ; mais, après une si abominable hérésie, je vous ordonne de sortir de ma présence, vous déclarant que, si vous n’étiez en quelque sorte mon élève, je vous passerais mon épée au travers du corps !
Dandelot demeura parfaitement calme, salua respectueusement sans répondre à cette terrible apostrophe du roi et se retira.
Mais Henri II n’avait pas conservé le même sang-froid. À peine la tapisserie qui pendait à la porte de la salle à manger fut-elle retombée derrière Dandelot, qu’il donna ordre à son maître de la garde-robe, la Bordaisière, d’arrêter le coupable et de le conduire prisonnier à Meaux.
L’ordre fut exécuté ; mais cela ne suffisait point au cardinal de Lorraine : il exigea du roi que la charge de colonel-général de l’infanterie française, qui était à Dandelot, lui fût ôtée et fût donnée à Blaise de Montluc, lequel était tout dévoué à la maison de Guise, ayant été page de René II, duc de Lorraine.
Telle fut la récompense de Dandelot pour les immenses services qu’il venait de rendre au roi et que le roi avait promis de ne jamais oublier !
On sait celle qui attendait plus tard son frère l’amiral de Coligny.
Voilà pourquoi le nom de Dandelot n’était point prononcé au milieu de tous ces noms qui éclataient à chaque instant, éclairés par la lueur de quelque victoire.
De son côté, Emmanuel Philibert n’était point resté dans l’inaction et il avait vigoureusement lutté contre ce suprême effort de la France.
La bataille de Gravelines, gagnée sur le maréchal de Termes, par le comte Lamoral d’Egmont, avait été une de ces journées que la France devait inscrire au nombre de ses jours malheureux.
Puis, comme dans ces combats singuliers où, après avoir lutté à armes égales, deux adversaires dignes l’un de l’autre, sans s’être rien dit mais se sentant épuisés d’une égale fatigue, font un pas en arrière et, sans se perdre de vue, se reposent appuyés sur la garde de leur épée, la France et l’Espagne, Guise et Emmanuel Philibert reprenaient haleine : le duc de Guise à Thionville, Emmanuel Philibert à Bruxelles.
Quant au roi Philippe II, il commandait en personne l’armée des Pays-Bas, forte de trente-cinq mille hommes de pied et de quatorze mille chevaux, campée sur la rivière d’Anthée. Ce fut là qu’il apprit la mort de la reine d’Angleterre, sa femme, qui venait de trépasser d’une hydropisie qu’elle s’était obstinée à prendre pour une grossesse.
Quant à l’armée principale de France, elle était, de son côté, retranchée derrière la Somme et, comme l’armée espagnole et ses chefs, se tenait momentanément inactive. Elle se composait, outre seize mille Français, de dix-huit mille reîtres, de vingt-six mille fantassins allemands, et de six mille Suisses ; rangée en bataille, – c’est ce que nous apprend Montluc, – elle tenait une lieue et demie de terrain et il fallait trois heures pour en faire le tour.
Enfin, Charles Quint, comme nous l’avons dit dans la première partie de cet ouvrage, était mort le 21 septembre 1558, au monastère de Saint-Just dans les bras de l’archevêque de Tolède.
Et, comme les événements de la terre ne sont qu’un enchaînement de contrastes, la jeune reine Marie Stuart, âgée de quinze ans, venait d’épouser le dauphin François, âgé de dix-sept.
Voilà où en étaient les affaires politiques et privées de la France, de l’Espagne, de l’Angleterre et, par conséquent, du monde, lorsque, par une matinée du mois d’octobre 1558, Emmanuel, – qui, vêtu de ce deuil dont parle Hamlet, lequel deuil s’étend des habits au cœur, donnait quelques ordres militaires à Scianca-Ferro, entièrement guéri de sa blessure et qu’il s’apprêtait à envoyer en courrier au roi Philippe, – vit entrer dans son cabinet Leona, toujours belle et souriante sous son costume habituel, mais ne pouvant voiler une teinte profonde de mélancolie perçant sous son sourire.
Au milieu de la terrible campagne de France qui s’était accomplie l’année précédente, nous avons vu disparaître la belle jeune fille. En effet, pour ne point l’exposer aux fatigues des camps, des batailles et des sièges, Emmanuel Philibert avait exigé qu’elle restât à Cambrai ; puis, la campagne achevée, avec un bonheur plus grand, avec un amour plus profond que jamais, les deux amants s’étaient retrouvés, et comme, soit par lassitude, soit par dégoût, Emmanuel Philibert avait pris peu de part à la campagne de 1558, dont il avait dirigé les opérations de Bruxelles, les deux amants ne s’étaient plus quittés.
Habitués à lire jusqu’aux plus secrètes pensées du cœur de Leona sur son visage, Emmanuel Philibert fut frappé de cette teinte de mélancolie qui éteignait le sourire presque forcé de la jeune fille.
Quant à Scianca-Ferro, moins habile que son ami à surprendre les mystérieux secrets du cœur, il ne vit dans l’entrée de Leona que son apparition quotidienne dans le cabinet du prince et, après avoir échangé avec le beau page, dont le sexe n’était plus depuis longtemps un secret pour lui, une poignée de main, moitié respectueuse, moitié amicale, il prit des mains d’Emmanuel Philibert la dépêche préparée et s’éloigna en fredonnant insoucieusement une chanson picarde et en faisant sonner bruyamment ses éperons.
Emmanuel Philibert le suivit des yeux jusqu’à la porte et, quand le jeune homme eut disparu, il reporta son regard inquiet sur Leona.
Leona souriait toujours ; elle était debout mais appuyée à un fauteuil, comme si, sans appui, ses jambes faiblissantes eussent refusé de la porter. Ses joues étaient pâles et son œil brillait d’une dernière larme mal essuyée.
– Qu’a donc, ce matin, mon enfant bien-aimé ? demanda Emmanuel Philibert avec ce ton de tendre paternité que donne à l’amour le passage, chez l’homme, du jeune âge à l’âge viril.
En effet, le 8 juillet 1668, Emmanuel Philibert venait d’accomplir sa trentième année. Protégé par le malheur, qui l’avait forcé de devenir un grand homme, ce qu’il n’eût peut-être pas été s’il eût tranquillement hérité des États du duc son père et régné sans conteste, Emmanuel Philibert avait, à cet âge si peu avancé de trente ans, acquis une réputation militaire qui rivalisait avec les premières de l’époque, c’est-à-dire avec celle du connétable, du duc de Guise, de l’amiral et du vieux maréchal de Trozzi, qui venait de mourir si glorieusement au siège de Thionville.
– J’ai, dit Leona de sa voix harmonieuse, tout à la fois un souvenir à te rappeler et une demande à te faire.
– Leona sait que, si ma mémoire est ingrate, mon cœur est fidèle. Voyons le souvenir d’abord, puis nous verrons la demande.
Et, en même temps qu’il sonnait pour donner à un huissier l’ordre de ne laisser entrer personne, il faisait signe à Leona de venir prendre place sur une pile de coussins entassés près de lui et qui étaient le siège ordinaire de la jeune fille dans ses tête-à-tête avec son amant.
Leona vint prendre sa place accoutumée et, appuyant ses deux coudes sur la cuisse d’Emmanuel et sa tête sur ses deux mains, elle plongea dans ses yeux un regard d’une douceur infinie où l’on pouvait lire un amour, mieux que cela encore, un dévouement sans bornes.
– Eh bien ? demanda le duc avec un sourire qui, de son côté, trahissait une inquiétude, comme celui de Leona trahissait sa mélancolie.
– Dans quel jour du mois sommes-nous aujourd’hui, Emmanuel ? demanda Leona.
– Le 17 novembre, si je ne me trompe, répondit le duc.
– Cette date ne rappelle-t-elle à mon bien-aimé prince aucun anniversaire qui mérite d’être fêté ?
Emmanuel sourit plus franchement que la première fois ; car sa mémoire, meilleure qu’il ne l’avait faite, venait de se reporter en arrière et de lui représenter dans tous ses détails l’événement auquel Leona faisait allusion.
– Il y a aujourd’hui vingt-quatre ans, dit-il, à l’heure à peu près où nous sommes, qu’emporté par mon cheval, effrayé à la vue d’un taureau furieux, je trouvai, à quelques pas du village d’Oleggio, au bord d’un ruisseau affluent du Tessin, une femme morte et un enfant presque mort. Cet enfant que j’ai eu le bonheur de rendre à la vie, c’était ma bien-aimée Leona !
– As-tu un instant, depuis ce jour, Emmanuel, eu l’occasion de regretter cette rencontre ?
– J’ai, au contraire, béni le ciel chaque fois que le souvenir de cet événement s’est présenté à ma mémoire, répondit le prince ; car cet enfant est devenu l’ange gardien de mon bonheur !
– Et si, dans ce jour solennel, pour la première fois de ma vie, je te demandais de me faire une promesse, Emmanuel, trouverais-tu que je suis trop exigeante et me refuserais-tu ma demande ?
– Tu m’inquiètes, Leona ! dit Emmanuel. Quelle demande peux-tu avoir à me faire, que tu ne sois pas sûre d’obtenir à l’instant même ?
Leona pâlit et, d’une voix tremblante en même temps qu’elle paraissait prêter l’oreille à un bruit lointain :
– Par la gloire de ton nom, Emmanuel ; par la devise de ta famille : Dieu reste à qui tout manque ; par les promesses solennelles faites à ton père mourant, jure-moi, Emmanuel, de m’accorder ce que je vais te demander !
Le duc de Savoie secoua la tête en homme qui sent qu’il s’engage à accomplir quelque grand sacrifice inconnu, mais qui, en même temps, est convaincu que ce sacrifice sera fait au profit de son bonheur et de sa fortune.
Levant donc solennellement la main :
– Tout ce que tu me demanderas, Leona, dit-il, excepté de ne plus te voir, je te l’accorderai.
– Oh ! murmura Leona, je me doutais que tu ne jurerais pas sans restriction. Merci, Emmanuel ! Maintenant, ce que je demande, ce que j’exige même, en vertu du serment que tu viens de faire, c’est que tu ne mettes aucune opposition personnelle à la paix entre la France et l’Espagne, dont mon frère vient, au nom du roi Philippe et du roi Henri, te soumettre les propositions.
– La paix ! ton frère !... Comment sais-tu ce que j’ignore, Leona ?
– Un puissant prince a cru qu’il avait besoin près de toi de son humble servante, Emmanuel ; et voilà comment je sais ce que tu ne connais pas encore, mais ce que tu vas savoir.
Alors, comme un grand bruit de chevaux se faisait sur la place de l’hôtel de ville, et sous la fenêtre même du cabinet du prince, Leona se leva et alla, au nom du duc de Savoie, donner l’ordre à l’huissier de laisser entrer le chef de la cavalcade.
Un instant après, tandis qu’Emmanuel Philibert retenait par le bras Leona qui voulait s’éloigner, l’huissier annonçait :
– Son Excellence le comte Odoardo de Maraviglia, envoyé de Leurs Majestés les rois d’Espagne et de France.
– Qu’il entre, répondit Emmanuel Philibert d’une voix presque aussi tremblante que l’était un instant auparavant celle de Leona.
II
L’envoyé de Leurs Majestés les rois de France et d’Espagne.
Au nom qu’ils viennent d’entendre prononcer, nos lecteurs ont reconnu le frère de Leona, le jeune homme condamné à mort pour avoir tenté d’assassiner le meurtrier de son père et, enfin, le gentilhomme recommandé à son fils Philippe II par Charles Quint, le jour même de son abdication.
Nos lecteurs se rappelleront en outre que, quoique, dans Odoardo Maraviglia, Leona reconnaisse son frère, celui-ci est loin de se douter que Leona, qu’il a à peine entrevue sous la tente d’Emmanuel Philibert au camp d’Hesdin, soit sa sœur.
Le duc de Savoie sait donc seul, avec son page, le secret qui a sauvé la vie à Odoardo.
Maintenant, comment Odoardo se trouve-t-il à la fois le mandataire de Philippe et de Henri ; c’est ce que nous allons expliquer en quelques mots.
Fils d’un ambassadeur du roi François Ier, élevé parmi les pages dans l’intimité du dauphin Henri II, adopté publiquement par l’empereur Charles Quint le jour de son abdication, Odoardo jouissait d’une faveur égale à la cour du roi de France et à la cour du roi d’Espagne.
On savait, de plus, sans connaître les détails de cet événement, que c’était à Emmanuel Philibert qu’il devait la vie.
Il était donc tout simple qu’une personne intéressée à la paix eût eu l’idée d’en faire la double ouverture par l’homme qui avait à la fois l’oreille du roi de France et celle du roi d’Espagne, et que, les principaux articles de cette paix arrêtés entre les deux princes, le même homme fût envoyé à Emmanuel Philibert pour lui faire adopter ces mêmes articles ; surtout, comme nous l’avons dit, d’après le bruit qui s’était répandu, que c’était à l’intercession du duc de Savoie qu’Odoardo Maraviglia avait dû, non seulement d’avoir la vie sauve, mais encore d’avoir été comblé d’honneurs et recommandé au roi Philippe II par l’empereur Charles Quint.
L’homme qui avait eu l’idée de mettre en avant Odoardo Maraviglia ne s’était trompé sur aucun point. La paix, également désirée par Philippe II et par Henri de Valois, avait vu ses préliminaires plus promptement posés que l’on eût dû s’y attendre dans une affaire de cette importance ; et, comme on l’avait pensé encore, quoiqu’on ne connût pas les causes de la sympathie d’Emmanuel Philibert pour le fils de l’ambassadeur du roi François Ier, celui-ci était un des plus agréables messagers que l’on pût lui envoyer.
Il se leva donc et, malgré cette arrière-pensée qu’il y avait une douleur privée pour lui au fond de ce grand événement politique, il tendit à Odoardo une main que l’envoyé extraordinaire baisa respectueusement.
– Monseigneur, dit-il, vous voyez en moi un homme bien heureux, car peut-être ai-je déjà prouvé dans le passé et vais-je prouver dans l’avenir à Votre Altesse que vous avez sauvé la vie à un homme reconnaissant.
– Ce qui vous a d’abord sauvé la vie, mon cher Odoardo, c’est la générosité du noble empereur dont nous portons tous le deuil. Je n’ai été, moi, vis-à-vis de vous, que l’humble intermédiaire de sa clémence.
– Soit, monseigneur ; mais vous avez été pour moi le messager visible de la faveur céleste. C’est donc vous que j’adore, comme les anciens patriarches faisaient des anges qui leur apportaient la volonté de Dieu. À mon tour, au reste, monseigneur, vous voyez en moi un ambassadeur de paix.
– C’est comme tel que vous m’êtes annoncé, Odoardo ; c’est comme tel que vous étiez attendu ; c’est comme tel que je vous reçois.
– Je vous étais annoncé ? Vous m’attendiez ?... Pardon, monseigneur, mais je croyais être le premier à vous annoncer ma présence par ma présence même ; et, quant aux propositions que j’étais chargé de vous transmettre, elles étaient si secrètes...
– Ne vous inquiétez point, monsieur l’ambassadeur, reprit, en s’efforçant de sourire, le duc de Savoie. N’avez-vous point entendu dire que certains hommes ont leur démon familier qui les avertit d’avance des choses les plus inconnues ? Je suis un de ces hommes-là.
– Alors, dit Odoardo, vous savez le motif de ma visite ?
– Oui, mais le motif seulement. Restent les détails.
– Quand Votre Altesse le désirera, je serai prêt à lui transmettre ces détails.
Et Odoardo, en s’inclinant, fit à Emmanuel un signe indiquant qu’ils n’étaient pas seuls.
Leona vit ce signe et fit un pas pour se retirer ; mais le prince la retint par la main.
– Je suis toujours seul quand je suis avec ce jeune homme, Odoardo, dit-il ; car ce jeune homme, c’est le démon familier dont je vous parlais tout à l’heure. Reste, Leone, reste ! ajouta le duc. Nous devons savoir tout ce que l’on me propose. J’écoute : parlez, monsieur l’ambassadeur.
– Que diriez-vous, monseigneur, demanda en souriant Odoardo, si j’annonçais à Votre Altesse qu’en échange de Ham, du Catelet et de Saint-Quentin, la France nous rend cent quatre-vingt-dix-huit villes ?
– Je dirais, répondit Emmanuel, que c’est impossible.
– Il en est pourtant ainsi, monseigneur.
– Et, au nombre des villes qu’elle rend, la France rend-elle Calais ?
– Non. La nouvelle reine d’Angleterre, Elisabeth, qui, sous prétexte de conscience religieuse, vient de refuser d’épouser le roi Philippe II, veuf de sa sœur Marie, a été un peu sacrifiée dans tout cela. Cependant, ce n’est qu’à condition que la France garde Calais et les autres villes de Picardie reprises par M. de Guise sur les Anglais.
– Et à quelles conditions ?
– Au bout de huit ans, le roi de France sera obligé de les restituer, si mieux il n’aime payer cinquante mille écus à l’Angleterre.
– Il les donnera, à moins qu’il ne soit aussi pauvre que Beaudoin, qui mettait en gage la couronne de Notre-Seigneur !
– Oui, mais c’est une espèce de satisfaction que l’on a voulu donner à la reine Elisabeth et dont, par bonheur, elle s’est contentée, ayant beaucoup à faire dans ce moment-ci avec le pape.
– Ne l’a-t-il pas déclarée bâtarde ? demanda Emmanuel.
– Oui, mais il y perdra sa suzeraineté sur l’Angleterre. Elisabeth, de son côté, vient de déclarer que tous les édits publiés par la feue reine Marie en faveur de la religion catholique étaient abolis, et qu’au contraire elle rétablissait tous les actes faits contre le pape sous Edouard et Henry VIII, et que, comme ces deux rois, elle joignait à ses prérogatives royales le titre de chef suprême de l’église anglicane.
– Et que fait la France de sa petite reine d’Écosse, au milieu de ce grand conflit ?
– Henri II a déclaré Marie Stuart reine d’Écosse et d’Angleterre comme héritière de la feue reine Marie Tudor, comme unique descendante de Jacques V, petit-fils de Henry VII, roi d’Angleterre, et en vertu de l’illégitimité d’Elisabeth, déclarée bâtarde par un pacte qui n’a jamais été révoqué.
– Oui, dit Emmanuel Philibert ; toutefois, il y a un testament de Henry VIII qui déclare Elisabeth héritière de la couronne au défaut d’Edouard et de Marie, et c’est sur cet acte que le parlement s’est appuyé pour proclamer Elisabeth reine. Mais, s’il vous plaît, revenons à nos affaires, monsieur l’ambassadeur.
– Eh bien, monseigneur, voici les principales conditions du traité, les bases sur lesquelles on propose de l’établir :
« Les deux rois – le roi d’Espagne et le roi de France – travailleront conjointement à rendre la paix à l’Église, en provoquant l’assemblée d’un concile général.
» Il y aura une amnistie pour ceux qui auront suivi le parti de l’un ou l’autre roi, à l’exception cependant des bannis de Naples, de Sicile et du Milanais, qui ne seront point compris dans le pardon général.
» Il est stipulé ensuite que toutes les villes et tous les châteaux pris par la France au roi d’Espagne, et particulièrement Thionville, Marienbourg, Ivoy, Montmédy, Damvilliers, Hesdin, le comté de Charolais, Valence dans la Loménie, seront restitués audit roi d’Espagne ;
» Qu’Ivoy sera démantelée en compensation de Thérouanne détruite ;
» Que le roi Philippe épousera la princesse Isabelle de France, qu’il avait d’abord demandée pour son fils don Carlos, et qu’avec cette princesse, il lui sera donné une dot de quatre cent mille écus d’or ;
» Que la forteresse de Bouillon sera restituée à l’évêque de Liège ;
» Que l’infante de Portugal sera mise en possession des biens qui lui appartiennent du côté de la reine Eleonora, sa mère, veuve de François Ier ;
» Enfin, que les deux rois rendront au duc de Mantoue ce qu’ils lui ont pris dans le Montferrat, sans pouvoir y démolir les citadelles qu’ils y ont bâties. »
– Et toutes ces conditions sont accordées par le roi de France ? demanda Emmanuel.
– Toutes !... Qu’en dîtes-vous ?
– Je dis que c’est à merveille, monsieur l’ambassadeur, et que, si c’est vous qui avez eu cette influence, l’empereur Charles Quint, lorsqu’il descendit du trône, avait bien raison de vous recommander à son fils le roi d’Espagne.
– Hélas ! non, monseigneur, répondit Odoardo, les deux principaux agents de cette paix étrange sont madame de Valentinois, qui s’inquiète de voir grandir la fortune des Guise et le crédit de la reine Catherine, et M. le connétable, qui sent que, pendant sa captivité, les Lorrains mettent le pied sur sa maison.
– Ah ! dit Emmanuel, voilà qui m’explique les fréquents congés sollicités par M. le connétable auprès du roi Philippe II pour passer en France et cette demande qu’il m’adresse de racheter lui et l’amiral moyennant deux cent mille écus ; demande que je viens de soumettre au roi par l’entremise de mon écuyer Scianca-Ferro, qui partait un moment avant que vous arrivassiez.
– Le roi ratifiera cette demande, à moins de profonde ingratitude, répondit l’ambassadeur.
Puis, après un moment de silence, et regardant le prince :
– Mais vous, monseigneur, dit-il, vous ne me demandez point ce qui sera fait pour vous ?
Emmanuel sentit frissonner la main de Leona, qu’il avait gardée dans la sienne.
– Pour moi ? répondit le prince. Hélas ! j’espérais avoir été oublié.
– Il eût fallu pour cela que les rois Philippe et Henri eussent choisi un autre négociateur que celui qui vous doit la vie, monseigneur. Oh ! non, non, Dieu merci, la Providence a été juste, cette fois, et le vainqueur de Saint-Quentin sera, je l’espère, largement récompensé.
Emmanuel échangea avec son page un regard douloureux et attendit.
– Monseigneur, dit Odoardo, toutes les places qui ont été prises au duc votre père et à vous, tant au-delà qu’en-deçà des Alpes, vous seront rendues, à l’exception de Turin, de Pignerol, de Chieri, de Chivas et de Villeneuve, dont la France demeura en possession jusqu’au jour où Votre Altesse aura un héritier mâle. En outre, jusqu’au jour de la naissance de cet héritier, qui tranchera ce grand procès de Louise de Savoie et du Piémont, il sera permis au roi d’Espagne de mettre des garnisons dans les villes d’Asti et de Verceil.
– Alors, dit vivement Emmanuel Philibert, en ne me mariant pas... ?
– Vous perdez cinq villes si magnifiques, monseigneur, qu’elles suffiraient à la couronne d’un prince !
– Mais, dit vivement Leona, monseigneur le duc de Savoie se mariera. Que Votre Excellence veuille donc bien terminer sa négociation en lui disant à quelle illustre alliance il est destiné.
Odoardo regarda le jeune homme avec étonnement ; puis ses yeux se reportèrent sur le prince, dont le visage exprimait la plus cruelle anxiété. Le négociateur, si habile qu’il fût, se trompa à cette expression.
– Oh ! rassurez-vous, monseigneur, lui dit-il, la femme que l’on vous destine est digne d’un roi.
Et, comme les lèvres blêmissantes d’Emmanuel restaient fermées au lieu de s’ouvrir à la question qu’attendait Odoardo :
– C’est, ajouta celui-ci, madame Marguerite de France, sœur du roi Henri II ; et, outre le duché de Savoie tout entier, elle apporte en dot à son heureux époux trois cent mille écus d’or.
– Madame Marguerite de France, murmura Emmanuel, est une grande princesse, je le sais ; mais je m’étais toujours dit, monsieur, que je reconquerrais mon duché par des victoires et non par un mariage.
– Mais, dit Odoardo, madame Marguerite de France est digne, monseigneur, d’être la récompense de vos victoires ; et peu de princes ont payé le gain d’une bataille et la prise d’une ville avec une sœur de roi, fille de roi.
– Oh ! murmura Philibert, que n’ai-je brisé mon épée au commencement de cette campagne !
Puis, comme Odoardo le regardait avec étonnement :
– Votre Excellence, lui dit Leona, voudrait-elle me laisser seule un instant avec le prince ?
Odoardo demeurait muet et continuait d’interroger Philibert du regard.
– Un quart d’heure, répété Leona, et dans un quart d’heure Votre Excellence recevra de Son Altesse une réponse telle qu’il la désire.
Le duc fit un mouvement négatif, comprimé à l’instant même par un geste muet et suppliant de Leona.
Odoardo s’inclina et sortit ; il avait compris que le page mystérieux pouvait seul vaincre cette incompréhensible résistance que paraissait devoir opposer le duc de Savoie aux désirs des rois de France et d’Espagne.
Un quart d’heure après, appelé par l’huissier, Odoardo Maraviglia rentra dans le cabinet du prince de Savoie.
Emmanuel Philibert était seul.
Triste, mais résigné, il tendit la main au négociateur.
– Odoardo, dit-il, vous pouvez retourner vers ceux qui vous envoient et leur dire qu’Emmanuel Philibert accepte avec reconnaissance la part que les rois de France et d’Espagne ont bien voulu faire au duc de Savoie.
III
Chez la reine.
Grâce à l’habileté du négociateur, doué de toute la finesse diplomatique que l’on prétend être un des apanages de la race florentine ou milanaise, grâce surtout à l’intérêt que les deux rois avaient à ce que le secret fût religieusement gardé, rien, à part ces bruits vagues qui accompagnent les grands événements, n’avait encore transpiré à la cour des grands projets que venait d’exposer au duc de Savoie Odoardo Maraviglia, et dont la réalisation coûtait si cher à la France.
Ce fut donc avec un grand étonnement que deux cavaliers, suivis chacun d’un écuyer et qui arrivaient chacun par une route opposée, se rencontrèrent quatre jours après l’entrevue que nous venons de raconter, et se reconnurent l’un pour le connétable de Montmorency, que l’on croyait prisonnier à Anvers, l’autre pour le duc de Guise, que l’on croyait au camp de Compiègne.
Entre ces deux ennemis acharnés, les compliments ne furent pas longs. En sa qualité de prince impérial, le duc de Guise avait le pas sur toute la noblesse de France ; M. de Montmorency fit donc faire un pas de retraite à son cheval, M. de Guise fit faire un pas en avant au sien, de sorte que l’on eût pu croire que le connétable était quelque écuyer de quelque gentilhomme de la suite du prince, si en entrant dans la cour du Louvre, où le roi était en résidence d’hiver, l’un n’eût pas pris à droite et l’autre à gauche.
En effet, l’un, le duc de Guise, se rendait chez la reine Catherine de Médicis ; l’autre, le connétable, se rendait chez la favorite Diane de Poitiers. Tous deux, par l’une et par l’autre, étaient attendus avec une égale impatience.
Que l’on nous permette d’accompagner le plus important de nos personnages chez la plus importante, en apparence du moins, des deux femmes que nous venons de nommer, c’est-à-dire le duc de Guise chez la reine.





























