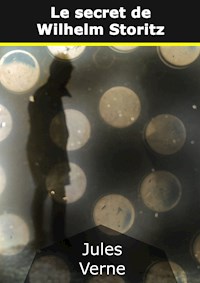
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quelques jours avant sa mort, Jules Verne remit à son éditeur Jules Hetzel le manuscrit de ce roman. L'éditeur trouve que cette oeuvre ne correspond pas à l'image "éducation et récréation" à laquelle il a cantonné Jules Verne. Il impose à Michel Verne de modifier l'ouvrage de son père. Le résultat est une oeuvre dénaturée, amputée de la fantastique inspiration de Jules Verne. C'est un chercheur qui découvre en 1977 dans les archives de Hetzel une copie du manuscrit original. Le Secret de Wilhelm Storitz relate l'histoire d'un savant prussien qui a percé des secrets scientifiques. Il s'en servira pour venger l'affront que lui a fait subir une famille de notables hongrois en lui refusant la main de leur fille. On retrouve avec un immense plaisir la manière fascinante de Jules Verne de créer une atmosphère, son style direct.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Le secret de Wilhelm Storitz
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXPage de copyrightJules Verne
Le secret de Wilhelm Storitz
I
« ... Et arrive le plus tôt que tu pourras, mon cher Henri. Je t’attends avec impatience. D’ailleurs, le pays est magnifique, et cette région de la Basse Hongrie est de nature à intéresser un ingénieur. Ne serait-ce qu’à ce point de vue, tu ne regretteras pas ton voyage.
« À toi de tout cœur,
« Marc Vidal. »
Ainsi se terminait la lettre que je reçus de mon frère, le 4 avril 1757.
Aucun signe prémonitoire ne marqua l’arrivée de cette lettre, qui me parvint de la manière habituelle, c’est-à-dire par l’entremise successive du piéton, du portier et de mon valet, lequel, sans se douter de l’importance de son geste, me la présenta sur un plateau avec sa tranquillité coutumière.
Et pareille fut ma tranquillité, tandis que j’ouvrais le pli et que je le lisais jusqu’au bout, jusqu’à ces dernières lignes, qui contenaient pourtant en germe les événements extraordinaires auxquels j’allais être mêlé.
Tel est l’aveuglement des hommes ! C’est ainsi que se tisse sans cesse, à leur insu, la trame mystérieuse de leur destin !
Mon frère disait vrai. Je ne regrette pas ce voyage. Mais ai-je raison de le raconter ? N’est-il pas de ces choses qu’il vaut mieux taire ? Qui ajoutera foi à une histoire si étrange, que les plus audacieux poètes n’eussent sans doute pas osé l’écrire ?
Eh bien, soit ! J’en courrai le risque. Qu’on doive ou non me croire, je cède à un irrésistible besoin de revivre cette série d’événements extraordinaires, dont la lettre de mon frère constitue en quelque sorte le prologue.
Mon frère Marc, alors âgé de vingt-huit ans, avait déjà obtenu des succès flatteurs comme peintre de portraits. La plus tendre, la plus étroite affection nous liait l’un à l’autre. De ma part, un peu d’amour paternel, car j’étais son aîné de huit ans. Nous avions été, jeunes encore, privés de notre père et de notre mère, et c’était moi, le grand frère, qui avais dû faire l’éducation de Marc. Comme il montrait d’étonnantes dispositions pour la peinture, je l’avais poussé vers cette carrière, où il devait obtenir des succès si personnels et si mérités.
Mais voici que Marc était à la veille de se marier. Depuis quelque temps déjà, il résidait à Ragz, une importante ville de la Hongrie méridionale. Plusieurs semaines passées à Budapest, la capitale, où il avait fait un certain nombre de portraits très réussis, très largement payés, lui avaient permis d’apprécier l’accueil que reçoivent en Hongrie les artistes. Puis, son séjour achevé, il avait descendu le Danube de Budapest à Ragz.
Parmi les premières familles de la ville, on citait celle du docteur Roderich, l’un des médecins les plus renommés de toute la Hongrie. À un patrimoine considérable, il joignait une fortune importante acquise dans la pratique de son art. Pendant les vacances qu’il s’accordait chaque année et qu’il employait à des voyages, poussant parfois jusqu’en France, en Italie ou en Allemagne, les riches malades déploraient vivement son absence. Les pauvres aussi, car il ne leur refusait jamais ses services, et sa charité ne dédaignait pas les plus humbles, ce qui lui valait l’estime de tous.
La famille Roderich se composait du docteur, de sa femme, de son fils, le capitaine Haralan, et de sa fille Myra. Marc n’avait pu fréquenter cette hospitalière maison sans être touché de la grâce et de la beauté de la jeune fille, ce qui avait infiniment prolongé son séjour à Ragz. Mais, si Myra Roderich lui avait plu, ce n’est pas trop s’avancer de dire qu’il avait plu à Myra Roderich. On voudra bien m’accorder qu’il le méritait, car Marc était – il l’est encore, Dieu merci ! – un brave et charmant garçon, d’une taille au-dessus de la moyenne, les yeux bleus très vifs, les cheveux châtains, le front d’un poète, la physionomie heureuse de l’homme à qui la vie s’offre sous ses plus riants aspects, le caractère souple, le tempérament d’un artiste fanatique des belles choses.
Quant à Myra Roderich, je ne la connaissais que par les lettres enflammées de Marc, et je brûlais du désir de la voir. Mon frère désirait encore plus vivement me la présenter. Il me priait de venir à Ragz comme chef de la famille, et il n’entendait pas que mon séjour durât moins d’un mois. Sa fiancée – il ne cessait de me le répéter – m’attendait avec impatience. Dès mon arrivée, on fixerait la date du mariage. Auparavant, Myra voulait avoir vu, de ses yeux vu, son futur beau-frère, dont on lui disait tant de bien sous tous les rapports – en vérité, c’est ainsi qu’elle s’exprimait, paraît-il !... C’est le moins qu’on puisse juger par soi-même les membres de la famille dans laquelle on va entrer. Assurément, elle ne prononcerait le oui fatal, qu’après qu’Henri lui aurait été présenté par Marc...
Tout cela, mon frère me le contait dans ses fréquentes lettres avec beaucoup d’entrain, et je le sentais éperdument amoureux de Myra Roderich.
J’ai dit que je ne la connaissais que par les phrases enthousiastes de Marc. Et cependant, puisque mon frère était peintre, il lui eût été facile de la prendre pour modèle, n’est-il pas vrai, et de la transporter sur la toile, ou tout au moins sur le papier, dans une pose gracieuse, revêtue de sa plus jolie robe. J’aurais pu l’admirer de visu, pour ainsi dire... Myra ne l’avait pas voulu. C’est en personne qu’elle apparaîtrait à mes yeux éblouis, affirmait Marc, qui, je le pense, n’avait pas dû insister pour la faire changer d’avis. Ce que tous deux prétendaient obtenir, c’était que l’ingénieur Henri Vidal mit de côté ses occupations, et vînt se montrer dans les salons de l’hôtel Roderich en tenue de premier invité.
Fallait-il tant de raisons pour me décider ? Non certes, et je n’aurais pas laissé mon frère se marier sans être présent à son mariage. Dans un délai assez court, je comparaîtrais donc devant Myra Roderich, et avant qu’elle ne fût devenue ma belle-sœur.
Du reste, ainsi que me le marquait la lettre, j’aurais grand plaisir et grand profit à visiter cette région de la Hongrie. C’est par excellence le pays magyar, dont le passé est riche de tant de faits héroïques, et qui, rebelle à tout mélange avec les races germaniques, occupe une place considérable dans l’histoire de l’Europe centrale.
Quant au voyage, voici dans quelles conditions je résolus de l’effectuer : moitié en poste, moitié par le Danube à l’aller, uniquement en poste au retour. Tout indiqué, ce magnifique fleuve que je ne prendrais qu’à Vienne. Si je ne parcourais pas les sept cents lieues de son cours, j’en verrais du moins la partie la plus intéressante, à travers l’Autriche et la Hongrie, jusqu’à Ragz, près de la frontière serbienne. Là serait mon terminus. Le temps me manquerait pour visiter les villes que le Danube arrose encore de ses eaux puissantes, alors qu’il sépare la Valachie et la Moldavie de la Turquie, après avoir franchi les fameuses Portes de Fer : Viddin, Nicopoli, Roustchouk, Silistrie, Braila, Galatz, jusqu’à sa triple embouchure sur la mer Noire.
Il me sembla que trois mois devaient suffire au voyage tel que je le projetais. J’emploierais un mois entre Paris et Ragz. Myra Roderich voudrait bien ne pas trop s’impatienter et accorder ce délai au voyageur. Après un séjour d’égale durée dans la nouvelle patrie de mon frère, le reste du temps serait consacré au retour en France.
Ayant mis ordre à quelques affaires urgentes et m’étant procuré les papiers réclamés par Marc, je me préparai donc au départ.
Mes préparatifs, fort simples, n’exigeraient que peu de temps, et je ne comptais pas m’encombrer de bagages. Je n’emporterais qu’une seule malle, de taille fort exiguë, contenant l’habit de cérémonie que rendait nécessaire l’événement solennel qui m’appelait en Hongrie.
Je n’avais point à m’inquiéter de la langue du pays, l’allemand m’étant familier depuis un voyage à travers les provinces du Nord. Quant à la langue magyare, peut-être n’éprouverais-je pas trop de difficulté à la comprendre. D’ailleurs, le français est couramment parlé en Hongrie, du moins dans les hautes classes, et mon frère n’avait jamais été gêné, de ce chef, au-delà des frontières autrichiennes.
« Vous êtes Français, vous avez droit de cité en Hongrie », a dit jadis un hospodar à l’un de nos compatriotes, et, dans cette phrase très cordiale, il se faisait l’interprète des sentiments du peuple magyar à l’égard de la France.
J’écrivis donc à Marc, en réponse à sa dernière lettre, en le priant de déclarer à Myra Roderich que mon impatience égalait la sienne, et que le futur beau-frère brûlait du désir de connaître sa future belle-sœur. J’ajoutais que j’allais partir sous peu, mais que je ne pouvais préciser le jour de mon arrivée à Ragz, ce jour étant livré aux hasards du voyage. J’assurais toutefois mon frère que je ne m’attarderais certainement pas en route. Si donc la famille Roderich le voulait, elle pouvait sans plus attendre fixer aux derniers jours de mai la date du mariage. « Prière de ne point me couvrir de malédictions, lui disais-je en manière de conclusion, si chacune de mes étapes n’est pas marquée par l’envoi d’une lettre indiquant ma présence en telle ou telle ville. J’écrirai quelquefois, juste assez pour permettre à Mlle Myra d’évaluer le nombre de lieues qui me sépareront encore de sa ville natale. Mais, dans tous les cas, j’annoncerai en temps voulu mon arrivée, à l’heure, et, s’il est possible, à la minute près. »
La veille de mon départ, le 13 avril, j’allai au bureau du lieutenant de police, avec lequel j’étais en relation d’amitié, lui faire mes adieux et retirer mon passeport. En me le remettant, il me chargea de mille compliments pour mon frère, qu’il connaissait de réputation et personnellement, et dont il avait appris les projets de mariage.
« Je sais en outre, ajouta-t-il, que la famille du docteur Roderich, dans laquelle va entrer votre frère, est une des plus honorables de Ragz.
– On vous en a parlé ? demandai-je.
– Oui, précisément hier, à la soirée de l’ambassade d’Autriche, où je me trouvais.
– Et de qui tenez-vous vos renseignements ?
– D’un officier de la garnison de Budapest, qui s’est lié avec votre frère pendant son séjour dans la capitale hongroise, et qui m’en a fait le plus grand éloge. Son succès y fut très vif, et l’accueil qu’il avait reçu à Budapest, il l’a retrouvé à Ragz, ce qui ne saurait vous surprendre, mon cher Vidal.
– Et, insistai-je, cet officier n’a pas été moins élogieux en ce qui concerne la famille Roderich ?
– Assurément. Le docteur est un savant dans toute l’acception du mot. Son renom est universel dans le royaume d’Autriche-Hongrie. Toutes les distinctions lui ont été accordées, et, au total, c’est un beau mariage que fait là votre frère, car, paraît-il, Mlle Myra Roderich est fort jolie personne.
– Je ne vous étonnerai pas, mon cher ami, répliquai-je, en vous affirmant que Marc la trouve telle, et qu’il me semble en être très épris.
– C’est au mieux, mon cher Vidal, et vous voudrez bien transmettre mes félicitations et mes souhaits à votre frère, dont le bonheur aura ce raffinement suprême qu’il fera des jaloux... Mais, s’interrompit mon interlocuteur en hésitant, je ne sais si je ne commets pas une indiscrétion... en vous disant...
– Une indiscrétion ?... fis-je, étonné.
– Votre frère ne vous a jamais écrit que quelques mois avant son arrivée à Ragz...
– Avant son arrivée ?... répétai-je.
– Oui... Mlle Myra Roderich... Après tout, mon cher Vidal, il est possible que votre frère n’en ait rien su.
– Expliquez-vous, cher ami, car je ne vois absolument pas à quoi vous faites allusion.
– Eh bien, il paraît – ce qui ne saurait surprendre – que Mlle Roderich avait été déjà très recherchée, et plus spécialement par un personnage qui, d’ailleurs, n’est pas le premier venu. C’est, du moins, ce que m’a raconté mon officier de l’ambassade, lequel, il y a cinq semaines, se trouvait encore à Budapest.
– Et ce rival ?...
– Il a été éconduit par le docteur Roderich.
– Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’en préoccuper. Du reste, si Marc se fût connu un rival, il m’en eût parlé dans ses lettres. Or, il ne m’en a pas soufflé mot. C’est donc que la chose est sans importance.
– En effet, mon cher Vidal, et cependant les prétentions de ce personnage à la main de Mlle Roderich ont fait quelque bruit à Ragz, et mieux vaut, en somme, que vous en soyez informé...
– Sans doute, et vous avez bien fait de me prévenir, puisqu’il ne s’agit pas là d’un simple racontar.
– Non, l’information est très sérieuse...
– Mais l’affaire ne l’est plus, répondis-je, et c’est le principal. »
Comme j’allais prendre congé :
« À propos, mon cher ami, demandai-je, votre officier a-t-il prononcé devant vous le nom de ce rival éconduit ?
– Oui.
– Il se nomme ?...
– Wilhelm Storitz.
– Wilhelm Storitz ?... Le fils du chimiste, de l’alchimiste plutôt ?
– Précisément.
– Eh mais ! c’est un nom !... Celui d’un savant que ses découvertes ont rendu célèbre.
– Et dont l’Allemagne est très fière à juste titre, mon cher Vidal.
– N’est-il pas mort ?
– Oui, il y a quelques années, mais son fils est vivant, et même, d’après mon interlocuteur, ce Wilhelm Storitz serait un homme inquiétant.
– Inquiétant ?... Qu’entendez-vous par cette épithète, cher ami ?
– Je ne saurais dire... Mais, à en croire mon officier de l’ambassade, Wilhelm Storitz ne serait pas comme tout le monde.
– Fichtre ! m’écriai-je plaisamment, voilà qui devient palpitant d’intérêt ! Notre amoureux évincé aurait-il donc trois jambes, ou quatre bras, ou seulement un sixième sens ?
– On n’a pas précisé, répondit en riant mon interlocuteur. Toutefois, je suis porté à supposer que le jugement s’appliquait plutôt à la personne morale qu’à la personne physique de Wilhelm Storitz, dont, si j’ai bien compris, il conviendrait de se défier...
– On s’en défiera, mon cher ami, au moins jusqu’au jour où Mlle Myra Roderich sera devenue Mme Marc Vidal. »
Là-dessus, et sans m’inquiéter autrement de cette information, je serrai cordialement la main du lieutenant de police, et je rentrai chez moi achever mes préparatifs de départ.
II
Je quittai Paris le 14 avril, à sept heures du matin, dans une berline attelée en poste. En une dizaine de jours, je serais arrivé dans la capitale de l’Autriche.
Je glisserai rapidement sur cette première partie de mon voyage. Elle ne fut marquée d’aucun incident, et les contrées que je parcourais commencent à être trop connues pour mériter une description en règle.
Strasbourg fut ma première halte sérieuse. Au sortir de cette ville, je me penchai à la portière. La grande flèche de la cathédrale, le Munster, m’apparut toute baignée des rayons du soleil, qui lui venaient du Sud-Est.
Je passai plusieurs nuits, bercé par la chanson des roues écrasant le gravier de la route, par cette monotonie bruyante, qui, mieux que le silence, finit par vous endormir. Je traversai successivement Oos, Bade, Carlsruhe et quelques autres villes. Puis je laissai en arrière Stuttgart et Ulm en Wurtemberg, en Bavière Augsbourg et Munich. Près de la frontière autrichienne, une halte plus prolongée m’arrêta à Salzbourg, et enfin, le 25 avril, à six heures trente-cinq du soir, les chevaux tout fumants pénétraient dans la cour de la meilleure hôtellerie de Vienne.
Je ne restai que trente-six heures, dont deux nuits, dans cette capitale. C’est à mon retour que je comptais la visiter en détail.
Vienne n’est ni traversée ni bordée par le Danube. Je dus faire environ une lieue en voiture pour atteindre la rive du fleuve dont les eaux complaisantes allaient me descendre jusqu’à Ragz.
La veille, je m’étais assuré d’une place dans une gabare, la Dorothée, aménagée pour le transport des passagers. À bord de cette gabare, il y avait un peu de tout, j’entends par là toutes sortes de gens, des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, des Russes, des Anglais. Les passagers occupaient l’arrière, car les marchandises encombraient l’avant, au point que personne n’y eût trouvé place.
Mon premier soin fut de retenir une couchette pour la nuit dans le dortoir commun. De faire entrer ma malle dans ce dortoir, il n’y fallait pas songer. Je dus la déposer en plein air, près d’un banc sur lequel je comptais bien faire de longues stations au cours du voyage, tout en surveillant ma propriété du coin de l’œil.
Sous la double impulsion du courant et d’un vent assez vif, la gabare descendait rapidement, fendant de son étrave les eaux jaunâtres du beau fleuve, car elles paraissent plutôt teintes d’ocre que d’outremer, quoi qu’en dise la légende. Nous croisions de nombreux bateaux, leurs voiles tendues à la brise, transportant les produits de la campagne qui s’étend à perte de vue sur les deux rives. On passa également près d’un de ces immenses radeaux, trains de bois formés d’une forêt entière, où sont établis des villages flottants, bâtis au départ, détruits à l’arrivée, et qui rappellent les prodigieuses jangadas brésiliennes de l’Amazone. Puis les îles succèdent aux îles, capricieusement semées, grandes ou petites, la plupart émergeant à peine, et si basses parfois qu’une crue de quelques pouces les eût submergées. Le regard se réjouissait à les voir si verdoyantes, si fraîches, avec leurs lignes de saules, de peupliers, de trembles, leurs humides herbages piqués de fleurs aux couleurs vives.
Nous longions aussi des villages aquatiques, élevés tout au bord de la rive. Il semble que le remous des bateaux les fasse osciller sur leurs pilotis. Plus d’une fois, nous passâmes sous une corde tendue d’une berge à l’autre, au risque d’y accrocher notre mât, la corde d’un bac que supportaient deux perches surmontées du pavillon national.
Pendant cette journée, nous perdîmes de vue Fischamenan, Rigelsbrun, et la Dorothée relâcha, le soir, à l’embouchure de la March, un affluent de gauche, qui descend de la Moravie, à peu près à la frontière du royaume magyar. C’est là qu’on passa la nuit du 27 au 28 avril, pour repartir le matin, dès l’aube, entraîné par le courant à travers ces territoires, où au XVIe siècle les français et les Turcs se battirent avec tant d’acharnement. Enfin, après avoir fait escale à Pétronel, à Altenbourg, à Hainbourg, après avoir franchi le défilé de la Porte de Hongrie, après que le pont de bateaux se fut ouvert devant elle, la gabare arriva au quai de Presbourg.
Une relâche de vingt-quatre heures nécessité par le mouvement des marchandises me permit de visiter cette ville, digne de l’attention des voyageurs. Elle a véritablement l’air d’être bâtie sur un promontoire. Ce serait la mer qui s’étendrait à ses pieds et dont les lames roulantes baigneraient sa base, au lieu des eaux calmes d’un fleuve, qu’il n’y aurait pas lieu d’en être surpris. Au-dessus de la ligne de ses magnifiques quais se dessinent des silhouettes de maisons construites avec une remarquable régularité dans un beau style.
J’admirai la cathédrale, dont la coupole se termine par une couronne dorée, et de nombreux hôtels, quelquefois des palais, qui appartiennent à l’aristocratie hongroise. Puis je fis l’ascension de la colline à laquelle s’accroche le château et visitai cette vaste bâtisse quadrangulaire, flanquée de tours à ses angles comme une ruine féodale. Peut-être pourrait-on regretter d’être monté jusque-là, si la vue ne s’étendait largement sur les superbes vignobles des environs et la plaine infinie où se déroule le Danube.
En aval de Presbourg, dans la matinée du 30 avril, la Dorothée s’engagea à travers la puszta. C’est le steppe russe, c’est la savane américaine, que cette puszta, dont les plaines immenses s’étendent dans toute la Hongrie centrale. Un territoire extrêmement curieux, avec ses pâturages dont on ne voit pas la fin, que parcourent quelquefois dans une galopade échevelée d’innombrables bandes de chevaux, et qui nourrit des troupeaux de bœufs et de buffles par milliers de têtes.
Là se développe en ses multiples zigzags le véritable Danube hongrois. Déjà grossi de puissants tributaires venus des petites Karpathes ou des Alpes Styriennes, il y prend des allures de grand fleuve, après n’avoir guère été que rivière dans sa traversée de l’Autriche.
En imagination, j’en remontais le cours, jusqu’à sa source lointaine, presque à la frontière française, dans le grand-duché de Bade limitrophe de l’Alsace, et je pensais que c’étaient les pluies de France qui lui apportaient ses premières eaux.
Arrivée le soir à Raab, la gabare s’amarra au quai pour la nuit, la journée du lendemain et la nuit suivante. Douze heures me suffirent pour visiter cette cité, plus forteresse que ville, le Gyor des Magyars.
À quelques lieues au-dessous de Raab, le lendemain, je pus, sans m’y arrêter, apercevoir la célèbre citadelle de Kromorn, créée de toutes pièces au XVe siècle par Mathias Corvin, et où se joua le dernier acte de l’insurrection.
Je ne sais rien de plus beau que de s’abandonner au courant du Danube en cette partie du territoire magyar. Toujours des méandres capricieux, des coudes brusques qui varient le paysage, des îles basses à demi noyées, au-dessus desquelles voltigent grues et cigognes. C’est la puszta dans toute sa magnificence, tantôt en prairies luxuriantes, tantôt en collines qui ondulent à l’horizon. Là prospèrent les vignobles des meilleurs crus de la Hongrie. On peut estimer à plus d’un million de pipes, dont le Tokay a sa part, la production de ce pays qui vient après la France, avant l’Italie et l’Espagne, sur la liste des régions viticoles. Cette récolte, dit-on, est presque entièrement consommée sur place. Je ne cacherai pas que je m’en suis offert quelques bouteilles dans les auberges du rivage. Autant de moins pour les gosiers magyars !
À noter que les méthodes de culture s’améliorent d’année en année dans la puszta. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait créer un réseau de canaux d’irrigation qui lui assureraient une extrême fertilité, planter des milliers d’arbres, et les disposer en longs et épais rideaux, comme une barrière contre les mauvais vents. Ainsi les céréales ne tarderaient pas à doubler et tripler leurs rendements.
Par malheur, la propriété n’est pas assez divisée en Hongrie. Les biens de main-morte y sont considérables, il est tel domaine de vingt-cinq milles carrés que son propriétaire n’a jamais pu explorer dans toute son étendue, et les petits cultivateurs ne détiennent pas même le quart de ce vaste territoire.
Cet état de choses, si préjudiciable au pays, changera graduellement, et rien que par cette logique forcée que possède l’avenir. D’ailleurs, le paysan hongrois n’est point réfractaire au progrès. Il est plein de bon vouloir, de courage et d’intelligence. Peut-être est-il un peu trop content de lui-même, moins toutefois que ne l’est le paysan germanique. Entre eux, il y a cette différence que si le premier croit pouvoir tout apprendre, le second croit déjà tout savoir.
Ce fut à Gran, sur la rive droite, que je remarquai un changement dans l’aspect général. Aux plaines de la puszta succédèrent de longues et épaisses collines, extrêmes ramifications des Karpathes et des Alpes Noriques qui enserrent le fleuve et l’obligent à traverser d’étroits défilés.
Gran est le siège de l’évêché primatial de Hongrie, et sans doute le plus envié de tous les évêchés du globe si les biens de ce monde ont quelque attrait pour un prélat catholique. En effet, le titulaire de ce siège, cardinal, primat, légat, prince de l’Empire et chancelier du royaume, est doté d’un revenu qui peut dépasser un million de livres.
En aval de Gran recommence la puszta. Il faut reconnaître que la nature est très artiste. La loi des contrastes, elle la pratique, en grand d’ailleurs, comme tout ce qu’elle fait. Ici, elle a voulu que le paysage, après les aspects si variés entre Presbourg et Gran, fût triste, chagrin, monotone.
En cet endroit, la Dorothée dut choisir l’un des bras qui forment l’île de Saint-André, et qui, d’ailleurs, sont tous les deux praticables à la navigation. Elle prit celui de gauche, ce qui me permit d’apercevoir la ville de Waitzen, dominée par une demi-douzaine de clochers, et dont une église, édifiée sur la rive même, se reflète dans les eaux, entre de grandes masses de verdure.
Au-delà, l’aspect du pays commence à se modifier. Dans la plaine s’échantillonnent des cultures maraîchères, sur le fleuve glissent des embarcations plus nombreuses. L’animation succède au calme. Il est visible que nous approchons d’une capitale. Et quelle capitale ! Double comme certaines étoiles, et si ces étoiles ne sont pas de première grandeur, du moins brillent-elles avec éclat dans la constellation hongroise.
La gabare a contourné une dernière île boisée. Bude apparaît d’abord, Pest ensuite, et c’est dans ces deux cités, inséparables comme des sœurs siamoises, que, du 3 au 6 mai, j’allais prendre quelque repos, en me fatiguant au-delà de toute raison à les visiter consciencieusement.
Entre Bude et Pest, entre la cité turque et la cité magyare passent les flottilles de barques, qui composent la batellerie de l’amont et de l’aval, sortes de galiotes surmontées d’un mât de pavillon à l’avant, et munies d’un large gouvernail dont la barre s’allonge démesurément. L’une et l’autre rive sont transformées en quais, que bordent des habitations d’aspect architectural, au-dessus desquelles pointent flèches et clochers.
Bude, la ville turque, est située sur la rive droite, Pest sur la rive gauche, et le Danube, toujours semé d’îles verdoyantes, forme la corde de la demi-circonférence occupée par la cité hongroise. De son côté, c’est la plaine, où la ville a pu et pourra s’étendre à son aise. Du côté de Bude, c’est une succession de collines bastionnées, que couronne la citadelle.
De turque qu’elle était, Bude tend à devenir hongroise, et même, à bien l’observer, autrichienne. Plus militaire que commerçante, l’animation des affaires lui fait défaut. Qu’on ne s’étonne pas si l’herbe pousse dans ses rues et encadre ses trottoirs. Pour habitants, surtout des soldats. On dirait qu’ils circulent dans une ville en état de siège. En maint endroit flotte le drapeau national dont la soie se déroule à la brise. C’est, à tout prendre, une cité un peu morte à laquelle fait face la si vivante Pest. Ici, pourrait-on dire, le Danube coule entre l’avenir et le passé.
Cependant, si Bude possède un arsenal, et si les casernes ne lui manquent point, on peut y visiter aussi plusieurs palais qui ont fort grand air. J’ai ressenti quelque impression devant ses vieilles églises, devant sa cathédrale qui fut changée en mosquée sous la domination ottomane. J’ai suivi une large rue dont les maisons, à terrasses comme en Orient, sont entourées de grilles. J’ai parcouru les salles de la Maison de Ville, ceinte de barrières aux bigarrures jaunes et noires. J’ai contemplé ce tombeau de Gull-Baba que visitent les pèlerins turcs.
Mais il en fut pour moi comme pour le plus grand nombre des étrangers, et Pest me prit le meilleur de mon temps. Ce temps ne fut point perdu, on peut m’en croire, car, en vérité, deux jours ne suffisent pas à visiter la capitale hongroise, la noble cité universitaire.
Il convient, d’abord, de gravir la colline située au sud de Bude, à l’extrémité du faubourg de Taban, afin d’avoir la vue complète des deux villes. De ce point, on aperçoit les quais de Pest et ses places bordées de palais et d’hôtels d’une belle disposition architecturale. Çà et là, des dômes aux nervures dorées, des flèches hardiment dressées vers le ciel. L’aspect de Pest est assurément grandiose, et ce n’est pas sans raison qu’on l’a quelquefois préféré à celui de Vienne.
Dans la campagne environnante, semée de villas, se développe cette immense plaine de Rakos où, jadis, les cavaliers hongrois tenaient à grand bruit leurs diètes nationales.
On ne peut ensuite négliger de voir avec soin le Musée, les toiles et statues, les salles d’histoire naturelle et d’antiquités préhistoriques, les inscriptions, les monnaies, les collections ethnographiques de grande valeur qu’il contient. Puis, il faut visiter l’île Marguerite, ses bosquets, ses prairies, ses bains alimentés par une source thermale, et aussi le Jardin public, le Stadtwaldchen, arrosé par une petite rivière praticable aux légères embarcations, ses beaux ombrages, ses tentes, ses jeux, et dans lequel s’ébat une foule vive, cavalière, où se rencontrent en grand nombre de remarquables types d’hommes et de femmes.
La veille de mon départ, j’entrai dans une des principales hôtelleries de la ville pour me reposer un instant. La boisson favorite des Magyars, vin blanc mélangé d’une eau ferrugineuse, m’avait agréablement rafraîchi, et j’allais continuer mes courses à travers la ville, lorsque mes regards tombèrent sur une gazette déployée. Je la pris machinalement, et ce titre en grosses lettres gothiques : « Anniversaire Storitz », attira aussitôt mon attention.
Ce nom était celui qu’avait prononcé le lieutenant de police, celui du fameux alchimiste allemand et aussi de ce prétendant évincé à la main de Myra Roderich. Il ne pouvait y avoir doute à cet égard.
Voici ce que je lus :
« Dans une vingtaine de jours, le 25 mai, l’anniversaire d’Otto Storitz sera célébré à Spremberg. On peut affirmer que la population se portera en foule au cimetière de la ville natale du célèbre savant.
« On le sait, cet homme extraordinaire a illustré l’Allemagne par ses travaux merveilleux, par ses découvertes étonnantes, par ses inventions qui ont tant contribué aux progrès des sciences physiques. »
L’auteur de l’article n’exagérait pas, en vérité. Otto Storitz était justement célèbre dans le monde scientifique. Mais, ce qui me donna le plus à penser, ce furent les lignes suivantes :
« Personne n’ignore que, de son vivant, près de certains esprits enclins au surnaturel, Otto Storitz a passé pour être quelque peu sorcier. Un ou deux siècles plus tôt, il n’est pas bien sûr qu’il n’eût pas été arrêté, condamné, brûlé en place publique. Nous ajouterons que, depuis sa mort, nombre de gens, évidemment disposés à la crédulité, le tiennent plus que jamais pour un faiseur de sortilèges et d’incantations, ayant possédé un pouvoir surhumain. Ce qui les rassure, c’est qu’il a emporté ses secrets dans la tombe. Il ne faut pas compter que ces braves gens ouvriront jamais les yeux, et pour eux Otto Storitz restera bel et bien un kabaliste, un magicien, voire un démoniaque. »
Qu’il soit ce que l’on voudra, pensai-je, l’important est que son fils ait été définitivement éconduit par le docteur Roderich. Quant au reste, peu me chaud !
La gazette concluait en ces termes :
« Il y a donc lieu de croire que la foule sera considérable, comme tous les ans, à la cérémonie de l’anniversaire, sans parler des amis sérieux restés fidèles au souvenir d’Otto Storitz. Il n’est pas téméraire de penser que la population on ne peut plus superstitieuse de Spremberg s’attend à quelque prodige et désire en être témoin. D’après ce qu’on répète couramment en ville, le cimetière doit être le théâtre des plus invraisemblables et des plus extraordinaires phénomènes. Personne ne s’étonnerait si, au milieu de l’épouvante générale, la pierre du tombeau se soulevait et si le fantastique savant ressuscitait dans toute sa gloire.
« Selon l’opinion de quelques-uns, Otto Storitz ne serait même pas mort, et on aurait procédé à de fausses funérailles le jour de ses obsèques.
« Nous ne nous attarderons pas à discuter de pareilles sornettes. Mais, comme chacun sait, les superstitions n’ont que faire de la logique, et bien des années s’écouleront avant que le bon sens ait détruit ces ridicules légendes. »
Cette lecture ne laissa pas de me suggérer quelques réflexions pessimistes. Que Otto Storitz fût mort et enterré, rien de plus certain. Que son tombeau dût se rouvrir le 25 mai, et qu’il dût apparaître comme un nouveau Lazare aux regards de la foule, cela ne valait pas la peine qu’on s’y arrêtât un instant. Mais, si le décès du père n’était pas contestable, il ne l’était pas davantage qu’il eût un fils vivant et bien vivant, ce Wilhelm Storitz repoussé par la famille Roderich. N’y avait-il lieu de craindre qu’il ne causât des ennuis à Marc, qu’il ne créât des difficultés à son mariage ?...





























