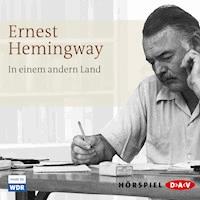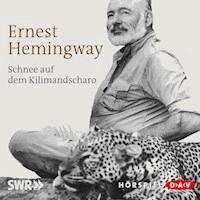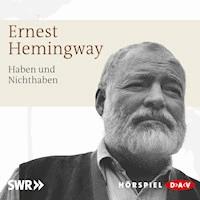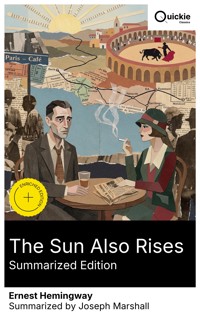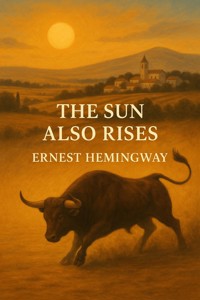3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
Le soleil se lève aussi est un roman d'Ernest Hemingway, publié pour la première fois en 1926. Situé dans les années 1920, il suit un groupe d'expatriés américains et britanniques qui se rendent de Paris au festival de San Fermín à Pampelune, en Espagne. L'histoire tourne autour de Jake Barnes, journaliste et vétéran de la Première Guerre mondiale, dont les blessures dues à la guerre l'ont rendu incapable d'avoir des relations sexuelles, et de ses relations amoureuses avec Lady Brett Ashley, une belle femme britannique qui a pleinement embrassé la liberté sexuelle que l'époque lui a donnée. Le roman explore les thèmes de l'amour, de la désillusion, de la masculinité et de la génération perdue au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tout au long du récit, les personnages s'adonnent à la boisson, aux combats et à l'errance sans but, reflétant ainsi l'absence de but et l'ambiguïté morale de leur vie. Le soleil se lève aussi, bien qu'initialement accueilli par des critiques mitigées, est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes œuvres d'Hemingway et comme un roman déterminant du mouvement littéraire de la Génération perdue.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table des matières
Livre I
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Livre II
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Livre III
Chapitre XIX
Le soleil se lève aussi Ernest Hemingway
Dédicace
Ce livre est destiné à Hadley et à John Hadley Nicanor.
"Vous êtes tous une génération perdue n".
-Gertrude Stein dans une conversation
"Une génération passe, une autre vient, mais la terre demeure éternellement. . . . Le soleil se lève, et le soleil se couche ; il se hâte vers le lieu où il s'est levé. . . . Le vent va vers le midi, et se retourne vers le nord ; il tourbillonne sans cesse, et le vent revient selon ses circuits. . . . Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est pas pleine ; les fleuves reviennent au lieu d'où ils viennent.
-Ecclésiaste
Livre I
Chapitre I
Robert Cohn a été champion de boxe poids moyen de Princeton. Ne croyez pas que je sois très impressionné par ce titre de champion de boxe, mais il signifiait beaucoup pour Cohn. Il n'aimait pas la boxe, en fait il la détestait, mais il l'avait apprise péniblement et à fond pour contrer le sentiment d'infériorité et de timidité qu'il avait ressenti en étant traité comme un juif à Princeton. Il y avait un certain réconfort intérieur à savoir qu'il pouvait mettre au tapis quiconque se montrait prétentieux à son égard, même si, étant très timide et un garçon tout à fait gentil, il ne s'est jamais battu, sauf au gymnase. Il était l'élève vedette de Spider Kelly. Spider Kelly enseignait à tous ses jeunes gentlemen à boxer comme des poids plume, qu'ils pèsent cent cinq ou deux cent cinq livres. Mais cela semblait convenir à Cohn. Il était vraiment très rapide. Il était si bon que Spider le surpassa rapidement et lui aplatit le nez de façon permanente. Cela augmenta le dégoût de Cohn pour la boxe, mais lui procura une certaine satisfaction d'un genre étrange, et améliora certainement son nez. Au cours de sa dernière année à Princeton, il lisait trop et s'est mis à porter des lunettes. Je n'ai jamais rencontré un seul membre de sa classe qui se souvenait de lui. Ils ne se souvenaient même pas qu'il était champion de boxe poids moyen.
Je me méfie de toutes les personnes franches et simples, surtout lorsque leurs histoires se tiennent, et j'ai toujours soupçonné que Robert Cohn n'avait peut-être jamais été champion de boxe poids moyen, et qu'un cheval lui avait peut-être marché sur le visage, ou que sa mère avait peut-être eu peur ou vu quelque chose, ou qu'il s'était peut-être heurté à quelque chose lorsqu'il était jeune enfant, mais j'ai finalement eu quelqu'un qui a vérifié l'histoire auprès de Spider Kelly. Spider Kelly ne se souvenait pas seulement de Cohn. Il s'est souvent demandé ce qu'il était devenu.
Robert Cohn était membre, par son père, de l'une des familles juives les plus riches de New York et, par sa mère, de l'une des plus anciennes. À l'école militaire où il préparait Princeton et jouait un très bon joueur dans l'équipe de football, personne ne l'avait sensibilisé à la question raciale. Personne ne lui avait jamais fait sentir qu'il était juif et donc différent des autres, jusqu'à ce qu'il aille à Princeton. C'était un gentil garçon, un garçon amical, mais très timide, et cela lui a donné de l'amertume. Il s'en est pris à la boxe, et il est sorti de Princeton avec une douloureuse conscience de soi et un nez aplati, et il s'est marié avec la première fille qui a été gentille avec lui. Il resta marié cinq ans, eut trois enfants, perdit la plus grande partie des cinquante mille dollars que son père lui avait laissés, le reste de la succession étant allé à sa mère, s'endurcit dans un moule peu attrayant sous le malheur domestique d'une femme riche ; et juste au moment où il s'était décidé à quitter sa femme, elle le quitta et partit avec un peintre miniature. Comme il pensait depuis des mois à quitter sa femme et qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il aurait été trop cruel de la priver de lui-même, son départ fut un choc très salutaire.
Le divorce est prononcé et Robert Cohn part sur la Côte. En Californie, il rencontra des gens de lettres et, comme il lui restait encore un peu de ses cinquante mille dollars, il soutint en peu de temps une revue sur les arts. La revue commença à être publiée à Carmel, en Californie, et finit à Provincetown, dans le Massachusetts. À ce moment-là, Cohn, qui avait été considéré comme un simple ange et dont le nom n'apparaissait sur la page éditoriale qu'en tant que membre du comité consultatif, était devenu l'unique rédacteur en chef. C'était son argent et il découvrit qu'il aimait l'autorité de la rédaction. Il a regretté que le magazine devienne trop cher et qu'il doive y renoncer.
Mais à ce moment-là, il avait d'autres chats à fouetter. Il avait été pris en main par une dame qui espérait s'élever avec le magazine. Elle était très énergique, et Cohn n'avait aucune chance de ne pas être pris en main. De plus, il était sûr de l'aimer. Lorsque cette dame a vu que le magazine n'allait pas monter, elle a été un peu dégoûtée par Cohn et a décidé qu'elle pourrait aussi bien obtenir ce qu'il y avait à obtenir pendant qu'il y avait encore quelque chose de disponible, et elle a donc insisté pour qu'ils aillent en Europe, où Cohn pourrait écrire. Ils se rendirent en Europe, où la dame avait été éduquée, et y restèrent trois ans. Pendant ces trois années, la première passée à voyager, les deux dernières à Paris, Robert Cohn avait deux amis, Braddocks et moi-même. Braddocks était son ami littéraire. J'étais son ami de tennis.
La dame qui l'avait, Frances, s'aperçut vers la fin de la deuxième année que son apparence se dégradait, et son attitude envers Robert passa d'une possession et d'une exploitation insouciantes à une détermination absolue à ce qu'il l'épouse. Pendant cette période, la mère de Robert lui avait accordé une allocation d'environ trois cents dollars par mois. Pendant deux ans et demi, je ne crois pas que Robert Cohn ait regardé une autre femme. Il était assez heureux, sauf que, comme beaucoup de gens vivant en Europe, il aurait préféré être en Amérique, et il avait découvert l'écriture. Il a écrit un roman, et ce n'était pas vraiment un mauvais roman, comme l'ont dit plus tard les critiques, même si c'était un très mauvais roman. Il lit de nombreux livres, joue au bridge, au tennis et fait de la boxe dans un gymnase local.
J'ai pris conscience pour la première fois de l'attitude de sa dame à son égard un soir après que nous ayons dîné tous les trois ensemble. Nous avions dîné à l'Avenue et étions ensuite allés prendre un café au Café de Versailles. Nous avons eu plusieurs amendes après le café, et j'ai dit que je devais y aller. Cohn avait parlé de partir tous les deux en week-end. Il voulait quitter la ville et faire une bonne promenade. J'ai proposé que nous prenions l'avion pour Strasbourg et que nous marchions jusqu'à Sainte-Odile, ou quelque part en Alsace. "Je connais une fille à Strasbourg qui peut nous montrer la ville", ai-je dit.
Quelqu'un m'a donné un coup de pied sous la table. J'ai pensé que c'était accidentel et j'ai continué : "Elle est là depuis deux ans et sait tout ce qu'il y a à savoir sur la ville. C'est une fille formidable."
J'ai reçu un nouveau coup de pied sous la table et, en regardant, j'ai vu Frances, la femme de Robert, dont le menton se levait et dont le visage se durcissait.
"J'ai dit : "Bon sang, pourquoi aller à Strasbourg ? Nous pourrions aller jusqu'à Bruges ou dans les Ardennes."
Cohn avait l'air soulagé. Je n'ai pas reçu de nouveau coup de pied. J'ai dit bonne nuit et je suis sorti. Cohn me dit qu'il voulait acheter un journal et qu'il m'accompagnerait jusqu'au coin de la rue. "Pour l'amour de Dieu", dit-il, "pourquoi avez-vous dit cela à propos de cette fille à Strasbourg ? Tu n'as pas vu Frances ?"
"Non, pourquoi le ferais-je ? Si je connais une Américaine qui vit à Strasbourg, qu'est-ce que ça peut bien faire à la France ?"
"Cela ne fait aucune différence. N'importe quelle fille. Je ne pourrais pas y aller, c'est tout."
"Ne soyez pas stupide."
"Tu ne connais pas Frances. Aucune fille. Tu n'as pas vu à quoi elle ressemblait ?"
"Oh, eh bien", ai-je dit, "allons à Senlis".
"Ne vous énervez pas."
"Je n'ai pas mal. Senlis est un bon endroit et nous pouvons rester au Grand Cerf, faire une randonnée dans les bois et rentrer à la maison."
"Bien, c'est parfait".
"Eh bien, je vous verrai demain au tribunal", ai-je dit.
"Bonne nuit, Jake", dit-il, et il reprit le chemin du café.
"Tu as oublié de prendre ton journal", ai-je dit.
"C'est vrai. Il m'accompagne jusqu'au kiosque au coin de la rue. "Tu n'as pas mal, n'est-ce pas, Jake ?" Il s'est retourné, le papier à la main.
"Non, pourquoi devrais-je l'être ?"
Il m'a dit : "On se voit au tennis". Je l'ai regardé retourner au café en tenant son journal. Je l'aimais bien et, de toute évidence, elle lui a mené la vie dure.
Chapitre II
Cet hiver-là, Robert Cohn est parti en Amérique avec son roman, qui a été accepté par un assez bon éditeur. J'ai entendu dire que son départ avait fait un scandale, et je pense que c'est là que Frances l'a perdu, parce que plusieurs femmes étaient gentilles avec lui à New York, et lorsqu'il est revenu, il avait changé du tout au tout. Il était plus enthousiaste que jamais à l'égard de l'Amérique, mais il n'était plus aussi simple, ni aussi gentil. Les éditeurs avaient fait l'éloge de son roman et cela lui était monté à la tête. Ensuite, plusieurs femmes s'étaient mises en tête d'être gentilles avec lui, et son horizon avait changé. Pendant quatre ans, son horizon s'était limité à sa femme. Pendant trois ans, ou presque, il n'avait jamais vu au-delà de Frances. Je suis sûr qu'il n'avait jamais été amoureux de sa vie.
Il s'était marié sur un coup de tête après la période pourrie qu'il avait vécue à l'université, et Frances l'avait pris sur un coup de tête après avoir découvert qu'il n'avait pas été tout ce qu'il fallait pour sa première femme. Il n'était pas encore amoureux, mais il s'est rendu compte qu'il était une quantité attrayante pour les femmes, et que le fait qu'une femme s'intéresse à lui et veuille vivre avec lui n'était pas simplement un miracle divin. Cela l'a transformé et il n'était plus aussi agréable à vivre. De plus, en jouant des enjeux plus élevés que ce qu'il pouvait se permettre dans des parties de bridge plutôt ardues avec ses relations new-yorkaises, il avait gardé des cartes et gagné plusieurs centaines de dollars. Cela le rendit plutôt vaniteux de son jeu de bridge, et il dit à plusieurs reprises qu'un homme pouvait toujours gagner sa vie au bridge s'il y était contraint.
Et puis il y a eu autre chose. Il avait lu W. H. Hudson. Cela semble être une occupation innocente, mais Cohn avait lu et relu "La terre pourpre". "La Terre pourpre est un livre très sinistre s'il est lu trop tard dans la vie. Il raconte les splendides aventures amoureuses imaginaires d'un parfait gentleman anglais dans un pays intensément romantique, dont les paysages sont très bien décrits. Qu'un homme le prenne à trente-quatre ans comme guide de ce que la vie lui réserve est à peu près aussi sûr qu'il le serait pour un homme du même âge d'entrer à Wall Street en sortant directement d'un couvent français, équipé d'un ensemble complet des livres plus pratiques d'Alger. Cohn, je crois, a pris chaque mot de "The Purple Land" aussi littéralement que s'il s'agissait d'un rapport de R. G. Dun. Vous me comprenez, il a émis quelques réserves, mais dans l'ensemble, le livre lui a semblé solide. C'était tout ce qu'il fallait pour le mettre en route. Je n'ai pas réalisé à quel point cela l'avait mis en colère jusqu'au jour où il est venu dans mon bureau.
"Bonjour, Robert", dis-je. "Tu es venu pour me remonter le moral ?"
"Il a demandé : "Veux-tu aller en Amérique du Sud, Jake ?
"Non.
"Pourquoi pas ?
"Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu y aller. C'est trop cher. De toute façon, on peut voir tous les Sud-Américains que l'on veut à Paris."
"Ce ne sont pas les vrais Sud-Américains.
"Ils me semblent terriblement réels".
J'avais un train à prendre avec le courrier d'une semaine, dont la moitié seulement était écrite.
"Connaissez-vous des saletés ?" ai-je demandé.
"Non.
"Aucune de vos relations exaltées n'a divorcé ?"
"Non, écoute, Jake. Si je m'occupe de nos dépenses à tous les deux, tu viendras en Amérique du Sud avec moi ?"
"Pourquoi moi ?
"Tu peux parler espagnol. Et ce serait plus amusant à deux".
"Non, j'ai dit, j'aime cette ville et je vais en Espagne pendant l'été.
"Toute ma vie, j'ai voulu faire un voyage comme celui-là", dit Cohn. Il s'est assis. "Je serai trop vieux avant de pouvoir le faire."
"Ne fais pas l'imbécile", ai-je dit. "Tu peux aller où tu veux. Tu as beaucoup d'argent."
"Je sais. Mais je n'arrive pas à commencer."
"Je lui ai dit : "Courage ! "Tous les pays ressemblent à des images animées".
Mais j'ai eu pitié de lui. Il était mal en point.
"Je ne supporte pas de penser que ma vie passe si vite et que je ne la vis pas vraiment.
"Personne ne vit sa vie jusqu'au bout, sauf les toreros".
"Les toreros ne m'intéressent pas. C'est une vie anormale. Je veux retourner dans mon pays, en Amérique du Sud. Nous pourrions faire un grand voyage".
"Avez-vous déjà envisagé d'aller tourner en Afrique de l'Est britannique ?
"Non, je n'aimerais pas ça".
"J'irais là-bas avec toi."
"Non, cela ne m'intéresse pas."
"C'est parce que vous n'avez jamais lu de livre sur le sujet. Va donc lire un livre plein d'histoires d'amour avec les belles princesses noires et brillantes."
"Je veux aller en Amérique du Sud.
Il avait un côté dur, juif et têtu.
"Descendez et prenez un verre."
"Tu ne travailles pas ?"
"Non", ai-je répondu. Nous avons descendu les escaliers jusqu'au café du rez-de-chaussée. J'avais découvert que c'était le meilleur moyen de se débarrasser de ses amis. Une fois qu'on a bu un verre, tout ce qu'on a à dire, c'est : "Bon, il faut que je rentre et que j'enlève quelques câbles", et c'était fait. Il est très important de découvrir des sorties gracieuses comme celle-là dans le secteur de la presse, où une part si importante de l'éthique veut que vous ne sembliez jamais travailler. Quoi qu'il en soit, nous sommes descendus au bar et avons pris un whisky et un soda. Cohn a regardé les bouteilles dans les bacs autour du mur. "C'est un bon endroit", a-t-il dit.
"Il y a beaucoup d'alcool", ai-je convenu.
"Écoute, Jake", dit-il en s'appuyant sur le bar. "Tu n'as jamais l'impression que ta vie passe et que tu n'en profites pas ? Tu te rends compte que tu as déjà vécu près de la moitié du temps qu'il te reste à vivre ?"
"Oui, de temps en temps".
"Sais-tu que dans environ trente-cinq ans, nous serons morts ?"
"C'est quoi ce bordel, Robert", ai-je dit. "C'est quoi ce bordel."
"Je suis sérieux."
"C'est une chose dont je ne me préoccupe pas", ai-je dit.
"Vous devriez".
"J'ai eu beaucoup de raisons de m'inquiéter à un moment ou à un autre. J'ai fini de m'inquiéter".
"Eh bien, je veux aller en Amérique du Sud".
"Écoute, Robert, aller dans un autre pays ne change rien. J'ai essayé tout cela. On ne peut pas s'éloigner de soi-même en changeant d'endroit. Il n'y a rien à faire."
"Mais vous n'êtes jamais allé en Amérique du Sud."
"L'Amérique du Sud, c'est l'enfer ! Si vous y alliez comme vous vous sentez maintenant, ce serait exactement la même chose. C'est une bonne ville. Pourquoi ne pas commencer à vivre votre vie à Paris ?"
"J'en ai marre de Paris, et j'en ai marre du quartier."
"Restez à l'écart du quartier. Promenez-vous seul et vous verrez ce qui vous arrivera."
"Il ne m'arrive rien. J'ai marché seul toute une nuit et il ne s'est rien passé sauf qu'un flic à vélo m'a arrêté et m'a demandé de voir mes papiers."
"La ville n'était-elle pas agréable la nuit ?"
"Je n'aime pas Paris."
C'est ainsi que les choses se sont passées. J'étais désolé pour lui, mais il n'y avait rien à faire, parce qu'on se heurtait tout de suite à deux entêtements : L'Amérique du Sud pouvait arranger les choses et il n'aimait pas Paris. La première idée lui est venue d'un livre, et je suppose que la seconde est venue d'un livre également.
"Eh bien", ai-je dit, "il faut que je monte à l'étage et que j'enlève quelques câbles".
"Tu dois vraiment partir ?"
"Oui, je dois enlever ces câbles."
"Ça vous dérange si je monte m'asseoir dans le bureau ?"
"Non, montez".
Il s'est assis dans la pièce extérieure et a lu les journaux, tandis que le rédacteur en chef, l'éditeur et moi-même avons travaillé dur pendant deux heures. Ensuite, j'ai trié les carbones, j'ai apposé un cachet sur une ligne secondaire, j'ai mis le tout dans deux grandes enveloppes en papier manille et j'ai appelé un garçon pour qu'il les emmène à la gare Saint-Lazare. Je suis sorti dans l'autre pièce et j'ai trouvé Robert Cohn endormi dans le grand fauteuil. Il dormait la tête sur les bras. Je n'aimais pas le réveiller, mais je voulais fermer le bureau et partir. J'ai posé ma main sur son épaule. Il a secoué la tête. "Je ne peux pas le faire", a-t-il dit en enfonçant davantage sa tête dans ses bras. "Je ne peux pas le faire. Rien ne me fera le faire."
"Robert", ai-je dit, et je lui ai serré l'épaule. Il a levé les yeux. Il a souri et a cligné des yeux.
"Est-ce que j'ai parlé à voix haute à ce moment-là ?"
"Quelque chose. Mais ce n'était pas clair."
"Mon Dieu, quel rêve pourri !"
"La machine à écrire vous a-t-elle endormi ?"
"Je suppose que oui. Je n'ai pas dormi de la nuit."
"Qu'est-ce qui se passe ?"
"Parler", a-t-il dit.
J'ai pu l'imaginer. J'ai la mauvaise habitude d'imaginer les scènes de chambre de mes amis. Nous sommes allés au Café Napolitain pour prendre un apéritif et regarder la foule du soir sur le Boulevard.
Chapitre III
C'était une chaude nuit de printemps et j'étais assis à une table sur la terrasse du Napolitain après le départ de Robert, regardant la nuit tomber et les panneaux électriques s'allumer, et le signal rouge et vert d'arrêt et de marche, et la foule qui passait, et les fiacres qui cliquetaient au bord de la circulation des taxis, et les poules qui passaient, seules ou par deux, à la recherche du repas du soir. J'ai regardé une belle fille passer devant la table, je l'ai regardée remonter la rue, je l'ai perdue de vue, j'en ai regardé une autre, puis j'ai vu la première revenir. Elle est repassée, j'ai croisé son regard, elle s'est approchée et s'est assise à la table. Le serveur s'est approché.
"Eh bien, qu'allez-vous boire ?" demandai-je.
"Pernod".
"Ce n'est pas bon pour les petites filles".
"Petite fille toi-même. Dites garçon, un pernod."
"Un pernod pour moi aussi".
"Qu'est-ce qu'il y a ?" demande-t-elle. "Vous allez à une fête ?"
"Bien sûr. N'est-ce pas ?"
"Je ne sais pas. On ne sait jamais dans cette ville."
"Vous n'aimez pas Paris ?"
"Non.
"Pourquoi n'allez-vous pas ailleurs ?"
"N'est nulle part ailleurs."
"Vous êtes heureux, d'accord."
"Heureux, bon sang !"
Le Pernod est une imitation verdâtre de l'absinthe. Lorsque vous ajoutez de l'eau, elle devient laiteuse. Il a un goût de réglisse et une bonne sensation d'euphorie, mais il vous fait tomber tout aussi bas. Nous nous sommes assis et avons bu, et la fille avait l'air maussade.
"Eh bien", ai-je dit, "allez-vous m'offrir un dîner ?"
Elle a souri et j'ai compris pourquoi elle s'efforçait de ne pas rire. La bouche fermée, elle était plutôt jolie. J'ai payé les soucoupes et nous sommes sortis dans la rue. J'ai hélé un fiacre et le chauffeur s'est arrêté au bord du trottoir. Installés dans le fiacre qui roulait lentement et sans à-coups, nous avons remonté l'avenue de l'Opéra, passé les portes fermées des magasins, leurs vitrines éclairées, l'avenue large et brillante et presque déserte. Le taxi passa devant le bureau du New York Herald dont la fenêtre était remplie d'horloges.
"Elle a demandé à quoi servaient toutes ces horloges.
"Ils diffusent l'heure dans toute l'Amérique.
"Ne vous moquez pas de moi."
Nous avons quitté l'avenue pour remonter la rue des Pyramides, traverser la circulation de la rue de Rivoli et franchir une porte sombre pour entrer dans les Tuileries. Elle s'est blottie contre moi et j'ai passé mon bras autour d'elle. Elle a levé les yeux pour être embrassée. Elle m'a touché d'une main et j'ai repoussé sa main.
"Peu importe".
"Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es malade ?"
"Oui.
"Tout le monde est malade. Moi aussi, je suis malade."
Nous sommes sortis des Tuileries dans la lumière, avons traversé la Seine et avons pris la rue des Saints Pères.
"Il ne faut pas boire de pernod quand on est malade."
"Toi non plus".
"Cela ne fait aucune différence avec moi. Cela ne fait aucune différence avec une femme."
"Comment vous appelez-vous ?"
"Georgette. Comment t'appelles-tu ?"
"Jacob.
"C'est un nom flamand."
"Américain aussi".
"Vous n'êtes pas Flamand ?"
"Non, l'Américain.
"Bien, je déteste les Flamands."
À ce moment-là, nous étions arrivés au restaurant. J'ai demandé au cocher de s'arrêter. Nous sommes descendus et Georgette n'a pas aimé l'aspect de l'endroit. "Ce n'est pas un grand restaurant".
"Non", dis-je. "Peut-être préférez-vous aller chez Foyot. Pourquoi ne pas garder le taxi et continuer ?"
Je l'avais prise avec une vague idée sentimentale qu'il serait agréable de manger avec quelqu'un. Il y avait longtemps que je n'avais pas dîné avec une poule, et j'avais oublié à quel point cela pouvait être ennuyeux. Nous entrâmes dans le restaurant, passâmes devant Madame Lavigne à la réception et entrâmes dans une petite salle. Georgette s'est un peu égayée en mangeant.
"Ce n'est pas mal ici", dit-elle. "Ce n'est pas chic, mais la nourriture est bonne.
"Mieux que ce que l'on mange à Liège".
"Bruxelles, vous voulez dire".
Nous avons bu une autre bouteille de vin et Georgette a fait une blague. Elle a souri et a montré toutes ses mauvaises dents, et nous avons touché nos verres. "Tu n'es pas un mauvais type", a-t-elle dit. "C'est dommage que tu sois malade. Nous nous entendons bien. Qu'est-ce que tu as, d'ailleurs ?"
"J'ai été blessé pendant la guerre", ai-je dit.
"Oh, cette sale guerre".
Nous aurions probablement continué à discuter de la guerre et nous serions tombés d'accord sur le fait qu'il s'agissait en réalité d'une calamité pour la civilisation et qu'il aurait peut-être mieux valu l'éviter. Je m'ennuyais assez. A ce moment-là, quelqu'un appela de l'autre pièce : "Barnes ! Je dis : Barnes ! Jacob Barnes !"
"C'est un ami qui m'appelle", ai-je expliqué, et je suis sorti.
Braddocks était à une grande table avec un groupe : Cohn, Frances Clyne, Mme Braddocks, plusieurs personnes que je ne connaissais pas.
"Vous venez au bal, n'est-ce pas ?" demande Braddocks.
"Quelle danse ?"
"Pourquoi, les dancings. Vous ne savez pas que nous les avons relancées ?" dit Mme Braddocks.
"Tu dois venir, Jake. Nous partons tous", dit Frances du bout de la table. Elle était grande et souriante.
"Bien sûr, il vient", dit Braddocks. "Entrez et prenez un café avec nous, Barnes."
"C'est vrai.
"Et amenez votre ami", dit Mme Braddocks en riant. C'était une Canadienne et elle avait toutes les grâces sociales faciles.
"Merci, nous serons là", ai-je dit. Je suis retourné dans la petite pièce.
"Qui sont tes amis ? demande Georgette.
"Écrivains et artistes".
"Il y en a beaucoup de ce côté-ci de la rivière.
"Trop".
"Je pense que oui. Pourtant, certains d'entre eux gagnent de l'argent."
"Oh, oui".
Nous avons terminé le repas et le vin. "Viens", ai-je dit. "Nous allons prendre un café avec les autres."
Georgette ouvre son sac, fait quelques passes sur son visage en se regardant dans le petit miroir, redessine ses lèvres avec le rouge à lèvres et redresse son chapeau.
"Bien", dit-elle.
Nous sommes entrés dans la salle pleine de monde et Braddocks et les hommes de sa table se sont levés.
"Je vous présente ma fiancée, Mademoiselle Georgette Leblanc", dis-je. Georgette a souri de son merveilleux sourire et nous nous sommes serré la main.
"Avez-vous un lien de parenté avec Georgette Leblanc, la chanteuse ? demande Mme Braddocks.
"Connais pas", répond Georgette.
"Mais vous avez le même nom", insiste cordialement Mme Braddocks.
"Non, dit Georgette. "Pas du tout. Je m'appelle Hobin."
"Mais M. Barnes vous a présentée comme Mademoiselle Georgette Leblanc. Il l'a certainement fait", insiste Mme Braddocks qui, dans l'excitation de parler français, risque de ne pas savoir ce qu'elle dit.
"C'est un imbécile", dit Georgette.
"Oh, c'était une blague, alors", a dit Mme Braddocks.
"Oui, dit Georgette. "Pour rire."
"Tu as entendu ça, Henry ?" Mme Braddocks a appelé Braddocks en bas de la table. "M. Barnes a présenté sa fiancée comme étant Mademoiselle Leblanc, et son nom est en fait Hobin."
"Bien sûr, ma chérie. Mademoiselle Hobin, je la connais depuis très longtemps."
Frances Clyne, parlant français très rapidement et ne semblant pas aussi fière et étonnée que Mme Braddocks de le voir sortir vraiment en français, appela : "Oh, Mademoiselle Hobin". "Vous êtes à Paris depuis longtemps ? Vous vous plaisez ici ? Vous aimez Paris, n'est-ce pas ?"
"Qui est-elle ?" Georgette se tourne vers moi. "Dois-je lui parler ?"
Elle se tourna vers Frances, assise et souriante, les mains croisées, la tête posée sur son long cou, les lèvres pincées, prête à reprendre la parole.
"Non, je n'aime pas Paris. C'est cher et sale."
"Vraiment ? Je la trouve extraordinairement propre. C'est l'une des villes les plus propres d'Europe."
"Je trouve ça sale".
"Comme c'est étrange ! Mais peut-être n'êtes-vous pas là depuis longtemps."
"Je suis ici depuis assez longtemps."
"Mais il y a des gens sympas. Il faut l'admettre."
Georgette se tourne vers moi. "Tu as de bons amis".
Frances était un peu ivre et aurait aimé continuer, mais le café est arrivé, et Lavigne avec les liqueurs, et après cela nous sommes tous sortis et avons commencé à nous rendre au dancing de Braddocks.
Le dancing-club était un bal musette dans la rue de la Montagne Sainte Geneviève. Cinq soirs par semaine, les ouvriers du quartier du Panthéon y dansaient. Un soir par semaine, c'était le dancing. Le lundi soir, il était fermé. Lorsque nous sommes arrivés, il était bien vide, à l'exception d'un policier assis près de la porte, de la femme du propriétaire à l'arrière du zinc, et du propriétaire lui-même. La fille de la maison est descendue au moment où nous sommes entrés. Il y avait de longues banquettes et des tables qui traversaient la pièce, et au fond une piste de danse.
"J'aimerais que les gens viennent plus tôt", a déclaré M. Braddocks. La fille s'est approchée et a voulu savoir ce que nous allions boire. Le propriétaire est monté sur un haut tabouret à côté de la piste de danse et a commencé à jouer de l'accordéon. Il avait un chapelet de clochettes autour d'une cheville et battait la mesure avec son pied tout en jouant. Tout le monde dansait. Il faisait chaud et nous sortions de la piste en transpirant.
"Mon Dieu", dit Georgette. "Quelle boîte pour transpirer !"
"Il fait chaud".
"Chaud, mon Dieu !"
"Enlevez votre chapeau".
"C'est une bonne idée".
Quelqu'un a demandé à Georgette de danser et je suis allé au bar. Il faisait vraiment très chaud et la musique de l'accordéon était agréable dans la nuit chaude. J'ai bu une bière, debout dans l'embrasure de la porte, et j'ai respiré le souffle frais du vent de la rue. Deux taxis descendaient la rue en pente. Ils se sont tous deux arrêtés devant le Bal. Une foule de jeunes hommes, certains en maillot, d'autres en manches de chemise, en sont sortis. Je pouvais voir leurs mains et leurs cheveux ondulés fraîchement lavés dans la lumière de la porte. Le policier qui se tenait près de la porte m'a regardé et a souri. Ils sont entrés. En entrant, sous la lumière, j'ai vu des mains blanches, des cheveux ondulés, des visages blancs, grimaçant, faisant des gestes, parlant. Brett était avec eux. Elle était très belle et elle était très proche d'eux.
L'un d'eux a vu Georgette et a dit : "Je le déclare. Il y a une vraie prostituée. Je vais danser avec elle, Lett. Tu me surveilles."
Le grand ténébreux, appelé Lett, dit : "Ne sois pas téméraire."
La blonde ondulée a répondu : "Ne t'inquiète pas, chérie". Et Brett les accompagnait.
J'étais très en colère. D'une manière ou d'une autre, ils me mettent toujours en colère. Je sais qu'ils sont censés être amusants et qu'il faut être tolérant, mais j'avais envie de me jeter sur l'un d'entre eux, n'importe lequel, n'importe quoi pour briser cette contenance supérieure et mièvre. Au lieu de cela, j'ai descendu la rue et j'ai bu une bière au bar du Bal le plus proche. La bière n'était pas bonne et j'ai bu un cognac encore plus mauvais pour faire passer le goût dans ma bouche. Lorsque je suis revenu au Bal, il y avait une foule sur la piste et Georgette dansait avec le grand jeune homme blond, qui dansait avec hâte, en portant la tête sur le côté, les yeux levés pendant qu'il dansait. Dès que la musique s'est arrêtée, un autre d'entre eux l'a invitée à danser. Elle avait été prise par eux. Je savais alors qu'ils danseraient tous avec elle. Ils sont comme ça.
Je me suis assis à une table. Cohn était assis là. Frances dansait. Mme Braddocks a fait venir quelqu'un et l'a présenté comme étant Robert Prentiss. Il venait de New York, en passant par Chicago, et était un nouveau romancier en pleine ascension. Il avait une sorte d'accent anglais. Je lui ai proposé de prendre un verre.
"Merci beaucoup", a-t-il dit, "je viens d'en prendre un".
"Prenez-en un autre".
"Merci, je le ferai alors."
Nous avons fait venir la fille de la maison et chacun a eu droit à un bon à l'eau.
"Ils m'ont dit que vous veniez de Kansas City.
"Oui.
"Vous trouvez Paris amusant ?"
"Oui.
"Vraiment ?"
J'étais un peu ivre. Pas ivre dans le bon sens du terme, mais juste assez pour être imprudent.
"Pour l'amour de Dieu", j'ai dit "oui". N'est-ce pas ?
"Oh, comme vous vous mettez en colère de façon charmante", a-t-il dit. "J'aimerais avoir cette faculté."
Je me suis levée et je me suis dirigée vers la piste de danse. Mme Braddocks me suivit. "Ne vous fâchez pas avec Robert", dit-elle. "Il n'est encore qu'un enfant, vous savez."
"Je n'étais pas fâché", ai-je dit. "J'ai juste pensé que j'allais peut-être vomir".
"Votre fiancée a beaucoup de succès", dit Mme Braddocks en regardant la piste où Georgette dansait dans les bras du grand ténébreux appelé Lett.
"N'est-ce pas ?" ai-je dit.
"Plutôt", dit Mme Braddocks.
Cohn s'est approché. "Viens, Jake", a-t-il dit, "prends un verre". Nous nous sommes dirigés vers le bar. "Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air de t'énerver pour quelque chose ?"
"Rien. Tout ce spectacle me rend malade, c'est tout."
Brett s'est approché du bar.
"Bonjour, les gars."
"Bonjour, Brett", dis-je. "Pourquoi n'es-tu pas serré ?"
"Il n'y aura plus jamais d'étroitesse d'esprit. Je dis, donnez-lui un brandy et un soda."
Elle tenait le verre et j'ai vu Robert Cohn qui la regardait. Il ressemblait beaucoup à ce que son compatriote avait dû ressentir lorsqu'il avait vu la terre promise. Bien sûr, Cohn était beaucoup plus jeune. Mais il avait ce regard d'attente impatiente et méritante.
Brett était sacrément belle. Elle portait un pull-over en jersey et une jupe en tweed, et ses cheveux étaient coiffés en arrière comme ceux d'un garçon. C'est elle qui a commencé. Elle était bâtie avec des courbes comme la coque d'un yacht de course, et ce jersey de laine n'en laissait rien paraître.
"C'est une belle équipe que tu fréquentes, Brett", ai-je dit.
"Ne sont-ils pas adorables ? Et vous, ma chère. Où l'avez-vous eu ?"
"Au Napolitain".
"Et vous avez passé une bonne soirée ?"
"Oh, c'est inestimable", ai-je dit.
Brett rit. "Ce n'est pas bien de ta part, Jake. C'est une insulte pour nous tous. Regarde Frances et Jo."
Ceci pour le bénéfice de Cohn.
"C'est une entrave au commerce", a dit Brett. Elle rit à nouveau.
"Vous êtes merveilleusement sobre", ai-je dit.
"Oui, n'est-ce pas ? Et quand on est avec les gens comme moi, on peut boire en toute sécurité."
La musique a commencé et Robert Cohn a dit : "Voulez-vous danser avec moi, Lady Brett ?"
Brett lui sourit. "J'ai promis de danser avec Jacob", dit-elle en riant. "Tu as un sacré nom biblique, Jake".
"Et le suivant ?", demande Cohn.
"On y va", dit Brett. "On a un rendez-vous à Montmartre." En dansant, j'ai regardé par-dessus l'épaule de Brett et j'ai vu Cohn, debout au bar, qui la regardait toujours.
"Tu en as fait une nouvelle", lui ai-je dit.
"N'en parlez pas. Pauvre homme. Je ne l'ai jamais su jusqu'à maintenant."
"Oh, bien sûr", ai-je dit. "Je suppose que tu aimes les additionner."
"Ne parlez pas comme un imbécile."
"C'est vrai".
"Oh, bien sûr. Et si je le fais ?"
"Rien", ai-je répondu. Nous dansions au son de l'accordéon et quelqu'un jouait du banjo. Il faisait chaud et je me sentais heureux. Nous sommes passés près de Georgette qui dansait avec un autre.
"Qu'est-ce qui vous a poussé à l'amener ?"
"Je ne sais pas, je l'ai juste amenée."
"Tu deviens sacrément romantique".
"Non, je m'ennuie."
"Maintenant ?"
"Non, pas maintenant."
"Sortons d'ici. On s'est bien occupé d'elle."
"Tu veux le faire ?"
"Est-ce que je te le demanderais si je ne le voulais pas ?"
Nous avons quitté l'étage et j'ai pris mon manteau sur un cintre accroché au mur et je l'ai enfilé. Brett se tenait près du bar. Cohn lui parlait. Je me suis arrêté au bar et j'ai demandé une enveloppe. La patronne en a trouvé une. J'ai sorti un billet de cinquante francs de ma poche, je l'ai mis dans l'enveloppe, je l'ai scellée et je l'ai tendue à la patronne.
"Si la fille avec qui je suis venu me demande, tu lui donneras ceci ? J'ai dit : "Si elle sort avec l'un de ces messieurs, tu me garderas ça ? "Si elle sort avec un de ces messieurs, tu me garderas ça ?"
"C'est entendu, Monsieur, dit la patronne. "Vous partez maintenant ? Si tôt ?"
"Oui, j'ai répondu.
Nous avons commencé à sortir. Cohn parlait encore à Brett. Elle m'a dit bonne nuit et m'a pris le bras. Je lui ai dit : "Bonne nuit, Cohn". Dehors, dans la rue, nous avons cherché un taxi.
"Vous allez perdre vos cinquante francs, dit Brett.
"Oh, oui".
"Pas de taxis.
"Nous pourrions marcher jusqu'au Panthéon et en obtenir un."
"Viens, on va boire un verre dans le pub d'à côté et on envoie en chercher un".
"Vous ne traverseriez pas la rue".
"Pas si je peux m'en empêcher."
Nous sommes entrés dans le bar suivant et j'ai envoyé un serveur chercher un taxi.
"Eh bien", ai-je dit, "nous sommes loin d'eux".
Nous sommes restés debout contre le grand bar en zinc, sans parler et en nous regardant l'un l'autre. Le serveur est arrivé et a dit que le taxi était dehors. Brett m'a pressé la main. J'ai donné un franc au serveur et nous sommes sortis. "Où dois-je lui dire ? ai-je demandé.
"Oh, dites-lui de faire le tour".
J'ai dit au chauffeur d'aller au Parc Montsouris, je suis monté et j'ai claqué la porte. Brett était adossée dans un coin, les yeux fermés. Je suis monté et me suis assis à côté d'elle. Le taxi a démarré en trombe.
"Oh, chéri, j'ai été si malheureux, dit Brett.