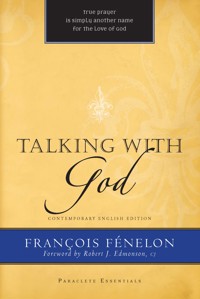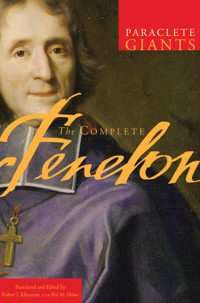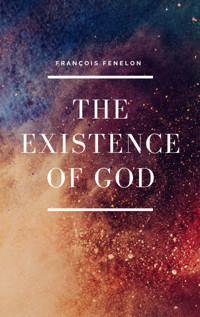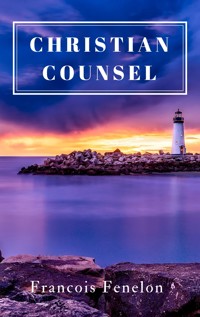Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une œuvre devenue célèbre alors qu'elle était supposée rester dans l'ombre
Dans l’
Odyssée d’Homère, Athénée, sous les traits de Mentès, conseille à Télémaque de partir à Pylos, puis à Sparte, à la recherche de son père Ulysse. L’assemblée des Dieux a en effet exprimé le souhait qu’Ulysse abandonne l’île de Calypso et rentre à Ithaque. Pourtant, toujours dans l’Odyssée, Télémaque disparaît, entre le chant IV et le chant XV, et Homère ne nous éclaire que sur les origines et le succès final de son héros. C’est dans ce manque, cette absence que s’immisce Fénelon pour nous raconter l’errance du fils d’Ulysse dans une Méditerranée mythique. C’est dans cette faille qu’il façonne à sa guise l’histoire inconnue d’un personnage, moins caractérisé que les autres grands héros.
Pour l’instruire en l’amusant, Fénelon propose au duc de Bourgogne, petit fils de Louis XIV, un tour du monde homérique, une « carte du Tendre » en forme de périple autour de la Méditerranée, où alternent récits et aventures : l’amour, la mort, la lutte contre le monstre… À travers la passion de Télémaque pour Eucharis et son chaste amour pour Antiope,
Les aventures de Télémaque sont riches de poésie allégorique et de mythes captivants. Présentées par lui-même comme une « Narration fabuleuse en forme de poème héroïque… où j’ai mis les principales instructions qui conviennent à un prince… »,
Les Aventures comportent également une leçon politique et morale claire. Elle s’adresse à un prince que sa naissance destine à régner. En aucune façon, Fénelon ne souhaite la publication de
Télémaque, œuvre strictement réservée à l’éducation des princes.
Publiée en 1699 sans son accord, elle connaît un grand succès. Considéré comme l’auteur d’une satire ouverte de Louis XIV et d’un roman à clef, Fénelon se trouve plongé, bien malgré lui, dans un scandale politique qui le mène à la disgrâce. « Il aurait fallu que j’eusse été non seulement l’homme le plus ingrat, mais encore le plus insensé pour y vouloir faire des portraits satiriques et insolents. J’ai horreur de la seule pensée d’un tel dessein », nous dit-il pourtant. Quoi qu’il en soit, Fénelon a trouvé dans l’univers mythologique un véhicule pour la richesse de sa pensée.
Epopée, roman ou encore idylle, il joue des genres et des styles. Qu’il soit considéré comme un récit aux « charmes inconnus » (Voltaire), ou de « l’antique ressaisi naturellement et sans effort par un génie moderne » (Sainte Beuve),
Les Aventures de Télémaque sont une invitation au voyage. Fénelon, entre Homère et Virgile, nous y dépeint, tel un promeneur contemplatif sur les rivages d’un monde ancien, un héros emporté de tempêtes en naufrages, d’île en île, dans un monde adolescent et mythologique.
Une invitation au voyage dans l’univers de la mythologie
EXTRAIT
Calypso ne pouvait se consoler du départ d’Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d’être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus de son chant : les nymphes qui la servaient n’osaient lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île : mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d’Ulysse, qu’elle y avait vu tant de fois auprès d’elle. Souvent elle demeurait immobile sur le rivage de la mer, qu’elle arrosait de ses larmes ; et elle était sans cesse tournée vers le côté où le vaisseau d’Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Aventures de Télémaque Fénelon
UPblisher.com
LIVRE PREMIER
Télémaque, conduit par Minerve, sous la figure de Mentor, aborde, après un naufrage, dans l’île de Calypso. La déesse, inconsolable du départ d’Ulysse, fait au fils du héros l’accueil le plus favorable, conçoit une vive passion pour lui et lui offre l’immortalité, s’il veut demeurer avec elle. Elle lui demande le récit de ses aventures. Télémaque raconte son voyage à Pylos et à Lacédémone, son naufrage sur la côte de Sicile, le danger qu’il y courut d’être immolé aux mânes d’Anchise, le secours que Mentor et lui donnèrent à Aceste dans une incursion de Barbares, et le soin que ce prince eut de reconnaître ce service, en leur procurant un vaisseau tyrien pour retourner dans leur pays.
Calypso ne pouvait se consoler du départ d’Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d’être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus de son chant : les nymphes qui la servaient n’osaient lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île[1] : mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d’Ulysse, qu’elle y avait vu tant de fois auprès d’elle. Souvent elle demeurait immobile sur le rivage de la mer, qu’elle arrosait de ses larmes ; et elle était sans cesse tournée vers le côté où le vaisseau d’Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux. Tout à coup elle aperçut les débris d’un navire qui venait de faire naufrage, des bancs de rameurs mis en pièces, des rames écartées çà et là sur le sable, un gouvernail, un mât, des cordages flottants sur la côte, puis elle découvre de loin deux hommes, dont l’un paraissait âgé ; l’autre, quoique jeune, ressemblait à Ulysse. Il avait sa douceur et sa fierté, avec sa taille et sa démarche majestueuse. La déesse comprit que c’était Télémaque, fils de ce héros. Mais, quoique les dieux surpassent de loin en connaissance tous les hommes, elle ne put découvrir qui était cet homme vénérable dont Télémaque était accompagné : c’est que les dieux supérieurs cachent aux inférieurs tout ce qu’il leur plaît ; et Minerve, qui accompagnait Télémaque sous la figure de Mentor, ne voulait pas être connue de Calypso. Cependant Calypso se réjouissait d’un naufrage qui mettait dans son île le fils d’Ulysse, si semblable à son père. Elle s’avance vers lui ; et sans faire semblant de savoir qui il est : D’où vous vient, lui dit-elle, cette témérité d’aborder en mon île ? Sachez, jeune étranger, qu’on ne vient point impunément dans mon empire. Elle tâchait de couvrir sous ces paroles menaçantes la joie de son cœur, qui éclatait malgré elle sur son visage.
Télémaque lui répondit :
– Ô vous, qui que vous soyez, mortelle ou déesse (quoique à vous voir on ne puisse vous prendre que pour une divinité), seriez-vous insensible au malheur d’un fils, qui, cherchant son père à la merci des vents et des flots, a vu briser son navire contre vos rochers ?
– Quel est donc votre père que vous cherchez ? reprit la déesse.
– Il se nomme Ulysse, dit Télémaque ; c’est un des rois qui ont, après un siège de dix ans, renversé la fameuse Troie. Son nom fut célèbre dans toute la Grèce et dans toute l’Asie, par sa valeur dans les combats, et plus encore par sa sagesse dans les conseils. Maintenant, errant dans toute l’étendue des mers, il a parcouru tous les écueils les plus terribles. Sa patrie semble fuir devant lui. Pénélope sa femme, et moi qui suis son fils ; nous avons perdu l’espérance de le revoir. Je cours, avec les mêmes dangers que lui, pour apprendre où il est. Mais que dis-je ? peut-être qu’il est maintenant enseveli dans les profonds abîmes de la mer. Ayez pitié de nos malheurs ; et si vous savez, ô déesse, ce que les destinées ont fait pour sauver ou pour perdre Ulysse, daignez en instruire son fils Télémaque.
Calypso, étonnée et attendrie de voir dans une si vive jeunesse tant de sagesse et d’éloquence, ne pouvait rassasier ses yeux en le regardant ; et elle demeurait en silence. Enfin elle lui dit : Télémaque, nous vous apprendrons ce qui est arrivé à votre père. Mais l’histoire en est longue : il est temps de vous délasser de tous vos travaux. Venez dans ma demeure, où je vous recevrai comme mon fils : venez ; vous serez ma consolation dans cette solitude, et je ferai votre bonheur, pourvu que vous sachiez en jouir.
Télémaque suivait la déesse accompagnée d’une foule de jeunes nymphes, au-dessus desquelles elle s’élevait de toute la tête, comme un grand chêne, dans une forêt, élève ses branches épaisses au-dessus de tous les arbres qui l’environnent. Il admirait l’éclat de sa beauté, la riche pourpre de sa robe longue et flottante, ses cheveux noués par derrière négligemment, mais avec grâce, le feu qui sortait de ses yeux, et la douceur qui tempérait cette vivacité. Mentor, les yeux baissés, gardant un silence modeste, suivait Télémaque.
On arriva à la porte de la grotte de Calypso, où Télémaque fut surpris de voir, avec une apparence de simplicité rustique, des objets propres à charmer les yeux. Il est vrai qu’on n’y voyait ni or, ni argent, ni marbre, ni colonnes, ni tableaux, ni statues : mais cette grotte était taillée dans le roc, en voûte pleine de rocailles et de coquilles ; elle était tapissée d’une jeune vigne qui étendait ses branches souples également de tous côtés. Les doux zéphyrs conservaient en ce lieu, malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse fraîcheur : des fontaines, coulant avec un doux murmure sur des prés semés d’amarantes et de violettes, formaient en divers lieux des bains aussi purs et aussi clairs que le cristal : mille fleurs naissantes émaillaient les tapis verts dont la grotte était environnée. Là on trouvait un bois de ces arbres touffus qui portent des pommes d’or, et dont la fleur, qui se renouvelle dans toutes les saisons, répand le plus doux de tous les parfums ; ce bois semblait couronner ces belles prairies, et formait une nuit que les rayons du soleil ne pouvaient percer. Là on n’entendait jamais que le chant des oiseaux ou le bruit d’un ruisseau, qui, se précipitant du haut d’un rocher, tomba à gros bouillons pleins d’écume, et s’enfuyait au travers de la prairie.
La grotte de la déesse était sur le penchant d’une colline. De là on découvrait la mer, quelquefois claire et unie comme une glace, quelquefois follement irritée contre les rochers, où elle se brisait en gémissant, et élevant ses vagues comme des montagnes. D’un autre côté, on voyait une rivière où se formaient des îles bordées de tilleuls fleuris et de hauts peupliers qui portaient leurs têtes superbes jusque dans les nues. Les divers canaux qui formaient ces îles semblaient se jouer dans la campagne : les uns roulaient leurs eaux claires avec rapidité ; d’autres avaient une eau paisible et dormante ; d’autres, par de longs détours, revenaient sur leurs pas, comme pour remonter vers leur source, et semblaient ne pouvoir quitter ces bords enchantés. On apercevait de loin des collines et des montagnes qui se perdaient dans les nues, et dont la figure bizarre formait un horizon à souhait pour le plaisir des yeux. Les montagnes voisines étaient couvertes de pampre vert qui pendait en festons : le raisin, plus éclatant que la pourpre, ne pouvait se cacher sous les feuilles, et la vigne était accablée sous son fruit. Le figuier, l’olivier, le grenadier, et tous les autres arbres couvraient la campagne, et en faisaient un grand jardin.
Calypso, ayant montré à Télémaque toutes ces beautés naturelles, lui dit : Reposez-vous ; vos habits sont mouillés, il est temps que vous en changiez : ensuite nous nous reverrons ; et je vous raconterai des histoires dont votre cœur sera touché. En même temps elle le fit entrer avec Mentor dans le lieu le plus secret et le plus reculé d’une grotte voisine de celle où la déesse demeurait. Les nymphes avaient eu soin d’allumer en ce lieu un grand feu de bois de cèdre, dont la bonne odeur se répandait de tous côtés ; et elles y avaient laissé des habits pour les nouveaux hôtes.
Télémaque, voyant qu’on lui avait désigné une tunique d’une laine fine dont la blancheur effaçait celle de la neige, et une robe de pourpre avec une broderie d’or, prit le plaisir qui est naturel à un jeune homme, en considérant cette magnificence.
Mentor lui dit d’un ton grave : Est-ce donc là, ô Télémaque, les pensées qui doivent occuper le cœur du fils d’Ulysse ? Songez plutôt à soutenir la réputation de votre père, et à vaincre la fortune qui vous persécute. Un jeune homme qui aime à se parer vainement, comme une femme, est indigne de la sagesse et de la gloire : la gloire n’est due qu’à un cœur qui sait souffrir la peine et fouler aux pieds les plaisirs.
Télémaque répondit en soupirant : Que les dieux me fassent périr plutôt que de souffrir que la mollesse et la volupté s’emparent de mon cœur ! Non, non, le fils d’Ulysse ne sera jamais vaincu par les charmes d’une vie lâche et efféminée. Mais quelle faveur du ciel nous a fait trouver, après notre naufrage, cette déesse ou cette mortelle qui nous comble de biens ?
Craignez, repartit Mentor, qu’elle ne vous accable de maux ; craignez ses trompeuses douceurs plus que les écueils qui ont brisé votre navire : le naufrage et la mort sont moins funestes que les plaisirs qui attaquent la vertu. Gardez-vous bien de croire ce qu’elle vous racontera. La jeunesse est présomptueuse, elle se promet tout d’elle-même : quoique fragile, elle croit pouvoir tout, et n’avoir jamais rien à craindre ; elle se confie légèrement et sans précaution. Gardez-vous d’écouter les paroles douces et flatteuses de Calypso, qui se glisseront comme un serpent sous les fleurs ; craignez le poison caché ; défiez-vous de vous-même, et attendez toujours mes conseils.
Ensuite ils retournèrent auprès de Calypso, qui les attendait. Les nymphes, avec leurs cheveux tressés et des habits blancs, servirent d’abord un repas simple, mais exquis pour le goût et pour la propreté. On n’y voyait aucune autre viande que celle des oiseaux qu’elles avaient pris dans des filets, ou des bêtes qu’elles avaient percées de leurs flèches à la chasse : un vin plus doux que le nectar coulait des grands vases d’argent dans des tasses d’or couronnées de fleurs. On apporta dans des corbeilles tous les fruits que le printemps promet et que l’automne répand sur la terre. En même temps, quatre jeunes nymphes se mirent à chanter. D’abord elles chantèrent le combat des dieux contre les géants, puis les amours de Jupiter et de Sémélé, la naissance de Bacchus et son éducation conduite par le vieux Silène, la course d’Atalante et d’Hippomène, qui fut vainqueur par le moyen des pommes d’or venues du jardin des Hespérides ; enfin la guerre de Troie fut aussi chantée ; les combats d’Ulysse et sa sagesse furent élevés jusqu’aux cieux. La première des nymphes, qui s’appelait Leucothoé, joignit les accords de sa lyre aux douces voix de toutes les autres. Quand Télémaque entendit le nom de son père, les larmes qui coulèrent de ses joues donnèrent un nouveau lustre à sa beauté. Mais comme Calypso aperçut qu’il ne pouvait manger, et qu’il était saisi de douleur, elle fit signe aux nymphes. À l’instant on chanta le combat des Centaures avec les Lapithes, et la descente d’Orphée aux enfers pour en retirer Eurydice.
Quand le repas fut fini, la déesse prit Télémaque, et lui parla ainsi : Vous voyez, fils du grand Ulysse, avec quelle faveur je vous reçois. Je suis immortelle : nul mortel ne peut entrer dans cette île sans être puni de sa témérité ; et votre naufrage même ne vous garantirait pas de mon indignation, si d’ailleurs je ne vous aimais» Votre père a eu le même bonheur que vous ; mais, hélas ! Il n’a pas su en profiter. Je l’ai gardé longtemps dans cette île : il n’a tenu qu’à lui d’y vivre avec moi dans un état immortel ; mais l’aveugle passion de retourner dans sa misérable patrie lui fit rejeter tous ces avantages. Vous voyez tout ce qu’il a perdu pour Ithaque[2], qu’il n’a pu revoir. Il voulut me quitter : il partit ; et je fus vengée par la tempête : son vaisseau, après avoir été le jouet des vents, fut enseveli dans les ondes. Profitez d’un si triste exemple. Après son naufrage, vous n’avez plus rien à espérer, ni pour le revoir, ni pour régner jamais dans l’île d’Ithaque après lui : consolez-vous de l’avoir perdu, puisque vous trouvez ici une divinité prête à vous rendre heureux, et un royaume qu’elle vous offre.
La déesse ajouta à ces paroles de longs discours pour montrer combien Ulysse avait été heureux auprès d’elle : elle raconta ses aventures dans la caverne du cyclope Polyphème, et chez Antiphates, roi des Lestrygons[3] ; elle n’oublia pas ce qui lui était arrivé dans l’île de Circé[4], fille du Soleil, ni les dangers qu’il avait courus entre Scylle et Charybde[5]. Elle représenta la dernière tempête que Neptune avait excitée contre lui quand il partit d’auprès d’elle. Elle voulut faire entendre qu’il était péri dans ce naufrage, et elle supprima son arrivée dans l’île des Phéaciens[6].
Télémaque, qui s’était d’abord abandonné trop promptement à la joie d’être si bien traité de Calypso, reconnut enfin son artifice et la sagesse des conseils que Mentor venait de lui donner. Il répondit en peu de mots : Ô déesse, pardonnez à ma douleur ; maintenant je ne puis que m’affliger. Peut-être que dans la suite j’aurai plus de force pour goûter la fortune que vous m’offrez ; laissez-moi en ce moment pleurer mon père ; vous savez mieux que moi combien il mérite d’être pleuré.
Calypso n’osa d’abord le presser d’avantage : elle feignit même d’entrer dans sa douleur et de s’attendrir pour Ulysse. Mais, pour mieux connaître les moyens de toucher le cœur du jeune homme, elle lui demanda comment il avait fait naufrage, et par quelles aventures il était sur ces côtes. Le récit de mes malheurs, dit-il, serait trop long. Non, non, répondit-elle ; il me tarde de les savoir, hâtez-vous de me les raconter. Elle le pressa longtemps. Enfin il ne put lui résister, et il parla ainsi :
J’étais parti d’Ithaque pour aller demander aux autres rois revenus du siège de Troie des nouvelles de mon père. Les amants de ma mère Pénélope furent surpris de mon départ : j’avais pris soin de le leur cacher, connaissant leur perfidie. Nestor, que je vis à Pylos[7], ni Ménélas, qui me reçut avec amitié dans Lacédémone, ne purent m’apprendre si mon père était encore en vie. Lassé de vivre toujours en suspens et dans l’incertitude, je me résolus d’aller dans la Sicile, où j’avais ouï dire que mon père avait été jeté par les vents. Mais le sage Mentor, que vous voyez ici présent, s’opposait à ce téméraire dessein : il me représentait, d’un côté, les Cyclopes, géants monstrueux qui dévorent les hommes ; de l’autre, la flotte d’Énée et des Troyens, qui étaient sur ces côtes. Ces Troyens, disait-il, sont animés contre tous les Grecs ; mais surtout ils répandraient avec plaisir le sang du fils d’Ulysse. Retournez, continuait-il, en Ithaque : peut-être que votre père, aimé des dieux, y sera aussitôt que vous. Mais si les dieux ont résolu sa perte, s’il ne doit jamais revoir sa patrie, du moins il faut que vous alliez le venger, délivrer votre mère, montrer votre sagesse à tous les peuples, et faire voir en vous à toute la Grèce un roi aussi digne de régner que le fut jamais Ulysse lui-même.
Ces paroles étaient salutaires, mais je n’étais pas assez prudent pour les écouter ; je n’écoutais que ma passion. Le sage Mentor m’aima jusqu’à me suivre dans un voyage téméraire que j’entreprenais contre ses conseils, et les dieux permirent que je fisse une faute qui devait servir à me corriger de ma présomption.
Pendant qu’il parlait, Calypso regardait Mentor. Elle était étonnée ; elle croyait sentir en lui quelque chose de divin ; mais elle ne pouvait démêler ses pensées confuses ; ainsi, elle demeurait pleine de crainte et de défiance à la vue de cet inconnu. Alors elle appréhenda de laisser voir son trouble. Continuez, dit-elle à Télémaque, et satisfaites ma curiosité. Télémaque reprit ainsi :
Nous eûmes assez longtemps un vent favorable pour aller en Sicile : mais ensuite une noire tempête déroba le ciel à nos yeux, et nous fûmes enveloppés dans une profonde nuit. À la lueur des éclairs, nous aperçûmes d’autres vaisseaux exposés au même péril, et nous reconnûmes bientôt que c’étaient les vaisseaux d’Énée ; ils n’étaient pas moins à craindre pour nous que les rochers. Alors, je compris, mais trop tard, ce que l’ardeur d’une jeunesse imprudente m’avait empêché de considérer attentivement. Mentor parut dans ce danger, non seulement ferme et intrépide, mais encore plus gai qu’à l’ordinaire ; c’était lui qui m’encourageait ; je sentais qu’il m’inspirait une force invincible. Il donnait tranquillement tous les ordres, pendant que le pilote était troublé. Je lui disais : Mon cher Mentor, pourquoi ai-je refusé de suivra vos conseils ! Ne suis-je pas malheureux d’avoir voulu me croire moi-même, dans un âge où l’on n’a ni prévoyance de l’avenir, ni expérience du passé, ni modération pour ménager le présent ! Oh ! Si jamais nous échappons de cette tempête, je me défierai de moi-même comme de mon plus dangereux ennemi : c’est vous Mentor, que je croirai toujours.
Mentor, en souriant, me répondait : Je n’ai gardé de vous reprocher la faute que vous avez faite ; il suffit que vous la sentiez et qu’elle vous serve à être une autre fois plus modéré dans vos désirs. Mais quand le péril sera passé, la présomption reviendra peut-être. Maintenant il faut se soutenir par le courage. Avant que de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre ; mais, quand on y est, il ne reste plus qu’à le mépriser. Soyez donc le digne fils d’Ulysse ; montrez un cœur plus grand que tous les maux qui vous menacent.
La douceur et le courage du sage Mentor me charmèrent, mais je fus encore bien plus surpris quand je vis avec quelle adresse il nous délivra des Troyens. Dans le moment où le ciel commençait à s’éclaircir et où les Troyens, nous voyant de près, n’auraient pas manqué de nous reconnaître, il remarqua un de leurs vaisseaux qui était presque semblable au nôtre et que la tempête avait écarté. La poupe en était couronnée de certaines fleurs ; il se hâta de mettre sur notre poupe des couronnes de fleurs semblables ; il les attacha lui-même avec des bandelettes de la même couleur que celles des Troyens ; il ordonna à tous nos rameurs de se baisser le plus qu’ils pourraient le long de leurs bancs, pour n’être point reconnus des ennemis. En cet état, nous passâmes au milieu de leur flotte ; ils poussèrent des cris de joie en nous voyant, comme en revoyant des compagnons qu’ils avaient crus perdus. Nous fûmes même contraints, par la violence de la mer, d’aller assez longtemps avec eux ; enfin, nous demeurâmes un peu derrière, et, pendant que les vents impétueux les poussaient vers l’Afrique, nous fîmes les derniers efforts pour aborder, à force de rames, sur la côte voisine de Sicile.
Nous y arrivâmes en effet. Mais ce que nous cherchions n’était guère moins funeste que la flotte qui nous faisait fuir. Nous trouvâmes sur cette côte de Sicile d’autres Troyens ennemis des Grecs. C’était là que régnait le vieux Aceste, sorti de Troie. À peine fûmes-nous arrivés sur ce rivage, que les habitants crurent que nous étions ou d’autres peuples de l’île, armés pour les surprendre, ou des étrangers qui venaient s’emparer de leurs terres. Ils brûlent notre vaisseau ; dans le premier emportement, ils égorgent tous nos compagnons, ils ne réservent que Mentor et moi pour nous présenter à Aceste, afin qu’il pût savoir de nous quels étaient nos desseins et d’où nous venions. Nous entrons dans la ville, les mains liées derrière le dos ; et notre mort n’était retardée que pour nous faire servir de spectacle à un peuple cruel, quand on saurait que nous étions Grecs.
On nous présenta d’abord à Aceste, qui, tenant son sceptre d’or en main, jugeait les peuples et se préparait à un grand sacrifice. Il nous demanda, d’un ton sévère, quel était notre pays et le sujet de notre voyage. Mentor se hâta de répondre, et lui dit : Nous venons de côtes de la grande Hespérie, et notre patrie n’est pas loin de là : ainsi il évita de dire que nous étions Grecs. Mais Aceste, sans l’écouter davantage, et nous prenant pour des étrangers qui cachaient leur dessein, ordonna qu’on nous envoyât dans une forêt voisine, où nous servirions en esclaves sous ceux qui gouvernaient ses troupeaux.
Cette condition me parut plus dure que la mort. Je m’écriai : Ô roi, faites-nous mourir plutôt que de nous traiter si indignement ; sachez que je suis Télémaque, fils du sage Ulysse, roi des Ithaciens. Je cherche mon père dans toutes les mers ; si je ne puis le trouver, ni retourner dans ma patrie, ni éviter la servitude, ôtez-moi la vie, que je ne saurais supporter.
À peine eus-je prononcé ces mots, que tout le peuple ému s’écria qu’il fallait faire périr le fils de ce cruel Ulysse, dont les artifices avaient renversé la ville de Troie. Ô fils d’Ulysse, me dit Aceste, je ne puis refuser votre sang aux mânes de tant de Troyens que votre père a précipités sur les rivages du noir Cocyte : vous, et celui qui vous mène, vous périrez. En même temps, un vieillard de la troupe proposa au roi de nous immoler sur le tombeau d’Anchise. Leur sang, disait-il, sera agréable à l’ombre de ce héros ; Énée même, quand il saura un tel sacrifice, sera touché de voir combien vous aimez ce qu’il avait de plus cher au monde.
Tout le peuple applaudit à cette proposition, et ne songea plus qu’à nous immoler. Déjà on nous menait sur le tombeau d’Anchise ; on y avait dressé deux autels, où le feu sacré était allumé ; le glaive qui devait nous percer était devant nos yeux ; on nous avait couronnés de fleurs, et nulle compassion ne pouvait garantir notre vie ; c’était fait de nous, quand Mentor demanda tranquillement à parler au roi. Il lui dit :
Ô Aceste, si le malheur du jeune Télémaque, qui n’a jamais porté les armes contre les Troyens, ne peut vous toucher, du moins que votre propre intérêt vous touche. La science que j’ai acquise des présages et de la volonté des dieux me fait connaître qu’avant que trois jours soient écoulés vous serez attaqué par des peuples barbares, qui viennent comme un torrent du haut des montagnes, pour inonder votre ville et pour ravager tout votre pays. Hâtez-vous de les prévenir ; mettez vos peuples sous les armes, et ne perdez pas un moment pour retirer au dedans de vos murailles les riches troupeaux que vous avez dans la campagne. Si ma prédiction est fausse, vous serez libre de nous immoler dans trois jours ; si, au contraire, elle est véritable, souvenez-vous qu’on ne doit pas ôter la vie à ceux de qui on la tient.
Aceste fut étonné de ces paroles, que Mentor lui disait avec une assurance qu’il n’avait jamais trouvée en aucun homme. Je vois bien, répondit-il, ô étranger, que les dieux, qui vous ont si mal partagé pour tous les dons de la fortune, vous ont accordé une sagesse qui est plus estimable que toutes les prospérités. En même temps, il retarda le sacrifice, et donna avec diligence les ordres nécessaires pour prévenir l’attaque dont Mentor l’avait menacé. On ne voyait de tous côtés que des femmes tremblantes, des vieillards courbés, de petits enfants, les larmes aux yeux, qui se retiraient dans la ville. Les bœufs mugissants et les brebis bêlantes venaient en foule, quittant les gras pâturages, et ne pouvant trouver assez d’étables pour être mis à couvert. C’était, de toutes parts, des cris confus de gens qui se poussaient les uns les autres, qui ne pouvaient s’entendre, qui prenaient dans ce trouble un inconnu pour leur ami, et qui couraient sans savoir où tendaient leurs pas. Mais les principaux de la ville, se croyant plus sages que les autres, s’imaginaient que Mentor était un imposteur qui avait fait une fausse prédiction pour sauver sa vie.
Avant la fin du troisième jour, pendant qu’ils étaient pleins de ces pensées, on vit sur le penchant des montagnes voisines un tourbillon de poussière ; puis on aperçut une troupe innombrable de Barbares armés : c’étaient les Himériens[8], peuples féroces, avec les nations qui habitent sur les monts Nébrodes, et sur le sommet d’Acratas, où règne un hiver que les zéphyrs n’ont jamais adouci. Ceux qui avaient méprisé la prédiction de Mentor perdirent leurs esclaves et leurs troupeaux. Le roi dit à Mentor : J’oublie que vous êtes des Grecs ; nos ennemis deviennent nos amis fidèles. Les dieux vous ont envoyés pour nous sauver, je n’attends pas moins de votre valeur que de la sagesse de vos conseils ; hâtez-vous de nous secourir.
Mentor montre dans ses yeux une audace qui étonne les plus fiers combattants. Il prend un bouclier, un casque, une épée, une lance ; il range les soldats d’Aceste ; il marche à leur tête, et s’avance en bon ordre vers les ennemis. Aceste, quoique plein de courage, ne peut dans sa vieillesse le suivre que de loin. Je le suis de plus près, mais je ne puis égaler sa valeur. Sa cuirasse ressemblait, dans le combat, à l’immortelle égide. La mort courait de rang en rang partout sous ses coups. Semblable à un lion de Numidie que la cruelle faim dévore, et qui entre dans un troupeau de faibles brebis, il déchire, il égorge, il nage dans le sang ; et les bergers, loin de secourir le troupeau, fuient, tremblants, pour se dérober à sa fureur.
Ces Barbares, qui espéraient de surprendre la ville, furent eux-mêmes surpris et déconcertés. Les sujets d’Aceste, animés par l’exemple et par les ordres de Mentor, eurent une vigueur dont ils ne se croyaient point capables. De ma lance je renversai le fils du roi de ce peuple ennemi. Il était de mon âge, mais il était plus grand que moi ; car ce peuple venait d’une race de géants qui étaient de la même origine que les Cyclopes. Il méprisait un ennemi aussi faible que moi : mais, sans m’étonner de sa force prodigieuse, ni de son air sauvage et brutal, je poussai ma lance contre sa poitrine, et je lui fis vomir, en expirant, des torrents d’un sang noir. Il pensa m’écraser. Dans sa chute, le bruit de ses armes retentit jusques aux montagnes. Je pris ses dépouilles, et je revins trouver Aceste. Mentor, ayant achevé de mettre les ennemis en désordre, les tailla en pièces, et poussa les fuyards jusque dans les forêts.
Un succès si inespéré fit regarder Mentor comme un homme chéri et inspiré des dieux. Aceste, touché de reconnaissance, nous avertit qu’il craignait tout pour nous, si les vaisseaux d’Énée revenaient en Sicile : il nous en donna un pour retourner sans retardement en notre pays, nous combla de présents, et nous pressa de partir pour prévenir tous les malheurs qu’il prévoyait ; mais il ne voulut nous donner ni un pilote ni des rameurs de sa nation, de peur qu’ils ne fussent trop exposés sur les côtes de la Grèce. Il nous donna des marchands phéniciens, qui, étant en commerce avec tous les peuples du monde, n’avaient rien à craindre, et qui devaient ramener le vaisseau à Aceste quand ils nous auraient laissés à Ithaque. Mais les dieux, qui se jouent des desseins des hommes, nous réservaient à d’autres dangers.
LIVRE DEUXIÈME
Télémaque raconte que le vaisseau tyrien qu’il montait ayant été pris par Sésostris, il fut fait prisonnier ainsi que Mentor, et emmené captif en Égypte. Merveilles de ce pays : sagesse de son gouvernement. Mentor est envoyé esclave en Éthiopie, et Télémaque est réduit à conduire un troupeau dans le désert d’Oasis. Un prêtre d’Apollon, Termosiris, le console et lui apprend à imiter ce dieu qui avait été autrefois berger chez Admète, roi de Thessalie. Bientôt Sésostris, informé de tout ce que fait de merveilleux Télémaque parmi les bergers, le rappelle, reconnaît son innocence et lui promet de le renvoyer à Ithaque. La mort de Sésostris amène de nouveaux malheurs pour Télémaque. Il est enfermé dans une tour au bord de la mer. Du haut de cette tour il voit le nouveau roi d’Égypte, Bocchoris, périr dans un combat contre ses sujets révoltés et secourus par les Phéniciens.
Les Tyriens, par leur fierté, avaient irrité contre eux le grand roi Sésostris, qui régnait en Égypte, et qui avait conquis tant de royaumes. Les richesses qu’ils ont acquises par le commerce, et la force de l’imprenable ville de Tyr[9], située dans la mer, avaient enflé le cœur de ces peuples. Ils avaient refusé de payer à Sésostris le tribut qu’il leur avait imposé en revenant de ses conquêtes ; et ils avaient fourni des troupes à son frère, qui avait voulu, à son retour, le massacrer au milieu des réjouissances d’un grand festin. Sésostris avait résolu, pour abattre leur orgueil, de troubler leur commerce dans toutes les mers. Ses vaisseaux allaient de tous côtés cherchant les Phéniciens. Une flotte égyptienne nous rencontra, comme nous commencions à perdre de vue les montagnes de la Sicile. Le port et la terre semblaient fuir derrière nous, et se perdre dans les nues. En même temps nous voyions approcher les navires des Égyptiens, semblables à une ville flottante. Les Phéniciens les reconnurent, et voulurent s’en éloigner : mais il n’était plus temps ; leurs voile étaient meilleures que les nôtres ; le vent les favorisait ; leurs rameurs étaient en plus grand nombre : ils nous abordent, nous prennent, et nous emmènent prisonniers en Égypte.
En vain je leur représentai que nous n’étions pas Phéniciens ; à peine daignèrent-ils m’écouter : ils nous regardèrent comme des esclaves dont les Phéniciens trafiquaient ; et ils ne songèrent qu’au profit d’une telle prise. Déjà nous remarquons les eaux de la mer qui blanchissent par le mélange de celles du Nil, et nous voyons la côte d’Égypte presque aussi basse que la mer. Ensuite nous arrivons à l’île de Pharos[10], voisine de la ville de No : de là nous remontons le Nil jusques à Memphis[11].
Si la douleur de notre captivité ne nous eût rendus insensibles à tous les plaisirs, nos yeux auraient été charmés de voir cette fertile terre d’Égypte, semblable à un jardin délicieux arrosé d’un nombre infini de canaux. Nous ne pouvions jeter les yeux sur les deux rivages sans apercevoir des villes opulentes, des maisons de campagne agréablement situées, des terres qui se couvraient tous les ans d’une moisson dorée sans se reposer jamais, des prairies pleines de troupeaux, des laboureurs qui étaient accablés sous le poids des fruits que la terre épanchait de son sein ; des bergers qui faisaient répéter les doux sons de leurs flûtes et de leurs chalumeaux à tous les échos d’alentour.
Heureux, disait Mentor, le peuple qui est conduit par un sage roi ! Il est dans l’abondance ; il vit heureux, et aime celui à qui il doit tout son bonheur. C’est ainsi, ajoutait-il, ô Télémaque, que vous devez régner et faire la joie de vos peuples, si les dieux vous font posséder le royaume de votre père. Aimez vos peuples comme vos enfants ; goûtez le plaisir d’être aimé d’eux ; et faites qu’ils ne puissent jamais sentir la paix et la joie sans se ressouvenir que c’est un bon roi qui leur a fait ces riches présents. Les rois qui ne songent qu’à se faire craindre, et qu’à abattre leurs sujets pour les rendre plus soumis, sont les fléaux du genre humain. Ils sont craints comme ils le veulent être ; mais ils sont haïs, détestés ; et ils ont encore plus à craindre de leurs sujets, que leurs sujets n’ont à craindre d’eux.
Je répondais à Mentor : Hélas ! Il n’est pas question de songer aux maximes suivant lesquelles on doit régner ; il n’y a plus d’Ithaque pour nous ; nous ne reverrons jamais ni notre patrie, ni Pénélope ; et quand même Ulysse retournerait plein de gloire dans son royaume, il n’aura jamais la joie de m’y voir ; jamais je n’aurai celle de lui obéir pour apprendre à commander. Mourons, mon cher Mentor ; nulle autre pensée ne nous est plus permise : mourons, puisque les dieux n’ont aucune pitié de nous.
En parlant ainsi, de profonds soupirs entrecoupaient toutes mes paroles. Mais Mentor, qui craignait les maux avant qu’ils arrivassent, ne savait plus ce que c’était que de les craindre dès qu’ils étaient arrivés. Indigne fils du sage Ulysse ! s’écriait-il, quoi donc ! Vous vous laissez vaincre à votre malheur ! Sachez que vous reverrez un jour l’île d’Ithaque et Pénélope. Vous verrez même dans sa première gloire celui que vous n’avez point connu, l’invincible Ulysse, que la fortune ne peut abattre, et qui, dans ses malheurs, encore plus grands que les vôtres, vous apprend à ne vous décourager jamais. Oh ! S’il pouvait apprendre, dans les terres éloignées où la tempête l’a jeté, que son fils ne sait imiter ni sa patience ni son courage, cette nouvelle l’accablerait de honte, et lui serait plus rude que tous les malheurs qu’il souffre depuis si longtemps.
Ensuite Mentor me faisait remarquer la joie et l’abondance répandue dans toute la campagne d’Égypte, où l’on comptait jusqu’à vingt-deux mille villes. Il admirait la bonne police de ces villes : la justice exercée en faveur du pauvre contre le riche ; la bonne éducation des enfants, qu’on accoutumait à l’obéissance, au travail, à la sobriété, à l’amour des arts ou des lettres ; l’exactitude pour toutes les cérémonies de religion ; le désintéressement, le désir de l’honneur, la fidélité pour les hommes, et la crainte pour les dieux, que chaque père inspirait à ses enfants. Il ne se lassait point d’admirer ce bel ordre. Heureux, me disait-il sans cesse, le peuple qu’un sage roi conduit ainsi ! mais encore plus heureux le roi qui fait le bonheur de tant de peuples, et qui trouve le sien dans sa vertu ! Il tient les hommes par un lien beaucoup plus fort que celui de la crainte, c’est celui de l’amour. Non seulement on lui obéit, mais encore on aime à lui obéir. Il règne dans tous les cœurs : chacun, bien loin de vouloir s’en défaire, craint de le perdre, et donnerait sa vie pour lui.
Je remarquais ce que disait Mentor, et je sentais renaître mon courage au fond de mon cœur, à mesure que ce sage ami me parlait. Aussitôt que nous fûmes arrivés à Memphis, ville opulente et magnifique, le gouverneur ordonna que nous irions jusqu’à Thèbes[12] pour être présentés au roi Sésostris, qui voulait examiner les choses par lui-même, et qui était fort animé contre les Tyriens. Nous remontâmes donc encore le long du Nil, jusqu’à cette fameuse Thèbes à cent portes, où habitait ce grand roi. Cette ville nous parut d’une étendue immense, et plus peuplée que les plus florissantes de la Grèce. La police y est parfaite pour la propreté des rues, pour le cours des eaux, pour la commodité des bains, pour la culture des arts, et pour la sûreté publique. Les places sont ornées de fontaines et d’obélisques ; les temples sont de marbre, et d’une architecture simple, mais majestueuse. Le palais du prince est lui seul comme une grande ville, on n’y voit que colonnes de marbre, que pyramides et obélisques, que statues colossales, que meubles d’or et d’argent massif.
Ceux qui nous avaient pris dirent au roi que nous avions été trouvés dans un navire phénicien. Il écoutait chaque jour, à certaines heures réglées, tous ceux de ses sujets qui avaient, ou des plaintes à lui faire, ou des avis à lui donner. Il ne méprisait ni ne rebutait personne, et ne croyait être roi que pour faire du bien à tous ses sujets, qu’il aimait comme ses enfants. Pour les étrangers, il les recevait avec bonté, et voulait les voir, parce qu’il croyait qu’on apprenait toujours quelque chose d’utile en s’instruisant des mœurs et des maximes des peuples éloignés. Cette curiosité du roi fit qu’on nous présenta à lui. Il était sur un trône d’ivoire, tenant en main un sceptre d’or. Il était déjà vieux, mais agréable, plein de douceur et de majesté ; il jugeait tous les jours les peuples, avec une patience et une sagesse qu’on admirait sans flatterie. Après avoir travaillé toute la journée à régler les affaires et à rendre une exacte justice, il se délassait le soir à écouter des hommes savants, ou à converser avec les plus honnêtes gens, qu’il savait bien choisir pour les admettre dans sa familiarité. On ne pouvait lui reprocher en toute sa vie que d’avoir triomphé avec trop de faste des rois qu’il avait vaincus, et de s’être confié à un de ses sujets que je vous dépeindrai tout à l’heure.
Quand il me vit, il fut touché de ma jeunesse et de ma douleur ; il me demanda ma patrie et mon nom. Nous fûmes étonnés de la sagesse qui parlait par sa bouche. Je répondis : Ô grand roi, vous n’ignorez pas le siège de Troie, qui a duré dix ans, et sa ruine, qui a coûté tant de sang à toute la Grèce. Ulysse, mon père, a été un des principaux rois qui ont ruiné cette ville : il erre sur toutes les mers, sans pouvoir retrouver l’île d’Ithaque, qui est son royaume. Je le cherche ; et un malheur semblable au sien fait que j’ai été pris. Rendez-moi à mon père et à ma patrie. Ainsi puissent les dieux vous conserver à vos enfants, et leur faire sentir la joie de vivre sous un si bon père !
Sésostris continuait à me regarder d’un œil de compassion ; mais, voulant savoir si ce que je disais était vrai, il nous renvoya à un de ses officiers, qui fut chargé de savoir de ceux qui avaient pris notre vaisseau si nous étions effectivement ou Grecs ou Phéniciens. S’ils sont Phéniciens, dit le roi, il faut doublement les punir, pour être nos ennemis, et plus encore pour avoir voulu nous tromper par un lâche mensonge : si, au contraire, ils sont Grecs, je veux qu’on les traite favorablement, et qu’on les renvoie dans leur pays, sur un de mes vaisseaux, car j’aime la Grèce ; plusieurs Égyptiens y ont donné des lois. Je connais la vertu d’Hercule ; la gloire d’Achille est parvenue jusqu’à nous ; et j’admire ce qu’on m’a raconté de la sagesse du malheureux Ulysse : tout mon plaisir est de secourir la vertu malheureuse.
L’officier auquel le roi renvoya l’examen de notre affaire avait l’âme aussi corrompue et aussi artificieuse que Sésostris était sincère et généreux. Cet officier se nommait Méthophis ; il nous interrogea pour tâcher de nous surprendre, et, comme il vit que Mentor répondait avec plus de sagesse que moi, il le regarda avec aversion et avec défiance ; car les méchants s’irritent contre les bons. Il nous sépara ; et, depuis ce moment, je ne sus point ce qu’était devenu Mentor. Cette séparation fut un coup de foudre pour moi. Méthophis espérait toujours qu’en nous questionnant séparément il pourrait nous faire dire des choses contraires ; surtout il croyait m’éblouir par ses promesses flatteuses et me faire avouer ce que Mentor lui aurait caché. Enfin, il ne cherchait pas de bonne foi la vérité ; mais il voulait trouver quelque prétexte de dire au roi que nous étions des Phéniciens, pour nous faire ses esclaves. En effet, malgré notre innocence et malgré la sagesse du roi, il trouva le moyen de le tromper.
Hélas ! À quoi les rois sont-ils exposés ! Les plus sages même sont souvent surpris. Des hommes artificieux et intéressés les environnent ; les bons se retirent, parce qu’ils ne sont ni empressés ni flatteurs ; les bons attendent qu’on les cherche, et les princes ne savent guère les aller chercher ; au contraire, les méchants sont hardis, trompeurs, empressés à s’insinuer et à plaire, adroits à dissimuler, prêts à tout faire contre l’honneur et la conscience pour contenter les passions de celui qui règne. Ô qu’un roi est malheureux d’être exposé aux artifices des méchants ! Il est perdu, s’il ne repousse la flatterie et s’il n’aime ceux qui disent hardiment la vérité. Voilà les réflexions que je faisais dans mon malheur, et je rappelais tout ce que j’avais ouï dire à Mentor. Cependant Méthophis m’envoya vers les montagnes du désert d’Oasis, avec ses esclaves, afin que je servisse avec eux à conduire ses grands troupeaux.
En cet endroit, Calypso interrompit Télémaque, disant : Eh bien ! que fîtes-vous alors, vous qui aviez préféré en Sicile la mort à la servitude ? Télémaque répondit : mon malheur croissait toujours ; je n’avais plus la misérable consolation de choisir entre la servitude et la mort ; il fallut être esclave et épuiser, pour ainsi dire, toutes les rigueurs de la fortune. Il ne me restait plus aucune espérance, et je ne pouvais pas même dire un mot pour travailler à me délivrer. Mentor m’a dit depuis qu’on l’avait vendu à des Éthiopiens, et qu’il les avait suivis en Éthiopie.
Pour moi, j’arrivai dans des déserts affreux ; on y voit des sables brûlants au milieu des plaines. Des neiges qui ne se fondent jamais font un hiver perpétuel sur le sommet des montagnes ; et on trouve seulement, pour nourrir les troupeaux, des pâturages parmi des rochers, vers le milieu du penchant de ces montagnes escarpées ; les vallées y sont si profondes, qu’à peine le soleil y peut faire luire ses rayons.
Je ne trouvai d’autres hommes, en ce pays, que des bergers aussi sauvages que le pays même. Là, je passais les nuits à déplorer mon malheur, et les jours, à suivre un troupeau, pour éviter la fureur brutale d’un premier esclave, qui, espérant d’obtenir sa liberté, accusait sans cesse les autres pour faire valoir à son maître son zèle et son attachement à ses intérêts. Cet esclave se nommait Buthis. Je devais succomber en cette occasion : la douleur me pressant, j’oubliai un jour mon troupeau, et je m’étendis sur l’herbe auprès d’une caverne ou j’attendais la mort, ne pouvant plus supporter mes peines.
En ce moment, je remarquai que toute la montagne tremblait ; les chênes et les pins semblaient descendre du sommet de la montagne ; les vents retenaient leurs haleines ; une voix mugissante sortit de la caverne et me fit entendre ces paroles : Fils du sage Ulysse, il faut que tu deviennes, comme lui, grand par la patience ; les princes qui ont toujours été heureux ne sont guère dignes de l’être ; la mollesse les corrompt, l’orgueil les enivre. Que tu seras heureux, si tu surmontes tes malheurs, et si tu ne les oublies jamais ! Tu reverras Ithaque, et ta gloire montera jusqu’aux astres. Quand tu seras le maître des autres hommes, souviens-toi que tu as été faible, pauvre et souffrant comme eux ; prends plaisir à les soulager ; aime ton peuple, déteste la flatterie, et sache que tu ne seras grand qu’autant que tu seras modéré et courageux pour vaincre tes passions.
Ces paroles divines entrèrent jusqu’au fond de mon cœur ; elles y firent renaître la joie et le courage. Je ne sentis point cette horreur qui fait dresser les cheveux sur la tête et qui glace le sang dans les veines, quand les dieux se communiquent aux mortels ; je me levai tranquille, j’adorai à genoux, les mains levées vers le ciel, Minerve, à qui je crus devoir cet oracle. En même temps, je me trouvai un nouvel homme ; la sagesse éclairait mon esprit, je sentais une douce force pour modérer toutes mes passions, et pour arrêter l’impétuosité de ma jeunesse. Je me fis aimer de tous les bergers du désert ; ma douceur, ma patience, mon exactitude, apaisèrent enfin le cruel Buthis, qui était en autorité sur les autres esclaves, et qui avait voulu d’abord me tourmenter.
Pour mieux supporter l’ennui de la captivité et de la solitude, je cherchai des livres, car j’étais accablé de tristesse, faute de quelque instruction qui pût nourrir mon esprit et le soutenir. Heureux, disais-je, ceux qui se dégoûtent des plaisirs violents, et qui savent se contenter des douceurs d’une vie innocente ! Heureux ceux qui se divertissent en s’instruisant, et qui se plaisent à cultiver leur esprit par les sciences ! En quelque endroit que la fortune ennemie les jette, ils portent toujours avec eux de quoi s’entretenir et l’ennui, qui dévore les autres hommes au milieu même des délices, est inconnu à ceux qui savent s’occuper par quelque lecture. Heureux ceux qui aiment à lire et qui ne sont point, comme moi, privés de la lecture !
Pendant que ces pensées roulaient dans mon esprit, je m’enfonçai dans une sombre forêt, où j’aperçus tout à coup un vieillard qui tenait dans sa main un livre. Ce vieillard avait un grand front chauve et un peu ridé ; une barbe blanche pendait jusqu’à sa ceinture ; sa taille était haute et majestueuse ; son teint était encore frais et vermeil, ses yeux vifs et perçants, sa voix douce, ses paroles simples et aimables. Jamais je n’ai vu un si vénérable vieillard : il s’appelait Termosiris, et il était prêtre d’Apollon, qu’il servait dans un temple de marbre que les rois d’Égypte avaient consacré à ce dieu dans cette forêt. Le livre qu’il tenait était un recueil d’hymnes en l’honneur des dieux. Il m’aborde avec amitié ; nous nous entretenons. Il racontait si bien les choses passées, qu’on croyait les voir ; mais il les racontait courtement, et jamais ses histoires ne m’ont lassé. Il prévoyait l’avenir par la profonde sagesse qui lui faisait connaître les hommes et les desseins dont ils sont capables. Avec tant de prudence, il était gai, complaisant ; et la jeunesse la plus enjouée n’a point autant de grâce qu’en avait cet homme dans une vieillesse si avancée : aussi aimait-il les jeunes gens, quand ils étaient dociles et qu’ils avaient le goût de la vertu.
Bientôt il m’aima tendrement, et me donna des livres pour me consoler : il m’appelait mon fils. Je lui disais souvent : mon père, les dieux, qui m’ont ôté Mentor, ont eu pitié de moi ; ils m’ont donné en vous un autre soutien. Cet homme, semblable à Orphée ou à Linus, était sans doute inspiré des dieux : il me récitait les vers qu’il avait faits, et me donnait ceux de plusieurs excellents poètes favorisés des Muses. Lorsqu’il était revêtu de sa longue robe d’une éclatante blancheur, et qu’il prenait en main sa lyre d’ivoire, les tigres, les lions et les ours venaient le flatter et lécher ses pieds ; les Satyres sortaient des forêts pour danser autour de lui ; les arbres mêmes paraissaient émus ; et vous auriez cru que les rochers attendris allaient descendre du haut des montagnes au charme de ses doux accents. Il ne chantait que la grandeur des dieux, la vertu des héros, et la sagesse des hommes qui préfèrent la gloire aux plaisirs.
Il me disait souvent que je devais prendre courage, et que les dieux n’abandonneraient ni Ulysse, ni son fils. Enfin, il m’assura que je devais, à l’exemple d’Apollon, enseigner aux bergers à cultiver les Muses. Apollon, disait-il, indigné de ce que Jupiter par ses foudres troublait le ciel dans ses plus beaux jours, voulut s’en venger sur les Cyclopes qui forgeaient les foudres, et il les perça de ses flèches. Aussitôt le mont Etna cessa de vomir des tourbillons de flammes ; on n’entendit plus les coups des terribles marteaux qui, frappant l’enclume, faisaient gémir les profondes cavernes de la terre et les abîmes de la mer : le fer et l’airain, n’étant plus polis par les Cyclopes, commençaient à se rouiller. Vulcain, furieux, sort de sa fournaise ; quoique boiteux, il monte en diligence vers l’Olympe ; il arrive, suant et couvert d’une noire poussière, dans l’assemblée des dieux ; il fait des plaintes amères. Jupiter s’irrite contre Apollon, le chasse du ciel et le précipite sur la terre. Son char vide faisait de lui-même son cours ordinaire, pour donner aux hommes les jours et les nuits avec le changement régulier des saisons. Apollon, dépouillé de tous ses rayons, fut contraint de se faire berger, et de garder les troupeaux du roi Admète. Il jouait de la flûte ; et tous les autres bergers venaient à l’ombre des ormeaux, sur le bord d’une claire fontaine, écouter ses chansons. Jusque-là ils avaient mené une vie sauvage et brutale ; ils ne savaient que conduire leurs brebis, les tondre, traire leur lait et faire des fromages : toute la campagne était comme un désert affreux.
Bientôt Apollon montra à tous ces bergers les arts qui peuvent rendre leur vie agréable. Il chantait les fleurs dont le printemps se couronne, les parfums qu’il répand, et la verdure qui naît sous ses pas. Puis il chantait les délicieuses nuits de l’été, où les zéphyrs rafraîchissent les hommes, et où la rosée désaltère la terre. Il mêlait aussi dans ses chansons les fruits dorés dont l’automne récompense les travaux des laboureurs, et le repos de l’hiver, pendant lequel la jeunesse folâtre danse auprès du feu. Enfin il représentait les forêts sombres qui couvrent les montagnes, et les creux vallons où les rivières, par mille détours, semblent se jouer au milieu des riantes prairies. Il apprit ainsi aux bergers quels sont les charmes de la vie champêtre, quand on sait goûter ce que la simple nature a de merveilleux. Bientôt les bergers, avec leurs flûtes, se virent plus heureux que les rois ; et leurs cabanes attiraient en foule les plaisirs purs qui fuient les palais dorés. Les jeux, les ris, les grâces, suivaient partout les innocentes bergères. Tous les jours étaient des jours de fête : on n’entendait plus que le gazouillement des oiseaux, ou la douce haleine des zéphyrs qui se jouaient dans les rameaux des arbres, ou le murmure d’une onde claire qui tombait de quelque rocher, ou les chansons que les Muses inspiraient aux bergers qui suivaient Apollon. Ce dieu leur enseignait à remporter le prix de la course, et à percer de flèches les daims et les cerfs. Les dieux mêmes devinrent jaloux des bergers : cette vie leur parut plus douce que toute leur gloire, et ils rappelèrent Apollon dans l’Olympe.
Mon fils, cette histoire doit vous instruire. Puisque vous êtes dans l’état où fut Apollon, défrichez cette terre sauvage ; faites fleurir comme lui le désert ; apprenez à tous ces bergers quels sont les charmes de l’harmonie ; adoucissez les cœurs farouches ; montrez-leur l’aimable vertu ; faites-leur sentir combien il est doux de jouir, dans la solitude, des plaisirs innocents que rien ne peut ôter aux bergers. Un jour, mon fils, un jour les peines et les soucis cruels qui environnent les rois vous feront regretter sur le trône la vie pastorale.
Ayant ainsi parlé, Termosiris me donna une flûte si douce que les échos de ces montagnes qui la firent entendre de tous côtés, attirèrent bientôt autour de nous tous les bergers voisins. Ma voix avait une harmonie divine ; je me sentais ému et comme hors de moi-même, pour chanter les grâces dont la nature a orné la campagne. Nous passions les jours entiers et une partie des nuits à chanter ensemble. Tous les bergers, oubliant leurs cabanes et leurs troupeaux, étaient suspendus et immobiles autour de moi pendant que je leur donnais des leçons : il semblait que ces déserts n’eussent plus rien de sauvage ; tout y était devenu doux et riant ; la politesse des habitants semblait adoucir la terre.
Nous nous assemblions souvent pour offrir des sacrifices dans ce temple d’Apollon où Termosiris était prêtre. Les bergers y allaient couronnés de lauriers en l’honneur du dieu ; les bergères y allaient aussi en dansant, avec des couronnes de fleurs, et portant sur leurs têtes, dans des corbeilles, les dons sacrés. Après le sacrifice, nous faisions un festin champêtre ; nos plus doux mets étaient le lait de nos chèvres et de nos brebis, que nous avions soin de traire nous-mêmes, avec les fruits fraîchement cueillis de nos propres mains, tels que les dattes, les figues et les raisins : nos sièges étaient les gazons ; les arbres touffus nous donnaient une ombre plus agréable que les lambris dorés des palais des rois.
Mais ce qui acheva de me rendre fameux parmi nos bergers, c’est qu’un jour un lion affamé vint se jeter sur mon troupeau : déjà il commençait un carnage affreux, je n’avais en main que ma houlette ; je m’avance hardiment. Le lion hérisse sa crinière, me montre ses dents et ses griffes, ouvre une gueule sèche et enflammée ; ses yeux paraissent pleins de sang et de feu ; il bat ses flancs avec sa longue queue. Je le terrasse : la petite cotte de mailles dont j’étais revêtu, selon la coutume des bergers d’Égypte, l’empêcha de me déchirer. Trois fois je rabattis ; trois fois il se releva ; il poussait des rugissements qui faisaient retentir toutes les forêts. Enfin, je l’étouffai entre mes bras ; et les bergers, témoins de ma victoire, voulurent que je me revêtisse de la peau de ce terrible lion.
Le bruit de cette action et celui du beau changement de tous nos bergers se répandit dans toute l’Égypte ; il parvint même jusqu’aux oreilles de Sésostris. Il sut qu’un de ces deux captifs qu’on avait pris pour des Phéniciens avait ramené l’âge d’or dans ces déserts presque inhabitables. Il voulut me voir : car il aimait les Muses ; et tout ce qui peut instruire les hommes touchait son grand cœur. Il me vit ; il m’écoula avec plaisir ; il découvrit que Méthophis l’avait trompé par avarice ; il le condamna à une prison perpétuelle, et lui ôta toutes les richesses qu’il possédait injustement. Ô qu’on est malheureux, disait-il, quand on est au-dessus du reste des hommes ! souvent on ne peut voir la vérité par ses propres yeux : on est environné de gens qui l’empêchent d’arriver jusqu’à celui qui commande ; chacun est intéressé à le tromper ; chacun, sous une apparence de zèle, cache son ambition. On fait semblant d’aimer le roi, et on n’aime que les richesses qu’il donne : on l’aime si peu, que pour obtenir ses faveurs on le flatte et on le trahit.
Ensuite Sésostris me traita avec une tendre amitié, et résolut de me renvoyer en Ithaque avec des vaisseaux et des troupes, pour délivrer Pénélope de tous ses amants. La flotte était déjà prête ; nous ne songions qu’à nous embarquer. J’admirais les coups de la fortune, qui relève tout à coup ceux qu’elle a le plus abaissés. Cette expérience me faisait espérer qu’Ulysse pourrait bien revenir enfin dans son royaume après quelque longue souffrance. Je pensais aussi en moi-même que je pourrais encore revoir Mentor, quoiqu’il eût été emmené dans les pays les plus inconnus de l’Éthiopie. Pendant que je retardais un peu mon départ, pour tâcher d’en savoir des nouvelles, Sésostris, qui était fort âgé, mourut subitement, et sa mort me replongea dans de nouveaux malheurs.
Toute l’Égypte parut inconsolable de cette perte ; chaque famille croyait avoir perdu son meilleur ami, son protecteur, son père. Les vieillards, levant les mains au ciel, s’écriaient : Jamais l’Égypte n’eut un aussi bon roi ! Jamais elle n’en aura de semblable ! Ô dieux ! Il fallait ou ne le montrer point aux hommes, ou ne le leur ôter jamais ; pourquoi faut-il que nous survivions au grand Sésostris ! Les jeunes gens disaient : l’espérance de l’Égypte est détruite ; nos pères ont été heureux de passer leur vie sous un si bon roi ; pour nous, nous ne l’avons vu que pour sentir sa perte. Ses domestiques pleuraient nuit et jour. Quand on fit les funérailles du roi, pendant quarante jours tous les peuples les plus reculés, y accoururent en foule : chacun voulait voir encore une fois le corps de Sésostris ; chacun voulait en conserver l’image ; plusieurs voulurent être mis avec lui dans le tombeau.
Ce qui augmenta encore la douleur de sa perte, c’est que son fils Bocchoris n’avait ni humanité pour les étrangers, ni curiosité pour les sciences, ni estime pour les hommes vertueux, ni amour de la gloire. La grandeur de son père avait contribué à le rendre si indigne de régner. Il avait été nourri dans la mollesse et dans une fierté brutale ; il comptait pour rien les hommes, croyant qu’ils n’étaient faits que pour lui, et qu’il était d’une autre nature qu’eux : il ne songeait qu’à contenter ses passions, qu’à dissiper les trésors immenses que son père avait ménagés avec tant de soin, qu’à tourmenter les peuples, et qu’à sucer le sang des malheureux ; enfin, qu’à suivre les conseils flatteurs des jeunes insensés qui l’environnaient, pendant qu’il écartait arec mépris tous les sages vieillards qui avaient eu la confiance de, son père. C’était un monstre, et non pas un roi. Toute l’Égypte gémissait ; et quoique le nom de Sésostris, si cher aux Égyptiens, leur fît supporter la conduite lâche et cruelle de son fils, le fils courait à sa perte : et un prince si indigne du trône ne pouvait longtemps régner.
Il ne me fut plus permis d’espérer mon retour en Ithaque. Je demeurai dans une tour sur le bord de la mer, auprès de Péluse[13], où notre embarquement devait se faire, si Sésostris ne fût pas mort. Méthophis avait eu l’adresse de sortir de prison, et de se rétablir auprès du nouveau roi : il m’avait fait renfermer dans cette tour, pour se venger de la disgrâce que je lui avais causée. Je passais les jours et les nuits dans une profonde tristesse : tout ce que Termosiris m’avait prédit, et tout ce que j’avais entendu dans la caverne, ne me paraissait plus qu’un songe ; j’étais abîmé dans la plus amère douleur. Je voyais les vagues qui venaient battre le pied de la tour où j’étais prisonnier ; souvent je m’occupais à considérer des vaisseaux agités par la tempête, qui étaient en danger de se briser contre les rochers sur lesquels la tour était bâtie. Loin de plaindre ces hommes menacés du naufrage, j’enviais leur sort. Bientôt, disais-je en moi-même, ils finiront les malheurs de leur vie, ou ils arriveront en leur pays. Hélas ! Je ne puis espérer ni l’un ni l’autre.