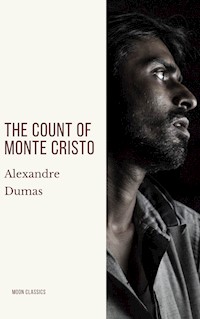0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexandre Dumas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Après une rapide évocation des guerres civiles de Vendée de 1793-94, l'intrigue se déroule entre 1831 et 1832. Filles jumelles et bâtardes d'un ancien combattant royaliste de 1793, le marquis de Souday, Mary et Bertha, auxquelles on prête, bien à tort, une sulfureuse réputation, sont cruellement surnommées «les louves de Machecoul». Loin de ces médisances, elles vivent sereinement leur solitude jusqu'au jour où le sort place sur le chemin deux nouveaux personnages : le baron Michel de la Logerie, fils d'un bourgeois enrichi par l'Empire, et Marie-Caroline de Bourbon, duchesse de Berry, qui veut offrir le trône de France à son fils en réveillant l'esprit royaliste vendéen. Dès leur première rencontre, les jeunes filles s'éprennent de Michel qui, pour sa part, tombe sous le charme de la douce Mary et s'engage, par amour pour elle, aux côtés de la duchesse...Roman méconnu de Dumas, Les louves de Machecoul s'avère pourtant une oeuvre riche, dense et palpitante, empreint d'une vie étourdissante et d'un puissant souffle romanesque.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Les Louves de Machecoul - Tome I
Alexandre Dumas
Alexandre Dumas, père, born Dumas Davy de la Pailleterie (July 24, 1802 – December 5, 1870) was a French writer, best known for his numerous historical novels of high adventure which have made him one of the most widely read French authors in the world. Many of his novels, including The Count of Monte Cristo, The Three Musketeers, and The Man in the Iron Mask were serialized, and he also wrote plays and magazine articles and was a prolific correspondent.
I – L’aide de camp de Charette
S’il vous est arrivé par hasard, cher lecteur, d’aller de Nantes à Bourgneuf, vous avez, en arrivant à Saint-Philbert, écorné, pour ainsi dire, l’angle méridional du lac de Grand-Lieu, et, continuant votre chemin, vous êtes arrivé, au bout d’une ou deux heures de marche, selon que vous étiez à pied ou en voiture, aux premiers arbres de la forêt de Machecoul.
Là à gauche du chemin, dans un grand bouquet d’arbres qui semble appartenir à la forêt, dont il n’est séparé que par la grande route, vous avez dû apercevoir les pointes aiguës de deux minces tourelles et le toit grisâtre d’un petit castel perdu au milieu des feuilles.
Les murs lézardés de cette gentilhommière, ses fenêtres ébréchées, sa couverture rougie par les iris sauvages et les mousses parasites lui donnent, malgré ses prétentions féodales et les deux tours qui la flanquent, une si pauvre apparence, qu’elle n’exciterait certainement la convoitise d’aucun de ceux qui la regardent en cheminant, sans sa délicieuse position en face des futaies séculaire de la forêt de Machecoul, dont les vagues verdoyantes montent à l’horizon aussi loin que la vue peut s’étendre.
En 1831, ce petit castel était la propriété d’un vieux gentilhomme nommé le marquis de Souday, et s’appelait le château de Souday, du nom de son propriétaire.
Faisons connaître le propriétaire, après avoir fait connaître le château.
Le marquis de Souday était l’unique représentant et le dernier héritier d’une vieille et illustre Maison de Bretagne ; car le lac de Grand-Lieu, la forêt de Machecoul, la ville de Bourg-neuf, situés dans cette partie de la France circonscrite aujourd’hui dans le département de la Loire-Inférieure, faisaient partie de la province de Bretagne, avant que la France fût divisée par départements. La famille du marquis de Souday avait été jadis un de ces arbres féodaux aux rameaux immenses dont l’ombrage s’étendait sur toute une province ; mais les ancêtres du marquis, à force de se mettre en frais pour monter dignement dans les carrosses du roi, l’avaient peu à peu si bien ébranché, que 89 était venu fort à propos pour empêcher le tronc vermoulu d’être jeté bas par la main d’un huissier, en lui réservant une fin peu digne de son illustration.
Lorsque sonna l’heure de la Bastille, lorsque croula la vieille maison des rois présageant l’écroulement de la royauté, le marquis de Souday, déjà héritier, sinon des biens – il n’en restait d’autres que la petite gentilhommière que nous avons dite, – au moins du nom de son père, était premier page de Son Altesse royale M. le comte de Provence.
À seize ans – c’était l’âge qu’avait alors le marquis, – les événements ne sont guère que des accidents ; il était, au reste, difficile de ne pas devenir profondément insoucieux à la cour épicurienne, voltairienne et constitutionnelle du Luxembourg, où l’égoïsme avait ses coudées franches.
C’était M. de Souday qui avait été envoyé sur la place de Grève pour guetter le moment où le bourreau serrerait la corde autour du cou de Favras, et où celui-ci, en rendant le dernier soupir, rendrait à Son Altesse royale sa tranquillité un instant troublée.
Il était revenu à grande course dire au Luxembourg :
– Monseigneur, c’est fait !
Et monseigneur, de sa voix claire et flûtée, avait dit :
À table, messieurs ! à table !
Et l’on avait soupé, comme si un brave gentilhomme, qui donnait gratuitement sa vie à Son Altesse, ne venait pas d’être pendu comme un meurtrier et comme un vagabond.
Puis étaient arrivés les premiers jours sombres de la Révolution, la publication du livre rouge, la retraite de Necker, la mort de Mirabeau.
Un jour, le 22 février 1791, une grande foule était accourue et avait enveloppé le palais du Luxembourg.
Il s’agissait de bruits répandus. Monsieur, disait-on, voulait fuir et aller rejoindre les émigrés qui se rassemblaient sur le Rhin.
Mais Monsieur se montra au balcon, et fit le serment solennel de ne point quitter le roi.
Et, en effet, le 21 juin, il partit avec le roi, sans doute pour ne point manquer à sa parole de ne le pas quitter.
Il le quitta néanmoins, et pour son bonheur ; car il arriva tranquillement à la frontière avec son compagnon de voyage le marquis d’Avaray, tandis que Louis XVI était arrêté à Varennes.
Notre jeune page tenait trop à sa réputation de jeune homme à la mode pour demeurer en France, où cependant la monarchie allait avoir besoin de ses plus zélés serviteurs ; il émigra donc à son tour, et, comme personne ne fit attention à un page de dix-huit ans, il arriva sans accident à Coblentz, et aida à compléter les cadres des compagnies de mousquetaires qui se reformaient là-bas, sous les ordres du marquis de Montmorin. Pendant les premières rencontres, il fit bravement campagne avec les trois Condés, fut blessé devant Thionville, puis, après bien des déceptions, éprouva la plus forte de toutes par le licenciement des corps d’émigrés ; mesure qui, avec leurs espérances, enlevait à tant de pauvres diables le pain du soldat, leur dernière ressource.
Il est vrai que ces soldats servaient contre la France, et que ce pain était pétri par la main de l’étranger.
Le marquis de Souday tourna alors les yeux vers la Bretagne et la Vendée, où, depuis deux ans, on combattait.
Voici où en était la Vendée.
Tous les premiers chefs de l’insurrection étaient morts : Cathelineau avait été tué à Vannes, Lescure avait été tué à la Tremblaye, Bonchamp avait été tué à Cholet, d’Elbée avait été ou allait être fusillé à Noirmoutiers.
Enfin, ce que l’on appelait la grande armée venait d’être anéantie au Mans.
Cette grande armée avait été vaincue à Fontenay, à Saumur, à Torfou, à Laval et à Dol ; elle avait eu l’avantage dans soixante combats ; elle avait tenu tête à toutes les forces de la République, commandées successivement par Biron, Rossignol, Kléber, Westermann, Marceau ; elle avait, en repoussant l’appui de l’Angleterre, vu incendier ses chaumières, massacrer ses enfants, égorger ses pères ; elle avait eu pour chefs Cathelineau, Henri de la Rochejaquelein, Stofflet, Bonchamp, Forestier, d’Elbée, Lescure, Marigny et Talmont ; elle était restée fidèle à son roi quand le reste de la France l’abandonnait ; elle avait adoré son Dieu quand Paris avait proclamé qu’il n’y avait plus de Dieu ; grâce à elle, enfin, la Vendée avait mérité d’être appelée, un jour, devant l’histoire, la terre des géants.
Charette et la Rochejaquelein étaient restés à peu près seuls debout.
Or, si Charette avait des soldats, la Rochejaquelein n’en avait plus.
C’est que, pendant que la grande armée se faisait détruire au Mans, Charette, nommé général en chef du bas Poitou, et secondé par le chevalier de Couëtu et Jolly, avait rassemblé une armée.
Charette, à la tête de cette armée, et la Rochejaquelein, suivi d’une dizaine d’hommes seulement, se rencontrèrent près de Maulevrier.
En voyant arriver la Rochejaquelein, Charette comprit que c’était un général qui lui arrivait et non un soldat ; il avait la conscience de lui-même, et ne voulait point partager son commandement ; il resta froid et hautain.
Il allait déjeuner : il n’invita pas même la Rochejaquelein à déjeuner avec lui.
Le même jour, huit cents hommes se détachaient de l’armée de Charette et passaient à la Rochejaquelein.
Le lendemain, Charette dit à son jeune rival :
– Je pars pour Mortagne ; vous allez me suivre.
– J’ai été habitué, jusqu’ici, non à suivre, dit la Rochejaquelein, mais à être suivi.
Et il partit de son côté, laissant Charette opérer du sien comme il l’entendait.
C’est celui-ci que nous suivrons, parce qu’il est le seul dont les derniers combats et l’exécution se rattachent à notre histoire.
Louis XVII était mort, et, le 26 juin 1795, Louis XVIII avait été proclamé roi de France, au quartier général de Belleville.
Le 15 août 1795, c’est-à-dire moins de deux mois après cette proclamation, un jeune homme apportait à Charette une lettre du nouveau roi.
Cette lettre, écrite de Vérone et en date du 8 juillet 1795, conférait à Charette le commandement légitime de l’armée royaliste.
Charette voulait répondre au roi par le même messager et le remercier de la faveur qu’il lui accordait ; mais le jeune homme fit observer qu’il était rentré en France pour y rester et pour y combattre, demandant que la dépêche apportée par lui lui servît de recommandation près du général en chef.
Charette, à l’instant même, l’attacha à sa personne.
Ce jeune messager n’était autre que l’ancien page de Monsieur, le marquis de Souday.
En se retirant, pour se reposer des vingt dernières lieues qu’il venait de faire à cheval, le marquis trouva sur son chemin un jeune garde de cinq ou six ans plus âgé que lui, et qui, le chapeau à la main, le regardait avec un affectueux respect.
Il reconnut le fils d’un des métayers de son père avec lequel il avait chassé et aimait fort à chasser autrefois, nul ne détournant mieux un sanglier et n’appuyant mieux les chiens quand l’animal était détourné.
– Eh ! Jean Oullier, s’écria-t-il, est-ce toi ?
– Moi-même en personne, pour vous servir, monsieur le marquis, répondit le jeune paysan.
– Ma foi, mon ami, bien volontiers ! Es-tu toujours bon chasseur ?
– Oh ! oui, monsieur le marquis ! seulement, pour le quart d’heure, ce n’est plus le sanglier que nous chassons, c’est un autre gibier.
– N’importe ; si tu veux, nous chasserons celui-ci ensemble comme nous chassions l’autre.
– Ça n’est pas de refus ; au contraire, monsieur le marquis, repartit Jean Oullier.
Et, à partir de ce moment, Jean Oullier fut attaché au marquis de Souday comme le marquis de Souday était attaché à Charette ; c’est-à-dire que Jean Oullier était l’aide de camp de l’aide de camp du général en chef.
Outre ses talents de chasseur, Jean Oullier était un homme précieux. Dans les campements, il était bon à tout, et le marquis de Souday n’avait à s’occuper de rien ; dans les plus mauvais jours ; le marquis ne manqua jamais d’un morceau de pain, d’un verre d’eau et d’une botte de paille – ce qui, en Vendée, était un luxe dont ne jouissait pas toujours le général en chef.
Nous serions fort tenté de suivre Charette et, par contrecoup, notre jeune héros dans quelques-unes de ces expéditions aventureuses tentées par le général royaliste et qui lui méritèrent la réputation de premier partisan du monde ; mais l’histoire est une sirène des plus décevantes, et, lorsqu’on est assez imprudent pour obéir au signe qu’elle vous fait de la suivre, on ne sait plus où elle vous mène.
Nous simplifierons donc notre récit autant que possible, laissant à un autre le soin de raconter l’expédition de M. le comte d’Artois à Noirmoutiers et à l’île Dieu, l’étrange conduite du prince, qui resta trois semaines en vue des côtes de France sans y aborder, et le découragement de l’armée royaliste en se voyant abandonnée par ceux-là pour lesquels elle combattait depuis plus de deux ans !
Charette n’en remporta pas moins, quelque temps après, la terrible victoire des Quatre-Chemins : ce fut la dernière, car la trahison allait se mettre de la partie.
Victime d’un guet-apens, de Couëtu, le bras droit de Charette, son autre lui-même depuis la mort de Jolly, fut pris et fusillé.
Dans les derniers temps de sa vie, Charette ne peut pas faire un pas, que son adversaire, quel qu’il soit, Hoche ou Travot, n’en soit averti sur-le-champ.
Environné de troupes républicaines, cerné de tous côtés, poursuivi jour et nuit, traqué de buissons en buissons, rampant de fossés en fossés, sachant qu’un peu plus tôt ou un peu plus tard il doit être tué dans quelque rencontre, ou, s’il est pris vivant, fusillé sur place ; sans asile, brûlé de la fièvre, mourant de soif et de faim, n’osant demander, aux fermes qu’il rencontre, ni un peu de pain, ni un peu d’eau, ni un peu de paille, il n’a plus autour de lui que trente-deux hommes dont font partie le marquis de Souday et Jean Oullier, quand, le 25 mars 1796, on lui annonce que quatre colonnes républicaines marchent simultanément contre lui.
– Bien ! dit-il ; en ce cas, c’est ici qu’il faut se battre jusqu’à la mort et vendre chèrement sa vie.
C’était à la Prélinière, dans la paroisse de Saint-Sulpice. Mais, avec ses trente-deux hommes, Charette ne se contente pas d’attendre les républicains : il marche au-devant d’eux. À la Guyonnière, il rencontre le général Valentin, à la tête de deux cents grenadiers et chasseurs.
Charette trouve une bonne position, et s’y retranche.
Là, pendant trois heures, il soutient les charges et le feu de deux cents républicains.
Douze de ses hommes tombent autour de lui. L’armée de la chouannerie, qui se composait de vingt-quatre mille hommes lorsque M. le comte d’Artois était à l’île Dieu, est aujourd’hui réduite à vingt hommes.
Ces vingt hommes tiennent autour de leur général, et pas un ne songe à fuir.
Pour en finir, le général Valentin prend un fusil, et, à la tête de cent quatre-vingts hommes qui lui restent, charge à la baïonnette.
Dans cette charge, Charette est blessé d’une balle à la tête et a trois doigts de la main gauche coupés d’un coup de sabre.
Il va être pris, quand un Alsacien nommé Pfeffer, qui a pour Charette plus que du dévouement – une religion – prend le chapeau empanaché de son général, lui donne le sien, et, s’élançant à gauche, lui crie :
– Sauvez-vous à droite !… C’est moi qu’ils vont poursuivre.
Et, en effet, c’est sur lui que s’acharnent les républicains, tandis que Charette s’élance du côté opposé avec ses quinze derniers hommes.
Charette touchait au bois de la Chabotière, lorsque la colonne du général Travot paraît.
Une nouvelle, une suprême lutte s’engage, dans laquelle Charette n’a d’autre but que de se faire tuer.
Perdant son sang par trois blessures, il chancelle et va tomber. Un Vendéen nommé Bossard le charge sur ses épaules et l’emporte vers le bois ; mais, avant d’y arriver, il tombe percé d’une balle.
Un autre, nommé Laroche-Davo, lui succède, fait cinquante pas et tombe à son tour dans le fossé qui sépare le bois de la plaine.
Le marquis de Souday prend à son tour Charette entre ses bras, et, tandis que Jean Oullier tue de ses deux coups de fusil les deux soldats républicains qui le pressent de plus près, il se jette dans le bois avec son général et sept hommes qui restent. À cinquante pas de la lisière, Charette semble reprendre sa force.
– Souday, dit-il, écoute mon dernier ordre.
Le jeune homme s’arrête.
– Dépose-moi au pied de ce chêne.
Souday hésitait à obéir.
– Je suis toujours ton général, lui dit Charette d’une voix impérieuse ; obéis-moi donc !
Le jeune homme, vaincu, obéit et dépose son général au pied du chêne.
– Là ! maintenant, dit Charette, écoute-moi bien. Il faut que le roi, qui m’a fait général en chef, sache comment son général en chef est mort. Retourne auprès de Sa Majesté Louis XVIII, et raconte-lui ce que tu as vu ; je le veux !
Charette parlait avec une telle solennité, que le marquis de Souday, qu’il tutoyait pour la première fois, n’eut pas même l’idée de désobéir.
– Allons, reprit Charette, tu n’as pas une minute à perdre, fuis ; voilà les bleus !
En effet, les républicains paraissaient à la lisière du bois.
Souday prit la main que lui tendait Charette.
– Embrasse-moi, dit celui-ci.
Le jeune homme l’embrassa.
– Assez, dit le général. Pars !
Souday jeta un regard à Jean Oullier.
– Viens-tu ? lui dit-il.
Mais celui-ci secoua la tête d’un air sombre.
– Que voulez-vous que j’aille faire là-bas, monsieur le marquis, dit-il, tandis qu’ici… ?
– Ici, que feras-tu ?
– Je vous dirai cela si, un jour, nous nous revoyons, monsieur le marquis.
Et il envoya ses deux balles aux deux républicains les plus proches.
Les deux républicains tombèrent.
L’un des deux était un officier supérieur ; ses soldats s’empressèrent autour de lui.
Jean Oullier et le marquis de Souday profitèrent de cette espèce de sursis pour s’enfoncer dans la profondeur du bois.
Seulement, au bout de cinquante pas, Jean Oullier, trouvant un épais buisson, s’y glissa comme un serpent en faisant un signe d’adieu au marquis de Souday.
Le marquis de Souday continua son chemin.
II – La reconnaissance des rois
Le marquis de Souday gagna les bords de la Loire, et trouva un pêcheur qui le conduisit à la pointe de Saint-Gildas.
Une frégate croisait en vue ; c’était une frégate anglaise.
Pour quelques louis de plus, le pêcheur conduisit le marquis jusqu’à la frégate.
Arrivé là, il était sauvé.
Deux ou trois jours après, la frégate héla un trois-mâts de commerce qui gouvernait pour entrer dans la Manche.
C’était un bâtiment hollandais.
Le marquis de Souday demanda à passer à son bord ; le capitaine anglais l’y fit conduire.
Le trois-mâts hollandais déposa le marquis à Rotterdam.
De Rotterdam, celui-ci gagna Blankenbourg, petite ville du duché de Brunswick que Louis XVIII avait choisie pour sa résidence.
Il avait à s’acquitter des dernières recommandations de Charette.
Louis XVIII était à table ; l’heure du repas fut toujours une heure solennelle pour lui.
L’ex-page dut attendre que Sa Majesté eût dîné.
Après le dîner, il fut introduit.
Il raconta les événements qu’il avait vus se dérouler sous ses yeux, et surtout la dernière catastrophe, avec une telle éloquence, que Sa Majesté, qui cependant était assez peu impressionnable, fut impressionnée au point de lui dire :
– Assez, assez, marquis ! Oui, le chevalier de Charette était un brave serviteur, nous le reconnaissons.
Et il lui fit signe de se retirer.
Le messager obéit ; mais, en se retirant, il entendit le roi qui disait d’un ton maussade :
– Cet imbécile de Souday qui vient me raconter ces choses-là après dîner ! C’est capable de troubler ma digestion !
Le marquis était susceptible ; il trouva que, après avoir exposé sa vie pendant six mois, être appelé imbécile par celui-là même pour qui il l’avait exposée, était une médiocre récompense.
Il lui restait une centaine de louis dans sa poche ; il quitta le même soir Blankenbourg, en se disant :
– Si j’avais su être reçu de cette façon-là, je ne me serais pas donné tant de peine pour venir !
Il regagna la Hollande, et, de la Hollande, passa en Angleterre. Là commença une nouvelle phase de l’existence du marquis de Souday. Il était de ces hommes que les circonstances façonnent selon leurs besoins ; qui sont forts ou faibles, valeureux ou pusillanimes selon le milieu où le hasard les jette. Pendant six mois, il s’était mis au niveau de cette terrible épopée vendéenne : il avait teint de son sang les buissons et les landes du haut et du bas Poitou ; il avait supporté avec une constance stoïque non-seulement la mauvaise chance des combats, mais encore toutes les privations qui résultaient de cette lutte de guérillas, bivouaquant dans les neiges, errant sans pain, sans vêtements, sans asile dans les forêts boueuses de la Vendée ; jamais il n’avait eu une pensée pour les regrets, une parole pour la plainte !
Eh bien, avec tous ces antécédents, isolé au milieu de cette grande ville de Londres, où il errait tristement, en regrettant les jours de lutte, il se trouva sans courage en face du désœuvrement, sans constance en face de l’ennui, sans énergie en face de la misère qui l’attendait dans l’exil.
Cet homme, qui avait bravé les poursuites des colonnes infernales, ne sut pas résister aux méchantes suggestions de l’oisiveté ; il chercha le plaisir partout et à tout prix, pour combler le vide qui s’était fait dans son existence depuis qu’il n’avait plus, pour l’occuper, les péripéties d’une lutte exterminatrice.
Or, ces plaisirs que demandait l’exilé, il était trop pauvre pour les choisir d’un ordre bien relevé : aussi, peu à peu, perdit-il de cette élégance de gentilhomme que l’habit de paysan porté pendant plus de deux mois n’avait pas pu amoindrir, et, avec cette élégance, la distinction de ses goûts ; il compara l’ale et le porter au champagne, et fit cas de ces filles enrubannées de Grosvenor et de Haymarket, lui qui avait eu à choisir pour ses premières amours parmi des duchesses !
Bientôt, la facilité de ses principes et les besoins sans cesse renaissants de la vie l’amenèrent à des compositions dont sa réputation se trouva mal ; il accepta ce qu’il ne pouvait plus payer ; il fit ses amis de compagnons de débauche d’une classe inférieure à lui ; il en résulta que ses camarades d’émigration se détournèrent de lui, et, par la pente toute naturelle des choses, plus l’isolement se faisait autour de sa personne, plus le marquis de Souday s’enfonçait dans la mauvaise voie où il était entré.
Il y avait deux ans qu’il menait cette existence, lorsque le hasard lui fit rencontrer, dans un tripot de la Cité dont il était un des hôtes les plus assidus, une jeune ouvrière qu’une de ces hideuses créatures qui pullulent à Londres arrachait de sa mansarde et produisait pour la première fois.
Malgré les changements que la mauvaise fortune avait apportés en lui, la pauvre jeune fille reconnut cependant un reste de seigneurie ; elle se jeta en pleurant aux pieds du marquis, le suppliant de la sauver de la vie infâme à laquelle on voulait la consacrer et pour laquelle elle n’était point faite, ayant été sage jusque-là.
La jeune fille était belle ; le marquis lui offrit de le suivre.
La jeune fille se jeta à son cou, et promit de lui donner tout son amour, de lui consacrer tout son dévouement.
Sans avoir le moins du monde l’intention d’accomplir une bonne action, le marquis fit donc échouer la spéculation échafaudée sur la beauté d’Éva.
La malheureuse enfant s’appelait Éva.
Elle tint parole, la pauvre et honnête fille qu’elle était : le marquis fut son premier et son dernier amour.
Au reste, le moment était heureux pour tous deux. Le marquis commençait à se fatiguer des combats de coqs, des aigres vapeurs de la bière, des démêlés avec les constables et des bonnes fortunes de carrefour ; la tendresse de cette jeune fille le reposa ; la possession de cette enfant, blanche comme les cygnes qui ont été l’emblème de la Grande-Bretagne, sa patrie, satisfit l’amour-propre de M. de Souday. Peu à peu, il changea donc d’existence, et, sans revenir aux habitudes d’un homme de son rang, au moins la vie qu’il adopta fut-elle la vie d’un honnête homme.
Il se réfugia avec Éva dans une mansarde de Piccadilly. La jeune fille savait très bien coudre ; elle trouva du travail chez une lingère. Le marquis donna des leçons d’escrime.
À partir de ce moment, ils vécurent un peu du modique produit des leçons du marquis et des travaux d’Éva, beaucoup du bonheur qu’ils trouvaient dans un amour devenu assez puissant pour dorer leur indigence.
Et cependant cet amour, comme toutes les choses mortelles, s’usa, mais à la longue.
Heureusement pour Éva que les émotions de la guerre vendéenne et les joies effrénées des enfers de Londres avaient absorbé la sève surabondante que pouvait avoir son amant ; il avait vieilli avant l’âge.
Effectivement, le jour où le marquis de Souday s’aperçut que son amour pour Éva n’était plus qu’un feu éteint, ou du moins bien près de s’éteindre ; le jour où les baisers de la jeune femme se trouvèrent impuissants, non pas à le rassasier, mais à le réveiller, l’habitude avait pris sur son esprit un tel ascendant, que, quand bien même il eût cédé au besoin de chercher des distractions au-dehors, il n’eût plus trouvé en lui ni la force ni le courage de rompre une liaison dans laquelle son égoïsme trouvait les monotones satisfactions du jour le jour.
Ce ci-devant viveur, dont les ancêtres avaient eu, pendant trois siècles, droit de haute et basse justice dans leur comté ; cet ex-brigand, aide de camp du brigand Charette, mena ainsi, pendant douze ans, l’existence triste, précaire, souffreteuse, d’un modeste employé, ou d’un artisan plus modeste encore.
Le ciel avait été longtemps sans se décider à bénir cette union illégitime ; mais enfin les vœux que formait depuis douze ans Éva furent exaucés. La pauvre femme devint enceinte et donna le jour à deux jumelles.
Malheureusement, Éva ne jouit que quelques heures de ces joies maternelles qu’elle avait tant souhaitées : la fièvre de lait l’emporta.
Sa tendresse pour le marquis de Souday était aussi vive et aussi profonde, après ces douze années, qu’aux premiers jours de leur liaison ; cependant son amour, si grand qu’il fût, n’avait pu l’empêcher de reconnaître que la frivolité et l’égoïsme faisaient le fond du caractère de son amant ; aussi mourut-elle partagée entre la douleur de dire un éternel adieu à cet homme tant aimé et la terreur de voir entre ses mains frivoles l’avenir de ses deux enfants.
Cette perte produisit sur le marquis de Souday des impressions que nous reproduirons minutieusement, parce qu’elles nous semblent donner la mesure de l’humeur de ce personnage, destiné à jouer un rôle important dans le récit que nous entreprenons.
Il commença par pleurer sérieusement et sincèrement sa compagne ; car il ne pouvait s’empêcher de rendre hommage à ses qualités et de reconnaître le bonheur qu’il avait dû à son affection.
Puis, cette première douleur apaisée, il éprouva un peu de la joie de l’écolier qui se sent débarrassé de ses entraves. Un jour ou l’autre, son nom, son rang, sa naissance, pouvaient rendre nécessaire la rupture de ce lien ; le marquis n’en voulait donc pas trop à la Providence de s’être chargée d’un soin qui lui eût été cruel.
Mais cette satisfaction fut courte ; la tendresse d’Éva, la continuité des petits soins dont il était l’objet avaient gâté le marquis, et ces petits soins, qui lui manquaient tout à coup, lui parurent plus nécessaires qu’autrefois ils ne lui avaient paru doux.
La mansarde, du moment où la voix pure et fraîche de l’Anglaise ne fut plus là pour l’animer, redevint ce qu’elle était en réalité, un affreux taudis, de même que, du moment où il chercha en vain sur son oreiller la chevelure soyeuse de son amie épanchée en flots blonds et abondants, son lit ne fut plus qu’un galetas.
Où trouverait-il maintenant les douces câlineries, les tendres prévenances dont, pendant douze ans, Éva l’avait entouré ?
Arrivé à cette période de son isolement, le marquis comprit qu’il les chercherait en vain ; en conséquence, il se remit de plus belle à pleurer sa maîtresse, et, quand il lui fallut se séparer des deux petites filles, qu’il mettait en nourrice dans le Yorkshire, il trouva dans sa douleur des élans de tendresse qui touchèrent bien vivement la paysanne qui les emmenait.
Lorsqu’il se fut ainsi séparé de tout ce qui le rattachait au passé, le marquis de Souday succomba sous le poids de son isolement ; il devint sombre et taciturne ; le dégoût de la vie s’empara de lui, et, comme sa foi religieuse n’était pas des plus solides, il eût fini, selon toute probabilité, par faire un saut dans la Tamise, si la catastrophe de 1814 n’était point arrivée à propos pour le distraire de ses idées lugubres.
Rentré dans sa patrie, qu’il n’espérait plus revoir, le marquis de Souday vint tout naturellement demander à Louis XVIII, à qui il n’avait rien demandé pendant tout le temps qu’avait duré son exil, le prix du sang qu’il avait répandu pour lui ; mais les princes ne cherchent souvent qu’un prétexte pour se montrer ingrats, et Louis XVIII en avait trois vis-à-vis de son ancien page :
Le premier, c’était la façon intempestive dont celui-ci était venu annoncer à Sa Majesté la mort de Charette, annonce qui avait, en effet, troublé la royale digestion.
Le second était son départ inconvenant de Blankenbourg, départ qui avait été accompagné de paroles plus inconvenantes encore que le départ lui-même.
Enfin, le troisième prétexte – et le plus grave – était l’irrégularité de sa conduite pendant l’émigration.
On donna de grands éloges à la bravoure et au dévouement de l’ex-page ; mais on lui fit comprendre tout doucement qu’avec de pareils scandales à se reprocher il ne pouvait avoir la prétention de remplir un emploi public.
Le roi n’était plus le maître absolu, lui dit-on ; il avait à compter avec l’opinion publique ; à un règne d’immoralité, il devait faire succéder une ère nouvelle et sévère.
On représenta au marquis combien il serait beau de sa part de couronner une vie d’abnégation et de dévouement en faisant aux nécessités de la situation le sacrifice de ses velléités ambitieuses.
Bref, on l’amena à se contenter de la croix de Saint-Louis, du grade et de la retraite de chef d’escadron, et à s’en aller manger le pain du roi dans sa terre de Souday, seule épave que le pauvre émigré eût recueillie de l’immense fortune de ses ancêtres.
Ce qu’il y eut de beau, c’est que ces déceptions n’empêchèrent point le marquis de Souday de faire son devoir, c’est-à-dire de quitter de nouveau son pauvre castel lorsque Napoléon opéra son merveilleux retour de l’île d’Elbe.
Napoléon tombe une seconde fois, une seconde fois le marquis de Souday rentra à la suite de ses princes légitimes.
Mais, cette fois, mieux avisé qu’en 1814, il se contenta de demander à la Restauration la place de lieutenant de louveterie de l’arrondissement de Machecoul, qui, étant gratuite, lui fut accordée avec empressement.
Privé pendant toute sa jeunesse d’un plaisir qui, dans sa famille, était une passion héréditaire, le marquis de Souday commença de s’adonner à la chasse avec fureur. Toujours triste de la vie solitaire, pour laquelle il n’était pas fait ; devenu encore plus misanthrope à la suite de ses déconvenues politiques, il trouvait dans cet exercice l’oubli momentané de ses souvenirs amers. Aussi la possession d’une louveterie qui lui donnait le droit de parcourir gratuitement les forêts de l’État lui causa-t-elle plus de satisfaction qu’il n’en avait éprouvé en recevant du ministre sa croix de Saint Louis et son brevet de chef d’escadron.
Or, le marquis de Souday vivait depuis deux ans déjà dans son petit castel, battant les bois jour et nuit, avec ses six chiens, seul équipage que lui permît son mince revenu, voyant ses voisins tout juste autant qu’il le fallait pour ne point passer pour un ours et songeant le moins possible aux héritages comme aux gloires du passé, lorsqu’un matin, qu’il partait pour aller explorer la partie nord de la forêt de Machecoul, il se croisa sur la route avec une paysanne qui portait une enfant de trois à quatre ans sur chacun de ses bras.
Le marquis de Souday reconnut cette paysanne et rougit en la reconnaissant.
C’était la nourrice du Yorkshire, à laquelle, depuis trente-six à trente-huit mois, il oubliait régulièrement de payer la pension de ses deux nourrissonnes.
La brave femme s’était rendue à Londres, et avait fort intelligemment été demander des renseignements à l’ambassade française. Elle arrivait donc par l’intermédiaire de M. le ministre de France, qui ne doutait point que le marquis de Souday ne fût on ne peut plus heureux de retrouver ses enfants.
Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est qu’il ne s’était pas tout à fait trompé.
Les petites filles rappelaient si parfaitement la pauvre Éva, que le marquis eut un moment d’émotion ; il les embrassa avec une tendresse qui n’était pas feinte, donna son fusil à porter à l’Anglaise, prit les deux enfants dans ses bras et rapporta à son castel ce butin inattendu, à la grande stupéfaction de la cuisinière nantaise qui composait son domestique, et qui l’accabla de questions sur la singulière trouvaille qu’il venait de faire.
Cet interrogatoire épouvanta le marquis.
Il n’avait que trente-neuf ans et songeait vaguement à se marier, regardant comme un devoir de ne pas laisser finir dans sa personne une maison aussi illustre que l’était la sienne ; il n’eût point été fâché, d’ailleurs, de se décharger sur une femme des soins du ménage, qui lui étaient odieux.
Mais la réalisation de ce projet devenait difficile si les deux petites filles restaient sous son toit.
Il le comprit, paya largement l’Anglaise et la fit repartir le lendemain.
Pendant la nuit, il avait pris une résolution qui lui avait paru tout concilier.
Quelle était cette résolution ?
C’est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.
III – Les deux jumelles
Le marquis de Souday s’était mis au lit, en se répétant à lui-même ce vieil axiome : « La nuit porte conseil. »
Puis, dans cette espérance, il s’était endormi.
En dormant, il avait rêvé.
Il avait rêvé à ses vieilles guerres de Vendée avec Charrette, dont il avait été l’aide de camp, et surtout il avait rêvé à ce brave fils d’un métayer de son père qui avait été son aide de camp, à lui : il avait rêvé à Jean Oullier, auquel il n’avait jamais songé, qu’il n’avait jamais revu depuis le jour où, Charette mourant, ils s’étaient séparés dans le bois de la Chabotière.
Autant qu’il pouvait se le rappeler, Jean Oullier, avant de se joindre à l’armée de Charette, habitait le village de la Chevrolière, près du lac de Grand-Lieu.
Le marquis de Souday fit monter à cheval un homme de Machecoul qui lui faisait d’habitude ses commissions, et, en lui remettant une lettre, le chargea d’aller à la Chevrolière s’informer si un nommé Jean Oullier vivait encore et habitait toujours le pays.
S’il vivait encore et habitait toujours le pays, l’homme de Machecoul aurait à lui porter la lettre et à le ramener, s’il était possible, avec lui.
S’il demeurait aux environs, le messager devait le joindre où il était.
S’il était trop loin pour le suivre, il fallait s’informer de la localité qu’il habitait.
S’il était mort, il fallait revenir dire qu’il était mort.
Jean Oullier n’était pas mort, Jean Oullier n’était pas dans un pays lointain, Jean Oullier n’était pas même aux environs de la Chevrolière.
Jean Oullier était à la Chevrolière même.
Voici ce qu’il était advenu de lui après sa séparation d’avec le marquis de Souday.
Il était resté caché dans le buisson d’où, sans être vu, il pouvait voir.
Il avait vu le général Travot faisant Charette prisonnier, et le traitant avec tous les égards qu’un homme comme le général Travot pouvait avoir pour Charette.
Mais il paraît que ce n’était pas là tout ce que voulait voir Jean Oullier, puisque, Charette placé sur un brancard et emporté, il resta encore, lui, dans son buisson.
Il est vrai qu’un officier et un piquet de douze hommes étaient, de leur côté, restés dans le bois.
Une heure après que ce poste était installé là, un paysan vendéen avait passé à dix pas de Jean Oullier, et avait répondu au qui-vive de la sentinelle bleue par le mot ami, réponse bizarre dans la bouche d’un paysan royaliste parlant à des soldats républicains.
Puis le paysan avait échangé un mot d’ordre avec la sentinelle, qui l’avait laissé passer.
Puis, enfin, il s’était approché de l’officier, qui, avec une expression de dégoût impossible à décrire, lui avait remis une bourse pleine d’or.
Après quoi, le paysan avait disparu.
Selon toute probabilité, l’officier et les douze hommes n’avaient été laissés dans le bois que pour attendre ce paysan ; car à peine avait-il disparu, qu’eux-mêmes s’étaient ralliés et avaient disparu à leur tour.
Selon toute probabilité encore, Jean Oullier avait vu ce qu’il voulait voir ; car il sortit de son buisson comme il y était entré, c’est-à-dire en rampant, se remit sur les pieds, arracha la cocarde blanche de son chapeau, et, avec l’insouciance d’un homme qui, depuis trois ans, joue sa vie chaque jour sur un coup de dés, s’enfonça dans la forêt.
La même nuit, il arriva à la Chevrolière.
Il alla droit à la place où il croyait trouver sa maison.
À la place de sa maison était une ruine noircie par la fumée.
Il s’assit sur une pierre et pleura.
C’est que, dans cette maison, il avait laissé une femme et deux enfants…
Mais, bientôt, Jean Oullier entendit un bruit de pas ; il releva la tête.
Un paysan passait ; Jean Oullier le reconnut dans l’obscurité.
Il appela :
– Tinguy !
Le paysan s’approcha.
– Qui es-tu, demanda-t-il, toi qui m’appelles ?
– Je suis Jean Oullier, répondit le chouan.
– Dieu te garde ! répondit Tinguy.
Et il voulut continuer son chemin.
Jean Oullier l’arrêta.
– Il faut que tu me répondes, lui dit-il.
– Es-tu un homme ?
– Oui.
– Eh bien, alors interroge, je répondrai.
– Mon père ?
– Mort.
– Ma femme ?
– Morte.
– Mes deux enfants ?
– Morts.
– Merci.
Jean Oullier se rassit ; il ne pleurait plus.
Un instant après, il se laissa tomber à genoux et pria.
Il était temps ; il allait blasphémer.
Il pria pour ceux qui étaient morts.
Puis, retrempé par cette foi profonde qui lui donnait l’espoir de les retrouver un jour dans un monde meilleur, il bivouaqua sur ces tristes ruines.
Le lendemain, au point du jour, il était à la besogne, aussi calme, aussi résolu, que si son père eût toujours été à la charrue, sa femme devant la cheminée, et ses enfants devant la porte.
Seul, et sans demander d’aide à personne, il rebâtit sa chaumière.
Il y vécut de son humble travail de journalier ; et qui eût conseillé à Jean Oullier de demander aux Bourbons le prix de ce qu’à tort ou à raison il regardait comme un devoir accompli, celui-là eût fort risqué de révolter la simplicité pleine de grandeur du pauvre paysan.
On comprend qu’avec ce caractère Jean Oullier, recevant une lettre du marquis de Souday, qui l’appelait son vieux camarade et le priait de se rendre à l’instant même au château, on comprend que Jean Oullier ne se fit pas attendre.
Il ferma la porte de sa maison, mit la clef dans sa poche, et, comme il vivait seul, n’ayant personne à prévenir, il partit à l’instant même.
Le messager voulut lui céder le cheval, ou du moins le faire monter en croupe, mais Jean Oullier secoua la tête.
– Grâce à Dieu, dit-il, les jambes sont bonnes.
Et, appuyant sa main sur le cou du cheval, il indiqua lui même par une espèce de pas gymnastique l’allure que le cheval pouvait prendre.
C’était un petit trot de deux lieues à l’heure.
Le soir, Jean Oullier était au château de Souday.
Le marquis le reçut avec une joie visible ; toute la journée, il avait été tourmenté à l’idée que Jean Oullier était absent ou mort.
Il va sans dire que cette absence ou cette mort le tourmentait, non pas pour Jean Oullier, mais pour lui-même.
Nous avons prévenu nos lecteurs que le marquis de Souday était légèrement égoïste.
La première chose que fit le marquis, ce fut de prendre Jean Oullier à part et de lui confier sa position et les embarras qui en résultaient pour lui.
Jean Oullier, qui avait eu ses deux enfants massacrés, ne comprenait pas très bien qu’un père se séparât volontiers de ses deux enfants.
Il accepta cependant la proposition que lui fit le marquis de Souday de lui faire élever ses deux enfants, jusqu’au moment où elles auraient atteint l’âge d’aller en pension.
Il chercherait, à la Chevrolière ou aux environs, quelque brave femme qui leur tînt lieu de mère – si toutefois quelque chose tient lieu de mère à des orphelins.
Quand bien même les deux jumelles eussent été laides et désagréables, Jean Oullier eût accepté ; mais elles étaient si gentilles, si avenantes, si gracieuses, leur sourire était si engageant, que le bonhomme les avait tout de suite aimées comme ces gens-là savent aimer.
Il prétendait qu’avec leurs petites figures blanches et roses et leurs longs cheveux bouclés, elles lui rappelaient si bien les anges qui, avant qu’on les eût brisés, entouraient la madone du maître-autel de Grand-Lieu, qu’en les apercevant il avait eu l’idée de s’agenouiller.
Il fut donc décidé que, le lendemain, Jean Oullier emmènerait les deux enfants.
Malheureusement, pendant tout le temps qui s’était écoulé entre le départ de la nourrice et l’arrivée de Jean Oullier, il avait plu.
Le marquis, confiné dans son castel, avait senti qu’il commençait à s’ennuyer.
S’ennuyant, il avait appelé auprès de lui ses deux filles et s’était mis à jouer avec elles ; puis, plaçant l’une à califourchon sur son cou, asseyant l’autre sur ses reins, il s’était, comme le Béarnais, promené à quatre pattes tout autour de l’appartement.
Seulement, il avait raffiné sur les amusements qu’Henri IV donnait à sa progéniture : avec sa bouche, le marquis de Souday imitait tour à tour le son du cor et l’aboi de toute une meute.
Cette chasse à l’intérieur avait énormément amusé le marquis de Souday.
Il va sans dire que les petites filles, elles, n’avaient jamais tant ri.
En outre, elles avaient pris goût à la tendresse accompagnée de toutes sortes de chatteries que leur père leur avait prodiguée pendant ces quelques heures, afin d’atténuer, selon toute probabilité, les reproches que lui faisait sa conscience à propos de cette séparation si prompte après une si longue absence.
Les deux enfants témoignaient donc au marquis un attachement féroce et une reconnaissance dangereuse pour ses projets.
Aussi, à huit heures du matin, lorsque la carriole fut amenée devant le perron du château, lorsque les deux jumelles eurent compris qu’on allait les emmener, commencèrent-elles à pousser des cris de désespoir.
Bertha se rua sur son père, embrassa une de ses jambes, et, se cramponnant aux jarretières du monsieur qui lui donnait tant de bonbons et qui faisait si bien le cheval, elle y enchevêtra ses petites mains de telle façon, que le pauvre marquis craignit de lui briser les poignets en essayant de les détacher.
Quant à Mary, elle s’était assise sur une marche et se contentait de pleurer ; mais elle pleurait avec une telle expression de douleur, que Jean Oullier se sentit encore plus remué de ce chagrin muet que du désespoir bruyant de l’autre petite fille.
Le marquis de Souday employa toute son éloquence à persuader aux deux petites filles qu’en montant dans la voiture elles auraient bien plus de friandises et de plaisir qu’en restant auprès de lui ; mais plus il parlait, plus Mary sanglotait et plus Bertha trépignait et l’étreignait avec rage.
L’impatience commençait à gagner le marquis ; et, voyant que la persuasion ne pouvait rien, il allait employer la force, lorsque, en levant les yeux, son regard se fixa sur Jean Oullier.
Deux grosses larmes roulaient le long des joues bronzées du paysan et allaient se perdre dans l’épais collier de favoris roux qui lui encadrait le visage.
Ces larmes étaient à la fois une prière pour le marquis et un reproche pour le père.
M. de Souday fit signe à Jean Oullier de dételer le cheval, et, tandis que Bertha, qui avait compris ce signe, dansait de joie sur le perron, il dit à l’oreille du métayer :
– Tu partiras demain.
Ce jour-là, comme il faisait très beau, le marquis voulut utiliser la présence de Jean Oullier en allant à la chasse et en s’y faisant accompagner par lui. Il le conduisit, en conséquence, dans sa chambre, pour qu’il l’aidât à revêtir son costume d’expédition.
Le paysan fut frappé de l’affreux désordre qui régnait dans cette petite chambre, et ce fut une occasion pour le marquis d’achever ses confidences intimes en se plaignant de son maître Jacques femelle, qui, convenable devant ses fourneaux, était d’une incurie odieuse dans tous les autres soins du ménage, et particulièrement dans ceux qui regardaient la toilette du marquis.
Ce dernier fut plus de dix minutes avant d’avoir trouvé une veste qui ne fût pas veuve de tous ses boutons ou une culotte qui ne fût pas affligée d’une solution de continuité par trop indécente.
Enfin, on y arriva.
Tout louvetier qu’il était, comme nous l’avons dit, le marquis était trop pauvre pour se donner le luxe d’un valet de chiens ; et il conduisait lui-même son petit équipage. Aussi, forcé de se partager entre le soin du défaut et la préoccupation du tir, était-il rare qu’il ne rentrât point bredouille.
Avec Jean Oullier, ce fut tout autre chose.
Le vigoureux paysan, dans toute la force de l’âge, gravissait les rampes les plus escarpées de la forêt avec la force et la légèreté d’un chevreuil : il bondissait au-dessus des halliers quand il lui semblait trop long de les tourner, et, grâce à ses jarrets d’acier, il ne quittait pas ses chiens d’une semelle ; enfin, dans deux ou trois occasions, il les appuya avec tant de bonheur, que le sanglier qu’on chassait, comprenant que ce n’était pas en fuyant qu’il se débarrasserait de ses ennemis, finit par les attendre et par faire tête dans un fourré où le marquis eut la joie de le tuer au ferme ; ce qui ne lui était pas encore arrivé.
Le marquis rentra chez lui transporté d’allégresse, en remerciant Jean Oullier de la délicieuse journée qu’il lui devait.
Pendant le dîner, il fut d’une humeur charmante et inventa de nouveaux jeux pour mettre les petites filles à l’unisson de son humeur.
Le soir, lorsqu’il rentra dans sa chambre, le marquis de Souday trouva Jean Oullier assis les jambes croisées, dans un coin, à la manière des Turcs ou des tailleurs.
Le brave homme avait en face de lui une montagne de vêtements et tenait à la main une vieille culotte de velours dans laquelle il promenait l’aiguille avec fureur.
– Que diable fais-tu là ? lui demanda le marquis.
– L’hiver est froid dans ce pays de plaine, surtout quand le vent vient de la mer ; et, rentré chez moi, j’aurais froid aux jambes, rien qu’en pensant que la bise peut arriver aux vôtres par de telles ouvertures ! répondit Jean Oullier en montrant à son maître une fente qui allait du genou à la ceinture, dans la culotte qu’il réparait.
– Ah çà ! tu es donc tailleur ? fit le marquis.
– Hélas ! dit Jean Oullier, est-ce qu’on ne sait pas un peu de tout quand, depuis plus de vingt ans, on vit seul ? D’ailleurs, on n’est jamais embarrassé quand on a été soldat.
– Bon ! est-ce que je ne l’ai pas été aussi, moi ? demanda le marquis.
– Non ; vous avez été officier, vous, et ce n’est pas la même chose.
Le marquis de Souday regarda Jean Oullier avec admiration, puis se coucha, s’endormit et ronfla sans que cela interrompît le moins du monde la besogne de l’ancien chouan.
Au milieu de la nuit, le marquis se réveilla.
Jean Oullier travaillait toujours.
La montagne de vêtements n’avait pas sensiblement diminué.
– Mais tu n’auras jamais fini, même en travaillant jusqu’au jour, mon pauvre Jean ! lui dit le marquis.
– Hélas ! j’en ai grand-peur !
– Alors, va te coucher, mon vieux camarade ; tu ne partiras que lorsqu’il y aura un peu d’ordre dans toute cette défroque, et nous chasserons encore demain.
IV – Comment, en venant pour une heure chez le marquis de Souday, Jean Oullier y serait encore, si le marquis et lui ne fussent pas morts depuis dix ans
Le matin, avant de partir pour la chasse, le marquis de Souday eut l’idée d’aller embrasser ses enfants.
En conséquence, il monta à leur chambre et fut fort étonné de trouver l’universel Jean Oullier qui l’avait devancé, et qui débarbouillait les deux petites filles avec la conscience et l’obstination de la meilleure gouvernante.
Et le pauvre homme, à qui cette occupation rappelait les enfants qu’il avait perdus, semblait y trouver une satisfaction complète.
L’admiration du marquis se changea en respect.
Pendant huit jours, les chasses se succédèrent sans interruption, toutes plus belles et plus fructueuses les unes que les autres.
Pendant ces huit jours, tour à tour piqueur et économe, Jean Oullier, en cette dernière qualité, une fois rentré à la maison, travailla sans relâche à rajeunir la toilette de son maître ; et il trouva encore le temps de ranger la maison du haut en bas.
Le marquis de Souday, loin de vouloir maintenant presser son départ, songeait avec effroi qu’il allait lui falloir se séparer d’un serviteur si précieux.
Du matin jusqu’au soir, et quelquefois du soir jusqu’au matin, il repassait dans son cerveau quelle était celle des qualités du Vendéen qui le touchait le plus sensiblement.
Jean Oullier avait le flair d’un limier pour découvrir une rentrée au bris des ronces ou sur l’herbe mouillée de rosée.
Dans les chemins secs et pierreux de Machecoul, de Bourgneuf et d’Aigrefeuille, il déterminait sans hésitation l’âge et le sexe du sanglier dont la trace semblait imperceptible.
Jamais piqueur à cheval n’avait appuyé des chiens comme Jean Oullier le savait faire, monté sur deux longues jambes.
Enfin, les jours où la fatigue le forçait de donner relâche à la petite meute, il était sans pareil pour deviner les enceintes fertiles en bécasses et y conduire son maître.
– Ah ! par ma foi, au diable le mariage ! s’écriait parfois le marquis lorsqu’on le croyait occupé de songer à tout autre chose. Qu’irais-je faire dans cette galère, où j’ai vu si tristement ramer les plus honnêtes gens ? Par la mort-Dieu ! je ne suis plus un tout jeune homme : voilà que je prends mes quarante ans ; je ne me fais aucune illusion, je ne compte séduire personne par mes agréments personnels. Je ne puis donc espérer autre chose que de tenter une vieille douairière avec mes trois mille livres de rente, dont la moitié meurt avec moi ; j’aurai une marquise de Souday grondeuse, quinteuse, hargneuse, qui m’interdira peut-être la chasse, que ce brave Jean sert si bien, et qui, à coup sûr, ne tiendra pas le ménage plus décemment qu’il ne le fait. Et cependant, reprenait-il en se redressant et en balançant le haut du corps, sommes-nous dans une époque où il soit permis de laisser finir les grandes races, soutiens naturels de la monarchie ? ne me serait-il pas bien doux de voir mon fils relever l’honneur de ma maison ? tandis qu’au contraire, moi à qui l’on n’a jamais connu de femme – légitime du moins – que vais-je faire penser de moi ? Que diront mes voisins de la présence de ces deux petites filles à la maison ?
Ces réflexions, lorsqu’elles lui venaient – et c’était d’ordinaire les jours de pluie, quand le mauvais temps l’empêchait de se livrer à son plaisir favori, – ces réflexions jetaient parfois le marquis de Souday dans de cruelles perplexités.
Il en sortit, comme sortent de pareilles situations tous les tempéraments indécis, les caractères faibles, tous les hommes qui ne savent pas prendre un parti : – en restant dans le provisoire.
Bertha et Mary, en 1831, avaient atteint leurs dix-sept ans, et le provisoire durait toujours.
Et, cependant, quoi qu’on en pût croire, le marquis de Souday ne s’était point encore décidé positivement à garder ses filles près de lui.
Jean Oullier, qui avait accroché à un clou la clef de sa maison de la Chevrolière, n’avait pas eu, depuis quatorze ans, l’idée de la décrocher de ce clou.
Il avait patiemment attendu que son maître lui donnât l’ordre de retourner chez lui, et, comme, depuis son arrivée au château, le château était propre et net, comme le marquis n’avait pas eu une seule fois à se lamenter sur l’inconvénient de se passer de boutons ; comme les bottes de chasse avaient toujours été convenablement graissées ; comme les fusils étaient tenus ni plus ni moins que dans la première armurerie de Nantes ; comme Jean Oullier, à l’aide de certains procédés coercitifs dont il tenait la tradition d’un de ses camarades à l’armée brigande, avait peu à peu amené la cuisinière à perdre l’habitude de faire supporter à son maître sa mauvaise humeur ; comme les chiens étaient constamment en bon état, brillants de poil, ni trop gras, ni trop maigres, capables de soutenir quatre fois par semaine une grande course de huit à dix heures et de la terminer autant de fois par un hallali ; comme aussi le babil et la gentillesse des enfants, leur tendresse expansive rompaient la monotonie de son existence ; comme ses causeries et ses entretiens avec Jean Oullier sur l’ancienne guerre, passée aujourd’hui à l’état de tradition – elle remontait à trente-cinq ou trente-six ans – rompaient la monotonie de son existence et allégeaient la longueur des soirées et des jours de pluie, le marquis, retrouvant les bons soins, la douce quiétude, le bonheur tranquille dont il avait joui près de la pauvre Éva, avec l’enivrant plaisir de la chasse en plus, le marquis, disons-nous, avait remis de jour en jour, de mois en mois, d’année en année, à fixer le moment de la séparation.
Quant à Jean Oullier, il avait, de son côté, ses motifs pour ne point provoquer de décision. Ce n’était pas seulement un homme brave, que celui-là, c’était encore un brave homme.
Ainsi que nous l’avons raconté, il s’était pris tout de suite d’affection pour Bertha et Mary ; cette affection, dans ce pauvre cœur veuf de ses propres enfants, s’était promptement changée en tendresse, et, avec le temps, cette tendresse était devenue du fanatisme. Il ne s’était point tout d’abord rendu un compte bien exact de la distinction que le marquis voulait établir entre leur situation et celle des enfants légitimes que celui-ci espérait obtenir d’une union quelconque pour perpétuer son nom : dans le bas Poitou, quand on a fait deuil à une brave fille, on ne connaît qu’un seul moyen de réparation, le mariage. Jean Oullier trouvait logique, puisque son maître ne pouvait légitimer sa liaison, de ne pas désavouer au moins la paternité qu’Éva lui avait léguée en mourant. Aussi, après deux mois de séjour au château, ces réflexions faites, pesées par son esprit, ratifiées par son cœur, le Vendéen eût reçu de fort mauvaise grâce un ordre de départ, et le respect qu’il portait à M. de Souday ne l’eût point empêché d’exposer vertement, dans ce cas extrême, ses sentiments à l’endroit de ce chapitre.
Heureusement, le marquis n’initia point son serviteur aux tergiversations de son esprit ; de sorte que Jean Oullier put prendre le provisoire pour un définitif, et croire que le marquis regardait la présence de ses deux filles au château comme un droit pour elles, et en même temps comme un devoir pour lui.
Au moment où nous sortons de ces préliminaires, peut-être un peu longs, Bertha et Mary ont donc entre dix-sept et dix-huit ans.
La pureté de race des marquis de Souday a fait merveille en se retrempant dans le sang plein de sève de la plébéienne Saxonne : les enfants d’Éva sont deux splendides jeunes filles aux traits fins et délicats, à la taille svelte et élancée, à la tournure pleine de noblesse et de distinction.
Elles se ressemblent comme se ressemblent tous les jumeaux ; seulement, Bertha est brune comme était son père, Mary est blonde comme était sa mère.
Malheureusement, l’éducation que ces deux belles personnes ont reçue, en développant, autant que possible, leurs avantages physiques, ne s’est pas suffisamment préoccupée des besoins de leur sexe.
Vivant au jour le jour auprès de leur père, avec le laisser aller de ce dernier, et son parti pris de jouir du présent sans s’inquiéter de l’avenir, il était impossible qu’il en fût autrement.
Jean Oullier avait été le seul instituteur des enfants d’Éva, comme il avait été leur seule gouvernante.
Le digne Vendéen leur avait appris tout ce qu’il savait, à lire, à écrire, à compter, à prier avec une tendre et profonde ferveur Dieu et la Vierge ; puis à courir les bois, à escalader les rochers, à traverser les halliers de houx, de ronces, d’épines, le tout sans fatigue, sans peur et sans faiblesse ; à arrêter d’une balle un oiseau dans son vol, un chevreuil dans sa course ; enfin, à monter à poil ces indomptables chevaux de Mellerault, aussi sauvages dans leurs prairies ou dans leurs landes que les chevaux des gauchos dans leurs pampas.
Le marquis de Souday avait vu tout cela sans être aucunement tenté d’imprimer une autre direction à l’éducation de ses filles, et sans avoir même l’idée de contrarier les goûts qu’elles puisaient dans ces exercices virils : le digne gentilhomme était trop heureux de trouver en elles de vaillants camarades de chasse, réunissant à une tendresse respectueuse pour leur père une gaieté, un entrain et une ardeur cynégétique qui, depuis qu’elles les partageaient, doublaient le charme de toutes ses parties.
Cependant, pour être juste, nous devons dire que le marquis avait ajouté quelque chose de son cru aux leçons de Jean Oullier.
Lorsque Bertha et Mary eurent atteint leur quatorzième année, lorsqu’elles commencèrent à accompagner leur père dans ses expéditions en forêt, les jeux enfantins qui remplissaient autrefois les soirées au château perdirent tout leur attrait.
Alors, pour combler le vide qui en résultait, le marquis de Souday apprit le whist à Bertha et à Mary.
De leur côté, les deux enfants avaient complété, aussi bien qu’elles avaient pu, au moral, leur éducation, si vigoureusement développée par Jean Oullier sous le rapport physique ; elles avaient, en jouant à cache-cache dans le château, découvert une chambre qui, selon toute probabilité, n’avait pas été ouverte depuis trente ans.
C’était la bibliothèque.
Là, elles avaient trouvé un millier de volumes, à peu près.
Chacune, dans ces volumes, avait choisi selon son goût.
La sentimentale et douce Mary avait donné la préférence aux romans, la turbulente et positive Bertha, à l’histoire.
Puis elles avaient fondu le tout ensemble : Mary en racontant Amadis et Paul et Virginie à Bertha, Bertha en racontant Mézeray et Velly à Mary.
De ces lectures tronquées, il était résulté pour les deux jeunes filles des notions assez fausses sur la vie réelle et sur les habitudes et les exigences d’un monde qu’elles n’avaient jamais vu, dont elles avaient à peine entendu parler.
Lors de la première communion des deux petites filles, le curé de Machecoul, qui les aimait pour leur piété et la bonté de leur cœur, avait hasardé quelques observations sur la singulière existence qu’on leur préparait en les élevant de la sorte ; mais ces amicales remontrances étaient venues se briser contre l’indifférence égoïste du marquis de Souday.
Et l’éducation que nous avons décrite avait continué, et, de cette éducation, il était résulté des habitudes qui avaient fait – grâce à leur position déjà si fausse – une fort méchante réputation à Bertha et à sa sœur, dans tout le pays.
Et, en effet, le marquis de Souday était entouré de gentillâtres qui lui enviaient fort l’illustration de son nom, et qui ne demandaient qu’une occasion de lui rendre le dédain que les ancêtres du marquis avaient probablement témoigné aux leurs ; aussi, lorsqu’on le vit conserver dans sa demeure et appeler ses filles les fruits d’une liaison illégitime, se mit-on à publier à son de trompe ce qu’avait été sa vie à Londres ; on exagéra ses fautes ; on fit de la pauvre Éva, qu’un miracle de la Providence avait conservée si pure, une fille des rues, et, peu à peu, les hobereaux de Beauvoir, de Saint-Léger, de Bourgneuf, de Saint-Philbert et de Grand-Lieu se détournèrent du marquis, sous prétexte qu’il avilissait la noblesse, dont, vu la roture de la plupart d’entre eux, ils étaient bien bons de prendre tant de souci.
Bientôt, ce ne furent pas seulement les hommes qui désapprouvèrent la conduite actuelle du marquis de Souday et calomnièrent sa conduite passée : la beauté des deux sœurs ameuta contre elles toutes les mères et toutes les filles, à dix lieues à la ronde, et cela, dès lors, devint infiniment plus grave.
Si Bertha et Mary eussent été laides, le cœur de ces charitables dames et de ces pieuses demoiselles, naturellement porté à l’indulgence chrétienne, eût peut-être pardonné sa paternité inconvenante au pauvre diable de châtelain ; mais il n’y avait pas moyen de ne point être révolté en voyant ces deux pécores écraser de leur distinction, de leur noblesse et des charmes de leur extérieur, les jeunes personnes les mieux nées des environs.
Ces insolentes supériorités ne méritaient donc ni merci ni miséricorde.
L’indignation contre les deux pauvres enfants était si générale, que, n’eussent-elles donné en rien matière à la médisance ou à la calomnie, la médisance et la calomnie les eussent encore touchées du bout de l’aile ; qu’on juge de ce qui devait arriver et de ce qui arriva avec les habitudes masculines et excentriques des deux sœurs !
Ce fut donc bientôt un tolle universel et réprobateur, qui, du département de la Loire-Inférieure, gagna les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire.
Sans la mer qui borne les côtes de la Loire-Inférieure, bien certainement cette réprobation eût fait autant de chemin vers l’occident qu’elle en faisait au sud et à l’est.
Bourgeois et gentilshommes, citadins et campagnards, tout s’en mêla.
Les jeunes gens qui avaient à peine rencontré Mary et Bertha, qui les avaient à peine vues, parlaient des filles du marquis de Souday avec un sourire avantageux, gros d’espérances lorsqu’il n’était pas gros de souvenirs.
Les douairières se signaient lorsqu’on prononçait leur nom ; les gouvernantes menaçaient d’elles les petits enfants lorsqu’ils n’étaient pas sages.
Les plus indulgents se bornaient à prêter aux deux jumelles les trois vertus d’Arlequin, qui passent généralement pour être le lot des disciples de saint Hubert, dont elles affectaient les goûts : c’est-à-dire l’amour, le jeu et le vin ; mais d’autres assuraient gravement que le petit castel de Souday était, chaque soir, le théâtre d’orgies dont la tradition se retrouvait dans les chroniques de la régence ; quelques romantiques, brochant sur le tout, voulaient absolument voir, dans une des petites tourelles abandonnées aux amours innocentes d’une vingtaine de pigeons, une réminiscence de la fameuse tour de Nesle, de luxurieuse et homicide mémoire.
Bref, on en dit tant sur Bertha et sur Mary, que, quelles qu’eussent été jusque-là, et quelles que fussent encore en réalité la pureté de leur vie et l’innocence de leurs actions, elles devinrent un objet d’horreur pour tout le pays.
Par les valets des châteaux, par les ouvriers qui approchaient des bourgeois, par les gens même qu’elles employaient ou à qui elles rendaient service, cette haine s’infiltra dans le populaire ; de sorte que – à l’exception de quelques pauvres aveugles ou de quelques bonnes vieilles femmes impotentes que les orphelines secouraient directement – toute la population en blouse et en sabots servait d’écho aux contes absurdes inventés par les gros bonnets des environs ; et il n’était pas un bûcheron, pas un sabotier de Machecoul, pas un cultivateur de Saint-Philbert ou d’Aigrefeuille qui ne se fût cru déshonoré de leur ôter son chapeau.
Enfin, les paysans avaient donné à Bertha et à Mary un sobriquet, et ce sobriquet parti d’en bas, avait été acclamé dans les régions supérieures, comme caractérisant parfaitement les appétits et les dérèglements que l’on prêtait aux jeunes filles.
Ils les appelaient les louves de Machecoul.
V – Une portée de louvarts
Le marquis de Souday resta complètement indifférent à ces manifestations de l’animadversion publique ; bien plus, il ne sembla pas même se douter qu’elle existât. Lorsqu’il s’aperçut qu’on ne lui rendait plus les rares visites que, de loin en loin, il se croyait obligé de faire à ses voisins, il se frotta joyeusement les mains, se tenant pour débarrassé de corvées qui lui étaient odieuses, et qu’il n’accomplissait jamais que contraint et forcé, soit par ses filles, soit par Jean Oullier.
Il lui revint bien par-ci par-là quelque chose des calomnies qui circulaient sur le compte de Bertha et de Mary ; mais il était si heureux entre son factotum, ses filles et ses chiens, qu’il jugea que ce serait compromettre la félicité dont il jouissait que d’accorder la moindre attention à ces absurdes propos ; de sorte qu’il continua de fesser ses lièvres tous les jours, de forcer un sanglier dans les grandes occasions, et de faire son whist chaque soir en compagnie des deux pauvres calomniées.
Jean Oullier fut loin d’être aussi philosophe que son maître ; il faut dire aussi que, sa condition imposant beaucoup moins, il en apprit davantage.
Sa tendresse pour les deux jeunes filles était devenue du fanatisme ; il passait sa vie à les regarder, soit que, doucement souriantes, elles fussent assises dans le salon du château, soit que, penchées sur l’encolure de leurs chevaux, les yeux étincelants, la figure animée, leurs beaux cheveux dénoués au vent, sous leurs feutres aux larges bords et à la plume onduleuse, elles galopassent à ses côtés. En les voyant si fièrement accomplies, et en même temps si bonnes et si tendres pour leur père et pour lui, son cœur tressaillait d’orgueil, de fierté et de bonheur ; il se regardait comme ayant été pour quelque chose dans le développement de ces deux admirables créatures, et il se demandait comment l’univers pouvait ne pas s’agenouiller devant elles.
Aussi, les premiers qui se hasardèrent à l’entretenir des rumeurs qui couraient le pays, furent-ils si vertement redressés, que cela en dégoûta les autres ; mais, véritable père de Bertha et de Mary, Jean Oullier n’avait pas besoin qu’on lui en parlât pour savoir ce que l’on pensait des deux objets de sa tendresse.
Dans un sourire, dans un regard, dans un geste, dans un signe, il devinait les méchantes idées de chacun, et cela, avec une sagacité qui le rendait vraiment misérable.