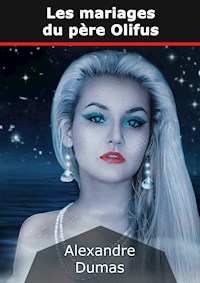
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
c'est Dumas qui part assister au couronnement du roi de Hollande...et qui en revient avec une histoire exotique digne des voyages de Sinbad: totalement improbable, complètement illogique, un brin , voire pas mal, versée dans le fantastique ! Depuis la Hollande jusqu'à l'Inde, Olifus fera de son mieux pour échapper à la femme sortie des eaux qu'il a épousée, se mariera même derechef à plusieurs reprises, mais rien à faire: la femme de la mer est un peu sorcière, et franchement, tant pis pour lui et tant mieux pour nous. Une longue nouvelle emplie de digressions, certaines anecdotiques, d'autres tristes quand Dumas interrompt carrément son récit pour parler de la mort d'un ami, qui est très plaisante à livre, distrayante, un brin loufoque, et tout à l'honneur de son talent de conteur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Les mariages du père Olifus
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIPage de copyrightAlexandre Dumas
Les mariages du père Olifus
I
Le preneur de corbeaux
Un matin du mois de mars 1848, en passant de ma chambre à coucher dans mon cabinet de travail, je trouvai comme d’habitude, sur mon bureau, une pile de journaux, et sur cette pile de journaux, une pile de lettres.
Parmi ces lettres, il y en avait une dont le large cachet rouge attira tout d’abord mes regards. Elle ne portait le timbre d’aucune poste, et était adressée tout simplement : « À monsieur Alexandre Dumas, à Paris » ; ce qui indiquait qu’elle avait été remise par une personne tierce.
L’écriture avait un caractère étranger, flottant, entre l’écriture anglaise et l’écriture allemande : celui qui l’avait tracée devait avoir l’habitude du commandement, une certaine fermeté de résolution dans l’esprit, le tout mitigé par des élans de coeur et des caprices de pensées qui parfois faisaient de lui un tout autre homme que l’homme apparent.
J’aime assez, quand je reçois une lettre d’une écriture inconnue, et que cette lettre me paraît venir de quelque personne considérable, j’aime assez à me faire d’avance et d’après les lignes insignifiantes tracées par cette personne sur la suscription, une idée de son rang, de ses habitudes, de son caractère.
Mes réflexions faites, j’ouvris la lettre et je lus ce qui suit :
La Haye, 22 février 1848
Monsieur,
Je ne sais si monsieur Eugène Vivier, le grand artiste qui est venu nous visiter dans le courant de l’hiver, et dont j’ai été assez heureux pour faire la connaissance, vous a dit que j’étais un de vos lecteurs les plus assidus, et je puis le dire, si nombreux qu’ils soient, car dire avoir lu Mademoiselle de Belle-Isle, Amaury, les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, Bragelonne et Monte-Cristo, ce serait vous accorder un compliment par trop banal.
Il me tardait donc depuis longtemps de vous offrir un souvenir et de vous faire connaître en même temps un de nos plus grands artistes nationaux, monsieur Backulsen.
Permettez-moi donc, monsieur, de vous adresser, ci-joint, quatre dessins de cet artiste, lesquels représentent les scènes les plus saillantes de votre roman des Trois Mousquetaires.
Maintenant, je vous dis adieu, et vous prie de me croire, monsieur, votre affectionné.
Guillaume, Prince d’Orange.
J’avoue que cette lettre, datée du 22 février 1848, c’est-à-dire du jour où éclatait la révolution parisienne, reçue le lendemain ou le surlendemain d’un jour où on avait voulu me tuer sous prétexte que j’étais un ami des princes, me fit un sensible plaisir.
En effet, pour le poète, l’étranger c’est la postérité, l’étranger placé en dehors de nos petites haines littéraires, de nos petites jalousies artistiques ! L’étranger, comme l’avenir, juge l’homme sur ses oeuvres, et la couronne qui passe la frontière est tressée des mêmes fleurs que celles que l’on jette sur une tombe.
Cependant la curiosité l’emporta sur la reconnaissance. Je commençai par ouvrir le carton qui était déposé dans un coin de mon bureau, et j’y trouvai en effet quatre charmants dessins : l’un représentant l’arrivée de d’Artagnan et de son cheval jaune à Meung ; l’autre, le bal où Milady coupe les ferrets de diamant au pourpoint de Buckingham ; le troisième, le bastion de Saint Gervais ; le quatrième, la mort de Milady.
Puis j’écrivis au prince pour le remercier.
Au reste, je connaissais depuis longtemps le prince pour un artiste. Je le savais compositeur distingué, et deux autres princes qui ne se trompaient guère en hommes et en arts m’en avaient parlé souvent, le duc d’Orléans et le prince Jérôme Napoléon.
On sait que le duc d’Orléans gravait d’une façon charmante. J’ai des épreuves sortant de ses mains et qui sont des modèles d’eau-forte et d’aqua-tinta.
Quant au prince Napoléon, j’ai de lui, chose qu’il a probablement oubliée, des vers républicains qui lui avaient valu un rude pensum au collège de Stuttgart, et qui m’ont été donnés à Florence en 1839 ou 1840 par la belle princesse Mathilde.
J’avais surtout entendu parler de la princesse d’Orange comme d’une de ces femmes supérieures qui lorsqu’elles ne s’appellent pas Élisabeth ou Christine, s’appellent madame de Sévigné ou madame de Staël.
Il en résulte que lorsque le prince d’Orange fut appelé à succéder à son père sur le trône de Hollande, il me vint naturellement à l’esprit cette idée de faire le voyage d’Amsterdam pour assister au couronnement du nouveau roi, et de présenter tous mes remerciements à l’ex-prince d’Orange.
Je partis donc le 9 mai 1849.
Le 10, les journaux annoncèrent que je me rendais à Amsterdam pour faire une relation des fêtes du couronnement.
On avait annoncé la même chose, quand, le 3 octobre 1846, je partis pour Madrid.
J’en demande pardon aux journaux qui veulent bien s’occuper de moi ; mais quand je vais aux noces des princes, j’y vais comme convive et non comme historien.
Ceci pesé, je reviens à mon départ.
Outre le plaisir de la locomotion, outre ce besoin de respirer de temps en temps un autre air que celui qu’on respire habituellement, une excellente surprise m’était réservée.
Comme j’allais passer du salon d’attente sous la gare, je sentis qu’on me tirait par le pan de ma redingote.
– Où allez-vous donc comme cela ? me demanda celui qui venait d’attirer mon attention à l’aide de ce geste.
Je jetai un cri de surprise.
– Et vous ?
– En Hollande.
– Mais moi aussi.
– Voir le couronnement ?
– Oui.
– Mais moi aussi. Êtes-vous invité directement, vous ?
– Non ; mais je sais le roi un prince artiste, et comme, depuis la mort du duc d’Orléans, il n’y a plus beaucoup de princes artistes, je veux aller voir couronner celui-là.
Mon compagnon de voyage, c’était Biard.
Vous connaissez Biard de nom, si vous ne le connaissez pas personnellement. Biard, vous le savez, c’est le spirituel pinceau qui a fait la Revue de la garde nationale dans un village, le Baptême du bonhomme Tropique, les Honneurs partagés. C’est le pinceau poétique qui vous a montré, au pied de cette montagne de glace qui craque et qui se fend, ces deux Lapons qui passent chacun dans une pirogue, et qui s’embrassent en passant ; c’est l’auteur enfin de tous ces ravissants portraits de femmes pleins de coquetterie et de lumières, que vous avez pu voir à la dernière exposition, et encore à celle-là ; mais c’est surtout, et plus que tout cela, car j’ai la mauvaise habitude de mettre l’homme avant l’artiste, c’est l’esprit charmant, l’infatigable conteur, le voyageur du midi et du nord, l’ami bienveillant, le confrère sans jalousie, qui s’oublie quand il parle des autres ; c’est enfin un compagnon de voyage comme j’en souhaite un à mon lecteur pour faire le tour du monde, et comme j’étais enchanté d’en avoir trouvé un pour aller en Hollande.
Il y avait un ou deux ans que nous ne nous étions vus. Étrange vie que la nôtre ; on s’aime quand on se rencontre, on est heureux de se voir, on passe des heures, des jours, une semaine toute joyeuse de cet accouplement que le hasard a fait ; on revient dans le même wagon, on se fait reconduire par le même fiacre ; on se serre la main en se disant le plus sérieusement du monde : « Ah çà ! mais, c’est stupide de ne pas se voir ; voyons-nous donc un peu » ; et l’on ne se revoit pas.
Car chacun rentre dans sa vie, se rejette dans son oeuvre, bâtit son édifice de fourmi ou de géant, auquel la postérité seule assignera sa véritable hauteur, le temps sa véritable durée.
Ce fut une bonne nuit que cette nuit passée sur la route de Bruxelles, entre Biard et mon fils. Il y avait cinq ou six autres personnes avec nous, dans la même diligence ; ont-elles compris quelque chose à ce que nous avons dit ? j’en doute ; au bout de cinquante lieues de route et de cinq ou six heures de voyage, étions-nous pour elles des gens d’esprit ou des imbéciles ? je n’en sais rien ; notre esprit à nous autres est si étrange ! il saute si rapidement des hauteurs de la philosophie dans les bas-fonds du calembour ! il a un cachet si particulier, si individuel, si excentrique ! il appartient tellement à une caste, qu’il faut en quelque sorte une longue initiation à cet esprit-là pour le comprendre !
Mais, comme on se lasse de tout, même de rire, vers deux heures du matin la conversation tarit ; vers trois heures, nous nous endormions ; vers cinq heures, on nous réveilla pour visiter nos malles ; enfin, vers huit heures, nous arrivâmes à Bruxelles.
À Bruxelles, tout était parfaitement tranquille, et si on n’y avait pas entendu dire en français tant de mal de la France, on aurait pu y oublier que la France existât.
Nous étions rentrés en pleine monarchie.
Singulier pays que la Belgique, pays qui garde son roi parce que son roi est toujours prêt à s’en aller.
Il est vrai que c’est un homme d’infiniment d’esprit que le roi Léopold Ier.
À chaque révolution qui se fait en France ou à chaque émeute qui gronde à Bruxelles, il accourt sur son balcon, met le chapeau à la main, et fait signe qu’il veut parler.
On écoute.
– Mes enfants, dit-il, vous savez qu’on m’a fait roi malgré moi. Je n’avais pas envie de l’être avant de l’avoir été, et, depuis que je le suis, j’ai le désir de ne l’être plus ; si donc vous êtes comme moi, et si vous avez assez de la royauté, donnez-moi une heure, je ne vous en demande pas davantage ; dans une heure, je serai hors du royaume : je n’ai encouragé les chemins de fer que pour cela. Seulement, soyez sages, ne cassez rien ; vous voyez que ce serait inutile.
Ce à quoi le peuple répond :
– Nous ne voulons pas que vous vous en alliez. Nous éprouvons le besoin de faire un peu de bruit, voilà tout ; nous l’avons fait, nous sommes contents. Vive le roi !
Après quoi, le roi et le peuple se quittent plus satisfaits l’un de l’autre que jamais.
Tout le long de la route, Biard m’avait dit : « Soyez tranquille, en arrivant à Bruxelles, je vous mènerai voir quelque chose que vous n’avez pas vu. »
Et, dans mon orgueil, à chaque fois qu’il me faisait cette promesse, je haussais les épaules.
J’ai été dix fois peut-être à Bruxelles. Dans ces dix voyages j’avais vu le Parc, le Jardin Botanique, le palais du prince d’Orange, l’église de Sainte-Gudule, le boulevard de Waterloo, les magasins de Méline et Cans, le palais du prince de Ligne. Que pouvait-il donc me rester à voir ?
Aussi, à peine arrivé :
– Allons voir ce que je n’ai pas encore vu, dis-je à Biard.
– Venez, me dit-il laconiquement.
Et nous partîmes, Biard, Alexandre et moi.
Notre guide nous conduisit droit à une assez belle maison, située aux environs de la cathédrale, s’arrêta à une porte cochère, et sonna sans hésitation.
Un domestique vint ouvrir.
Son aspect me frappa tout d’abord. Il avait le bout des doigts ensanglanté, son gilet et son pantalon étaient littéralement couverts de plumes ou plutôt de duvet appartenant à la dépouille de toutes sortes d’oiseaux.
De plus, il avait un singulier mouvement de tête, mouvement semi-circulaire et semblable à celui du torcol.
– Mon ami, dit Biard, voulez-vous avoir la bonté de prévenir votre maître que des étrangers qui passent à Bruxelles désirent visiter sa collection ?
– Monsieur, répondit le domestique, mon maître n’y est pas, mais, en son absence, je suis chargé de faire les honneurs de ses cabinets.
– Ah diable ! fit Biard. Puis, se retournant de mon côté : Ce sera moins curieux, dit-il, mais n’importe, allons toujours.
Le domestique attendait ; nous lui fîmes un signe de tête et il marcha devant nous.
– Regardez-le marcher, me dit Biard, c’est déjà une curiosité.
En effet, le brave homme qui nous conduisait n’avait pas l’allure d’un homme, mais d’un oiseau, et l’oiseau auquel il paraissait avoir le plus particulièrement emprunté son allure, c’était la pie.
Nous traversâmes d’abord une cour carrée peuplée d’un chat et de deux ou trois cigognes. Le chat paraissait défiant, les cigognes, au contraire, immobiles sur leurs longues pattes rouges, semblaient pleines de confiance.
Pendant tout le temps qu’il traversa la cour, je ne remarquai rien d’extraordinaire dans la marche de notre guide, si ce n’est ce tournoiement de tête que j’ai indiqué, et une allure grave que lui donnait sa façon de mettre une jambe devant l’autre.
En effet, comme je l’ai dit, il marchait à la manière des pies, quand les pies marchent gravement.
Nous arrivâmes au jardin.
Le jardin est une espèce de petit jardin des plantes carré comme la cour, mais plus grand, avec une multitude de fleurs étiquetées et divisées en une quantité de plates-bandes séparées par des allées, de manière à ce qu’on puisse faire facilement la toilette de ces plates-bandes.
À peine dans le jardin, l’allure de notre guide changea.
De la marche grave il passa au sautillement.
À trois ou quatre pas de distance, il apercevait un insecte, une chenille, un coléoptère ; aussitôt, avec un mouvement de reins que rien ne peut rendre, il faisait à pieds joints deux ou trois petits sauts en avant, puis un saut de côté, retombait sur un pied, se penchait du même coup, pinçait l’animal, sans jamais le manquer, entre le pouce et l’index, le jetait dans l’allée et retombait dessus avec le pied qu’il tenait en l’air, de toute la pesanteur de son corps.
De cette façon, il n’y avait pas une seconde perdue entre la découverte, l’arrestation et le supplice de l’animal.
L’exécution terminée, il se retrouvait, par un petit saut de côté, dans la même allée que nous.
Puis, à la première vue d’un animal quelconque, il recommençait la même opération ; mais cela, je le répète, si rapidement que nous pouvions, sans nous arrêter, continuer notre route vers un pavillon qui paraissait le numéro premier de l’exposition.
La porte était toute grande ouverte.
Le pavillon, de forme carrée, était plein de casiers.
À la première vue, il me sembla que ces casiers étaient pleins de graines. Je me crus chez quelque savant horticulteur, et je m’attendais à voir d’intéressantes variétés de pois, de haricots, de lentilles et de vesces ; mais, en m’approchant et en regardant avec attention, je m’aperçus que ce que je prenais pour des légumes secs, c’étaient tout simplement des yeux d’oiseaux : yeux d’aigles, yeux de vautours, yeux de perroquets, yeux de faucons, yeux de corbeaux, yeux de pies, yeux de sansonnets, yeux de merles, yeux de pinsons, yeux de moineaux, yeux de mésanges, yeux de toute espèce enfin.
On eût dit du plomb de toutes les dimensions, depuis les balles de douze à la livre, jusqu’à la plus fine cendrée.
Grâce à une préparation chimique, inventée sans doute par le propriétaire de l’établissement, tous ces yeux avaient conservé leur couleur, leur solidité, et je dirai presque leur expression.
Seulement, tirés de leurs orbites et privés de leurs paupières, ces yeux avaient pris une expression féroce et menaçante.
Au-dessus de chaque casier, une étiquette indiquait à quel volatile ces yeux appartenaient.
Oh ! Coppélius ! docteur Coppélius ! fantastique enfant d’Hoffmann, vous qui demandiez toujours des youx, de beaux youx, si vous étiez venu à Bruxelles, comme vous eussiez trouvé là ce que vous cherchiez avec tant de persévérance pour votre fille Olympia.
– Messieurs, nous dit notre guide lorsqu’il crut que nous avions suffisamment examiné cette première collection, voulez-vous passer dans la galerie des corbeaux ?
Nous nous inclinâmes en signe d’assentiment, et nous suivîmes notre guide, qui nous introduisit dans la galerie des corbeaux.
Jamais galerie n’a mieux justifié son titre. Imaginez-vous un long corridor, large de dix pieds, haut de douze, éclairé par des fenêtres donnant sur un jardin, et entièrement tapissé de corbeaux cloués sur le dos avec les ailes étendues, les pattes et le cou tirés.
Ces corbeaux formaient le long de la muraille les rosaces les plus fantastiques, les dessins les plus extravagants.
Les uns tombant en poussière, les autres à tous les degrés de putréfaction ; les autres frais, les autres enfin s’agitant et criant.
Il pouvait y en avoir huit ou dix mille.
Je me retournai vers Biard, plein de reconnaissance pour lui : en effet, je n’avais jamais rien vu de pareil.
– Et, demandai-je au domestique, c’est votre maître qui se donne la peine de tracer sur la muraille toutes ces figures cabalistiques ?
– Oh ! oui, monsieur, personne ne touche que lui à ses corbeaux. Ah bien ! il serait content si l’on y mettait la main.
– Mais il a donc par toute la Belgique des fournisseurs de corbeaux.
– Non, monsieur, il les prend lui-même.
– Comment ! il les prend lui-même ? et où cela ?
– Là, sur le toit.
Et il me montra un toit, sur lequel je voyais en effet une espèce de mécanique dont je ne pouvais distinguer les ingénieux détails.
Je suis grand chasseur aux oiseaux, quoique je ne pousse pas l’amour de l’ornithologie jusqu’à la rage comme le faisait notre digne Bruxellois. J’ai fort pratiqué, dans ma jeunesse, la pipée et la marette ; ce détail commençait donc à m’intéresser.
– Mais, dis-je au domestique, voyons : dites-moi un peu comment s’y prend votre maître. Le corbeau est un des oiseaux les plus fins, les plus subtils, les plus rusés, les plus défiants qui existent au monde.
– Oui, monsieur, contre les vieux moyens, contre le fusil, contre la noix vomique, contre le cornet englué ; mais pas à l’endroit de la basse.
– Comment ! pas à l’endroit de la basse ?
– Sans doute, monsieur ; le corbeau peut se défier d’un homme qui tient un fusil, et même d’un homme qui ne tient rien ; mais comment voulez-vous qu’il se défie d’un homme qui joue de la basse.
– Ainsi, votre maître, comme Orphée, attire les corbeaux en jouant de la basse ?
– Je ne dis pas cela précisément.
– Que dites-vous donc ?
– Tenez, je vais vous expliquer la chose ; mon maître a un traître.
– Un traître !
– Oui, un corbeau apprivoisé. Tenez, ce vieux gueux qui se promène là dans le jardin.
Et il nous montra un corbeau qui sautillait dans les allées. C’était un corbeau à mantelet, presque blanc de vieillesse.
– Il se lève à quatre heures du matin.
– Le corbeau ?
– Non, mon maître. Ah, oui ! le corbeau ; est-ce qu’il dort, lui : le jour comme la nuit il a les yeux toujours ouverts. Il rumine le mal. Moi, je crois que ce n’est pas un vrai corbeau, mais un démon. Mon maître se lève donc à quatre heures du matin, avant le jour ; il descend en robe de chambre ; il met son vieux gueux de corbeau au milieu du filet que vous voyez là-haut sur le toit, à l’autre bout du jardin ; il attache à son pied la ficelle, qui correspond au filet ; il prend sa basse, il se met à jouer : Une fièvre brûlante ; son corbeau crie ; les corbeaux de Sainte-Gudule entendent cela, ils descendent, ils voient un camarade qui mange du fromage blanc, un monsieur qui joue de la basse. Ils ne se doutent de rien vous comprenez, ces animaux. Ils descendent auprès du traître, plus il en descend plus mon maître fait avec son archet ron-ron-ron. Puis tout à coup, zing ! il tire le pied, crac ! le filet se ferme, et les imbéciles sont pris. Voilà.
– Et votre maître alors les cloue ?
– Oh ! mon maître, alors, voyez-vous, ce n’est plus un homme, c’est un tigre. Il lâche sa basse, il détache sa ficelle, court au mur, grimpe à l’échelle, prend les corbeaux, saute à terre, met des clous plein sa bouche, empoigne un marteau et pan ! pan ! voilà un corbeau crucifié ; il a beau faire coua ! coua ! Ah bien ! oui, ça l’excite, mon maître. D’ailleurs, vous voyez bien.
– Et il y a longtemps que cette maladie-là a pris votre maître ?
– Oh ! monsieur, voilà dix ans ! c’est sa vie, cet homme. S’il était trois jours sans prendre de corbeaux, il en tomberait malade ; s’il était huit jours, il en mourrait. Maintenant, voulez-vous voir la galerie des mésanges ?
– Volontiers.
Cette tenture de cadavres emplumés, cet air tout imprégné de miasmes d’une fétidité sèche, ces mouvements convulsifs et les cris des corbeaux agonisants, tout cela me soulevait le coeur.
Nous traversâmes le jardin à nouveau, et c’est alors, en regardant le corbeau à mantelet d’un oeil et notre domestique de l’autre, que je m’aperçus de la similitude de leurs mouvements dans la recherche et la punition des insectes. Il était évident que le corbeau avait copié le domestique ou le domestique imité le corbeau.
Quant à moi, comme de notoriété publique le corbeau avait cent vingt ans, et que le domestique n’en avait que quarante, je soupçonne le domestique d’être le plagiaire.
Nous arrivâmes à la galerie des mésanges : c’était un petit pavillon placé à l’autre angle du jardin, tout tapissé d’ailes et de têtes de moineaux francs, brodé d’ailes, de têtes et de queues de mésanges.
Figurez-vous une grande tenture grise avec des dessins jaunes et bleus.
Ces dessins représentaient des roues, des rosaces, des étoiles, des arabesques, enfin toutes les fantaisies que peut dessiner, avec des corps, des pattes et des becs d’oiseaux, une imagination malade.
Dans les intervalles des dessins, il y avait des têtes de chats appliquées à la muraille, la gueule ouverte, la face ridée, les yeux étincelants ; ces têtes de chats surmontaient des pattes de chats croisées comme ces os dont le funèbre ornement accompagne d’ordinaire les têtes de mort.
Ces têtes étaient surmontées elles-mêmes de légendes conçues en ces termes :
Misouf, condamné à la peine de mort, le 10 janvier 1846, pour avoir endommagé deux chardonnerets et une mésange.
Le Docteur, condamné à la peine de mort, le 7 juillet 1847, pour avoir dérobé une saucisse sur le gril.
Blucher, condamné à la peine de mort, le 10 juin 1848 pour avoir bu à même d’une jatte de lait réservée pour mon déjeuner.
– Ah ! ah ! fis-je, il paraît que votre maître, comme nos anciens seigneurs féodaux, s’est arrogé le droit de justice basse et haute.
– Oui, monsieur, comme vous voyez ; et il en use sans appel. Il dit que si chacun faisait comme lui et détruisait les pillards, les voleurs et les assassins, il ne resterait bientôt plus sur la terre que les animaux doux et bienfaisants, et qu’alors les hommes, n’ayant que de bons exemples, en deviendraient meilleurs.
Je m’inclinai devant cet axiome : je respecte les collectionneurs sans les comprendre. J’ai visité à Gand un amateur qui faisait collection de boutons ; eh bien ! la chose paraissait ridicule au premier abord et finissait par devenir intéressante ; il avait divisé ses boutons par séries depuis le IXe siècle jusqu’à nous. La collection commençait à un bouton de la robe de Charlemagne et finissait par un bouton de l’uniforme de Napoléon ; il y avait des boutons de tous les régiments qui avaient existé en France, depuis les francs-archers de Charles VII, jusqu’aux tirailleurs de Vincennes ; il en avait en bois, en plomb, en cuivre, en zinc, en argent, en or, en rubis, en émeraudes et en diamants ; la collection, valeur matérielle, était estimée 100 000 francs ; elle lui avait coûté 300 000 francs peut-être.
J’ai connu à Londres un Anglais qui faisait collection des cordes de pendus. Il avait voyagé dans une portion du globe et dans l’autre ; il avait des correspondants ; par lui et par ses correspondants, il s’était mis en relation avec les bourreaux des quatre parties du monde. Aussitôt un homme pendu en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique, l’exécuteur coupait un bout de la corde, et envoyait cela avec un brevet d’authenticité à notre collectionneur, lequel en échange lui retournait le prix de son envoi ; il y avait une de ces cordes qui lui avait coûté cent livres sterling ; il est vrai qu’elle avait eu l’honneur d’étrangler Sélim III, étranglement auquel, comme chacun le sait, la politique anglaise n’avait pas été totalement étrangère.
Je venais de copier l’épitaphe de maître Blucher, le buveur de lait, lorsque la demie après neuf heures sonna à Sainte-Gudule ; nous n’avions plus qu’une demi-heure pour gagner le chemin de fer d’Anvers ; je joignis mon offrande à celle qu’avait déjà donnée Biard en entrant, et nous sortîmes tout courant de cette nécropolis.
Notre guide, plein de reconnaissance, nous accompagna en sautillant jusqu’à la porte, et nous suivit des yeux, tout en se tordant le cou, jusqu’à l’angle de la rue.
Nous arrivâmes au débarcadère comme la machine jetait son cri de départ.
II
Gaufres et cornichons
Nous arrivâmes à Anvers à onze heures. Pour ne pas manquer le bateau, qui partait à midi, nous allâmes déjeuner sur le quai en face du bateau même. À midi, nous étions installés à bord. À midi cinq minutes, nous partions, accompagnés d’une jolie petite pluie fine que je crois particulière à Anvers, attendu que je l’y ai constamment retrouvée à chacun des voyages que j’ai faits dans cette ville.
Biard n’était pas sans inquiétude sur la façon dont nous nous logerions à Rotterdam, à la Haye et à Amsterdam, une cérémonie comme celle à laquelle nous allions assister devant amener un grand concours de voyageurs.
Mais je suis homme de précaution. D’ailleurs, quelle est la ville où je ne connaisse pas quelqu’un ?
En 1840 je descendais le Rhône. Embarqué à Lyon à quatre heures du matin, je m’étais endormi vers onze heures ou midi, sur le pont, à l’ombre de la tente, doucement caressé par cette brise fraîche qui court à la surface des fleuves.
C’était une si douce chose que ce sommeil, que, deux ou trois fois éveillé à moitié par un accident quelconque, je n’avais pas voulu rouvrir les yeux de peur de m’éveiller tout à fait. J’étais donc resté immobile, la raison suspendue au-dessus de ce vague qui accompagne le crépuscule du sommeil, quand, tiré de ma béate rêverie par une troisième ou quatrième secousse, je sentis pénétrer pour ainsi dire, dans le demi-jour de mon cerveau, quelques mots prononcés en français par des voix de femmes, teintés d’un léger accent anglais.
Je rouvris tout doucement les yeux, et, regardant avec précaution autour de moi, je distinguai, entre mes paupières closes aux trois quarts, un groupe composé de deux jeunes femmes de dix-huit à vingt ans, d’un jeune homme de vingt-six à vingt-huit, et d’un homme de trente-quatre à trente-six.
Les deux femmes étaient charmantes, non seulement de leur propre beauté, mais encore de cette grâce naïve et presque nonchalante toute particulière aux Anglaises.
Les deux hommes étaient remarquables de distinction.
Il y avait discussion dans le groupe.
La discussion roulait sur l’itinéraire à suivre : descendrait-on à Avignon, pousserait-on jusqu’à Arles ?
C’était fort grave et surtout fort embarrassant pour des étrangers qui n’avaient d’autre guide que Richard.
– Il faudrait, hasarda une des deux femmes, que quelqu’un qui eût fait le voyage par Arles et par Avignon voulût bien nous renseigner.
Ce souhait semblait envoyé à mon adresse. J’avais fait trois ou quatre fois la route de Lyon à Marseille par le Rhône et par chacune de ces deux villes. Je pensai que le moment était venu de me présenter, et que le service que j’allais rendre à la société voyageuse me ferait pardonner ma hardiesse.
Je rouvris les yeux tout à fait, et, m’inclinant à moitié :
– Si ces messieurs veulent permettre à l’auteur des Impressions de voyage de les éclairer sur cette grave question, interrompis-je, je dirai à ces dames que mieux vaut aller par Arles que par Avignon.
Les deux jeunes femmes rougirent ; les deux hommes se retournèrent de mon côté avec le sourire de la courtoisie sur les lèvres. Il était évident qu’ils me connaissaient avant que je ne leur parlasse, et que pendant mon sommeil on leur avait dit qui j’étais.
– Et pourquoi cela, s’il vous plaît ? me demanda l’aîné des deux voyageurs.
– D’abord, parce qu’en passant par Arles, vous verrez Arles, qui vaut bien la peine d’être vue. Puis, d’Arles à Marseille, vous aurez un chemin sans poussière et extrêmement curieux, en ce qu’il longe d’un côté la Camargue, c’est-à-dire l’ancien camp de Marins, et de l’autre la Crau.
– Mais il faut que nous soyons à Marseille après-demain.
– Nous y serons.
– Nous partons par le bateau de Livourne.
– Je pars par le même bateau.
– Nous voulons être à Florence pour la Saint-Jean.
– J’y suis attendu pour cette époque.
– Comment irons-nous d’Arles à Marseille ?
– J’ai ma calèche sur le bateau. Nous sommes cinq, on y tient six ; nous prendrons des chevaux de poste. Nous irons en pique-nique, et tout le long de la route, je serai votre cicérone.
Nos deux voyageurs se retournèrent vers les deux jeunes femmes, qui firent de la tête un signe presque imperceptible ; la chose était décidée.
On en était encore à la lune de miel dans le double ménage, et, pendant la lune de miel, la femme, on le sait, a l’initiative de la décision.
Nous fîmes un charmant voyage. À Arles, nous visitâmes les Arènes et achetâmes des saucissons. À Marseille, nous fûmes reçus par Méry et mangeâmes chez Courty. Enfin à Florence, nous vîmes les courses de chars chez monsieur Finzi et les illuminations de l’Arno chez le prince de Corsini.
Enfin, il fallut nous quitter. Je restais à Florence, et mes compagnons de voyage devaient parcourir toute l’Italie. Nous nous fîmes force promesses de nous revoir. Nous échangeâmes nos adresses dans le cas où ces messieurs viendraient à Paris, et où j’irais en Hollande.
De la part des voyageurs, les cartes étaient : l’une, celle de monsieur Jacobson à Rotterdam, l’autre, celle de monsieur Wittering à Amsterdam.
Contre les habitudes de ces sortes de promesses, elles furent tenues, plus que tenues, même, car monsieur Jacobson, de voyageur s’est fait mon ami, et, dans une circonstance, m’a rendu un service que beaucoup d’amis ne rendraient pas.
Au moment de partir pour la Hollande, j’avais donc écrit d’avance à monsieur Jacobson, à Rotterdam, lui annonçant mon arrivée.
Ce qui m’assurait une hospitalité royale, d’abord chez lui, ensuite chez monsieur Wittering.
En effet, monsieur Jacobson est non seulement un voyageur plein d’esprit, un banquier plein d’honneur, mais encore c’est un coeur tout artiste.
Nos plus charmants tableaux de Decamps, de Dupré, de Rousseau, de Scheffer, de Diaz, que nous voyons partir pour la Hollande, c’est lui qui nous les enlève : aussi à peine eus-je prononcé son nom, que Biard fut rassuré.
Quant à la Haye, huit jours auparavant Jacquand devait y être arrivé, avec son tableau de Guillaume le Taciturne vendant sa vaisselle à des Juifs, pour soutenir la guerre de l’indépendance.
Il avait dû me retenir une chambre à l’hôtel de la Cour-Impériale.
Nous pouvions donc nous laisser aller tranquillement au cours de l’Escaut, et, pendant les rares instants où le vent et la pluie nous permettaient de monter sur le pont, jeter un coup d’oeil sur les Paul Potter, les Hobbema, et les Van de Velde que nous côtoyions.
Nous traversâmes Dordrecht à travers une forêt de moulins près desquels les moulins de Puerto-Lapice ne sont que des pygmées. À Dordrecht, tout le monde a son moulin ; il y en a au bord de l’eau, il y en a dans les jardins, il y en a sur les maisons, il y en a de petits, il y en a de grands, il y en a de gigantesques, il y en a pour les enfants, pour les hommes, pour les vieillards ; tous ont la même forme, mais chacun peint son moulin à sa fantaisie ; il y en a de gris avec des ourlets blancs qui ont l’air de veuves en demi-deuil, il y en a de carmélites avec des ourlets noirs qui ont l’air de capucins désolés, il y en a de blancs avec des ourlets bleus qui ont l’air de pierrots en goguette. Rien de plus original que ces grands corps immobiles, rien de plus fantastique que toutes ces grandes ailes qui tournent. À côté de ces moulins, à leur ombre, pour ainsi dire, de petites maisons rouges à persiennes vertes, propres, époussetées, charmantes, apparaissant derrière des allées d’arbres à la chevelure frisée, aux tiges peintes à la chaux, et tout cela passant avec la rapidité de deux cent vingt chevaux : c’est un charmant panorama.
En approchant de Rotterdam les bâtiments foisonnent à leur tour : les navires glissant sur l’eau font concurrence aux moulins immobiles sur le sol. Il y en a aussi de toute grandeur, des trois-mâts, des bricks, des sloops, des chasse-marée ; il y en a surtout qui ont un aspect tout particulier, avec leur grande voile écrue et leur petite voile azurée au haut du mat ; on dirait d’immenses pains de sucre encore enveloppés de leur papier gris et bleu et que l’on a mis fondre dans le fleuve ; et je dis fondre, parce qu’au fur et à mesure qu’ils s’éloignent ils ont l’air de s’enfoncer dans l’eau. Tout cela est vivant, actif, marchand, on sent qu’on s’approche de cette vieille Hollande, qui n’est qu’un immense port, et qui essaimait tous les ans dix mille vaisseaux.
À huit heures du soir, le bateau stoppa devant le quai de Rotterdam. À peine une communication fut-elle établie entre le paquebot et la terre, que j’entendis prononcer mon nom ; c’était un commis de Jacobson m’annonçant que son patron était parti le jour même pour Amsterdam, où j’étais attendu avec impatience par son beau-frère Wittering, chez lequel était déjà depuis la veille installé Gudin.
Encore une bonne nouvelle ! Gudin venait comme moi et comme Biard pour assister au couronnement ; c’était non seulement un ami, mais encore un confrère. Gudin est pour le moins aussi poète que peintre ; rappelez-vous le naufragé n’ayant plus qu’un mât pour se soutenir et qu’une étoile pour se guider.
Nous sautâmes à terre ; il n’y avait pas de temps à perdre, le chemin de fer partait à neuf heures pour la Haye, il était huit heures et demie ; nous traversâmes toute la ville avec cet air affairé qui n’appartient qu’aux gens qui courent après les locomotives.
Comme à Bruxelles, nous arrivâmes à temps.
Trois quarts d’heures après, nous heurtions une folle kermesse, pleine de bruit, de danses, de cris, de sons d’instruments, de baraques foraines, de boutiques de marchands de gaufres et d’échoppes de détailleurs de cornichons.
Les détailleurs de cornichons et les marchands de gaufres sont les deux spécialités industrielles qui méritent la peine d’être consignées ici, attendu que l’équivalent de ces deux spéculations nous manque complètement en France.
En Hollande, on se grise avec des cornichons et des oeufs durs, et l’on se dégrise avec des gaufres et du punch.
Celui qui veut se mettre en goguette s’arrête tout simplement devant l’échoppe d’un détailleur de fruits au vinaigre, il dépose cinq sous sur une des tablettes, prend une fourchette de la main droite et un oeuf dur de la main gauche.
Puis il pique avec la fourchette dans un grand baquet où nagent comme des poissons rouges des portions de concombres de la grosseur d’un cornichon ordinaire.
Il en tire une de ces portions qu’il dévore, et sur laquelle il applique immédiatement un oeuf dur.
Et il alterne ainsi tant que son estomac ne crie pas assez ; tant mieux pour ceux dont la capacité gastrique est double, triple, quadruple : il ne leur en coûte pas plus cher qu’aux autres.
C’est cinq sous pour tout le monde.
Les médecins de tous les pays ont fait des remarques scientifiques et morales sur les différentes ivresses : ivresse d’eau-de-vie, ivresse de vin, ivresse de bière, ivresse de gin, tout a été étudié.
Il n’y a que l’ivresse de cornichons sur laquelle je crois qu’il n’a encore été fait aucun rapport.
Je vais essayer de combler la lacune.
À peine le Hollandais est-il ivre de cornichons, qu’il éprouve le besoin de faire des folies.
Il s’approche en conséquence des boutiques des marchandes de gaufres.
Ces boutiques méritent une description toute particulière.
C’est un carré long dont voici le plan :
Quatre femmes tiennent ordinairement ces boutiques, deux d’âge incertain, deux jeunes et jolies.
Toutes quatre portent le costume frison.
Le costume frison consiste dans un casaquin plus ou moins élégant, dans une robe plus ou moins élégante. Ce n’est pas là que gîte son originalité.
Son originalité consiste dans une double calotte de cuivre doré, qui, de chaque côté, enserre les tempes. Deux petits ornements d’or se dressent à l’extrémité extérieure de chaque sourcil : on dirait deux petits chenets.
Sur ces plaques de cuivre, on incruste d’ordinaire deux ou trois boucles de faux cheveux.
Sur le tout, on monte un bonnet à barbes.
Eh bien ! en général, cet assemblage étrange de cuivre qui donne à la tête l’aspect d’un crâne doré, de cheveux poussant sur du cuivre, et de dentelles éteignant les lumières trop vives sur toutes les parties qu’elles recouvrent, fait un ensemble très agréable à voir.
Ces dames font le métier que font les almées en Égypte, et les bayadères dans l’Inde, excepté qu’elles ne dansent ni ne chantent.
Les deux femmes d’un âge raisonnable se tiennent, l’une sur le fauteuil qui est à la porte, l’autre sur le fauteuil qui est derrière le comptoir.
Elles y sont incrustées.
Celle qui est à la porte fait les gaufres.
Celle qui est au comptoir sert le punch.
Les deux jeunes filles font... c’est assez difficile de dire ce qu’elles font, surtout après avoir dit ce qu’elles ne font pas.
Elles reconnaissent à la première vue les gens ivres de cornichons et leur font des signes.
Quand les signes ne suffisent pas, elles sortent de la boutique et vont les chercher.
Une fois entré dans la boutique, le consommateur disparaît dans un des cabinets particuliers.
Une Frisonne le suit.
Puis une assiette de gaufres et un demi-bol de punch y sont introduits.
Puis les rideaux, qui interceptent aux passants et aux habitants de la boutique l’intérieur des cabinets, retombent avec une naïveté toute hollandaise.
Un quart d’heure après, l’homme sort complètement dégrisé.
Voilà ce que nous vîmes le 10 mai au soir, vingt-quatre heures juste après avoir quitté Paris.
Nous avons fait, grâce à tous les tours et à tous les détours de l’Escaut, cent soixante lieues pendant ces vingt-quatre heures.





























