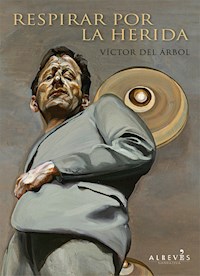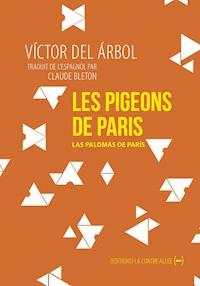
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
De la petite à la grande Histoire.
Dans un village isolé d’Espagne, Juan attend sur le pas de sa porte celles et ceux qui viennent pour exproprier le vieil homme de là où il a vécu et grandi. Ils sont jeunes et ambitieux, pressés de faire table rase du passé. Ce sont les enfants de Clio fille d’émigrés à Paris revenus au village le temps d’un été durant l’enfance de Juan. C’était alors les années 60, Clio rencontrait Juan, lui apprenait à lire et lui faisait découvrir un monde vaste et diversfié. Elle incarnait la promesse d’un avenir meilleur…
La destinée de deux Espagnols reflète celle de l'Europe d'après-guerre, avec son lot de désillusions.
EXTRAIT
Les épaules nues, adossé à la façade en pierre, il attend. Il a posé son transistor allumé sur le rebord de la fenêtre, et il puise dans un sachet des graines de tournesol qu’il décortique comme un perroquet. Il paraît que nous sommes l’Europe. Une histoire centenaire. Juan s’en moque de cette joie, de la Neuvième de Beethoven qu’on repasse à toute heure, des discours des politiciens. Elle arrive trop tard, l’Europe. Lui, il est plus vieux que tout ça –
Juanito, tu es presque devenu une tombe – et il se demande, sans trop forcer, juste pour tuer le temps de l’attente, si l’Europe arrivera jusqu’ici. La terre sourit sous le soleil, les cigales s’éclatent, les bourdons survolent le ruisseau, les pierres s’agitent avec inquiétude et les bras d’herbe sèche sont bercés par un vent qui les grille au lieu de les soulager.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Victor del Árbol […] noue les fils de ce récit simple et efficace avec une grande finesse. -
Jacques Josse, remue.net
Victor Del Árbol, que l'on connaît pour ses romans policiers, délivre ici un texte d'une grande beauté, d'une sincérité incroyable, qui laissera le lecteur franchement ému en refermant cette nouvelle - courte, certes, mais la vie ne l'est-elle pas aussi ? -
Librairie Le Bateau livre
À PROPOS DES AUTEURS
Victor Del Árbol
est né à Barcelone en 1968. Après avoir étudié l'Histoire, il travaille dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne. Son premier roman
La maison des chagrins publié en 2006 a reçu le prix Tiflos. C’est toutefois la parution en 2011 de
La Tristesse du Samouraï, traduit en une douzaine de langues et best-seller en France, qui lui apporte la notoriété.
Claude Bleton
a été enseignant d’espagnol, puis directeur de la collection « Lettres hispaniques » chez Actes Sud entre 1986 et 1997 et directeur du Collège International des Traducteurs Littéraires (Arles) de 1998 à 2005. Il a traduit environ 150 titres et a publié en tant qu’auteur
Les Nègres du traducteur (Métailié, 2004),
Vous toucher (Le Bec en l’air, 2007),
Broussaille (Éditions du Rocher, 2008).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 57
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Pigeons de Paris
© ( Éditions ) La Contre Allée, 2016, pour l’édition française.Collection Fictions d’Europe.
VÍCTOR DEL ÁRBOL
LES PIGEONS DE PARIS
Traduit de l’espagnolpar Claude Bleton
La collection « Fictions d’Europe » est née d’ une rencontre entre la maison d’édition La Contre Allée et la Maison européenne des sciences de l’homme et de la société. Désireuses de réfléchir ensemble au devenir de l’Europe, La Contre Allée et la MESHS proposent des récits de fiction et de prospective sur les fondations et refondations européennes.
Martine Benoit,directrice de la MESHS.
Juan – Juanito, comme l’appelaient autrefois les voix du village qui n’existent plus – attend. Assis sur la vieille chaise en bois d’un bleu décoloré, un peu bancale – la chaise –, et un peu aveugle – lui. Il a ôté son t-shirt parce que la chaleur est forte. Il ne se soucie pas des mouches qui agacent et butinent le crin de sa toison grise, sur sa poitrine. Les gouttes de sueur perlent lourdement sur son nez aux ancêtres arabes, restent en suspens un instant et glissent sur sa lèvre supérieure. Il les récupère au bout de la langue, sent l’âpreté de sa peau non rasée. Elles sont salées – les gouttes.
Il attend qu’ils arrivent. Il connaît ce sentier poussiéreux depuis toujours. C’est le seul accès possible à sa vieille maison, le chemin qui mène à la géographie de son enfance, quand il y avait d’autres gamins dans le village et qu’on les entendait jouer, barboter dans la fontaine ou martyriser le vieux chien de berger de son grand-père. Cette pauvre bête supportait tout, une vraie vocation de martyr. Juan avait voulu sauver le chien, le jour où les voyous du village voisin lui avaient passé la corde au cou pour le pendre au chêne. Juan, Juanito, était arrivé trop tard – il était toujours arrivé trop tard pour sauver les autres – ; l’animal tirait la langue, et ses pattes arrière effleuraient presque le sol qui aurait pu le sauver. Il ne put que l’enterrer. Il ne sait plus où se trouve cette tombe qu’il avait creusée de ses propres mains. Il oublia de mettre une croix – les chiens n’ont-ils pas aussi une âme à sauver ? avait-il demandé au curé, et ce prêtre en soutane élimée lui avait flanqué une gifle qui lui laissa un sifflement désagréable dans l’oreille pendant des semaines – et maintenant trop de temps a passé pour espérer retrouver l’endroit et fixer au moins une petite plaque en bois, avec le nom du chien gravé au couteau. Il s’appelait Valiente. Il se souvient de ça. Comme d’autres choses.
Des nichons de Leonor, par exemple, la matrone qui l’avait élevé, parce que sa mère était morte en couches. Il paraît qu’il est impossible de se rappeler le premier lait qu’on a tété. Mais on n’en sait rien. Juan se rappelle la saveur chaude, le mamelon dur, le contact de ces seins délicats qu’il ne retrouva jamais chez aucune femme. Il scandalisait ses petites amies quand il se mettait à sucer leurs tétons, certaines riaient et le laissaient faire. Mais elles se lassaient vite et le quittaient. Leonor était morte, les mamelles à sec, pourtant une demi-douzaine d’enfants lui devaient la faveur d’être devenus des hommes sains. Son lait était le meilleur de ces terres arides, qui n’offrent que de la sueur, de la peine et des chagrins.
Les épaules nues, adossé à la façade en pierre, il attend. Il a posé son transistor allumé sur le rebord de la fenêtre, et il puise dans un sachet des graines de tournesol qu’il décortique comme un perroquet. Il paraît que nous sommes l’Europe. Une histoire centenaire. Juan s’en moque de cette joie, de la Neuvième de Beethoven qu’on repasse à toute heure, des discours des politiciens. Elle arrive trop tard, l’Europe. Lui, il est plus vieux que tout ça – Juanito, tu es presque devenu une tombe – et il se demande, sans trop forcer, juste pour tuer le temps de l’attente, si l’Europe arrivera jusqu’ici. La terre sourit sous le soleil, les cigales s’éclatent, les bourdons survolent le ruisseau, les pierres s’agitent avec inquiétude et les bras d’herbe sèche sont bercés par un vent qui les grille au lieu de les soulager.
Au mieux, les grues, les trains, les camions chargés de matériaux de construction reviendront. On remplacera peut-être la cloche de la vieille église, paraît-il, mais en réalité il s’en fiche un peu. Il ne le verra pas. Il ne le verra plus. Éternels mensonges travestis de vérités neuves. On lui a toujours enseigné la même chose : le pauvre reste pauvre jusqu’à sa mort.
Comme Valiente, ce vieux chien, Juan – Juanito – dresse l’oreille en reconnaissant un son étrange. Le bruit d’un moteur au loin. Ils vont arriver.
Ils sont là.
Je vous attends depuis un bout de temps ; je savais que tôt ou tard, vous trouveriez ce chemin, que je ne pourrais rester éternellement au bord de l’oubli, même si je voulais me rendre le plus invisible possible. Tout a une fin, nous le savons depuis le début. Et maintenant que vous m’avez trouvé, je comprends votre déception. Comptiez-vous me trouver plus vivant ? Mes cheveux dans les oreilles, mes chairs tombantes, ma bouche abîmée, tout en moi vous fait peur, dans cette vieille ruine, n’est-ce pas ? Les jeunes redoutent le reflet de la décrépitude plus que tout. Mais n’ayez pas peur, la vieillesse – comme la folie – n’est pas contagieuse.
Vous ne voulez pas entrer, vous mettre à l’ombre et prendre un petit verre de vin ? C’est un vin qui râpe, mais il est de race, dès sa naissance, il colle à ces terres arides et authentiques. Je peux vous mettre un disque de Marchena… Plus personne ne sait qui est Marchena. Laissez-moi au moins enfiler ma chemise du dimanche ; j’ai passé des jours à en recoudre les boutons, à en frotter le col usé. Vu les circonstances, je mérite de m’habiller en blanc. Même si vous venez pour m’emmener à mon enterrement.
Me voilà prêt pour la cérémonie. Et maintenant, j’ai droit à quel baratin ?
Vous ne dites rien ?