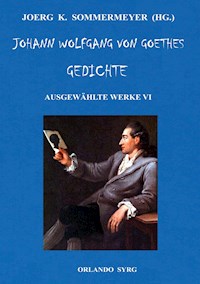Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La première lettre est datée du 4 mai 1771. Werther est un jeune homme qui s'installe à W, pour peut-être faire carrière. Là, il se promène dans la nature pour la dessiner, car il se croit artiste. Un jour, il est invité à un bal au cours duquel il rencontre une jeune femme prénommée Charlotte, fille d'un bailli, qui depuis la mort de sa mère, s'occupe de ses frères et de ses soeurs. Werther sait depuis le début que Charlotte est fiancée à Albert. Cependant, Werther tombe immédiatement amoureux de la jeune fille qui partage avec lui les goûts de sa génération, en particulier pour la poésie enthousiaste et sensible de Klopstock.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Préface
Considérations sur Werther et en général sur la poésie de notre époque
Chapitre I
Chapitre II
Au lecteur
Werther
4 mai 1771
10 mai
12 mai
13 mai
15 mai
17 mai
22 mai
26 mai
27 mai
30 mai
16 juin
19 juin
21 juin
29 juin
1 er juillet
6 juillet
8 juillet
10 juillet
11 juillet
15 juillet
16 juillet
18 juillet
19 juillet
20 juillet
24 juillet
26 juillet
26 juillet
30 juillet
8 août
Le même jour au soir
10 août
12 août
15 août
18 août
21 août
22 août
28 août
30 août
5 septembre
10 septembre
20 octobre
10 novembre
24 décembre
8 janvier 1772
20 janvier
8 février
17 février
20 février
15 mars
16 mars
24 mars
19 avril
5 mai
9 mai
25 mai
11 juin
16 juillet
18 juillet
29 juillet
4 août
21 août
5 septembre
4 septembre
5 septembre
6 septembre
11 septembre
15 septembre
10 octobre
12 octobre
19 octobre
26 octobre
27 octobre
Le soir
30 octobre
3 novembre
8 novembre
15 novembre
21 novembre
22 novembre
24 novembre
26 novembre
30 novembre
1 er décembre
4 décembre
6 décembre
L’éditeur au lecteur
12 décembre
14 décembre
20 décembre
Après onze heures
Préface
C’est une chose infiniment précieuse que le livre d’un homme de génie traduit dans une autre langue par un autre homme de génie. Que ne donnerait-on pas pour lire tous les chefs-d’œuvre étrangers traduits ainsi ! C’est lorsque de grands écrivains ne dédaigneront pas une si noble tâche, que nous posséderons véritablement l’esprit des maîtres, et que nous participerons au génie des autres nations.
C'est que, pour traduire une œuvre capitale, il faut la juger, la sentir profondément. Pour le faire d'une manière complète, il faudrait presque être l'égal de celui qui l'a créée. Quelle idée pouvons-nous donc nous former de Shakespeare, de Dante, de Byron ou de Goethe, si leurs ouvrages nous sont expliqués par des écoliers ou des manœuvres ?
Plusieurs traductions de WERTHER nous avaient passé sous les yeux, et ce livre sublime nous était tombé des mains. Avec grand effort de conscience, et en nous condamnant, pour ainsi dire, à reprendre cette lecture à bâtons rompus, nous avions réussi à nous faire l'idée de cette pure conception et de ce plan admirable ; mais la force, la clarté, la rapidité et la chaude couleur du style nous échappaient absolument. Nous disions avec les autres : C'est peut-être beau en allemand ; mais la beauté du style germanique est apparemment intraduisible, et ce mélange d'emphase obscure ou de puérile naïveté choque notre goût et rebuté l'exigence de notre logique française. Nous sommes donc bien heureux qu'une grande intelligence ait pu consacrer quelque loisir de jeunesse à écrire WERTHER en bon et beau français ; car nous lui devons une des plus grandes jouissances de notre esprit.
En effet, nous le savons maintenant, WERTHER est un chef-d’œuvre, et là, comme partout, Goethe est aussi grand comme écrivain que comme penseur. Quelle netteté, quel mouvement, quelle chaleur dans son expression ! Comme il peint à grands traits, comme il raconte avec feu ! Comme il est clair, surtout, lui h qui nous nous étions avisés de reprocher d'être diffus, vague et inintelligible ! Grâce à Dieu, depuis quelques années, nous avons enfin des traductions très-soignées de ses principaux ouvrages, et le WERTHER particulièrement est désormais aussi attachant à la lecture, dans notre langue, que si Goethe l'eut écrit lui-même en français.
La préface de M. Leroux est un morceau d’une trop grande importance philosophique, les questions de fond y sont traitées d’une manière trop complète, pour que nous puissions rien ajouter à son jugement sur la littérature du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. Nous nous bornerons à exprimer brièvement notre admiration personnelle pour le roman de WERTHER, en tant qu’œuvre d’art, et en tant que forme.
Il n’appartenait qu’à un génie du premier ordre d’exciter et de satisfaire tant d’intérêt dans un roman qu’on lit en deux heures, et qui laisse une impression de toute la vie. C’est bien là la touche puissante d’un grand artiste, et quel que soit le jugement porté par chaque lecteur sur le personnage de Werther, sur l’injustice de sa révolte contre la destinée, ou sur la douloureuse fatalité qui pèse sur lui, il n’en est pas moins certain que chaque lecteur est vaincu, terrifié et comme brisé avec lui en dévorant ces sombres pages d’une réalité si frappante et d’une si tragique poésie. Est-ce un roman, est-ce un poème ? On n’en sait rien, tant cela ressemble à une histoire véritable ; tant l’élévation fougueuse des pensées se mêle, se lie, et semble ressortir nécessairement du symbole de la narration naïve et presque trop vraisemblable. Avec quel soin, quel art et quelle facilité apparente cette tragédie domestique est composée dans toutes ses parties ! Comme ce type de Werther, cet esprit sublime et incomplet, est complètement tracé et soutenu sans défaillance d’un bout à l’autre de son monologue ! Cet homme droit et bon ne songe pas à se peindre, il ne pose jamais devant le confident qu’il s’est choisi, et cependant il ne lui parle jamais que de lui-même, ou plutôt de son amour. Il est plongé dans un égoïsme mâle et ingénu qu’on lui pardonne, parce qu’on sent la puissance de ce caractère qui s’ignore et qui succombe faute d’aliments lignes de lui ; parce que, d’ailleurs, ce n’est pas lui, c’est l’objet de son amour qu’il contemple en lui-même ; parce que ses violences et son délire sont l’inévitable résultat des grandes qualités et de l’immense amour comprimés dans son sein. Jamais figure ne fut moins fardée et plus saisissante. Il n’est pas une femme qui ne sente qu’en dépit de toute résistance intérieure et de toute vertu conjugale elle eût aimé Werther.
On a fait, dit-on, d’immenses progrès dans l’art de composer le drame depuis cinquante ans ; il est certain que cet art a bien changé, et qu’il y a déjà presque aussi loin de la forme de WERTHER à celle d’un roman moderne que de la forme d’un mélodrame de notre temps à celle d’une tragédie grecque. Mais est-ce réellement un progrès ? Cette action compliquée, que nous cherchons avidement dans les compositions nouvelles, ce besoin insatiable d’émotions factices, de situations embrouillées, d’événements imprévus, précipités, accumulés les uns sur les autres, par lesquels nous voulons, public éteint et gâté que nous sommes, être toujours tenu en haleine ; est-ce là véritablement de l’art, et l’intérêt naît-il réellement d’un si pénible travail ? Il nous le semble parfois à nous-mêmes, pendant que nous sommes occupés à débrouiller et à pressentir l’énigme savante que la lecture ou la représentation du drame moderne nous forcent à étudier. Mais cette prodigalité d’incidents, cette habileté de l’auteur à nous surprendre, à nous engager dans son labyrinthe pour nous en tirer à l’improviste par cette porte ou par cette autre, est-ce là la vraie, la bonne route ? Et, sans être ingrats envers les adroits ouvriers qui savent nous agacer, nous contenir, nous amuser et nous étonner ainsi, ne pouvons-nous pas dire que, sans un mot de tout cela, il y a plus que tout cela dans le petit drame à un seul personnage de WERTHER ? Il n’y a pourtant ni surprise ni ruse dans cette composition austère. Il n’y a qu’un seul coup de pistolet, un seul mort, et, dès la première page, on s’attend à la dernière. Le grand maître n’a songé ni à éprouver votre sagacité, ni à exciter votre impatience, ni à réveiller votre attention. Il vous présente tout d’abord un homme malheureux, qui ne peut se prendre à rien dans la société présente, qui n’est propre qu’à aimer, et qui va aimer tout de suite, passionnément, redoutablement, jusqu’à ce qu’il en meure. Est-ce donc parce que l’art est à l’état d’enfance à l’époque où le maître compose, qu’il vous livre si complaisamment la clef de son mystère ? Non, c’est qu’il sait qu’il a mis là un trésor, et que vous pouvez ouvrir en toute confiance, que vous y serez fasciné, et qu’en vous retirant vous ne vous plaindrez pas d’avoir été appelé par de vaines promesses.
En vérité, nous avons tant abusé de l’imprévu, que bientôt (si ce n’est déjà fait) l’imprévu deviendra impossible. Le lecteur s’exerce tous les jours à deviner l’issue des péripéties sans nombre où on l’enlace, comme il s’exerce à lire couramment les rébus que l’illustration a mis à la mode. Plus on lui en donne, plus vite il apprend à absorber cette nourriture excitante, qui ne le nourrit pas véritablement. Sa sympathie, disséminée sur un trop grand nombre de personnages, son émotion, trop vite épuisée dès les premiers événements, n’arrivent pas par la progression naturelle et nécessaire à se concentrer sur une figure principale, sur une situation dominante. L’art moderne en est là dans toutes ses branches, sous tous ses aspects. C’est une richesse sans choix, un luxe sans ordre, un essor sans mesure. La musique instrumentale et vocale, l’art du comédien et du chanteur sont arrivés, comme le reste, à cette prodigalité d’effets qui émousse tout d’abord le sens de l’auditoire et qui neutralise l’effet principal. Assistez à un drame lyrique : l’auteur du poème, le compositeur, le metteur en scène et les acteurs, sachant qu’ils ont affaire à un public Louis XIV, qui craint d’attendre, se hâtent, dès les premières scènes, de le saisir tout entier, et souvent ils y réussissent, parce que les talents et l’habileté ne leur manquent certainement pas. Mais c’est bien chose impossible que de s’emparer ainsi de l’homme tout entier pendant tout un soir. L’homme de ce temps-ci, surtout, vous l’avez rendu, à force d’art et à grands frais, tellement irritable et capricieux, que son esprit redoute quelques minutes de digestion comme un supplice intolérable. C’est que la place du cœur, vous avez développé la délicatesse de ses nerfs, et que vous avez mis toutes ses émotions dans ses yeux et dans ses oreilles. Son âme ne s’attache pas à votre sujet, parce que votre sujet n’a pas assez d’ensemble et d’homogénéité. Vous êtes bien forcé de le compliquer ainsi, puisque votre public veut désormais n’avoir pas une minute sans surprise et sans excitation. Ainsi l’acteur, d’accord avec son rôle, donne dès son entrée toute la mesure de sa force, toute l’étendue de ses facultés. Il enfle sa voix, il précipite ses gestes, il s’applique à des minuties de détail, il multiplie ses intentions, il fait des miracles de volonté. Lui aussi, il a la fièvre, ou il feint de l’avoir, pour entretenir la fièvre dans son auditoire. Mais que lui reste-t-il au bout d’une heure de cette puissance factice ? Épuisé, il ne peut plus arriver à la véritable émotion qui commanderait l’émotion à son public. On ne donne pas ce qu’on n’a plus. L’artiste dramatique, identifié forcément, d’ailleurs, avec le personnage qu’il représente, est bientôt contraint de retomber dans les mêmes effets déjà employés et de les forcer jusqu’à l’absurde. Ce n’est plus qu’un forcené à qui le souffle manque, qui crie et fausse s’il est à l’Opéra, qui se tord et grimace s’il est sur toute autre scène, qui râle et ne s’exprime plus que par points d’exclamation s’il est figuré seulement dans un livre. Non, non ! tout cela n’est pas l’art véritable, c’est l’art qui a fait fausse route ; nous le répétons, c’est un gaspillage de merveilleuses facultés, c’est une orgie de puissance dont l’abus est infiniment regrettable.
Mais quoi ? faisons-nous la guerre ici aux talents de notre époque ? À Dieu ne plaise ! Nous leur avons dû, en dépit de cette calamité publique qui pèse sur eux, des moments d’émotion et de transport véritable ; car, malgré la mauvaise manière et le faux goût qui dominent une époque, le feu sacré se trahit toujours à de certains moments et reprend tous ses droits dans les intelligences d’élite. Nous ne sommes donc point ingrats, parce que nous regrettons de les voir engagés malgré eux dans cette mauvaise voie.
Faisons-nous aussi la guerre au public, au mauvais goût de cette mauvaise époque ? Est-ce le public qui a gâté ses artistes, ou les artistes qui ont corrompu leur public ? Ce serait une question puérile. Public et artistes ne sont qu’un et sont condamnés à réagir continuellement l’un sur l’autre. La faute en est au siècle tout entier, à l’histoire, s’il est possible de s’exprimer ainsi, aux événements qui nous pressent, à la destruction qui s’est opérée en nous d’anciennes croyances, à l’absence de nouvelles doctrines dans l’art comme dans tout le reste. La richesse règne et domine ; mais aucun prestige, fondé sur un droit naturel ou sur l’équité des religions, n’accompagne cette richesse aveugle, bornée, vaniteuse, ouvrage plus que jamais du hasard, du désordre et des rapines, ou, ce qui est pis encore, de l’antagonisme barbare qu’on proclame aujourd’hui comme la loi définitive de l’économie sociale. Le luxe est partout, le bien-être nulle part. Le riche a étouffé le beau. Le moindre café des boulevards est plus chargé de dorures que le boudoir de Marie-Antoinette. Nos maisons, miroitantes de sculptures d’un travail inouï, n’ont plus ni ensemble, ni élégance, ni proportions. Quoi de plus laid et de plus misérable qu’une capitale où la caricature d’un palais vénitien ou arabe s’étale à côté d’une masure, et se pare de l’enseigne d’un perruquier et d’un marchand de vin ? L’aspect de la masure serre le cœur, et pourtant l’artiste lui consacrera plus volontiers ses crayons qu’à l’antique palais construit ce matin par des boutiquiers. Le romancier y placera plus volontiers la scène de son poème, parce qu’au moins elle est ce qu’elle est, cette masure, c’est la vérité, laide et triste, mais c’est la vérité. Cette maison prétendue renaissance n’est qu’un mensonge, un masque sans expression.
Oh ! qu’il ferait bien meilleur aller prendre le café sous les tilleuls du village, assis sur le soc de charrue d’où Werther contemple les deux enfants de la paysanne ! Que ce valet de ferme, dont il reçoit là les confidences et qui traverse le poème de son amour d’une manière si dramatique et si saisissante, est un bien autre personnage que tous ceux que nous détaillons si minutieusement des pieds à la tête, sans oublier un bouton d’habit, sans omettre une expression de leur harangue, un geste, un regard, une réticence ! Ce personnage-là est un de ces grands traits que la main d’un maître est seule capable de graver. Et non seulement il n’est pas nommé, mais encore il ne dit pas par lui-même un seul mot ; il occupe à peine trois pages du livre. Et cependant quelle place il remplit dans l’âme de Werther, et de quelle influence il s’empare, sans le savoir, sur sa destinée ! Détachez cet épisode, et l’épisode n’est rien par lui-même ; mais le poème est incomplet et la fin de Werther mal motivée. Ce personnage ne se fait-il pas voir et comprendre sans nous rien dire, ne se fait-il pas plaindre et aimer, malgré son crime ; ne se fait-il pas absoudre sans plaider sa cause ? Werther l’explique, et s’explique lui-même tout entier par ce cri profond du désespoir : « Ah ! malheureux, on ne peut te sauver, on ne peut nous sauver ! »
Ainsi travaillent les maîtres, sans qu’on aperçoive leur trame, sans qu’on sente l’effort de leur création. Ils ne songent pas à étonner : ils semblent l’éviter, au contraire. Il y a en eux un profond dédain pour tous nos puérils artifices. Ils prennent dans la réalité, dans la convenance et la vraisemblance la plus vulgaire ce qui leur tombe naturellement sous la main, et ils le transforment, ils l’idéalisent sans que leur main paraisse occupée. Il semble qu’il suffise que cela ait été porté un instant dans leur pensée pour prendre vie et durer éternellement. Loin de s’appesantir, comme nous faisons, sur toutes les parties de leur œuvre, ils laissent penser et comprendre ce qu’ils ne disent pas. Il y a, dans la vie d’amour de Werther, une lacune apparente que nous appellerions aujourd’hui lacune d’intérêt ; c’est quand il s’éloigne de Charlotte, résolu à l’oublier, et à se jeter dans le tumulte du monde. Pendant plusieurs lettres il n’entretient plus son ami que de choses indifférentes et, en quelque sorte, étrangères au sujet. C’est encore là un trait de génie. Dans ce semblant d’oubli de son amour, on voit profondément la plaie de son cœur, la crainte de nommer celle qu’il aime, ses efforts inutiles pour s’attacher à une autre, pour se distraire, pour s’étourdir. Le dégoût profond que les affaires et le monde lui inspirent sont l’expression muette et plus qu’éloquente de la passion qui l’absorbe. Aussi, quand tout d’un coup, à propos d’un incident puéril, il déclare qu’il abandonne toute carrière et qu’il va retrouver Charlotte, le lecteur n’est pas surpris un instant. Il s’écrie avec naïveté : « Je le savais bien, moi, qu’il l’aimait davantage depuis qu’il n’en parlait plus ! » L’intérêt ne naît donc pas de la surprise, et ce qui est profondément clair et vrai s’explique de soi-même ! Inclinons-nous donc devant les maîtres, quel que soit le goût de nos contemporains, quelque peu de succès qu’obtiendrait peut-être un chef-d’œuvre comme WERTHER, s’il venait à nous pour la première fois, sans l’appui du nom de Goethe.
La traduction de M. Pierre Leroux n’est pas seulement admirable de style, elle est d’une exactitude parfaite, d’un mot à mot scrupuleux. On ne conçoit pas qu’en traduisant un style admirable on ait pu jusqu’ici en faire un style monstrueux. C’est pourtant ce qui était arrivé, et il est assez prouvé, d’ailleurs, que pour ne pas gâter le beau en y touchant, il faut la main d’un homme supérieur.
GEORGE SAND
Considérations sur Werther et en général sur la poésie de notre époque
I
Madame de Staël, dans son livre de l’Allemagne, parle ainsi de Werther : « Les Allemands sont très forts en romans qui peignent la vie domestique. Plusieurs de ces romans méritent d’être cités ; mais ce qui est sans égal et sans pareil, c’est Werther. On voit là tout ce que le génie de Gœthe pouvait produire quand il était passionné. L’on dit qu’il attache maintenant peu de prix à cet ouvrage de sa jeunesse. L’effervescence d’imagination qui lui inspira presque de l’enthousiasme pour le suicide doit lui paraître maintenant blâmable. Quand on est très jeune, la dégradation de l’être n’ayant en rien commencé, le tombeau ne semble qu’une image poétique, qu’un sommeil environné de figures à genoux qui nous pleurent. Il n’en est plus ainsi, même dès le milieu de la vie ; et l’on apprend alors pourquoi la religion, cette science de l’âme, a mêlé l’horreur du meurtre à l’attentat contre soi-même. Goethe, néanmoins, aurait eu grand tort de dédaigner l’admirable talent qui se manifeste dans Werther. Ce ne sont pas seulement les souffrances de l’amour, mais les maladies de l’imagination dans notre siècle, dont il a su faire le tableau. Ces pensées qui se pressent dans l’esprit sans qu’on puisse les changer en acte de volonté, le contraste singulier d’une vie beaucoup plus monotone que celle des anciens, et d’une existence intérieure beaucoup plus agitée, causent une sorte d’étourdissement semblable à celui qu’on prend sur le bord de l’abîme ; et la fatigue même qu’on éprouve après l’avoir longtemps contemplé peut entraîner à s’y précipiter. Goethe a su joindre à cette peinture des inquiétudes de l’âme, si philosophique dans ses résultats, une fiction simple, mais d’un intérêt prodigieux. »
Ce jugement de madame de Staël est profond et parfait pour l’époque où elle écrivait. En trois ou quatre traits, elle caractérise admirablement l’œuvre de Goethe. C’est, dit-elle, la peinture des maladies de notre siècle ; et la cause de ces maladies, elle la trouve dans ces pensées qui nous assiègent, et qui ne peuvent se changer en actes, c’est-à-dire dans le contraste de notre développement intellectuel et sentimental, à nous autres modernes, avec la triste vie à laquelle nous condamne la constitution actuelle de la société. Tout cela, dis-je, est parfait, juste autant que profond. Mais quand madame de Staël écrivait cette page, les maladies d’imagination dont elle voit la peinture dans Werther n’étaient encore qu’au début de leur invasion, pour ainsi dire ; un grand nombre d’ouvrages remarquables qui ont la même origine et le même effet que Werther, et une foule bien plus grande de détestables productions puisées à la même source, n’existaient pas. Plus avancés aujourd’hui, nous devons porter sur ce livre un jugement plus philosophique encore, en le rattachant à toute la littérature contemporaine. Qu’on nous permette donc de compléter, jusqu’à un certain point, et de développer l’opinion de madame de Staël, en citant quelques réflexions que ce sujet nous a inspirées autrefois.
Il y a déjà plusieurs années, nous essayâmes, dans un recueil périodique, de caractériser d’une manière générale l’art de notre époque, et en particulier le genre de poésie dont Werther est le premier modèle.
Il est trop évident que l’œuvre entière de Byron a la plus grande affinité avec la partie la plus capitale de l’œuvre de Gœthe, c’est-à-dire Werther et Faust : Byron résume en lui ces deux types, et y ajoute encore. La maladie de l’imagination, que madame de Staël voyait déjà si marquée dans Werther, prend dans Byron un caractère plus intense, et sa cause se révèle plus clairement. Il ne s’agit plus avec lui de désirs ardents mais vagues, de pensées qui se pressent dans l’esprit sans qu’on puisse les réaliser en actes, parce que la vie sociale ne répond pas à l’activité de notre âme. La maladie est plus grande, et ses symptômes plus décidés. À cette simple discordance entre nos sentiments et le monde qui nous entoure, a succédé, chez Byron, un mépris profond pour toutes les croyances humaines et pour toute religion. Il a fini par douter de Dieu et de toute chose. Ce n’est pas seulement l’incrédulité vulgaire, c’est l’athéisme le plus prononcé qui le dévore. Comparant donc Byron à Gœthe, au milieu de tant d’autres écrivains de notre temps plus ou moins atteints de cet esprit général de doute et de désespoir, nous n’hésitions pas à donner à Byron la supériorité sur Gœthe, comme poète caractéristique de l’époque ; car nous trouvions dans Byron, pour employer une expression même de ce poète, une plus grande vitalité du poison . Nous disions :
« Depuis que la philosophie du dix-huitième siècle a porté dans toutes les âmes le doute sur toutes les questions de la religion, de la morale et de la politique, et a ainsi donné naissance à la poésie mélancolique de notre époque, deux ou trois génies poétiques tout à fait hors de ligne apparaissent dans chacune des deux grandes régions entre lesquelles se divise l’Europe intellectuelle, c’est-à-dire d’une part l’Angleterre et l’Allemagne, représentant tout le Nord, et la France, qui représente toute la partie sud occidentale, le domaine particulier de l’ancienne civilisation romaine. Autour de ces grands hommes gravitent, comme les planètes autour des soleils, une foule d’écrivains remarquables, mais d’un ordre inférieur. Byron, par la nature particulière de son génie, par l’influence immense qu’il a exercée, par la franchise avec laquelle il a accepté ce rôle de doute et d’ironie, d’enthousiasme et de spleen, d’espoir sans bornes et de désolation, réservé à la poésie de notre temps, méritera peut-être de la postérité de donner son nom à cette période de l’art : en tout cas, ses contemporains ont déjà commencé à lui rendre cet hommage. C’est que nul n’a su mieux que lui reproduire avec une parfaite originalité l’effet de cette poésie shakespearienne dont l’Allemagne et la France sont aujourd’hui plus enthousiastes que l’Angleterre elle-même. Goethe cependant l’avait précédé de bien des années ; mais Gœthe, dans une vie plus calme, se fit une religion de l’art, et l’auteur de Werther et de Faust, devenu un demi-dieu pour l’Allemagne, honoré des faveurs des princes, visité par les philosophes, encensé par les poètes, par les musiciens, par les peintres, par tout le monde, disparut pour laisser voir un grand artiste qui paraissait heureux, et qui, dans toute la plénitude de sa vie, au lieu de reproduire la pensée de son siècle, s’amusait à chercher curieusement l’inspiration des âges écoulés ; tandis que Byron, aux prises avec les ardentes passions de son cœur et les doutes effrayants de son esprit, en butte à la morale pédante de l’aristocratie et du protestantisme de son pays, blessé dans ses affections les plus intimes, exilé de son île, parce que son île antilibérale, antiphilosophique, antipoétique, ne pouvait ni l’estimer comme homme, ni le comprendre comme poète ; menant sa vie errante de grève en grève, cherchant le souvenir des ruines, voulant vivre de lumière, et se rejetant dans la nature, comme autrefois Rousseau, fut franchement philosophe toute sa vie, ennemi des prêtres, censeur des aristocrates, admirateur de Voltaire et de Napoléon, toujours actif, toujours en tête de son siècle, mais toujours malheureux, agité comme d’une tempête perpétuelle ; en sorte qu’en lui l’homme et le poète se confondent, que sa vie intime répond à ses ouvrages ; ce qui fait de lui le type de la poésie de notre âge. »
Ainsi ce que madame de Staël, qui n’avait devant les yeux que Gœthe, déplorait comme étant une maladie et n’étant qu’une maladie, nous, en contemplant Byron, chez qui cette maladie est au comble, nous ne le déplorions pas moins, mais nous le regardions comme un mal nécessaire, produit d’une époque de crise et de renouvellement. Un double aspect se montrait à nous dans cet affreux désespoir ; nous le voyions comme un mal, mais aussi comme un progrès. Nul enfantement n’a lieu sans douleur. Byron nous semblait porter le signe de deux destinées : d’une destinée qui s’achève, et d’une destinée qui commence ; d’un monde qui s’engloutit, et d’un monde qui surgit. Et si la mort nous paraissait plus glacée, pour ainsi dire, chez lui, nous découvrions aussi plus manifestement en lui l’esprit immortel qui, à travers le tombeau, retrouvera la vie.
Vainement, en effet, soutiendrait-on que sa poésie n’est que l’agonie du désespoir. Je dis qu’il y a dans cette agonie des traits qui indiquent la résurrection. Vainement on le comparerait, comme on l’a fait quelquefois, au Satan de Milton. Je dis que Satan, conservant de la force jusque dans sa damnation, se ressent encore par là du divin et s’y rattache. Cet ange tombé, se soutenant dans sa révolte, est encore dans la vie. Sa misère n’est que d’un degré plus profonde que celle du fier Ajax, s’écriant : « Je me sauverai, malgré les dieux ! » Et même est-il bien permis de dire que cet espoir de salut manque complètement à Satan ? N’est-ce pas la nécessité seule du symbole qui a fait que Milton lui a ôté tout espoir ? La mort absolue, en effet, est-elle concevable ? Satan vit, il combat ; donc il a de l’espoir. Cet espoir ne manque pas non plus à la poésie de Byron.
L’homme, ayant pris confiance dans sa force au dix-huitième siècle, a rêvé des destinées nouvelles ; il a abdiqué le passé, rejeté la tradition, et s’est élancé vers l’avenir. Mais cet élan du sentiment a devancé, comme toujours, les possibilités du monde. Un progrès intellectuel, un progrès matériel, sont nécessaires pour que le rêve du sentiment se réalise. Qu’arrive-t-il donc ? Ne voyant pas ses appétitions se réaliser, le sentiment se trouble, et, tout en persistant vers l’avenir, il arrive à le nier de la bouche et à nier toute chose. Mais lors même qu’il nie ainsi, c’est qu’il aspire encore vers cet avenir entrevu un instant et qui s’est dérobé à sa vue. Soyez sûr que s’il n’avait pas toujours le même but, il ne blasphémerait pas avec tant d’audace ; c’est la passion qu’il a pour ce but divin qui le rend si impie. Or le poète est le représentant du sentiment dans l’humanité. Tandis que l’homme de la sensation et de l’activité se satisfait de ce monde misérablement ébauché qu’il a devant les yeux, et que l’homme de l’intelligence cherche à le perfectionner, le poète s’indigne de ces lenteurs, et finit par n’avoir plus que des paroles d’ironie et des chants de désespoir. Mais si nous devions le condamner pour cela, il nous faudrait condamner avec lui nos pères qui ont rêvé une humanité nouvelle, une humanité plus grande. Si nous devions condamner absolument Byron sur ses paroles et sans vraiment le comprendre, il nous faudrait condamner absolument et Voltaire et Rousseau, et tout le dix-huitième siècle, et toute la révolution, qui ont éveillé la fièvre de son génie, et donné à son sang cette impulsion généreuse, mais désordonnée ; ou plutôt c’est toute la marche progressive de l’esprit humain qu’il nous faudrait condamner comme une chimère monstrueuse et funeste, si nous ne voulions pas voir dans cet homme perdu au sommet des précipices de la route, et que saisit le vertige, un de nous, un de nos frères, qui, lorsque la caravane humaine s’arrêtait interceptée dans sa voie, s’est élancé plus hardi jusqu’à la région des nuages, et qui meurt pour nous, en nous faisant signe qu’il n’y a point de route, parce qu’il n’en a pas trouvé.
Il y a une route, sans doute, et nous la trouverons ; mais qui oserait dire que le courage et la force de celui qui a pu s’élever si haut pour la chercher ne sera pas cause de notre courage pour la chercher à notre tour, nous qui sommes restés dans la plaine, et ne nous servira pas ainsi prodigieusement à la découvrir ?
Nous transformions donc le point de vue de madame de Staël, en embrassant avec confiance cette crise de désespoir de notre temps, comme un chrétien embrasse la croix qu’il plaît à la Providence de lui envoyer, et en fait l’ancre de son salut. « Si, disions-nous, la poésie ne faisait pas entendre aujourd’hui ce concert de douleur qui annonce le besoin d’une régénération sociale ; si elle ne jetait pas ainsi, dans toutes les âmes capables de la sentir, le premier germe de cette régénération ; si elle ne versait pas dans ces âmes, avec la douleur de ce qui est, le désir de ce qui doit y être, elle ne serait pas ce qu’elle a toujours été, prophétique. »
Poursuivant partout ce caractère de la poésie de notre temps, nous le montrions jusque chez les écrivains qui alors affectaient le calme d’artistes heureux, satisfaits du présent et des dons accordés par le ciel à leur génie, ou qui se rattachaient à un passé qui a été grand, mais qui ne peut plus être. Nous mettions au-dessus de ces vaines tentatives de l’art de la renaissance et de l’art pour l’art, la poésie véritablement inspirée par le sentiment de notre époque ; et nous montrions le concert unanime des diverses nations de l’Europe pour entrer, à l’insu souvent les unes des autres, dans cette phase de la poésie.
L’art, disions-nous, n’est pas plus la reproduction de l’art qu’il n’est la reproduction de la nature. L’art croît de génération en génération. Les œuvres des grands artistes, tous inspirés par leur époque, se succèdent, et cette succession est le développement de l’art. Mais s’inspirer uniquement du passé, refaire ce qui a été fait, c’est imiter, c’est traduire ; c’est manquer son époque ; c’est faire de l’art intermédiaire, de l’art qui n’a pas sa place marquée dans la vie de l’art.
Nous soutenions donc « que la poésie, comprise en général comme l’a comprise Byron, est la seule qui sorte des entrailles mêmes de la société actuelle, qu’elle découle naturellement de la philosophie du dix-huitième siècle et de la révolution française ; qu’elle est le produit le plus vivant d’une ère de crise et de renouvellement, où tout a dû être mis en doute, parce que, sur les ruines du passé, l’humanité cherche un monde nouveau. » Ainsi nous trouvions à la fois une confirmation de nos vues sur l’avenir de la société dans l’art actuel, et une explication de cet art même dans l’état de la société.