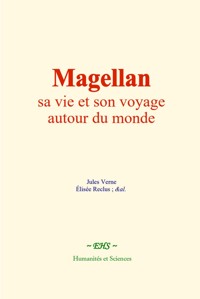
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Magellan, a rendu sa mémoire immortelle par la découverte qu’il fit l’an 1520 du détroit qui porte son nom (Le détroit de Magellan).
On ignorait encore l’immensité du continent découvert par Christophe Colomb. Aussi, cherchait-on obstinément sur la côte d’Amérique, qu’on supposait toujours former plusieurs îles, ce fameux détroit qui devait mener rapidement dans l’océan Pacifique et jusqu’à ces îles des épices dont la possession aurait fait la richesse de l’Espagne. Tandis que Cortereal et Cabot le cherchaient sur l’océan Atlantique, et Cortès jusqu’au fond du golfe de Californie, tandis que Pizarre descendait la côte du Pérou et que Valdivia conquérait le Chili, la solution de ce problème était trouvée par un Portugais au service de l’Espagne, par Fernand de Magellan.
Fils d’un gentilhomme de Cota e Armas, Fernand de Magellan naquit à Porto vers la fin du XVe siècle. Il avait été élevé dans la maison du roi Jean II, où il reçut une éducation aussi complète qu’on pouvait la donner alors. Après avoir étudié d’une manière toute spéciale les mathématiques et la navigation, (car il existait à cette époque en Portugal un courant irrésistible qui emportait le pays tout entier vers les expéditions et les découvertes maritimes), Magellan embrassa de bonne heure la carrière de la marine et s’embarqua, en 1505, avec Almeida, qui se rendait aux Indes. Il prit part au sac de Quiloa et à tous les événements de cette campagne...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1828 et décédé en 1905,
Jules Verne est un écrivain, dont une grande partie de l'œuvre est consacrée à des romans d'aventures et de science-fiction (appelés à l'époque de Jules Verne, romans d'anticipation).
Après un bac littéraire,
Jules Verne suit des études de droit à Paris. Il se consacre ensuite au théâtre, grâce au soutien des Dumas, père et fils, et devient secrétaire du théâtre lyrique jusqu'en 1854 où il fait représenter des pièces écrites en collaboration avec Michel Carré.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Magellan : sa vie et son voyage autour du monde
Magellan
sa vie et son voyage autour du monde
Ferdinand Magalhaens, que les Français nomment Magellan, a rendu sa mémoire immortelle par la découverte qu’il fit l’an 1520 du détroit qui porte son nom (Le détroit de Magellan). Ce fut cependant sous les auspices de Charles-Quint, vers lequel il s’était retiré, qu’il fit cette découverte. Magellan partit de Séville l’an 1519 avec cinq vaisseaux, passa le détroit jusqu’alors inconnu, et alla par la mer du sud jusqu’aux îles de Los-Ladrones (les Philippines) où il mourut, de poison selon les uns, dans un combat selon les autres. Un de ses vaisseaux arriva le 8 Septembre 1522 dans le port de Séville sous la conduite de Jean-Sébastien Catto, après avoir fait pour la première fois le tour de la terre.
(L. de Jaucourt, L’Encyclopédie, 1re éd.)
Magellan et le premier voyage autour du monde{1}
On ignorait encore l’immensité du continent découvert par Christophe Colomb. Aussi, cherchait-on obstinément sur la côte d’Amérique, qu’on supposait toujours former plusieurs îles, ce fameux détroit qui devait mener rapidement dans l’océan Pacifique et jusqu’à ces îles des épices dont la possession aurait fait la richesse de l’Espagne. Tandis que Cortereal et Cabot le cherchaient sur l’océan Atlantique, et Cortès jusqu’au fond du golfe de Californie, tandis que Pizarre descendait la côte du Pérou et que Valdivia conquérait le Chili, la solution de ce problème était trouvée par un Portugais au service de l’Espagne, par Fernand de Magellan.
Fils d’un gentilhomme de Cota e Armas, Fernand de Magellan naquit à Porto, à Lisbonne, à Villa-de-Sabrossa ou à Villa-de-Figueiro, on ne sait au juste, à une date inconnue, mais vers la fin du XVe siècle. Il avait été élevé dans la maison du roi Jean II, où il reçut une éducation aussi complète qu’on pouvait la donner alors. Après avoir étudié d’une manière toute spéciale les mathématiques et la navigation, —car il existait à cette époque en Portugal un courant irrésistible qui emportait le pays tout entier vers les expéditions et les découvertes maritimes, — Magellan embrassa de bonne heure la carrière de la marine et s’embarqua, en 1505, avec Almeida, qui se rendait aux Indes. Il prit part au sac de Quiloa et à tous les événements de cette campagne. L’année suivante, il accompagna Vaz Pereira à Sofala ; puis, de retour à la côte de Malabar, nous le voyons assister à la prise de Malacca avec Albuquerque et s’y conduire avec autant de prudence que de bravoure. Il fit partie de ces expéditions qu’Albuquerque envoya, vers 1510, à la recherche de ces fameuses îles aux épices, sous le commandement d’Antonio de Abreu et de Francisco Serrão, qui découvrirent Banda, Amboine, Ternate et Tidor. Pendant ce temps, Magellan avait abordé à des îles de la Malaisie éloignées de 600 lieues de Malacca, et il obtenait sur l’archipel des Moluques des renseignements circonstanciés qui firent naître, dans son esprit, l’idée du voyage qu’il devait accomplir plus tard.
De retour en Portugal, Magellan obtint, non sans difficulté, l’autorisation de fouiller dans les archives de la couronne. Il acquit bientôt la certitude que les Moluques étaient situées dans l’hémisphère qu’avait attribué à l’Espagne la bulle de démarcation, adoptée à Tordesillas par les rois d’Espagne et de Portugal, et confirmée, en 1494, par le pape Alexandre VI.
En vertu de cette démarcation qui devait donner lieu à tant de débats passionnés, tous les pays situés à trois cent soixante milles à l’ouest du méridien des îles du cap Vert devaient appartenir à l’Espagne, et tous ceux à l’est du même méridien au Portugal.
Magellan avait trop d’activité pour rester longtemps sans reprendre du service. Il alla donc guerroyer en Afrique, à Azamor, ville du Maroc, où il reçut au genou une blessure légère, mais qui, lésant un nerf, le laissa boiteux pour le reste de sa vie et le força à rentrer en Portugal. Conscient de la supériorité que ses connaissances théoriques et pratiques, et ses services lui assuraient sur la tourbe des courtisans, Magellan devait ressentir plus vivement qu’un autre l’injuste traitement qu’il reçut d’Emmanuel, au sujet de certaines plaintes portées par les habitants d’Azamor contre les officiers portugais. Les préventions d’Emmanuel se changèrent bientôt en une aversion véritable. Elle se traduisit par cette imputation outrageuse que, pour échapper à des accusations irréfutables, Magellan feignait de souffrir d’une blessure sans conséquence dont il était complètement guéri. Une telle assertion était grave pour l’honneur si susceptible, si ombrageux, de Magellan. Aussi s’arrêta-t-il dès lors à une résolution extrême, qui répondait, d’ailleurs, à la grandeur de l’offense reçue. Pour que personne n’en pût ignorer, il fit constater par acte authentique qu’il renonçait à ses droits de citoyen portugais, changeait de nationalité et prenait en Espagne des lettres de naturalisation. C’était proclamer, aussi solennellement qu’il était possible de le faire, qu’il entendait être traité en sujet de la couronne de Castille, à laquelle il voulait consacrer dorénavant ses services et sa vie tout entière. Grave détermination, on le voit, qui ne trouva personne pour la blâmer, que les historiens les plus rigoristes ont excusée, témoin Barros et Faria y Sousa.
En même temps que lui, un homme profondément versé dans les connaissances cosmographiques, le licencié Ruy Faleiro, également tombé dans la disgrâce d’Emmanuel, quittait Lisbonne avec son frère Francisco et un marchand nommé Christovam de Haro. Il avait conclu avec Magellan un traité d’association pour gagner les Moluques par une voie nouvelle qui n’était pas autrement déterminée et qui restait le secret de Magellan. Dès qu’ils furent arrivés en Espagne (1517), les deux associés soumirent leur projet à Charles-Quint, qui l’accepta en principe. Mais il s’agissait, ce qui est toujours délicat, de passer aux moyens d’exécution. Par bonheur, Magellan trouva en Juan de Aranda, facteur de la chambre de commerce, un partisan enthousiaste de ses théories, qui lui promit de mettre en jeu toute son influence pour faire réussir l’entreprise. Il vit, en effet, le grand chancelier, le cardinal et l’évêque de Burgos, Fonseca. Il sut exposer avec tant d’habileté le bénéfice considérable, pour l’Espagne, de la découverte d’une route conduisant au centre même de production des épices, et le préjudice immense qui en résulterait pour le commerce du Portugal, qu’une convention fut signée le 22 mars 1518. L’empereur s’engageait à faire tous les frais de l’armement, à condition que la plus grande partie des bénéfices lui reviendrait.
Mais Magellan avait encore bien des obstacles à surmonter avant de prendre la mer. Ce furent, d’abord, les remontrances de l’ambassadeur portugais, Alvaro da Costa, qui essaya même, voyant l’inutilité de ses tentatives, de faire assassiner Magellan, au dire de Faria y Sousa. Puis, il se heurta au mauvais vouloir des employés de la Casa de contratacion de Séville, jaloux de voir donner à un étranger le commandement d’une expédition si importante, et envieux de la dernière faveur qui venait d’être accordée à Magellan et à Ruy Faleiro, nommés commandeurs de l’ordre de Saint-Jacques. Mais Charles-Quint avait donné son consentement par un acte public qui paraissait devoir être irrévocable. On essaya cependant de le faire revenir sur sa décision, en organisant, le 22 octobre 1518, une émeute soldée par l’or du Portugal. Elle éclata sous le prétexte que Magellan, qui venait de faire tirer à terre un de ses navires pour le réparer et le peindre, l’avait décoré des armes portugaises. Cette dernière tentative échoua misérablement, et trois ordonnances des 30 mars, 6 et 30 avril vinrent fixer la composition des équipages et nommer l’état-major ; enfin une dernière cédule, datée de Barcelone, le 26 juillet 1519, confiait le commandement unique de l’expédition à Magellan.
Que s’était-il passé avec Ruy Faleiro ? nous ne saurions le dire exactement. Mais ce dernier, qui jusqu’alors avait été traité sur le même pied que Magellan, qui avait peut-être conçu le projet, se vit tout à fait exclu du commandement de l’expédition, à la suite de dissentiments dont on ne connaît pas la cause. Sa santé, déjà ébranlée, reçut un dernier coup de cet affront, et le pauvre Ruy Faleiro, devenu presque fou, étant retourné en Portugal pour voir sa famille, y fut arrêté et ne put être relâché que grâce à l’intercession de Charles-Quint.
Enfin, après avoir prêté lui-même foi et hommage à la couronne de Castille, Magellan reçut à son tour le serment de ses officiers et matelots et quitta le port de San-Lucar de Barrameda, le matin du 10 août 1519.
Mais, avant d’entamer le récit de cette mémorable campagne, il nous faut donner quelques détails sur celui qui nous en a conservé la relation la plus complète, sur François-Antoine Pigafetta ou Jérôme Pigaphète, ainsi qu’il est souvent appelé en France. Né à Vicence vers 1491 d’une famille noble, Pigafetta faisait partie de la suite de l’ambassadeur Francesco Chiericalco, que Léon X envoya à Charles-Quint alors à Barcelone. Son attention fut sans doute éveillée par le bruit que faisaient alors en Espagne les préparatifs de l’expédition, et il obtint de prendre part au voyage. Ce volontaire fut d’ailleurs une excellente recrue, car il se montra dans toutes les circonstances aussi fidèle et intelligent observateur que brave et courageux compagnon. Il fut blessé au combat de Zébu à côté de Magellan, ce qui l’empêcha même d’assister au banquet pendant lequel un si grand nombre de ses compagnons devaient trouver la mort. Quant à son récit, à part quelques exagérations de détail dans le goût du temps, il est exact, et la plupart des descriptions que nous lui devons ont été vérifiées par les voyageurs et les savants modernes, notamment par M. Alcide d’Orbigny.
Dès son retour à San-Lucar le 6 septembre 1522, le Lombard, ainsi qu’on l’appelait à bord de la Victoria, après avoir accompli le vœu qu’il avait fait d’aller remercier pieds nus « Nuesta Señora de la Victoria, » présenta à Charles-Quint, alors à Valladolid, le journal complet du voyage. À son retour en Italie, au moyen de l’original ainsi que de notes complémentaires et à la requête du pape Clément VII et du grand maître de l’ordre de Malte, Villiers de l’Isle-Adam, il écrivit un récit plus étendu de l’expédition, dont il adressa plusieurs copies à quelques grands personnages et notamment à Louise de Savoie, mère de François Ier. Mais cette dernière, ne pouvant comprendre, pense M. Harrisse, le très-érudit auteur de la Bibliotheca americana vetustissima, l’espèce de patois employé par Pigafetta et qui ressemblait à un mélange d’italien, de vénitien et d’espagnol, requit un certain Jacques-Antoine Fabre de le traduire en français. Au lieu d’en donner une traduction fidèle, Fabre en aurait fait une sorte d’abrégé. Quelques critiques supposent cependant que ce récit aurait été écrit originairement en français ; ils fondent leur opinion sur l’existence de trois manuscrits français du XVIe





























