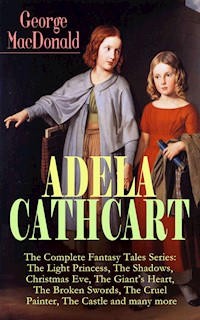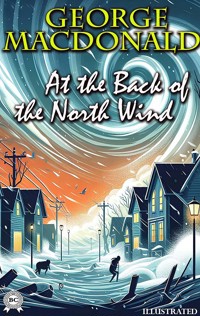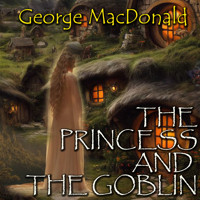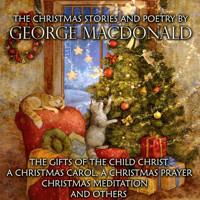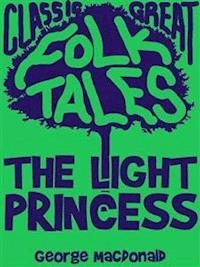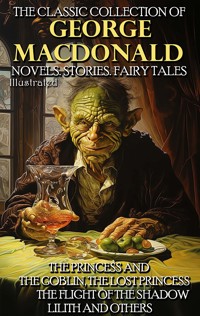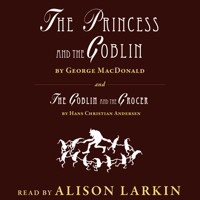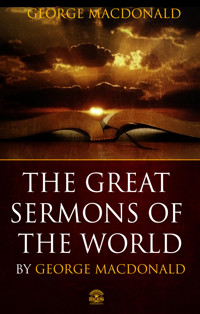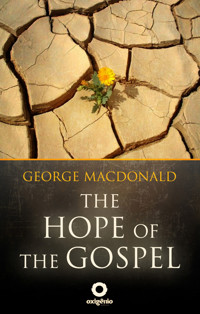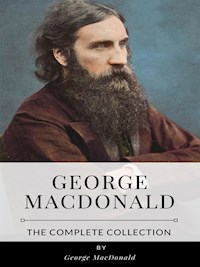Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Malcolm est un classique de la littérature écossaise écrit par George MacDonald, ce livre raconte l'histoire d'un jeune marin élevé par son grand-père dans un petit village d'Ecosse. Très marqué par son éducation chrétienne, Malcolm essaie de toujours se comporter en accord avec sa foi. Cela fait de lui un personnage très attachant qui étonne son entourage. Ses rencontres avec toute une galerie de personnages donnent lieu à des dialogues hauts en couleur. Il étonne également par sa culture littéraire. Laissez vous porter par une histoire marquée par les légendes et l'histoire de l'Ecosse, la vie au XIXe siècle dans un village de la côte écossaise. Goûtez la profonde humanité des personnages, la poésie d'un auteur passionné de littérature et de poésie. Laissez vous inspirer par la foi de Malcolm et comment elle guide toutes les actions de sa vie. Le titre original est : Malcolm, publié en 1875
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1007
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titre original : Malcolm
Auteur : George MacDonald
Traduction : Antoine Tabary
Date : le 30 septembre 2024
Avant-propos
Vous vous apprêtez à lire ma traduction d’un roman de George MacDonald « Malcolm ». Ce roman m’a profondément touché et j’ai entrepris cette traduction pour pouvoir partager ce bonheur avec ma femme et mes quatre filles. Vu l’ampleur de travail que cela m’a demandé, j’ai souhaité le diffuser plus largement.
En 1850 George MacDonald devient pasteur de l’Église congrégationaliste de la Trinité à Arundel, mais ses sermons (prêchant l’amour universel de Dieu et la possibilité que personne ne devrait, à la fin, ne pas parvenir à s’unir à Dieu), rencontrèrent peu de soutiens et son salaire fut divisé par deux. Plus tard, il fut engagé dans un travail pastoral à Manchester. Il le quitta à cause de problèmes de santé, et après un court séjour à Alger, il s’installa à Londres et enseigna pour quelque temps à l’université de Londres. Il écrivit de nombreux romans dans lesquels il exprime l’amour du Christ qu’il ressentait et comment les hommes peuvent y répondre et cet enseignement se fait au sein d’une histoire captivante avec des personnages pleins d’humanité. Parmi ses romans, certains sont des romans fantastiques et des contes féeriques, d’autres et c’est le cas de Malcolm sont tout à fait réalistes. J’ai le sentiment que ce livre me permet de mieux vivre ma vocation de chrétien et éclaire ma conscience. J’espère qu’en plus de vous distraire, sa lecture vous apportera un soutien similaire.
Si la façon dont je l’ai découvert ne vous intéresse pas, n’hésitez pas à aller directement au chapitre I pour commencer votre lecture.
Comment ai-je découvert cet auteur écossais du XIXᵉ siècle ? C’est une suite d’événements un peu inattendue qui m’a conduit jusqu’à lui.
Tout d’abord à la suite d’un cours sur la « Sémantique Générale », une science qui porte sur notre façon d’évaluer le monde. La Sémantique générale de Korzybski traite de la manière dont les êtres humains réagissent à leur propre processus de perception, elle étudie la manière dont nous produisons du sens dans notre expérience du monde, comment nous jugeons les différents aspects de notre vie quotidienne en fonction de nos croyances et notamment de nos valeurs. L’objet de ce cours était de nous apprendre à communiquer en évitant l’incompréhension que peuvent provoquer certaines formulations. Il y a deux phrases qui illustrent ces craintes d’incompréhension : « Le mot chien ne mord pas » et « La carte n’est pas le territoire », elles indiquent les risques d’incompréhension. Un des exemples qui m’a le plus frappé était que le mot « mais » au sein d’une phrase était perçu comme la négation de la première partie de la phrase. Ainsi, lorsque vous dites : « Cette personne est gentille, mais… » votre interlocuteur comprend immédiatement que la personne n’est en fait pas gentille et nous étions encouragés à remplacer ce « mais » par « et », ce changement évite la négation pour l’interlocuteur et si vous faites cet effort vous constaterez qu’il vous force à repenser, vous aussi, plus positivement ce que vous dites. Alfred Korzybski (1876 – 1950) s’est posé la question des présupposés – et notamment de l’héritage de la pensée d’Aristote dans la culture occidentale – qui sous-tendent notre utilisation de la langue et plus particulièrement des relations qui lient langue et réel. Notre professeur Henri Landier nous a encouragés à lire le roman de A. E. Van Vogt inspiré par la sémantique générale « Le monde des Non A », non Aristotélicien, qui a été merveilleusement traduit en français par Boris Vian.
Ayant beaucoup aimé ce livre, je me suis mis à lire de nombreux romans de science-fiction et j’en discutais volontiers avec des collègues ou des clients. Gérard Dechen m’a recommandé le roman Perelandra de C. S. Lewis, un roman fantastique qui s’inspire de l’histoire d’Adam et Ève en la situant sur Venus ce qui permet de glisser au sein de l’intrigue une réflexion sur le péché originel. J’ai beaucoup aimé la trilogie de C. S. Lewis « Au-delà de la planète silencieuse (Out of the Silent Planet) », « Perelandra (Perelandra ou Voyage to Venus) » et « Cette hideuse puissance (That Hideous Strength) ». Comme je remerciais Gérard, il m’a dit qu’il serait sans doute intéressant de se pencher sur d’autres livres de l’auteur. C’est ainsi que je me suis mis à lire de nombreux ouvrages de C. S. Lewis. Cet Irlandais élevé dans la foi chrétienne, a perdu la foi au cours de ses études universitaires et l’ayant redécouverte ultérieurement il a énormément écrit pour témoigner de cette foi retrouvée et est sans doute considéré comme l’apologiste chrétien ayant remporté le plus de succès durant le XXᵉ siècle. J’ai beaucoup appris de ces lectures au-delà du grand plaisir que j’y ai pris. Je me suis régalé en lisant « Tactique du diable (The Screwtape Letters) », un livre très drôle, recueil de lettres écrites par un démon confirmé à un jeune démon pour lui expliquer comment tenter les humains et « L’Autobus du paradis (The Great Divorce) ». Ce dernier roman nous décrit le ciel comme un lieu où Dieu nous invite à entrer et ce n’est pas lui qui empêche quiconque d’y entrer, mais ce sont les hommes qui étant libres peuvent refuser d’y entrer. Dans ce roman, le narrateur rencontre au ciel George MacDonald et c’est ainsi que j’ai entendu parler de lui pour la première fois. C. S. Lewis fait comprendre que George MacDonald l’a beaucoup inspiré, j’ai donc voulu lire un roman de lui. Le premier que j’ai trouvé est Malcolm et c’est pourquoi j’ai choisi de traduire celuilà.
Comme cet auteur est entré dans le domaine public, vous pouvez trouver ses œuvres en accès libre sur le site « gutenberg.org ». Attention toutefois, au-delà d’une bonne connaissance de l’anglais la lecture de Malcolm requiert certaines connaissances en écossais. Pour la traduction de l’écossais, je me suis appuyé sur le dictionnaire en ligne : « https:// dsl.ac.uk/ » Dictionary of the Scots Language. Dans ce roman, les gens simples s’expriment en écossais, alors que les nobles et le narrateur s’expriment en anglais. Dans ma traduction, je n’ai pas tenté d’utiliser un langage campagnard pour rendre le même effet pour faciliter la lecture et parce que je ne m’en suis pas senti capable.
Bonne lecture.
Personne ne peut affirmer que tel ou tel homme soit par sa propre faute en enfer. Mais l’enfer indique que l’homme a la possibilité de refuser définitivement la vie offerte par Dieu. L’amour de Dieu est tel qu’il respecte trop l’homme pour s’imposer à lui ; il crée l’homme libre. Dieu, qui « veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2,4), agit pour les arracher au mal et au péché, et les ouvrir à la vie. Mais il prend au sérieux la liberté de l’homme et reconnaît l’importance de ses décisions.
Catéchisme pour adultes écrit par Les évêques de France
Sommaire
Chapitre I : Mademoiselle Horn
Chapitre II : Barbara Catanach
Chapitre III : Le châtelain fou
Chapitre IV : Phemy Mair
Chapitre V : Lady Florimel
Chapitre VI : Duncan MacPhail
Chapitre VII : Alexandre Graham
Chapitre VIII : Le pierrier (canon pivotant)
Chapitre IX : La truite saumonée
Chapitre X : Les funérailles
Chapitre XI : La vieille église
Chapitre XII : Le cimetière
Chapitre XIII : Le marquis de Lossie
Chapitre XIV : La lampe de Meg Partan
Chapitre XV : La pente de la dune
Chapitre XVI : La tempête
Chapitre XVII : L’accusation
Chapitre XVIII : La dispute
Chapitre XIX : La cornemuse de Duncan
Chapitre XX : Les avances
Chapitre XXI : Médiation
Chapitre XXII : D’où vient-il et où va-t-il ?
Chapitre XXIII : L’apocalypse
Chapitre XXIV : La fête
Chapitre XXV : La veillée nocturne
Chapitre XXVI : Pas à l’église
Chapitre XXVII : Lord Gernon
Chapitre XXVIII : Un mariage de pêcheur
Chapitre XXIX : Florimel et Duncan
Chapitre XXX : La fête du renouveau
Chapitre XXXI : Étoiles errantes
Chapitre XXXII : La chambre du capitaine
Chapitre XXXIII : La bibliothèque
Chapitre XXXIV : Milton et la jument baie
Chapitre XXXV : Kirkbyres
Chapitre XXXVI : Le coup
Chapitre XXXVII : Le cotre58
Chapitre XXXVIII : Les deux chiens
Chapitre XXXIX : Le château des Colonsay
Chapitre XL : La fenêtre du diable
Chapitre XLI : Les saphirs embrumés
Chapitre XLII : La révélation de Duncan
Chapitre XLIII : La chambre du sorcier
Chapitre XLIV : L’ermite
Chapitre XLV : Monsieur Cairns et le marquis
Chapitre XLVI : La grotte de Baillies’Barn
Chapitre XLVII : L’allégation de Madame Stewart
Chapitre XLVIII : La grotte de Baillies’Barn à nouveau
Chapitre XLIX : Le mont Pisgah
Chapitre L : Lizzy Findlay
Chapitre LI : Le terrier du châtelain
Chapitre LII : Crème ou écume
Chapitre LIII : La maison de l’instituteur
Chapitre LIV : Un jour
Chapitre LV : La même nuit
Chapitre LVI : Quelque chose d’oublié
Chapitre LVII : La quête du châtelain
Chapitre LVIII : Malcolm et Madame Stewart
Chapitre LIX : Une honnête intrigue
Chapitre LX : Le sacrement
Chapitre LXI : Mademoiselle Horn et le joueur de cornemuse
Chapitre LXII : La seiche et le crabe
Chapitre LXIII : Mademoiselle Horn et Lord Lossie
Chapitre LXIV : Le châtelain et sa mère
Chapitre LXV : La vision du châtelain
Chapitre LXVI : Le cri venu de la chambre
Chapitre LXVII : Des pattes de velours
Chapitre LXVIII : Des mains de fer
Chapitre LXIX : Le marquis et l’instituteur
Chapitre LXX : La fin ou le commencement ?
REMERCIEMENTS
Chapitre I : Mademoiselle Horn
« Nan, nan ; je ne suis pas blessée, je suis heureuse de le dire. Je n’ai jamais vu rien de bon sortir du sentimentalisme », dit-elle en revenant.
« Personne n’a jamais pensé vous en faire le reproche, Madame. »
« Effectivement, j’ai eu suffisamment de mal à faire ce que j’avais à faire, sans parler de ce que personne, à part moi, ne voulait faire. Je n’ai pas eu de temps pour la sentimentalité et autres choses de ce genre », insista Mademoiselle Horn.
Mais, à ce moment-là, son attention fut attirée par un pas lourd descendant l’escalier juste derrière le mur et forcée de suspendre son discours, en trois enjambées gauches, elle rejoignit le palier.
Elle appela derrière les pas qui descendaient : « Watty Witherspail ! Watty ! »
D’en bas, une voix bourrue répondit : « Oui, Madame. »
« Watty, quand vous aurez fini avec la boîte, mettez donc un marteau et une poignée de clous dans votre poche pour réparer la porte du poulailler. »
« La boîte », c’était le cercueil de sa cousine au troisième degré, Griselda Campbell, dont le corps reposait dans la pièce sur sa gauche quand elle appelait dans l’escalier. Sur ce, sur sa droite Mademoiselle Horn ré-entra, pour rejoindre Madame Mellis, la femme du principal marchand drapier de la ville, qui était venue soi-disant pour présenter ses condoléances, mais surtout pour voir le corps de la morte.
« Ah ! Elle était encore jeune ! » soupira la visiteuse, en traînant sur les mots et opinant du bonnet pour bien indiquer que c’était un sujet de reproche, auquel les pauvres mortels n’osent faire qu’allusion.
« Pas si jeune » rétorqua Mademoiselle Horn. « Elle allait sur ses 38 ans. »
« C’est bien triste, dur même. »
« Pas si dur, à mon avis – et qui le saurait mieux que moi ? Elle a eu une vie bien protégée et l’airait eue aussi longtemps que j’aurais été à ses côtés. Non, non ce n’est ni si jeune, ni si dur. »
« Certes, mais c’était une créature patiente avec les autres », persista Madame Mellis, comme si elle ne pouvait accepter qu’on l’empêchât d’obtenir quelques mots de reconnaissance des lèvres de celle qui avait vécu à ses côtés.
« Effectivement, elle l’était ! – un peu trop patiente avec certains. Mais ça venait de ce qu’elle avait plus de cœur que de cervelle. Elle était sentimentale comme personne – et plus encore. Mais je n’en ai rien pris à son contact. Dommage qu’elle n’ait pas eu le jugement au même niveau, car elle ne s’est jamais méfiée assez de qui que ce soit. Mais c’est sans importance, car maintenant elle est partie là où c’est moins nécessaire. Pour une personne aussi innocente qu’une colombe dans ce monde malade, il y en a plus de dix qui ont la ruse du serpent. Et les serpents savent bien profiter des colombes – surtout celles qui volent jusqu’au milieu d’eux. »
« Certes, vous avez tout à fait raison sur ce point », dit Madame Mellis. « Et comme vous dites, elle était plutôt facile à convaincre. Je ne doute pas qu’elle ait cru jusqu’à la fin qu’il reviendrait pour l’épouser. »
« Reviendrait pour l’épouser ! De qui et de quoi parlez-vous ? Je vous le dis Madame Mellis – si vous osez encore faire allusion à de tels ragots, vous aurez moins l’occasion de voir ce côté de ma porte à l’avenir ! »
Et comme elle parlait, ses yeux de faucon se mirent à briller de part et d’autre de son nez de faucon, qui devint de plus en plus crochu tandis qu’elle lançait un regard furieux et que son cou se tendait en avant comme si elle s’apprêtait à fondre sur celle qui l’offensait. La voix de Madame Mellis se mit à trembler avec quelque chose comme de la peur quand elle répondit :
« Mon dieu, Mademoiselle Horn ! Qu’ai-je dit qui mérite un tel regard ? »
« Dit ! » répéta Mademoiselle Horn d’un ton qui révélait à la fois son agacement avec elle-même et son mépris pour sa visiteuse. « Il n’y a quasiment aucun ragot dans tout le voisinage qui ne vienne de vous. Et ce n’est que bêtise. Ne vous attendez pas à des remerciements pour ça ici ! Et ça alors qu’elle repose dans la pièce à côté ainsi qu’elle le fera pour l’éternité, la pauvre ! »
« C’était vraiment en toute bonne foi, Mademoiselle Horn, je croyais que tout le monde savait qu’elle était folle de lui. »
« Folle de qui, au nom du père de tous les menteurs ? »
« Oh, ce docteur aux jambes longues qui est parti pour les Indes et mort avant même de passer l’équateur. Sauf que les gens on dit qu’il n’était pas mort et qu’il reviendrait pour l’épouser ! »
« Tout ça n’est que mensonge, de la tête aux pieds. »
« N’empêche, qu’il est clair qu’elle a dépéri après son départ, et qu’elle n’est jamais redevenue ce qu’elle était – vous ne pouvez pas le nier. »
« Ce ne sont que des ragots », insista Mademoiselle Horn, mais avec plus de douceur. « Elle ne se souciait pas plus de cet homme que je ne le fais moi-même. Elle a dépéri, je vous l’accorde, et il est parti, je vous l’accorde, mais le vent souffle et l’eau coule, et l’un n’a pas grand-chose à voir avec l’autre. »
« Bien, bien ; je suis désolée d’avoir dit quelque chose qui vous offense, et je ne peux pas en dire plus. Si vous permettez, Mademoiselle Horn, je vais aller jeter un dernier regard sur elle, pauvre petite ! »
« Vous n’allez rien faire de tel ! Je ne laisserai personne, capable de colporter de tels racontars, poser son regard sur elle, Madame Mellis. Oser dire qu’une telle colombe que ma Grizel, pauvre, douce de cœur, et si séduisante ait pu regarder deux fois un serpent tel que lui ! Non, non, Madame ! Allez votre chemin et ne revenez que demain matin juste après vos prières. Elle sera alors tranquille dans son cercueil et j’aurai retrouvé mon calme. Alors, peut-être vous la laisserai-je voir. J’aimerais tant ne plus la voir, je ne le supporte plus, je ne le supporte plus. »
Ces derniers mots furent murmurés à part, inaudibles pour Madame Mellis, à laquelle toutefois, ils n’étaient pas adressés, mais bien au cadavre. Elle se leva, non sans grand déplaisir, et avec un au revoir formel quitta la pièce, jetant, en sortant de la pièce, un regard de curiosité dans la direction où reposait le corps, et descendit les escaliers avec autant de lenteur que si elle se demandait à chaque marche si la suivante supporterait son poids. Mademoiselle Horn, qui l’avait suivie jusqu’en haut des marches, la suivit du regard jusqu’à ce qu’elle disparaisse sous le palier puis se retourna et rentra dans le salon, en laissant traîner son regard vers l’autre pièce, comme si elle pouvait voir à travers la porte fermée la forme blanche qui reposait sur le lit blanc.
« Je remercie Dieu de ne pas être sentimentale », se dit-elle. « Comme l’était ma pauvre Grizel pour un homme aussi léger que celui-là. Ah, pauvre Grizel, elle m’a filé entre les doigts comme un fil sans nœud. »
Chapitre II : Barbara Catanach
Mademoiselle Horn fut interrompue par le bruit du loquet de la porte de la rue et bondit de sa chaise avec colère.
« Ils ne peuvent pas la laisser reposer cinq minutes ? » cria-t-elle tout fort, oubliant qu’il n’y avait plus aucun risque de la réveiller. Mais après réflexion, elle se dit « ce doit juste être Jeanne qui revient de la fontaine. »
Mais comme elle n’entendit aucun pas sur le chemin de la cuisine elle conclut, « Non, ça ne doit pas être elle, elle galope toujours comme un poulain fraîchement ferré. » Elle descendit au rez-de-chaussée pour voir qui s’était permis d’entrer sans y être invité.
Dans la cuisine, dont le sol était aussi blanc qu’une brosse puisse le rendre, et parsemé de sable de la plage – sous l’horloge hollandaise aux couleurs gaies, qui continuait son tic-tac aussi fort que jamais, bien qu’elle soit juste sous la morte – était assise une femme de soixante ans, dont le visage bien rond semblait au premier regard aimable, au second malin, et au troisième mauvais. Mais l’aspect rondouillard persistait et paraissait maladif, un peu comme de la pâte dont il avait la couleur. Ses yeux noirs, profondément enfoncés, brillaient sous des sourcils très sombres qui se rejoignaient au-dessus de son nez, et avaient un effet fascinant – à tel point qu’à la première entrevue on ne risquait pas de remarquer quelque autre de ses traits. Elle se leva à l’entrée de Mademoiselle Horn, s’enfonça le poing dans le côté charnu, et se tint silencieuse.
« Eh bien ? » interrogea Mademoiselle Horn, puis se tint également silencieuse.
« J’ai pensé que vous pourriez avoir besoin de mes services » dit la femme.
« Non, non. Aucune main ne posera un doigt, autre que le mien, sur la petite », dit Mademoiselle Horn. « J’avais tout fini avant le lever du jour. Elle repose tranquillement maintenant – très tranquillement – dans l’attente de Watty Witherspail. Quand il apportera le cercueil, nous la coucherons dedans et voilà tout. »
« Eh bien, Madame, pour une personne de votre naissance et de votre éducation, je dois dire que vous ne semblez pas très affectée. »
« Il ne me semble pas, Madame Catanach, qu’on vous ait demandé d’exprimer votre avis dans cette maison. On n’en a cure. Et en quoi devrais-je être affectée. Notre tour viendra bientôt, quelle que soit notre affectation, et nous nous éteindrons comme une chandelle – oui et laissant nos souvenirs derrière nous. »
« Pour ma part, je ne pense pas laisser beaucoup de souvenirs derrière moi, Mademoiselle Horn », dit la femme.
« Moins il y en aura, mieux ce sera », murmura Mademoiselle Horn, mais l’importune visiteuse continua.
« Ceux qui me doivent le plus sont aussi ceux qui en ont le moins conscience. Dieu m’est témoin, je connais des choses bien pires que ce que j’ai pu faire, Madame. Dans mon métier, il arrive fatalement qu’on se retrouve de temps à autre en mauvaise compagnie, car nous sommes tous nés pécheurs et avons été élevés dans l’iniquité, comme le dit la Bible. Mais vous savez que les gens comme moi doivent taire ces choses. Malgré tout, si vous n’acceptez pas l’aide de mes mains, vous ne pouvez la priver de mon regard, la pauvre petite. »
« Personne ne la regardera morte qui n’ait fait sa joie de son vivant. Et vous savez bien, Bawby, qu’elle ne supportait pas de vous voir. »
« Et elle avait bien raison si je peux me fier à ce qui me traverse l’esprit au moment de m’endormir le soir. Bien sûr, ça peut très bien n’être qu’une fable de vieilles bonnes femmes née de mon imagination. »
« Que voulez-vous dire ? », demanda brutalement, Mademoiselle Horn, avec un air sévère.
« Je m’comprends, et celle à qui cela déplaît n’est pas faite pour être sage-femme. Je voudrais juste chasser de mon esprit un soupçon que j’ai depuis de nombreuses années. Mais, faîtes comme il vous plaira, Madame, si vous me l’interdisez, je garderai ce soupçon un peu plus longtemps. »
« Vous ne l’approcherez pas ! – quand bien même cela pourrait vous débarrasser de tous les mauvais rêves qui s’accumulent autour de vous », cria Mademoiselle Horn.
« Tout doux, tout doux », dit Madame Catanach. « Ne provoquez pas trop ma colère, je ne suis qu’une mortelle. Les gens supportent beaucoup de choses de vous, Mademoiselle Horn, qu’ils n’accepteraient de personne d’autre, car votre tempérament colérique est bien connu. Mais ça ne porte pas chance de fâcher une sage-femme – tant de choses dépendent d’elle. Et je ne suis pas d’humeur à le supporter aujourd’hui. Je me demande d’où vient tant d’opposition – surtout en ce moment où il y a un cadavre dans votre maison. »
« Foutez le camp. C’est ma maison ! » dit Mademoiselle Horn, d’une voix basse et rauque, ne se retenant d’exploser qu’à cause de la présence du corps au-dessus d’elle de l’autre côté du plafond. « Je préférerais laisser entrer un chat dans la chambre mortuaire et gambader sur le corps plutôt que vous, Bawby Catanach. Et voilà pour vous. »
À ce moment, l’entrée opportune de Jeanne offrit à Mademoiselle Horn l’occasion de quitter la pièce sans être confrontée au dilemme de soit forcer la femme dehors – une opération que cette dernière, vu la façon dont elle tenait son large corps solidement appuyé sur le sol, semblait décidée à résister – ou alors de devoir céder le champ en pleine déconfiture : elle se retourna la tête haute, avec la démarche de quelqu’un qu’on aurait insulté chez lui.
Elle était assise dans le salon, toujours rouge de colère, quand Jeanne entra, et, fermant la porte derrière elle, et discutant déjà depuis le pas de la porte, de tout ce qu’elle avait, vu, entendu et fait, lors de son passage en ville. Mademoiselle Horn l’interrompit dès qu’elle ouvrit la bouche.
« Est-ce que cette femme a quitté la maison, Jeanne ? » demanda-t-elle, sur le ton de quelqu’un qui voulait entendre une réponse positive en condition préalable à toute autre conversation.
« Elle est partie, Madame », répondit Jeanne – ajoutant pour elle-même sans le dire « je ne vous dis pas où. »
« C’est une femme avec laquelle je ne voudrais pas te voir, Jeanne. »
« Je n’ai jamais rien entendu de mauvais à son sujet », répondit Jeanne.
« Elle suffirait à corrompre un cimetière », dit sa maîtresse avec plus de force que de justesse.
Jeanne, pourtant, était d’une cinquantaine bien avancée, et plutôt du genre à avoir déjà cédé à la tentation, que de risquer un premier assaut ; et Mademoiselle Horn mesurait guère à quel point sa mise en garde était inutile, ni où Barbara Catanach se trouvait à l’instant même confiante, à juste titre, dans le silence de Jeanne ; elle était dans la chambre mortuaire, penchée sur le corps. Elle avait relevé le drap – non pas depuis la tête, mais depuis les pieds – et soulevé la chemise de nuit de linge fin dont l’amour de sa cousine avait vêtu le corps pour l’enterrement.
« Elle aurait mieux fait », murmura-t-elle, « de me parler gentiment. Je n’ai pas l’habitude d’être aussi mal reçue. Mais j’aurai ma revanche. Je pense – la vieille chèvre !… Ah ! Merci mon dieu ! Elle est là. Un peu plus sombre, mais la même – juste là où j’aurais posé le bout de mon doigt dans le noir. Maintenant, que les vers la mangent », conclut-elle en remettant en place le linge et le drap. « Et nul hormis celui qui aurait été bien heureux de la voir, s’il avait été un peu meilleur que l’homme de Glenkindie dans la vieille balade et moi-même, aucun mortel ne le sait. »
Dès qu’elle eut réarrangé les vêtements de la morte, elle se retourna et se dirigea vers la porte avec un pas si léger qu’il contrastait avec la lourdeur de sa silhouette, et montrait une grande force musculaire, l’ouvrit d’un centimètre à peine, silencieusement, épia au travers de la fente, et voyant que la porte en face était encore fermée, se glissa en faisant rapidement tourner son corps en même temps que la porte, ferma la porte derrière elle, dégringola l’escalier, et quitta la maison. Pas une planche ne craqua, pas un loquet ne grinça alors qu’elle se sauvait. Elle partit dans la rue comme si elle était simplement venue rendre les derniers hommages à un mort en rapport avec sa fonction, projetant devant elle un air de dignité signe et symbole de sa bonne conscience et de son cœur généreux.
Chapitre III : Le châtelain fou
Quand Madame Catanach arriva, juste en face de sa porte d’entrée, à l’extrémité d’une rue qui descendait avec une forte pente vers le port, elle se redressa, et protégeant ses yeux en mettant sa main comme un petit auvent au-dessus, bien que le soleil fut déjà loin derrière elle, elle regarda vers le large. C’était le matin d’un jour du début de l’été. Les alouettes étaient nombreuses et bruyantes au-dessus d’elle – car, bien qu’elle fût dans une rue, elle n’était qu’à quelques mètres des champs verdoyants – mais elle n’aurait pas pu les entendre, car leur musique n’était pas pour elle. Vers le nord, où portait son regard – si on pouvait appeler cela un regard – c’était un ciel bleu presque sans un nuage surplombant une mer bleue presque sans une ombre ; deux fiers promontoires déchiquetés, un de chaque côté d’elle, formaient une large baie ; entre celui à l’ouest et le port à ses pieds, une grande courbe de sable jaune s’étendait, sur laquelle la longue houle née du vent de la veille, venait déferler avec fracas depuis le nord-est, bien que la tempête se fût apaisée en une brise – froide et sans guère d’influence. De la cheminée des maisons de pêcheurs plus bas, s’élevait une fumée jaunâtre, qui, sur le fond bleu de la mer, prenait une couleur vert pâle tandis qu’elle se dissipait vers le sud-ouest. Mais Madame Catanach ne regardait rien et ne cherchait rien : elle n’avait pas de mari pêcheur, ni de parent en mer ; elle ne faisait que retourner quelque chose dans son esprit malsain, et c’était sa façon de dissimuler une opération qui se serait exécutée la tête inclinée et les yeux sur le sol.
Alors qu’elle se tenait ainsi une étrange silhouette se rapprocha avec des pas presque aussi silencieux que ceux qu’elle avait elle-même faits lorsqu’elle s’échappait de la maison de Mademoiselle Horn. À quelques mètres de distance la silhouette se tenait debout, et la regardait avec autant d’intensité qu’elle semblait elle-même scruter la mer. C’était un homme de petite taille et d’un âge incertain, avec une énorme bosse dans le dos, des traits d’une grande finesse, une longue barbe fine et un front anormalement large, au-dessus d’yeux, qui bien que d’un bleu pâle, mêlé d’une lueur laiteuse, lui donnaient une expression pathétique de petit chien. Habillé décemment de noir, il se tenait les mains dans les poches de son pantalon, fixant immobile le visage de Madame Catanach.
Réalisant soudain sa présence, elle baissa le regard, sursauta violemment, poussa presque un cri et dit avec rudesse : « Dieu me garde ! D’où venez-vous ? »
Ce n’était pas qu’elle ne le connût pas, ni qu’elle lui en voulût : ses mots exprimaient juste sa surprise : mais leur effet fut bizarre.
Sans autre mouvement, il tourna soudainement sur un talon, scruta la mer de ses yeux brillants, tandis que ses joues s’empourpraient, mais, apparemment trop poli pour refuser de répondre à la question clairement déplaisante, il répondit d’un ton bas et presque renfrogné :
« Je ne sais pas d’où je viens. Vous savez que je ne sais pas d’où je viens. Je ne sais pas d’où vous venez. Je ne sais pas d’où quiconque vient. »
« Allez, châtelain ! Ne vous fâchez pas ! » répondit Madame Catanach. « Ce n’est pas votre faute. Qu’est-ce qui vous prend de regarder ainsi les gens, sans leur signaler votre présence ? »
« Je croyais que vous regardiez d’où vous veniez », répondit l’homme d’un ton d’excuse hésitant.
« Je ne faisais rien de tel », dit Madame Catanach
« Tant que vous savez encore où vous allez », suggéra l’homme.
« Pfft ! Je ne me soucie guère de cela non plus et j’en sais autant sur l’un que sur l’autre », répondit-elle dans un rire qui lui racla la gorge exprimant une pitié méprisante.
« Je n’en sais guère plus », dit l’homme. « Je ne sais pas d’où je viens, et pas plus où je vais ; mais je sais que je retourne d’où je viens. C’est logique, voyez-vous ; mais on m’a dit que vous saviez d’où nous venons tous. »
« Si diablement peu ! » persista Madame Catanach, comme pour le contredire. « Que m’importe d’où je viens, tant que - »
« Tant que quoi, je vous prie ? » supplia l’homme, avec un espoir enfantin dans la voix .
« Eh bien, puisque vous y tenez, tant que je viens de ma mère », dit la femme, en toisant son interlocuteur d’un rire vulgaire.
Le bossu poussa un cri d’angoisse, se retourna et prit la fuite ; et comme il se retournait de longues mains fines et blanches s’envolèrent de ses poches, vinrent lui boucher les oreilles, alors que ses doigts se nouaient derrière sa nuque. Et vif comme l’éclair, il dévala la pente raide vers le rivage.
« Diable, voilà que je l’ai fâché ! » dit la femme, puis elle s’en alla, en éclatant d’un rire satisfait.
Le titre qu’elle avait donné au bossu n’était pas un surnom. Stephen Stewart était bien châtelain des pauvres terres et de la vieille maison des Kirkbyres, dont sa mère gérait les affaires – pas tellement pour son fils, vu que, en dehors de ses vêtements et de cinq livres par an d’argent de poche, il ne retirait guère d’avantage de ses possessions. Il ne s’approchait jamais de sa maison, car, pour quelque raison inconnue, largement discutée dans son dos par ses voisins, il détestait tant sa mère qu’il ne supportait pas le nom de mère, pas même la moindre allusion à ce lien familial.
Certains le disaient idiot ; d’autres, fou ; d’autres, les deux ; mais aucun ne disait qu’il fût un voyou ; et tous auraient été d’accord pour reconnaître que quelle que soit l’origine de sa différence d’avec les autres hommes, il soufflait de ce trouble quelque chose comme un air de douce humanité.
Le long du rivage, dans la direction du grand promontoire rocheux qui fermait la baie sur l’ouest, les mains bouchant toujours ses oreilles, comme si les mots horribles le poursuivaient, il volait plutôt qu’il ne fuyait. La marée était presque basse, et le sable mouillé offrait une route aisée à ses pieds volants. Entre mer et rivage, telle la venue d’une voile, seule autre chose en déplacement dans ce paysage solitaire, comme une créature chassée il filait, ses traces fondant et s’effaçant derrière lui dans des sables presque mouvants.
Là ou la courbure de la ligne d’eau tournait vers le nord, au pied du promontoire, six ou huit bateaux de pêche avaient été tirés sur la plage présentant des stages différents d’existence. L’un était à peine construit à moitié, le bois neuf brillant sur un fond de sombre rocher. Un autre venait d’être goudronné ; ses flancs luisaient de ce brun ombragé et remplissaient l’air d’une odeur réconfortante. Un autre portait l’âge d’un long abandon sur chaque planche et chaque couture ; la moitié de ses supports avaient coulé ou s’étaient désagrégés, et le grand vide ouvert sur le côté, montrait la désolation de son ossature émaciée et de son intérieur vide, produisait l’effet fantasmatique d’un désert marécageux ; quelques vieilles flaques d’eau envahies de saleté verdâtre reposaient au fond entre les armatures pourrissantes, tandis que les planches du haut cuisaient et éclataient au soleil. Pas loin de là un chemin escarpé escaladait la falaise, d’où, traversant prairies et labours, il conduisait au travers du promontoire au village de pêche de Scaurnose qui était de l’autre côté. Le châtelain fou, ou le fou bossu, comme l’appelaient les plus vils, y trouvait un abri, le plus souvent auprès de la famille d’un certain Joseph Mair, l’un des habitants les plus respectables de l’endroit.
Mais le chemin qu’il suivait maintenant était près des falaises, il était rocailleux et difficile. Il passa les bateaux, passant entre eux et la falaise, d’un pas soutenu, les yeux rivés au sol, et ne jeta pas même un regard aux deux hommes qui travaillaient sur le bateau pas encore achevé. L’un d’eux était son ami Joseph Mair. Ils cessèrent leur travail un instant pour le regarder.
« C’est encore le pauvre châtelain », dit Joseph, dès qu’il fut hors d’entente. « Quelque chose ne va pas. Je me demande ce qui lui est arrivé ! »
« Ça fait un bout de temps que je ne l’avais pas vu », répondit l’autre. « On raconte que sa mère l’a voué au diable avant qu’il ne voie le jour ; et à cause de cela, lorsque son anniversaire approche, Satan s’empare de lui. Et, il fait peur à voir dans cet état ! » continua-t-il. « Je l’ai rencontré une fois, au crépuscule, juste au bord de la ville, avec les yeux brillant comme des lampes à pétrole, et la barbe dégoulinante de bave. Je me suis enfui comme si je voyais Satan en personne. »
« Vous n’aviez pas besoin de faire ça », fut la réponse. « Il est aussi inoffensif, même dans le pire des cas, qu’un agneau. C’est une créature pure qui ne comprends pas ce qui lui arrive. Satan a encore moins à voir avec lui qu’avec n’importe quel homme que je connaisse. »
Chapitre IV : Phemy Mair
Avec le regard fixe, comme si c’étaient ses yeux et non ses oreilles qui étaient l’organe de l’ouïe, cet échange fut entendu par une enfant d’à peu près dix ans, assis au fond d’un bateau pourri, comme une perle dans une coquille d’huître en décomposition, une main arrêtée alors qu’elle barbotait dans une flaque verdâtre, l’autre sur le chemin de ses lèvres avec une bouchée d’algues Dulse1. C’était la fille de Joseph Mair, dont nous venons de parler – un pêcheur qui avait navigué sur un bateau de guerre (en conséquence de quoi il était surnommé Pierre le bleu), où comme on avait apprécié sa compétence, il était employé comme matelot charpentier, et où il devint très habile avec ses outils : ayant mis un peu d’argent de côté en servant sur le bateau d’un autre, il était maintenant en train de s’en construire un pour lui-même.
C’était un homme à la peau sombre, à l’air étranger, avec des boucles en or aux oreilles, qui d’après lui, lui permettaient de voir au-delà du vent « sans faire pleurer ses yeux. » Contrairement à la plupart de ses camarades, il était sobre et c’était un homme réfléchi, prêt à écouter la voix de la raison de quelque côté qu’elle vienne ; c’étaient en général, des hommes courageux et travailleurs, faisant face comme par évidence à des temps périlleux tels que de nombreux pêcheurs sur la plupart de nos côtes auraient refusé de les affronter, et à la saison de la pêche ils étaient tout dédiés à leur métier, et se faisaient pas mal d’argent ; mais quand le temps ne permettait pas d’aller en mer, quand leurs filets étaient en bon état, et qu’il n’y avait pas de tâches à faire, ils faisaient des concours de boissons, et dépensaient une grande part de ce qui aurait dû être leurs réserves pour l’hiver.
Leurs femmes étaient en général peu sophistiquées et avaient un parler grossier ; souvent fortes et courageuses, avec un caractère bien trempé. Elles étaient presque toujours filles de pêcheurs, car une femme choisie dans la population rurale n’aurait guère pu faire face aux tâches spécifiques qui leur revenaient. Si elles étaient moins dangereuses que celles de leurs maris, elles étaient tout aussi exigeantes, et moins intéressantes. La plus dure consistait à porter le poisson dans la campagne pour le vendre, dans un énorme panier ou nasse, qui une fois rempli pesait plus que ce qu’un homme peut soulever pour le mettre sur le dos de sa femme. Avec cette charge, maintenue en place par des bandes croisées sur sa poitrine, elle pouvait marcher jusqu’à trente kilomètres, arrivant dans une ville de l’intérieur tôt le matin, à temps pour fournir ses poissons pour les besoins de la journée. Je peux même ajouter, que bien que son aîné fut probablement né dans les quelques semaines suivant son mariage, l’infidélité était quasiment inconnue parmi elles.
D’un certain côté, bien que pour aucune de ses bonnes qualités, Madame Mair était une exception parmi elles. Sa mère avait été la fille d’un petit fermier, et elle avait des parents aisés dans une paroisse de l’intérieur ; mais il est difficile de dire en quoi cela eut un effet sur le reste : elle était certainement une de ces élues que la Nature envoie dans le monde pour rendre ses autres enfants plus doux et plus généreux. Elle était encore élancée et jolie, avec un teint clair, et les plus jolies dents qu’on puisse imaginer ; elle aurait perdu au moins les deux premiers avantages depuis longtemps, si la prudence de son mari n’avait pas rendu le travail pénible moins indispensable, il était très attaché à sa beauté ; et s’il n’y avait pas eu sa sœur aînée, à lui, forte et honnête qui vivait avec eux, et qu’il n’aurait pas été gentil de priver des tâches les plus pénibles, vu que c’était la seule façon pour elle de trouver assez de force et de goût de vivre. Alors que Janet Mair portait la nasse, Anny ne faisait qu’aider pour l’entretien des filets, le nettoyage et le séchage des poissons, dont ils fumaient une grande quantité ; cela, en plus de ses tâches domestiques et de ses devoirs maternels, suffisait amplement à l’occuper. Leurs enfants étaient bien élevés, et par force, vu l’étroitesse de leur habitation, passaient beaucoup de temps avec leurs parents, ce qui leur donnait l’occasion d’entendre largement de quoi développer leurs facultés.
Le châtelain fou, comme je l’ai dit, leur rendait plus souvent visite qu’à qui que ce soit d’autre. Il dormait alors dans un grenier auquel on accédait par une échelle depuis le rez-de-chaussée, qui était constitué d’une cuisine et d’un placard. La petite Phemy Mair était donc habituée à son apparence, ses habitudes et sa façon de parler ; elle était sa préférée, même si jusque-là, sa timidité l’avait empêché de nouer des liens avec même une enfant de dix ans.
Après que le pauvre homme se soit encore éloigné d’une bonne distance au-delà des bateaux, il s’arrêta et retira ses mains de ses oreilles : le bruit de la mer s’engouffra, d’autant plus violemment que les cavernes de son cerveau lui avaient été longtemps fermées. Avec un soupir plaintif, il se pressa à nouveau les paumes sur les oreilles, et devenu sourd à nouveau, il hurla d’une voix d’agonie dans le bruit de la mer montante : « Je n’sais pas d’où je viens ! » après ce cri, arraché à la peine de l’ignorance humaine, il prit à nouveau ses jambes à son cou, mais avec moins de légèreté et de vitesse qu’avant, et prit la fuite en trébuchant et grimpant sur les rochers.
À peine eut-il disparu de la vue des bateaux, que Phemy s’arracha à sa grosse coquille de moule. Comme la partie haute du bateau était tournée vers le bateau où son père travaillait, elle s’échappa sans être vue, elle courut à la base du promontoire, où le chemin rugueux était sans doute plus adapté aux pieds d’un enfant content de faire de plus petites enjambées et de grimper ou descendre à l’aide d’aspérités plus insignifiantes. Le châtelain lui réapparut, juste au moment où il pénétrait une grotte bien connue où il disparut.
Phemy était d’une de ces natures rares et bénies dotées d’un courage illimité, car dénuées de méfiance, et elle se précipita dans la grotte après lui, sans même s’arrêter pour regarder à l’intérieur.
Ce n’était pas une grotte très intéressante à regarder. La strate dont elle était composée, s’élevait presque à la verticale, et formait une ouverture semblable à une demi arche gothique coupée sur la verticale et légèrement penchée d’un côté, cette ouverture montait jusqu’en haut de la grotte, et semblait révéler tout l’intérieur sur un simple coup d’œil. Sa longueur faisait seulement quatre à cinq fois sa hauteur. Le sol était lisse et sec, un rocher solide. Les murs et la voûte étaient déchiquetés avec des excroissances et ombrés de cavités, mais il n’y avait pas de quoi éveiller des peurs imaginaires.
Quand Phemy entra, il n’y avait aucune trace du châtelain. Mais elle alla directement au fond de la grotte, le point le plus éloigné qu’elle puisse voir. Là, elle contourna une excroissance et commença une escalade que seule l’habitude des rochers permit d’accomplir à une telle enfant. En haut, elle passa au travers d’une autre ouverture, et par une descente plus longue et plus douce elle atteignit le plancher d’une deuxième grotte, aussi horizontal, et presque aussi lisse qu’une table. Sur sa gauche, le peu de lumière qui avait réussi à filtrer au travers du chemin tortueux était aspirée et se réfléchissait en pâle lueur depuis la surface floue d’un puits d’eau douce qui affleurait dans une sorte de bassin creusé dans le rocher : sur une pierre couchée à côté, le châtelain était assis, la tête dans les mains, les coudes sur les genoux, et sa bosse dominait sa tête, comme le mont Sinaï celle des chrétiens dans « The Pilgrim’s Progress2 ».
Comme ses mains étaient encore pressées sur ses oreilles, il n’entendit rien de l’approche de Phemy, et elle se tint debout le fixant du regard dans la vague lueur, apparemment sans inquiétude de ce qui pourrait arriver ensuite.
Elle finit par se lasser – car le pauvre homme restait immobile, plongé dans ses pensées, ou ce qu’il avait en guise de pensées – les yeux de l’enfant se mirent à se promener dans l’ombre, à laquelle ils s’étaient déjà assez accoutumés pour profiter de la faible lumière. Soudain, elle crût voir quelque chose briller dans l’ombre – deux choses : ce devait être des yeux ! – les yeux d’une loutre ou d’un putois, dont les grottes de la côte étaient largement peuplées. Prise d’une peur soudaine, elle courut jusqu’au châtelain et posa sa main sur son épaule, en criant : « Regardez, châtelain, regardez ! »
Il bondit sur ses pieds et posa sur l’enfant un regard surpris, se frottant les yeux de façon répétée. Elle se tenait entre le puits et l’entrée, de sorte que toute la lumière se posait sur son visage pâle.
« D’où venez-vous ? » cria-t-il.
« Je viens du vieux bateau », répondit-elle.
« Que me voulez-vous ? »
« Rien, monsieur ; je suis juste venue voir comment vous alliez. Je ne vous aurais pas dérangé, monsieur, si je n’avais vu les deux yeux d’un putois, ou d’un autre animal, briller dans l’ombre, ça m’a fait peur et je me suis raccrochée à vous. »
« Allons, allons ; asseyez-vous, ma petite », dit le châtelain fou d’une voix rassurante ; « le putois ne va pas vous toucher. Vous n’avez pas peur de moi, si ? »
« Non ! » répondit l’enfant. « Pourquoi aurais-je peur de vous ? Je suis Phemy Mair. »
« Eh, c’est bien vous ma petite, n’est-ce pas ? » répondit-il avec satisfaction, car jusque-là, il ne l’avait pas reconnue. « Asseyez-vous, asseyezvous, et on va s’en occuper. »
Phemy obéit, et s’assit sur l’excroissance la plus proche.
Le châtelain se mit à côté d’elle, et enfouit à nouveau son visage, mais pas ses oreilles dans ses mains. Aucun son n’entra, toutefois, autre que celui de la marée montante, car Phemy était assise à côté de lui dans la lueur du crépuscule, sans aucune inquiétude et donc sans mot dire.
Le soir continua d’avancer, et la nuit tomba, mais le seul effet de la pénombre grandissante fut que l’enfant se rapprocha peu à peu de son compagnon bizarre, jusqu’à ce que sa main se glisse dans la sienne, sa tête s’appuie sur son épaule, il passa son bras autour de ses épaules pour la protéger, et elle s’endormit profondément. Un peu plus tard, le châtelain la réveilla doucement et la ramena chez elle, lui demandant en chemin, avec des paroles étranges, mais qu’elle comprenait, de ne pas dire où elle l’avait trouvé, parce que si elle révélait le lieu de son refuge, de méchantes personnes viendraient le prendre, et qu’elle ne le verrait jamais plus.
1 Algue rouge, la Dulse a un goût unique, à la fois doux et corsé, iodé, voir de noisette, que l’on pourra associer à beaucoup d’autres saveurs.
2 Le Voyage du pèlerin est un roman allégorique de John Bunyan, publié en 1678. L’auteur rédigea cet ouvrage en 1675, alors qu’il était emprisonné pour avoir violé le Conventicle Act, qui punissait les personnes coupables d’avoir organisé des services religieux non autorisés et sans supervision de l’Église anglicane.
Chapitre V : Lady Florimel
Toute la côte à l’est du petit port consistait en un rocher, fier et élevé, d’une pierre dure gris-brun, qui après un large balayage, filait au nord, et fermait la baie de ce côté d’un deuxième grand promontoire. La deuxième longue bande de sable à l’ouest, qui menait au promontoire de Scaurnose, était la seule partie ouverte de la côte sur des kilomètres. Là, le vaisseau qui rentrait au port, filant le long de la côte avait la vue plaisante de champs ouverts, de ceintures de forêts et de fermes, apercevant de temps à autre une grande maison au milieu de ses arbres. Plus loin une ou deux collines dénudées et solitaires, n’en imposant que par leur désolation, car leur forme ne soulignait guère leur altitude, s’élevaient à plus de troiscent mètres.
Sur cette partie plutôt plane de la côte, parallèlement à sa ligne et audelà de la ligne habituelle des hautes eaux, les vagues de dix mille tempêtes de vent du nord avaient construit une longue dune ou un banc de sable, finissant à l’ouest à deux pas d’un gigantesque rocher solitaire du genre affreux qu’on appelle conglomérat, qui avait dû être coupé des racines du promontoire par les eaux rugissantes lors de marées exceptionnellement fortes, car en hiver il leur arrivait encore de faire le tour du rocher, et en coulant de l’autre côté de la dune d’en faire une longue île. Le sable de la dune, du côté de la terre, était couvert d’une herbe courte et douce, que les moutons broutaient, et avec les plus grandes et les plus rouges des marguerites, il était ainsi parfois balayé par de sauvages vagues salées, et d’autres fois, quand le vent du nord soufflait droit comme une flèche et affûté comme une épée en provenance de la région des neiges éternelles, se recouvrait d’un drap de glace scintillante.
Le soleil était levé depuis quelque temps déjà dans un ciel sans nuage. Le vent avait tourné au sud, et faisait flotter de doux parfums de la campagne vers la côte, au lieu de balayer vers les fermes de l’intérieur des odeurs d’algues et d’eau salée, mêlées d’un soupçon d’iceberg. Et depuis ce qu’on appelle la ville côtière, de Portlossie, une foule de maisonnettes toutes habitées par des pêcheurs, une silhouette solitaire marchait vers l’ouest le long de cette herbe derrière la dune en chantant. À sa gauche le sol s’élevait vers la route haute ; à sa droite était la dune, entrelacée et arrimée par les longues racines tenaces de l’herbe éparse, sans lesquelles son sable aurait été le jouet des vents changeants. Elle lui cachait toute vue de la mer, mais le murmure et le flux des vagues de la mer montante s’entendaient juste derrière. Dans son dos s’élevait la ville de Portlossie, bien au-dessus du port et de la ville côtière, avec ses maisons en pierres gris-brun, aux toits d’ardoises bleues ou de tuiles rouges. Ce n’était pas une ville des Highlands – presque personne dans ses murs ne savait parler la langue des Highlands, pourtant au bas de ses rues hautes, dans le bon air du matin flottait maintenant par intermittence le son de la cornemuse – tournoyant de rue en rue, et soufflé avec force pour réveiller les habitants endormis et leur faire savoir qu’il était maintenant six heures du matin.
C’était un jeune homme d’environ vingt ans, à la démarche longue et dansante, le pied assuré, la progression rapide – un mouvement différent de celui des autres hommes de l’endroit, qui marchaient toujours lentement, et ne couraient qu’en cas de danger grave. Il était plutôt grand, bien bâti. Il était habillé comme un pêcheur, un pantalon de serge bleue, une chemise à rayures bleues et blanches, et un pull marin de Guernesey, qu’il portait jeté sur l’épaule. Sur sa tête, il portait un bonnet bleu rond avec un pompon rouge au milieu.
Son visage était plus que beau – avec les traits fermes, pas finement découpés, et un air combinant noblesse et intelligence – cette dernière proche de la simplicité, ou même de l’innocence ; tandis que le clair regard de ses yeux noisette largement ouverts indiquait courage et rapidité. Ses cheveux brun foncé s’échappaient en masses bouclées de son bonnet. C’est un visage qui aurait attiré le regard de tous dans une rue passante.
À peu près au milieu de la longue dune, une sorte d’embrasure large était découpée sur le dessus, dans laquelle se tenait un vieux canon pivotant en fonte : quand le jeune homme atteignit l’endroit, il escalada d’un bond la pente, s’assit sur le canon, sortit de son pantalon une grosse montre en argent, la fixa quelques minutes, la remit en place, et prit dans sa poche une pierre à fusil, avec laquelle il alluma un boutefeu et se levant l’appliqua sur la lumière de canon. Il s’ensuivit un énorme grondement.
Son écho s’était presque tu, lorsqu’un petit cri parvint à son oreille attentive, et balayant la côte du regard pour trouver d’où il provenait, il aperçut une femme sur un rocher plat qui s’avançait un peu dans l’eau. Elle s’était à moitié levée de sa position assise, et apparemment son cri venait de ce qu’elle découvrait que la marée montante l’avait dépassée et encerclée. Il n’y avait pas le moindre danger, mais la fille avait peut-être peur de plonger dans l’eau émeraude claire où ondulaient des algues qui habillaient les pentes glissantes du rocher. Il se précipita depuis la dune, en criant, alors qu’il s’approchait d’elle, « ne vous inquiétez pas Madame, attendez que je vienne à vous », et courant droit dans l’eau, luttant contre la marée montante, car la distance était courte et la profondeur presque insuffisante pour nager. En un instant, il fut à ses côtés, vit à peine ses pieds nus qu’elle avait plongés dans l’eau, ne fit pas plus attention au léger signe de la main qui repoussait son aide, la prit dans ses bras comme un bébé, et la ramena en sécurité sur le rivage avant qu’elle n’ait pu dire un mot ; et il ne s’arrêta pas avant d’avoir monté la pente de la dune, où il la déposa doucement sans soupçonner avoir pris une quelconque liberté, et rempli de sa passion de rendre service, il se mit à lui sécher les pieds avec le pull qu’il avait laissé là avant de courir à son secours.
« Laissez-moi seule, je vous prie », cria la fille avec une indignation à moitié amusée, retirant ses pieds et jetant un livre qu’elle tenait pour mieux les cacher sous ses jupons. Mais bien qu’elle refusât sa dévotion, elle ne pouvait pas ne pas la reconnaître, ni s’empêcher d’apprécier sa gentillesse. Elle ne s’était probablement jamais trouvée directement redevable envers un être de la race humaine, aussi mal attifé, mais bien qu’il fût habillé de la sorte elle ne put s’empêcher de voir que c’était un beau jeune homme. Et cette impression ne changea pas non plus lorsqu’il ouvrit la bouche pour parler dans le patois du pays, car elle n’avait aucune raison de confondre sa simplicité avec de la vulgarité.
« Où sont vos bas, Madame ? » dit-il.
« Vous ne m’avez pas laissé le temps de les emporter, vous m’avez saisie si – grossièrement », répondit la fille à moitié querelleuse, mais d’une voix si jolie que jamais ses oreilles écossaises n’en avaient entendue de telle.
Avant que ces mots n’aient quitté ses lèvres il était déjà en chemin pour le rocher, courant de ses grands pas assurés. Les chaussures et les bas abandonnées étaient en grand danger d’être emportés au loin par la mer montante, mais il se précipita, fit quelques brasses, les attrapa, pataugea jusqu’au rivage, et, laissant sur tout le chemin derrière lui une trace mouillée, mais portant devant lui à bout de bras les vêtements sauvés, rejoignit leur propriétaire. Étendant devant elle son pull, il déposa dessus les chaussures et les bas, et voyant qu’elle gardait ses pieds cachés sous les jupons de sa robe, il se retourna et se tint debout.
« Pourquoi ne partez-vous pas ? » dit la fille, risquant les orteils d’un pied de dessous leur tente, mais hésitant à poursuivre.
Sans un mot et sans tourner la tête, il s’en alla.
Soit qu ‘elle fut flattée par son obéissance totale, et persuadée qu’il était un vrai gentilhomme, soit qu’elle ne voulut renoncer au plaisir qu’elle pourrait prendre à ses dépens, elle retira le pied qui avait commencé à sortir, et, certainement poussée par une prédisposition à taquiner, elle parla à nouveau.
« Vous ne partez pas sans me remercier ? » dit-elle.
« Vous remercier de quoi, Madame ? » répondit-il simplement, s’arrêtant net, lui tournant toujours le dos.
« Vous n’avez pas besoin de rester comme ça. Vous ne pensez quand même pas que j’allais me rhabiller alors que vous restiez en vue. »
« C’était comme si j’étais déjà parti, Madame », dit-il, et tournant son visage radieux, il la regarda un moment, puis baissa les yeux vers le sol.
« Dites-moi pourquoi vous ne voulez pas me remercier », insista-t-elle.
« Ce seraient des remerciements bien pauvres, Madame, qui seraient donnés avant d’en connaître la raison. »
« De vous avoir permis de me porter jusqu’au rivage, bien sûr. »
« Soyez en remerciée, Madame, de tout mon cœur. Dois-je m’agenouiller ? »
« Non. Pourquoi devriez-vous vous agenouiller ? »
« Parce que vous êtes bien trop belle à regarder debout, Madame, et je craindrais de vous offenser. »
« Ne m’appelez pas Madame. »
« Comment dois-je dire, alors, Madame ? – Je vous demande pardon, Madame. »
« Dites Milady. C’est ainsi que les gens s’adressent à moi. »
« Je me disais bien que vous deviez être quelqu’un d’importance, Milady ! C’est pour ça que vous êtes aussi exceptionnellement belle », répondit-il avec un léger tremblement dans la voix. « mais vous devriez remettre vos bas, Milady, si vous ne voulez pas que vos pieds ne prennent froid, ce qui n’est guère recommandé aux personnes comme vous. »
L’appellation qu’elle lui avait recommandée d’utiliser ne lui donnait aucune idée précise de son rang. Mais il confirmait l’idée qu’elle était une dame, bien plus distinguée que celles de sa condition à lui dans la vie.
« Mais, alors, dites-moi, s’il vous plaît, ce qui va vous arriver », répondit-elle, « avec vos vêtements aussi trempés que l’eau puisse les rendre ? »
« L’eau salée me connaît trop bien pour me causer du mal », répondit le jeune homme. « Je me promène souvent le jour trempé jusqu’à l’os du matin au soir et la nuit du soir au matin – lors de la pêche au hareng, vous savez, Milady. »
On serait en droit de se demander ce qui l’avait encline à parler de façon aussi familière à une créature comme lui – certes humaine, mais séparée d’elle par une barrière bien plus infranchissable que celle qui la séparait, elle, des trônes, principautés et autres puissances de la haute société ? Et comment expliquer qu’elle ait pu se permettre, à ce moment-là, de sortir un pied délicat, et attrapant un de ses bas, commencer à l’enfiler doucement sur ledit pied ? Soit le sens de son infériorité était tel qu’elle ne considérait pas plus sa présence que celle d’un chien, soit qu’elle fut tentée de tester son attitude. Lui, de son côté, se tenait tranquillement, observant l’opération, soit qu’ayant nativement l’instinct du raffinement, il était conscient de ne pas devoir montrer plus de pudeur que la demoiselle elle-même, soit qu’il fut aussi peu habitué à la vue d’un poisson scintillant qu’à celle du pied nu d’une jeune fille.
« Je me dis, Milady », continua-t-il, en toute simplicité, « que votre pied a dû danser de nombreuses fois, sur de nombreux planchers. »
« Quel âge me donnez-vous donc, alors ? » répondit-elle tandis qu’elle continuait à passer le bas au-dessus de son pied, le plus rapidement possible.
« Vous ne devez guère avoir plus de vingt ans », dit-il.
« Je n’ai que seize ans », répondit-elle, en riant joyeusement.
« Je ne l’aurais jamais cru ! » s’exclama-t-il après un instant d’étonnement.
« Vous arrive-t-il de danser par ici ? », demanda-t-elle, sans réagir à sa surprise.
« Pas trop, du moins parmi les pêcheurs, sauf aux mariages. J’y étais justement hier soir. »
« Et avez-vous dansé ? »
« Certainement, Milady. J’ai dansé avec la plupart des jeunes-filles, jusqu’à ce qu’elles n’aient plus la force de tenir sur leurs jambes. »
« Qui vous a rendu si cruel ? »
« Eh bien, vous voyez, Madame, – je veux dire Milady, – les gens disaient que j’étais entiché de la mariée ; et j’ai donc dû danser jusqu’à leur sortir cette idée de la tête. »
« Et qu’y avait-il de vrai dans ce qu’ils disaient ? » demanda-t-elle, lançant un petit regard malin vers son beau visage, maintenant rayonnant.
« À supposer qu’il y ait eu quelque chose de vrai, ce n’était vraiment pas grand-chose », répondit-il. « Nous étions amis d’enfance. Mais c’était la plus belle jeune fille que nous avions. C’était ce que nous appelons un mariage payant3 », continua-t-il, comme s’il souhaitait changer de sujet.
« Et qu’est-ce que c’est qu’un mariage payant ? »
« C’est une sorte de coutume chez les pêcheurs. Certains d’entre eux sont vraiment très pauvres, vous voyez, et quand deux d’entre eux se marient, les autres veulent les aider à démarrer dans la vie. Alors, nous allons au mariage, mangeons et buvons à satiété, nous payons ce que nous consommons ; et cela crée un bon bénéfice, car les choses sont loin de coûter le prix que nous les payons. Et ainsi, il leur reste quelque argent pour se lancer dans la vie. »
« Et qu’est-ce qu’ils vous donnent à manger et à boire ? » demanda la jeune fille, histoire de parler.
« Oh, de la viande avec de la moutarde à manger et du whisky à boire », répondit le jeune homme en riant. « Mais c’est surtout pour la fête. Je n’aime pas trop le whisky et ce genre de choses pour ma part. Ce sont les violons et la danse qui me plaisent. »
« Alors, vous avez de la musique ? »
« Oui ; juste des violons et des vents. »
« Vous voulez-dire des cornemuses ? »
« Oui ; mon grand-père en joue. »
« Mais vous n’êtes pas dans les Highlands ici : comment faites-vous pour avoir des cornemuses ? »
« C’est juste une cornemuse égarée. Mais les gens d’ici aiment assez son cri, et apprécient d’être réveillés par elle le matin. C’est mon grand-père que vous avez entendu avant que je ne tire le canon. C’est sa cornemuse qui réveillait ces honnêtes gens. »
« Et pourquoi avez-vous tiré le canon de façon si téméraire ? Ne savezvous pas que c’est très dangereux ? »
« Dangereux, Madame – Milady, je veux dire ! Il n’y avait rien jusqu’à ce que je mette une pincée de poudre à canon. Ça ne ferait même pas s’envoler l’écume de la houle. »
« Ça m’a presque fait perdre mes moyens. »
« Je suis désolé, si je vous ai effrayée. Mais, si je vous avais vue, j’aurais quand même dû tirer le canon. »
« Je ne vous suis pas bien ; mais je suppose que vous voulez dire que cela rentrait dans vos obligations de tirer le canon. »
« Tout à fait, Milady. »
« Pourquoi ? »
« Parce que le conseil a décrété que le canon devait être tiré à six heures chaque matin – au moins tant que Monsieur le marquis, réside au château de Portlossie. Voyez-vous, c’est un burgh royal4, ici, et ça ne coûte que quelques centimes, et ça fait grandiose d’avoir un petit canon à tirer. Et si je négligeais de tirer le canon, mon grand-père aurait continué à sonner de la cornemuse, Milady, ou comment dit-on cela en anglais ? »
« Je ne sais pas, je dirais jouer de la cornemuse. »