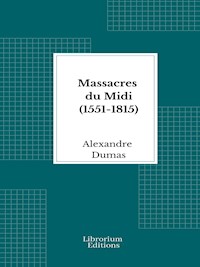
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nîmes, réunie à la France par Louis VIII, gouvernée par ses consuls, dont le pouvoir, substitué à celui de Bernard Athon VI, son vicomte, date de l’an 1207, venait à peine de célébrer, sous l’épiscopat de Michel Briçonnet, la découverte des reliques de saint Bauzile, martyr et patron de la ville, lorsque les doctrines nouvelles se répandirent en France. Le Midi eut tout d’abord sa part de persécution, et, en 1551, la sénéchaussée de Nîmes fit brûler en place publique plusieurs religionnaires, au nombre desquels se trouvait Maurice Sécenat, missionnaire des Cévennes, surpris en flagrant délit de prédication. Dès lors, Nîmes eut deux martyrs et deux patrons, l’un révéré par les catholiques, l’autre, par les protestants ; et saint Bauzile, après vingt-quatre ans de règne, fut forcé de partager les honneurs du protectorat avec son nouveau concurrent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
MASSACRES DU MIDI1551-1815
Alexandre
Dumas
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383835233
Peut-être notre lecteur, préoccupé seulement de ses derniers souvenirs, qui remontent à la Restauration, s’étonnera-t-il du large cadre dans lequel nous enfermons le tableau que nous allons mettre sous ses yeux et qui n’embrasse pas moins de deux siècles et demi : c’est que toute chose a son précédent, toute rivière, sa source, tout volcan, son foyer ; c’est que, de 1551 à 1815, tout a été, sur le point de la terre où nous portons le regard, action et réaction, vengeance et représailles ; c’est que les annales religieuses du Midi ne sont rien autre chose qu’un registre en partie double tenu par le fanatisme au profit de la mort, et écrit d’un côté avec le sang des catholiques, et de l’autre avec celui des protestants.
Dans ces grandes commotions politiques et religieuses du Midi dont les tressaillements, pareils à des tremblements de terre, ont parfois ébranlé jusqu’à la capitale, Nîmes s’est toujours fait centre. Nous choisirons donc Nîmes comme le pivot de notre récit, qui s’en éloignera quelquefois, mais qui y reviendra toujours.
Nîmes, réunie à la France par Louis VIII, gouvernée par ses consuls, dont le pouvoir, substitué à celui de Bernard Athon VI, son vicomte, date de l’an 1207, venait à peine de célébrer, sous l’épiscopat de Michel Briçonnet, la découverte des reliques de saint Bauzile, martyr et patron de la ville, lorsque les doctrines nouvelles se répandirent en France. Le Midi eut tout d’abord sa part de persécution, et, en 1551, la sénéchaussée de Nîmes fit brûler en place publique plusieurs religionnaires, au nombre desquels se trouvait Maurice Sécenat, missionnaire des Cévennes, surpris en flagrant délit de prédication. Dès lors, Nîmes eut deux martyrs et deux patrons, l’un révéré par les catholiques, l’autre, par les protestants ; et saint Bauzile, après vingt-quatre ans de règne, fut forcé de partager les honneurs du protectorat avec son nouveau concurrent.
À Maurice Sécenat succéda Pierre de Lavau. À quatre ans de distance, ces deux prédicateurs, dont les noms surnagent au-dessus de beaucoup d’autres noms de martyrs obscurs et oubliés, furent mis à mort sur la place de la Salamandre. Toute la différence qu’il y eut entre eux, c’est que le premier fut brûlé et le second pendu.
Pierre de Lavau avait été assisté à ses derniers moments par Dominique Deyron, docteur en théologie ; mais au lieu que ce fût, comme d’habitude, le prêtre qui convertît le patient, ce fut cette fois le patient qui convertit le prêtre. La parole qu’on avait voulu étouffer retentit donc de nouveau. Dominique Deyron fut décrété, poursuivi, traqué, et n’échappa au gibet qu’en se réfugiant dans la montagne.
La montagne est l’asile de toute secte qui s’élève ou qui tombe : Dieu a donné aux rois et aux puissants les villes, les plaines et la mer, mais, en échange de tout cela, aux faibles et aux opprimés, il a donné la montagne.
Au reste, la persécution et le prosélytisme marchaient d’un pas égal ; mais le sang produisit son effet ordinaire, il féconda le sol, et après deux ou trois ans de lutte, après deux ou trois cents huguenots brûlés ou pendus, Nîmes se réveilla un matin avec une majorité protestante. Ainsi, en 1556, les consuls de Nîmes avaient été vivement semoncés sur les tendances de la ville vers la réformation. En 1557, c’est-à-dire un an à peine après cette admonestation, le roi Henri II était forcé de remettre la charge de président au présidial aux mains du protestant Guillaume de Calvière. Enfin, une décision du juge mage ayant ordonné aux consuls d’assister en chaperon à l’exécution des hérétiques, les magistrats bourgeois protestèrent contre cet arrêt, et la puissance royale se trouva insuffisante pour le leur faire exécuter.
Henri mourut, et Catherine de Médicis et les Guises montèrent sur le trône sous le nom de François II : il y a toujours un moment où les peuples respirent, c’est pendant les funérailles de leurs rois : Nîmes profita de celles de Henri II, et, le 29 septembre 1559, Guillaume Moget y fonda la première communauté protestante.
Guillaume Moget venait de Genève : c’était l’enfant des entrailles de Calvin ; il arrivait à Nîmes avec la ferme résolution de convertir à la foi nouvelle tout ce qu’il y restait de catholiques ou de se faire pendre. Au reste, éloquent, vif, rusé, trop éclairé pour être violent et disposé à faire des concessions, si on voulait lui en faire1 ; toutes les chances étaient pour lui : aussi Guillaume Moget ne fut point pendu.
Du moment où une secte naissante n’est plus esclave, elle est reine : l’hérésie, déjà maîtresse des trois quarts de la ville, commença de lever hardiment la tête dans les rues. Un bourgeois, nommé Guillaume Raymond, prêta sa maison au missionnaire calviniste ; un prêche public s’y établit, la foi gagna les plus incertains ; bientôt, la maison se trouva trop étroite pour contenir la foule qui venait recevoir le poison de la parole révolutionnaire, et les plus impatients commencèrent à tourner les yeux vers les églises.
Cependant le vicomte de Joyeuse, qui venait d’être nommé gouverneur du Languedoc en remplacement de M. de Villars, s’inquiéta de ces progrès que les protestants ne cachaient plus, mais dont, au contraire, ils se vantaient ; il fit venir les consuls et les admonesta vertement au nom du roi, menaçant d’envoyer une garnison qui saurait bien mettre un terme à tous ces troubles. Les consuls promirent d’arrêter le mal sans qu’on eût besoin de leur adjoindre un secours étranger et, pour tenir leur promesse, doublèrent la garde du guet et nommèrent un capitaine de ville chargé exclusivement de la police des rues. Or, ce capitaine de ville qui avait mission de réprimer l’hérésie était le capitaine Bouillargues, c’est-à-dire le plus damné huguenot qui eût jamais existé.
Il résulta de cet heureux choix qu’un jour que Guillaume Moget prêchait dans un jardin et qu’il y avait foule au prêche, il survint une grande pluie : il fallait ou se disperser ou trouver un endroit couvert ; mais, comme le prédicateur en était à l’endroit le plus intéressant de son sermon, on n’hésita point un instant à s’arrêter au dernier parti. L’église de Saint-Étienne-du-Capitole se trouvait dans les environs. Un des assistants proposa ce lieu, sinon comme un des plus convenables, du moins comme un des plus commodes. La motion fut reçue avec enthousiasme ; la pluie redoublait ; on courut directement à l’église ; le curé et les prêtres en furent chassés, le Saint-Sacrement, foulé aux pieds, et les images pieuses mises en pièces. Puis, cette exécution faite, Guillaume Moget monta en chaire et reprit son prêche avec tant d’éloquence que les assistants, se montant la tête de nouveau, ne voulurent point borner là leurs exploits de la journée, mais coururent du même pas s’emparer du couvent des Cordeliers, où, séance tenante, ils installèrent Moget et les deux femmes qui, au dire de Ménard, l’historien du Languedoc, ne le quittaient ni jour ni nuit ; quant au capitaine Bouillargues, il s’était montré magnifique d’impassibilité.
Les consuls, convoqués une troisième fois, avaient bonne envie de nier le désordre ; mais il n’y avait pas moyen : ils se mirent donc à la merci de M. de Villars, qui était réinstallé dans sa place de gouverneur du Languedoc, et M. de Villars, ne s’en rapportant plus à eux, fit occuper le château de Nîmes par une garnison que la ville paya et nourrit, tandis qu’un gouverneur, assisté de quatre capitaines de quartier, établit une police militaire indépendante de la police municipale. Moget fut chassé de Nîmes et le capitaine Bouillargues, destitué.
François II mourut à son tour. Sa mort produisit l’effet ordinaire ; la persécution se relâcha, et Moget rentra dans Nîmes : c’était une victoire, et comme chaque victoire amène un progrès, le prédicateur conquérant organisa un consistoire, et les députés nîmois réclamèrent des temples aux états-généraux d’Orléans. Cette demande resta sans effet ; mais les protestants savaient comment s’y prendre en pareil cas : le 21 décembre 1561, les églises de Sainte-Eugénie, de Saint-Augustin et des Cordeliers furent prises d’assaut et nettoyées de leurs images en un tour de main : cette fois, le capitaine Bouillargues ne se contenta point de regarder faire, il dirigea les opérations.
Restait encore l’église cathédrale, où s’étaient retranchés, comme dans une dernière forteresse, les débris du clergé catholique ; mais il était évident qu’à la première occasion, elle tournerait au temple : cette occasion ne se fit point attendre.
Un dimanche, que l’évêque Bernard d’Elbène officiait, et que le prédicateur ordinaire venait de commencer son sermon, des enfants de réformés qui jouaient sur le parvis de l’église huèrent le béguinier. Des fidèles, que les cris des enfants tiraient de leurs méditations, sortirent de l’église et rossèrent les huguenotins ; les parents se regardèrent comme insultés dans la personne de leurs enfants ; une grande rumeur s’éleva aux alentours, des attroupements se formèrent, les cris : À l’église ! à l’église ! retentirent. Le capitaine Bouillargues passait par hasard dans le quartier ; c’était un homme méthodique : il organisa l’insurrection, et, marchant en tête, il enleva l’église au pas de charge, malgré les barricades faites à la hâte par les papistes ; l’assaut dura à peine quelques minutes ; les prêtres et les fidèles s’enfuirent par une porte, tandis que les réformés entraient par l’autre. L’église fut en un tour de main appropriée au nouveau culte ; le grand crucifix qui surmontait l’autel fut traîné dans les rues au bout d’une corde et fouetté par tous les carrefours. Enfin, quand le soir vint, on alluma un grand feu devant la cathédrale et l’on y jeta tous les papiers des maisons ecclésiastiques et religieuses, les images et les reliques des saints, les ornements des autels, les habits sacerdotaux, tout enfin, jusqu’aux saintes hosties2, tout fut brûlé sans empêchement de la part des consuls : le vent qui soufflait sur Nîmes était à l’hérésie.
Pour le coup, Nîmes était en pleine révolte ; aussi s’organisa-t-elle en conséquence : Moget prit le titre de pasteur et ministre de l’église chrétienne. Le capitaine Bouillargues fit fondre les vases sacrés des églises catholiques, et paya avec leur produit des volontaires nîmois et des reîtres allemands : les pierres des couvents démolis servirent à bâtir des fortifications, et, avant même qu’on eût songé à l’attaquer, la ville était en défense. Ce fut alors que, Guillaume Calvière étant à la tête du présidial, Moget président du consistoire, et le capitaine Bouillargues commandant de la force armée, on songea à créer un nouveau pouvoir qui, partageant la puissance des consuls, fût plus que ceux-ci encore à la dévotion de Calvin, et le bureau des Messieurs prit naissance : c’était un comité de salut public, ni plus ni moins ; aussi le nouveau conseil, institué révolutionnairement, agit-il en conséquence ; le pouvoir des consuls fut absorbé, et le consistoire réduit à se mêler des affaires spirituelles. Sur ces entrefaites, survint l’édit d’Amboise et l’annonce que le roi Charles IX, accompagné de Catherine de Médicis, allait visiter ses fidèles provinces du Midi.
Si entreprenant que fût le capitaine Bouillargues, il avait, cette fois, affaire à trop forte partie pour essayer de résister ; aussi, malgré les murmures des enthousiastes, la ville de Nîmes résolut-elle non seulement d’ouvrir ses portes à son souverain, mais encore de lui faire une réception qui effaçât toutes les mauvaises impressions que Charles IX avait pu recevoir de ses antécédents. En effet, on attendit le cortège royal au pont du Gard ; des jeunes filles vêtues en nymphes sortirent d’une grotte, portant une collation qu’elles dressèrent sur la route et à laquelle leurs majestés firent le plus grand honneur. Le repas terminé, les illustres voyageurs se remirent en route ; mais l’imagination des autorités nîmoises ne s’était pas bornée à si peu : en arrivant à l’entrée de la ville, le roi trouva la porte de la Couronne changée en une montagne couverte de vignes et d’oliviers, et sur laquelle un berger faisait paître son troupeau. Mais, comme si tout devait céder par enchantement devant sa puissance, à l’approche du roi, la montagne s’ouvrit ; les plus belles et les plus nobles demoiselles de Nîmes vinrent à sa rencontre et lui remirent les clefs de la ville dans des bouquets de fleurs, en lui chantant des vers accompagnés par la musette du berger. En passant sous la montagne, Charles IX vit, au fond d’une grotte, enchaîné à un palmier, un crocodile monstrueux et qui jetait des flammes : c’étaient les anciennes armes accordées à la ville par Octave-César-Auguste après la bataille d’Actium, et que François Ier lui avait rendues, en échange d’une représentation en argent de l’amphithéâtre qu’elle lui avait offerte. Enfin il trouva la place de la Salamandre tout ornée de feux de joie ; si bien que, sans s’informer si ces feux n’étaient point les restes du bûcher de Maurice Sécenat, le roi s’endormit fort content de la réception que lui avait faite sa bonne ville de Nîmes, et ne doutant point qu’on ne l’eût tout à fait calomniée dans son esprit.
Cependant, pour que de pareils bruits, si peu fondés qu’ils lui parussent, ne se renouvelassent point, le roi nomma Damville gouverneur du Languedoc, et l’installa lui-même dans la capitale de son gouvernement ; puis il destitua les consuls, depuis les premiers jusqu’aux derniers : ceux qu’il nomma à leur place étaient tous catholiques et se nommaient Guy-Rochette, docteur et avocat ; Jean Beaudan, bourgeois ; François Aubert, maçon ; et Christol Ligier, laboureur : après quoi, il partit pour Paris, où il signa, quelque temps après, avec les calvinistes, le traité que le peuple, cet éternel prophète, appela la paix boiteuse et mal assise3, et qui eut pour résultat la Saint-Barthélemi.
Toute gracieuse qu’eût été la mesure prise par l’autorité royale pour la tranquillité future de sa bonne ville de Nîmes, ce n’en était pas moins une réaction : en conséquence, les catholiques, se sentant soutenus par l’autorité, rentrèrent en foule, les bourgeois reprirent leurs maisons, les curés reprirent leurs églises, et, affamés par le pain amer de l’exil, prêtres et laïques firent main basse sur le trésor. Cependant aucun meurtre n’ensanglanta ce retour ; mais forces injures furent dites aux calvinistes, qu’à leur tour on insulta dans les rues. Mieux peut-être eussent valu quelques coups de poignard ou d’arquebuse : une blessure se cicatrise, mais jamais une raillerie.
En effet, le lendemain de la Saint-Michel, c’est-à-dire le 30 septembre 1567, on vit tout à coup, vers midi, deux ou trois cents conjurés sortir d’une maison et se répandre par les rues en criant : Aux armes ! mort aux papistes ! monde nouveau ! C’était le capitaine Bouillargues qui prenait sa revanche.
Comme les catholiques étaient surpris à l’improviste, ils n’essayèrent pas même de faire résistance ; un groupe des mieux armés, parmi les protestants, courut à la maison de Guy-Rochette, premier consul, et s’empara des clés de la ville. Guy-Rochette, prévenu par les clameurs des habitants, avait mis la tête à la fenêtre : voyant ce rassemblement de furieux se diriger vers sa maison, il avait deviné que c’était à lui qu’on en voulait et s’était sauvé chez son frère Grégoire. Alors, s’étant remis et ayant repris courage, l’importance de ses fonctions lui revint à l’esprit, et il résolut de les remplir, quelque chose qui pût en arriver : en conséquence, il courut chez les officiers de justice ; mais tous lui donnèrent de si excellentes raisons pour ne pas se mêler de la chose, qu’il vit qu’il ne fallait pas compter sur des lâches ou des traîtres. Il se rendit donc chez l’évêque, et le trouva dans son palais épiscopal, entouré des principaux catholiques, lesquels, à genoux comme lui, priaient le Seigneur et attendaient le martyre. Guy-Rochette se joignit à eux, et tous ensemble continuèrent à prier.
Un instant après, la rue retentit de nouvelles clameurs, et les portes de l’évêché gémissent sous les coups de hache et de levier : à ce bruit menaçant, l’évêque oublie qu’il doit l’exemple du martyre et se sauve par une brèche dans une maison contiguë ; mais Guy-Rochette et quelques autres catholiques, résignés à leur sort et résolus courageusement à ne point le fuir, demeurent à leur place. Les portes cèdent, les protestants se répandent dans la cour et dans les appartements. Le capitaine Bouillargues entre, l’épée à la main ; Guy-Rochette et ses compagnons sont pris, enfermés dans une chambre sous la garde de quatre sentinelles, et l’évêché est pillé : en même temps une autre troupe se porte chez le vicaire-général Jean Peberean, lui prend huit cents écus, lui donne sept coups de poignard et jette son cadavre par la fenêtre, comme les catholiques firent, huit ans plus tard, de celui de l’amiral de Coligny ; puis les deux troupes réunies s’élancent vers la cathédrale, qu’ils saccagent une seconde fois.
La journée s’écoula tout entière au milieu de ces scènes de meurtre et de pillage ; puis enfin, la nuit arriva : alors, comme on avait eu l’imprudence de faire grand nombre de prisonniers et qu’ils commençaient à être embarrassants vu leur quantité, on résolut de profiter de l’obscurité pour s’en défaire sans exciter trop d’émotion dans la cité. En conséquence, on les tira des différentes maisons où on les avait enfermés, et on les conduisit tous dans une grande salle de l’Hôtel-de-Ville, qui pouvait contenir quatre ou cinq cents personnes, et qui se trouva pleine : alors une espèce de tribunal s’organisa ; un greffier se chargea d’enregistrer les arrêts de ce tribunal de mort improvisé ; une liste des prisonniers lui fut remise : une croix tracée en marge indiquait les condamnés. Il alla de chambre en chambre, cette liste à la main, appelant et faisant sortir ceux dont les noms portaient le signe fatal ; puis, ce triage achevé, on les conduisit par bandes au lieu désigné d’avance pour leur supplice.
Ce lieu était la cour de l’évêché : au milieu de cette cour était un puits de cinquante pieds de profondeur et de vingt-quatre pieds de circonférence : c’était une tombe toute creusée, et les religionnaires, qui étaient pressés, avaient résolu de l’utiliser pour ne pas perdre de temps.
Là, les malheureux catholiques furent amenés, percés à coups de dague ou mutilés à coups de haches, puis précipités dans le puits ; Guy-Rochette y fut traîné un des premiers et ne demanda pour lui ni grâce ni miséricorde ; mais il demanda la vie pour son jeune frère, dont le seul crime était de lui tenir de si près par les liens du sang. Les assassins n’entendirent à rien, ils frappèrent l’homme et l’enfant, et les précipitèrent tous deux. Le cadavre du vicaire-général, quoiqu’il fût tué de la veille, fut amené à son tour, traîné par une corde et réuni aux autres martyrs. Le massacre dura toute la nuit : l’eau sanglante montait à mesure qu’on y jetait de nouveaux cadavres ; au point du jour, le puits débordait : il est vrai qu’on y avait précipité à peu près cent vingt personnes.
Le lendemain, 1er octobre, les scènes de tumulte recommencèrent : dès le point du jour, le capitaine Bouillargues parcourait les rues de la ville en criant : — Courage, compagnons ! Montpellier, Pézenas, Aramon, Beaucaire, Saint-Andéol et Villeneuve sont pris et sont à notre dévotion. Le cardinal de Lorraine est mort, et nous tenons le roi. – Ces cris réveillèrent ceux des assassins qui commençaient à s’assoupir ; ils se réunirent au capitaine, demandant à grands cris qu’on fouillât les maisons qui entouraient l’évêché et dans l’une desquelles il était à peu près certain que l’évêque, qui, ainsi qu’on s’en souvient, s’était échappé la veille, avait trouvé asile : cette proposition fut acceptée, et les visites commencèrent ; lorsqu’on en fut à la maison de M. Sauvignargues, celui-ci avoua que le prélat était caché dans sa cave, et proposa au capitaine Bouillargues de traiter de sa rançon. La proposition n’avait rien d’inconvenant ; aussi fut-elle acceptée ; on discuta seulement quelques instants sur la somme, qui fut fixée à cent vingt écus : l’évêque donna tout ce qu’il avait sur lui ; ses domestiques se dépouillèrent ; le sieur de Sauvignargues compléta la somme, et comme il avait l’évêque chez lui, il le retint en gage. Le prélat ne réclama aucunement contre cette mesure, si impertinente qu’elle lui eût paru dans un autre temps ; il se croyait plus en sûreté dans la cave de M. de Sauvignargues qu’à l’évêché.
Mais, sans doute, le secret de la retraite du digne prélat ne fut pas très-scrupuleusement gardé par ceux qui venaient de traiter avec lui ; car, au bout d’un instant, une seconde troupe se présenta, dans l’espérance d’obtenir une seconde rançon. Malheureusement le sieur de Sauvignargues, l’évêque et les domestiques s’étaient dépouillés, au premier coup, de tout ce qu’ils avaient d’argent comptant ; de sorte que cette fois le maître de la maison, craignant pour lui-même, fit barricader les portes, et, se sauvant par une ruelle, abandonna l’évêque à sa mauvaise fortune. Les huguenots escaladèrent les fenêtres, et entrèrent dans la maison en criant : — Tue ! tue ! à mort les papistes ! –Les domestiques de l’évêque furent massacrés, le prélat tiré de son caveau, et jeté dans la rue. Là on lui arracha ses bagues et sa croix pastorale, on le dépouilla de ses habits, pour le couvrir d’un vêtement grotesque que l’on improvisa avec des haillons ; on lui mit, au lieu de sa mitre, un chapeau de paysan ; puis, dans cet état, on le traîna jusqu’à l’évêché, et on le mena au bord du puits pour l’y précipiter ; là un des massacreurs fit observer qu’il était déjà plein de cadavres : — Bah ! répondit un autre, ils se presseront bien un peu pour un évêque4.
Pendant ce temps le prélat, qui voit qu’il n’y a plus aucune miséricorde à attendre des hommes, se jette à genoux, recommandant son âme à Dieu, quand tout à coup un des assassins, nommé Jean Coussinal, et qui jusque-là s’était fait remarquer parmi les plus féroces, touché, comme par miracle, de cette résignation, s’élance entre l’évêque et ceux qui allaient le frapper, le prend sous sa garde, et déclare que quiconque le touchera aura affaire à lui ; ses camarades, étonnés, reculent. Pendant ce temps Jean Coussinal soulève l’évêque entre ses bras, l’emporte dans une maison voisine, et se place sur le seuil l’épée à la main.
Néanmoins les assassins, revenus de leur première surprise, réclament à grands cris l’évêque, et, réfléchissant qu’à tout prendre, ils sont cinquante contre un, et qu’il est honteux à eux de se laisser intimider ainsi par un seul homme, s’élancent contre Coussinal, qui, d’un revers de son épée, abat la tête du premier qui se présente ; alors les cris redoublent, deux ou trois coups de pistolet et d’arquebuse sont tirés sur l’entêté défenseur du pauvre prélat ; mais aucune balle ne le touche. En ce moment passe le capitaine Bouillargues, qui, voyant un seul homme assailli par cinquante, demande ce que c’est : on lui raconte la prétention étrange de Coussinal, qui veut sauver l’évêque : — Il a raison, dit le capitaine, l’évêque a payé rançon, et personne n’a plus droit sur lui. – À ces mots, il marche à Coussinal, lui tend la main, et tous deux entrent dans la maison, d’où ils sortent bientôt, tenant l’évêque chacun sous un bras. Ils traversent ainsi toute la ville, suivis des cris et des murmures des assassins, qui n’osent cependant point faire autre chose que crier et que murmurer ; à la porte ils remettent l’évêque à une escorte, et demeurent là jusqu’à ce qu’ils l’aient perdu de vue.
Les massacres durèrent encore toute la journée, mais en diminuant à mesure qu’on avançait vers le soir ; cependant la nuit il y eut quelques meurtres isolés : le lendemain, on était fatigué de tuer, on se mit à démolir ; cela dure plus longtemps, on se lasse moins de remuer des pierres que des cadavres. Tous les couvents, toutes les églises, tous les monastères, toutes les maisons des prêtres et des chanoines y passèrent : on ne conserva que la cathédrale, sur laquelle haches et leviers s’émoussèrent, et l’église de Sainte-Eugénie, dont on fit un magasin à poudre.
La journée de la tuerie fut nommée la Michelade, parce qu’elle avait eu lieu le lendemain de la Saint-Michel, et comme elle date de 1567, la Saint-Barthélemi ne fut qu’un plagiat.
Cependant, avec l’aide de M. Damville, les catholiques reprirent le dessus, et ce fut aux protestants de fuir à leur tour ; ils se retirèrent dans les Cévennes. Dès le commencement des troubles, les Cévennes avaient été l’asile des religionnaires : encore aujourd’hui la plaine est papiste, et la montagne huguenote. Que le parti catholique triomphe à Nîmes, la plaine monte ; que les protestants soient vainqueurs, la montagne descend.
Cependant, tout vaincus et fugitifs qu’ils étaient, les calvinistes n’avaient point perdu courage : exilés d’un jour, ils comptaient bien prendre leur revanche le lendemain, et tandis qu’on les pendait par contumace, ou qu’on les brûlait en effigie, ils se partageaient devant notaire les biens de leurs bourreaux.
Mais ce n’était pas le tout que de vendre ou d’acheter les biens des catholiques, il fallait entrer en possession ; c’est de quoi s’occupèrent les protestants : ils y réussirent en novembre 1569, c’est-à-dire après dix-huit mois d’exil. Voici de quelle manière :
Un jour, les religionnaires réfugiés virent venir à eux un charpentier d’un petit village nommé Cauvisson, qui demanda à parler à M. Nicolas de Calvière, seigneur de Saint-Cosme, frère du président, et qui était connu dans tout le parti comme un homme d’exécution. Voici quelle était la proposition du charpentier.
Il y avait dans les fossés de la ville, près de la porte des Carmes, une grille de fer par laquelle se dégorgeait l’eau de la fontaine. Maduron, c’était le nom du charpentier, offrit de limer cette grille, de manière à ce que, en l’enlevant une belle nuit, elle donnât passage à une troupe de protestants armés : Nicolas de Calvière accepta la proposition, demandant à la mettre à exécution le plus tôt possible ; mais le charpentier fit observer qu’il fallait attendre quelque orage, afin que les eaux, grossies par la pluie, pussent couvrir par leur bruit celui que produirait le grincement de la lime. La chose était d’autant plus importante, que la guérite de la sentinelle se trouvait presque au-dessus de cette grille. M. de Calvière insista ; Maduron, qui jouait dans cette affaire plus gros jeu que personne, tint bon ; de sorte que, bon gré mal gré, il fallut attendre son loisir.
Quelques jours après, la saison des pluies arriva, et la fontaine grossit comme d’habitude ; alors Maduron, jugeant que le moment favorable était venu, se glissa dans le fossé et se mit à limer sa grille, tandis qu’un ami, caché sur le rempart, le tirait par une ficelle qu’il s’était attachée au bras, chaque fois que la sentinelle, dans sa promenade circonscrite, revenait de son côté. Vers le point du jour l’ouvrage était déjà en bon train. Maduron couvrit les entailles avec de la cire et de la boue, afin de les dissimuler aux regards, et se retira. Trois nuits de suite il se remit encore à l’œuvre avec les mêmes précautions ; enfin, vers la fin de la quatrième, il sentit qu’avec un léger effort la grille serait prête à céder ; c’était tout ce qu’il fallait : il retourna donc prévenir messire Nicolas de Calvière que le moment était venu.
Cela tombait à merveille : la lune, entre son retour et son déclin, était complètement absente du ciel ; on fixa l’entreprise à la même nuit, et lorsque l’obscurité fut venue, messire Nicolas de Calvière, suivi de trois cents protestants choisis parmi les plus braves, vint se cacher dans un plant d’oliviers, à un demi-quart de lieue des murailles.
Tout était tranquille, la nuit était sombre, onze heures sonnèrent ; messire Nicolas de Calvière se mit en route avec ses hommes, qui descendirent sans bruit, traversèrent le fossé, ayant de l’eau jusqu’à la ceinture, remontèrent de l’autre côté, et, suivant le pied de la muraille, se glissèrent sans être aperçus jusqu’à la grille ; Maduron les y attendait ; en les apercevant, il donna une légère secousse, la grille tomba, et tous, entrant par le conduit, Nicolas de Calvière en tête, se trouvèrent bientôt à l’autre extrémité de l’aquéduc, c’est-à-dire place de la Fontaine.
Les protestants coururent aussitôt, par pelotons de vingt hommes, aux quatre principales portes, tandis que tout le reste de la troupe se répandait par les rues, criant : — Ville gagnée ! mort aux papistes ! monde nouveau ! À ces cris, les protestants de l’intérieur reconnurent des frères, et les catholiques des ennemis : mais les uns étaient prévenus et les autres pris à l’improviste ; il n’y eut donc pas de défense, ce qui n’empêcha point qu’il n’y eût carnage. M. de Saint-André, le gouverneur de la ville, contre lequel, dans sa courte administration, les protestants avaient amassé de grandes haines, fut tué d’un coup de pistolet dans son lit, et son corps, jeté par la fenêtre, fut mis en morceaux par la populace. Les assassinats durèrent toute la nuit ; puis le lendemain, les vainqueurs organisèrent à leur tour la persécution, beaucoup plus facile à l’égard des catholiques, qui n’avaient pour refuge que la plaine, qu’à l’égard des protestants, qui avaient, comme nous l’avons dit, les Cévennes pour forteresse.
Vers ce temps arriva la paix de 1570, qu’on appela, comme nous l’avons dit, la paix mal assise, et à laquelle, deux ans après, la Saint-Barthélemi vint confirmer son nom.
Alors, chose étrange, le Midi regarda faire la capitale : protestants et catholiques nîmois, tous rougis encore du sang les uns des autres, demeurèrent mutuellement en face, la main à la garde de leur poignard ou de leur épée, mais sans tirer ni épée ni poignard. Il y avait de la curiosité dans leur fait, et ils étaient bien aises, à leur tour, de voir comment les Parisiens s’en tireraient.
Cependant la Saint-Barthélemi eut un résultat : ce fut la fédéralisation des principales villes du Midi et de l’Ouest : Montpellier, Uzès, Montauban et La Rochelle firent une ligue militaire et civile, présidée par Nîmes, – en attendant, dit l’acte de fédéralisme, qu’un prince, suscité par Dieu, partisan et défenseur de la cause protestante, montât sur le trône. – Dès 1575, les protestants du Midi devinaient Henri IV.
Alors Nîmes, donnant l’exemple aux autres villes confédérées, creuse ses fossés, rase ses faubourgs, élève ses murailles ; nuit et jour elle augmente ses moyens de défense, met double garde à chaque porte, et, sachant comment on surprend une ville, ne laisse pas sur toute l’enceinte de ses murailles un trou où puisse passer un papiste. C’est alors que, dans sa crainte de l’avenir, elle devient sacrilège pour le passé, abat à moitié son temple de Diane, et mutile son amphithéâtre, dont chaque pierre gigantesque fait à elle seule un pan de muraille. Pendant une trêve elle sème, pendant l’autre elle récolte ; et cet état dure tant que dure le règne des mignons. Enfin, ce prince suscité de Dieu, qu’attendent depuis si longtemps les religionnaires, apparaît ; Henri IV monte sur le trône.
Mais en montant sur le trône, Henri IV se trouve dans la position où, quinze cents ans auparavant, s’est trouvé Octave, et où trois siècles plus tard, se trouvera Louis-Philippe : porté au souverain pouvoir par un parti qui n’est point la majorité, il est obligé de se détacher de ce parti, et d’abjurer sa croyance religieuse, comme les autres ont abjuré ou abjureront leurs croyances politiques ; de sorte qu’il aura son Biron, comme Octave avait eu son Antoine, et comme Louis-Philippe aura son Lafayette. Arrivés à ce point, les rois n’ont plus ni volontés ni sympathie personnelle : ils subissent la puissance des choses, et, forcés de s’appuyer sans cesse sur les masses, ils ne cessent pas plus tôt d’être proscrits, que, malgré eux, ils deviennent proscripteurs.
Cependant, avant d’en venir à l’arrestation de Fontainebleau, Henri IV, avec la franchise d’un vieux soldat, réunit autour de lui ses anciens compagnons de guerre et de religion ; il déploya sous leurs yeux une carte de la France, il leur montra que le dixième à peine de son immense population était protestante ; encore les protestants étaient-ils confinés tous, les uns dans les montagnes du Dauphiné, qui leur avaient donné leurs trois principaux chefs, le baron des Adrets, le capitaine Montbrun et Lesdiguières ; dans les montagnes des Cévennes, qui leur avaient donné leurs principaux prédicateurs, Maurice Sécenat et Guillaume Moget ; enfin dans les montagnes de la Navarre, d’où il était sorti lui-même. Il leur montra que, chaque fois qu’ils s’étaient hasardés hors de leurs montagnes, ils avaient été battus, ainsi que cela était arrivé à Jarnac, à Moncontour et à Dreux. Enfin, il termina par leur faire sentir l’impossibilité où il était de leur remettre le pouvoir ; mais, en échange, il leur donna trois choses : sa bourse pour assurer les besoins du présent, l’édit de Nantes pour assurer la tranquillité de l’avenir, enfin des places fortes pour se défendre au cas où un jour cet édit serait révoqué ; car, dans sa prévoyance profonde, l’aïeul avait deviné le petit-fils, et Henri IV craignait Louis XIV.
Les protestants prirent ce qu’on leur offrait ; puis, comme cela arrive toujours à ceux qui ont reçu, se retirèrent mécontents de ne pas avoir obtenu davantage.
Le règne de Henri IV n’en fut pas moins, tout renégat que ce prince était à leurs yeux, l’ère dorée des protestants ; et tant que ce règne dura, Nîmes fut calme ; car cette fois les vainqueurs, chose étrange, oubliant la Saint-Barthélemi parisienne, dont ils n’avaient point encore pris leur revanche, se contentaient de défendre aux catholiques toute pratique de culte extérieur, les laissant assez libres d’exercer leur religion, pourvu que ce fût en secret, et même de porter le viatique, pourvu que les malades se résignassent à attendre la nuit. Quand la mort était trop pressée, il fallait bien porter le Saint-Sacrement de jour ; mais alors ce n’était pas sans danger pour le prêtre, qu’au reste ce danger n’arrêta jamais, tant c’est le propre des dévouements religieux de demeurer inflexibles, et peu de soldats, si braves qu’ils fussent, moururent aussi courageusement que les martyrs.
Pendant tout ce temps, profitant de la trêve et de l’impartiale protection qu’accordait, aux uns comme aux autres, le connétable Damville, carmes, capucins, jésuites, moines de tout ordre ou de toute couleur enfin, rentraient dans Nîmes les uns après les autres, sans bruit, il est vrai, d’une manière sourde et nocturne, il est vrai encore ; mais enfin, au bout de trois ou quatre ans, ils n’en furent pas moins réinstallés : seulement ils se trouvèrent alors dans la situation où avaient été d’abord les protestants ; c’étaient eux qui n’avaient plus d’églises, et c’étaient leurs ennemis qui avaient des temples. Enfin il arriva même un moment où un supérieur des Jésuites, nommé le père Coston, prêcha avec tant de succès, que les protestants, voulant combattre à armes égales, et opposer la parole à la parole, firent venir d’Alais, c’est-à-dire de la montagne, cette source éternelle d’éloquence huguenote, le révérend Jérémie Ferrier, qui passait en ce moment pour l’aigle du parti. Alors les controverses religieuses recommencèrent entre les deux religions ; ce n’était pas encore une guerre, mais c’était déjà moins qu’une paix ; on avait cessé de s’assassiner, mais on anathématisait toujours : on ne tuait plus le corps, mais on damnait l’âme ; c’était une manière, tout en prenant du repos, de ne pas perdre son temps et de s’entretenir la main pour le moment où les massacres recommenceraient.
La mort de Henri IV donna le signal de nouvelles collisions, qui, d’abord au profit des protestants, commencèrent peu à peu à tourner à celui des catholiques : c’est qu’avec Louis XIII Richelieu était monté sur le trône ; à côté du roi, le cardinal ; derrière le manteau de pourpre, la robe rouge. C’est alors qu’apparaît dans le Midi Henri de Rohan, l’un des plus illustres chefs de cette grande race qui, alliée aux maisons royales d’Écosse, de France, de Savoie et de Lorraine, avait pris pour devise : « Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan je suis. »
Henri de Rohan était alors un homme de quarante à quarante-cinq ans, dans toute la force de l’âge et du génie. Jeune, il avait parcouru, pour achever son éducation, l’Angleterre, l’Écosse et l’Italie. En Angleterre, Élisabeth l’avait appelé son chevalier ; en Écosse, Jacques VI avait voulu qu’il devînt le parrain de son fils, qui fut depuis Charles Ier ; enfin, en Italie, il avait pénétré si avant dans l’amitié des principaux seigneurs et dans la politique des principales villes, qu’on avait l’habitude de dire qu’après Machiavel, c’était lui qui, sous ce rapport, en savait le plus. Revenu en France, il avait, du vivant de Henri IV, épousé la fille de Sully, et, Henri IV mort, il avait commandé les Suisses et les Grisons au siège de Juliers. C’était cet homme que le roi avait eu l’imprudence de maltraiter, en lui refusant la survivance du gouvernement du Poitou, dont son beau-père était investi, et qui, ainsi qu’il le dit lui-même dans ses Mémoires avec une ingénuité toute militaire, excité par le désir de se venger du mépris qu’on lui avait témoigné à la cour, venait de se jeter dans le parti de Condé, par sa complaisance pour son frère, et par l’envie de servir ceux de sa religion.
De ce jour, les révoltes de la rue et les colères du moment prirent un plus large caractère et une plus longue durée ; ce ne fut plus une émeute isolée qui souleva une cité, ce fut une conflagration générale qui enflamma le Midi, et l’insurrection monta au rang de guerre civile.
Cet état de choses dura sept ou huit ans : pendant sept ou huit ans, Rohan, abandonné par Châtillon et La Force, qui payaient de leur défection le bâton de maréchal, pressé par Condé, son ancien ami, et par Montmorency, son éternel rival, fit des prodiges de courage et des miracles de stratégie. Enfin, sans soldats, sans munitions, sans argent, il était encore tellement redoutable à Richelieu, que le ministre lui accorda les conditions qu’il demandait, c’est-à-dire la garantie de l’édit de Nantes, la restitution des temples aux réformés, et une amnistie générale pour lui et ses partisans. En outre, chose inouïe jusqu’alors, il obtint trois cent mille livres comme indemnité de l’argent qu’il avait dépensé pendant sa rébellion ; il en abandonna deux cent quarante à ses coreligionnaires, ne gardant, pour rebâtir ses châteaux et remettre sur pied sa maison entièrement délabrée, qu’une somme de soixante mille livres, c’est-à-dire le quart à peine de ce qu’il avait reçu. Cette paix fut signée le 27 juillet 1629.
Le duc de Richelieu, à qui rien ne coûtait pour parvenir à son but, y était enfin arrivé ; il achetait la paix quarante millions à peu près ; mais la Saintonge, le Poitou et le Languedoc étaient soumis : Les La Trimouille, les Condé, les Bouillon, les Rohan et les Soubise avaient traité ; enfin les grandes oppositions armées avaient disparu, et le cardinal-duc regardait de trop haut pour apercevoir les oppositions particulières. Il laissa donc Nîmes faire ses affaires intérieures comme elle l’entendait, et tout y rentra bientôt dans l’ordre ou plutôt dans le désordre accoutumé. Enfin Richelieu meurt, Louis XIII le suit à quelques mois de distance, et les embarras de la minorité donnent aux protestants et aux catholiques du Midi liberté plus entière que jamais de continuer ce grand duel qui n’est pas encore terminé de nos jours.
Seulement, chaque flux et reflux porte de plus en plus le caractère particulier du parti qui triomphe : si ce sont les protestants qui sont vainqueurs, la vengeance est brutale et colère ; si c’est le parti catholique, les représailles sont hypocrites et sordides.
Les protestants jettent bas les églises, rasent les couvents, chassent les moines, brûlent les crucifix, détachent quelque malfaiteur de la potence, clouent le cadavre en croix, lui percent le côté, lui mettent une couronne sur la tête, et vont le planter sur la place du marché, pour parodier Jésus au Calvaire.
Les catholiques imposent des contributions, reprennent ce qu’on leur a pris, exigent des indemnités, et, ruinés à chaque défaite, se retrouvent plus riches à chaque victoire.
Les protestants procèdent au grand jour, et, au son de la caisse, fondent publiquement les cloches pour faire des canons, violent les signatures, se chauffent dans les rues avec le bois des chanoines, affichent leurs thèses sur les portes de la cathédrale, battent les curés catholiques qui vont porter le Saint-Sacrement aux moribonds, et enfin, pour comble d’insulte, transforment les églises en abattoirs et en voiries.
Les catholiques, au contraire, marchent dans la nuit, rentrent, par les portes entr’ouvertes, plus nombreux qu’ils n’ont été chassés, font l’évêque président du conseil, mettent les jésuites en possession du collège, achètent les conversions avec l’argent du fisc, et comme ils ont toujours un appui dans la cour, ils commencent par faire exclure les calvinistes des grâces, en attendant qu’ils puissent les faire exclure de la justice.
Enfin, le 31 décembre 1657, une dernière émeute arrive, dans laquelle les protestants ont le dessous, et ne sont sauvés que parce que, de l’autre côté de la France et du détroit, Cromwell s’émeut en leur faveur, et écrit de sa main au bas d’une dépêche relative aux affaires d’Autriche : « J’apprends qu’il y a eu des émotions populaires dans une ville du Languedoc que l’on appelle Nîmes : que tout s’y passe, je vous prie, sans qu’on y verse le sang, et le plus doucement possible. »
Par bonheur pour les protestants, Mazarin avait, en ce moment, besoin de Cromwell : en conséquence, on décommanda les supplices, et on s’en tint aux vexations.
Mais aussi, à compter de ce jour, non-seulement elles n’eurent point de fin, mais pas même de trêve ; toujours fidèle à son système d’envahissement, le parti catholique organisa une persécution incessante, que vinrent bientôt renforcer les ordonnances successives de Louis XIV. Le petit-fils de Henri IV ne pouvait, par respect humain, déchirer d’un seul coup l’édit de Nantes, mais il le lacérait article par article.
Dès 1630, c’est-à-dire un an après la paix signée avec Rohan, et sous le règne précédent, Châlons-sur-Saône avait décidé qu’aucun protestant ne serait admis à la fabrication des produits commerciaux de la ville.
En 1643, c’est-à-dire six mois après l’avènement au trône de Louis XIV, les lingères de Paris dressent un règlement qui déclare les filles et les femmes protestantes indignes d’obtenir la maîtrise de leur respectable profession.
En 1654, c’est-à-dire un an après sa majorité, Louis XIV permet l’imposition sur la ville de Nîmes d’une somme de quatre mille francs, pour l’entretien de l’hôpital catholique et de l’hôpital protestant ; et, au lieu d’imposer proportionnellement chaque culte pour défrayer l’hôpital de sa religion, il ordonne que la taxe sera levée sur tous indifféremment ; de sorte que les protestants, qui sont deux fois plus nombreux que les catholiques, payent deux sixièmes de l’impôt prélevé sur eux à leurs ennemis. Le 9 août de la même année, un arrêt du conseil ordonne que les consuls des artisans seront tous catholiques ; le 16 décembre, un arrêt défend aux protestants de faire des députations au roi ; enfin, le 20 décembre, un autre arrêt décide que les consuls catholiques auront seuls l’administration des hôpitaux.
En 1662, il est enjoint aux protestants de n’enterrer leurs morts qu’au point du jour ou à l’entrée de la nuit, et un article de l’arrêt fixe le nombre de ceux qui pourront suivre le convoi.
En 1663, le conseil d’État rend ses arrêts qui prohibent l’exercice du culte réformé dans cent quarante-deux communes des diocèses de Nîmes, d’Uzès et de Mende ; les mêmes arrêts ordonnent la démolition de leurs temples.
En 1664, cet ordre s’étend aux temples des villes d’Alençon et de Montauban, et au petit temple de Nîmes. Le 17 juillet de la même année, le parlement de Rouen fait défense aux maîtres merciers de recevoir aucun ouvrier ou apprenti protestant, tant que le nombre des protestants dépassera le quinzième du nombre des catholiques ; le 24 du même mois, le conseil d’État invalide toute lettre de maîtrise obtenue ou acquise à quelque titre que ce soit par un protestant ; et enfin, en octobre, réduit à deux seulement les monnayers qui peuvent être de la religion réformée.
En 1665, le règlement fait pour les merciers est étendu aux orfèvres.
En 1666, une déclaration du roi régularise les arrêts du parlement ; décide, article 31, que les charges de greffier des maisons consulaires ou les secrétaires de communautés d’horlogers, portiers ou autres charges municipales, ne pourront être tenues que par les catholiques :
Article 33, que, lorsque des processions dans lesquelles le Saint-Sacrement sera porté passeront devant les temples de ceux de la religion prétendue réformée, ils cesseront de chanter leurs psaumes jusqu’à ce que lesdites processions aient passé ;
Enfin, article 34, que lesdits de la religion réformée seront tenus de souffrir qu’il soit tendu des draps et tapisseries, par l’autorité des officiers de la ville, au devant de leurs maisons et autres lieux à eux appartenant.
En 1669, les chambres de l’édit dans les cours des parlements de Rouen et de Paris sont supprimées, ainsi que les places des clercs et des commis des greffes ; puis, la même année, au mois d’août, comme on commence à remarquer l’émigration des protestants, un édit est rendu, dont voici un des articles :
« Considérant que plusieurs de nos sujets ont passé dans les pays étrangers, y travaillent à tous les exercices dont ils sont capables, même à la construction des vaisseaux, s’engagent dans les équipages maritimes, s’y habituent sans dessein de retour, et y prennent leurs établissements par mariage et par acquisition de biens de toute nature ; » Faisons défense à aucun de la religion prétendue réformée de sortir du royaume sans notre permission, sous peine de confiscation de corps et de biens, et ordonnons à ceux qui ont déjà quitté la France de rentrer dans les limites. »
En 1670, le roi exclut les médecins réformés du décannat du collège de Rouen, et ne tolère à ce collège que deux médecins de la religion.
En 1671, publication d’arrêt qui ordonne que les armes de la France seront enlevées des temples de la prétendue religion réformée.
En 1680, une déclaration du roi interdit aux femmes de la religion réformée la profession de sages-femmes.
En 1681, ceux qui abandonnent la religion réformée sont exempts des contributions et du logement des gens de guerre pendant deux ans, et au mois de juillet de la même année on fait fermer le collège de Sédan, le seul qui reste aux calvinistes dans tout le royaume pour l’instruction de leurs enfants.
En 1682, le roi ordonne aux notaires, procureurs, huissiers et sergents calvinistes de se démettre de leurs offices, les déclarant inhabiles à ces professions, et un arrêt du mois de septembre de la même année restreint à trois mois le terme qui leur est accordé pour la vente de leur charge.
En 1684, le conseil d’État étend les dispositions précédentes aux titulaires des charges de secrétaires du roi, et, au mois d’août, le roi déclare les protestants inhabiles à être nommés experts.
En 1685, le prévôt des marchands de Paris enjoint aux marchands privilégiés calvinistes de vendre leur privilège dans l’espace d’un mois.
Au mois d’octobre de la même année, cette longue suite de persécutions, que nous n’avons point encore exposée tout entière, est couronnée par la révocation de l’édit de Nantes. Henri IV, tout en prévoyant ce résultat, avait espéré que l’on procéderait autrement, et que les places fortes resteraient à ses coreligionnaires après la révocation de l’édit ; mais tout au contraire, on avait commencé par prendre les places fortes, et révoquer l’édit ensuite ; de sorte que les calvinistes se trouvèrent entièrement à la merci de leurs ennemis mortels.
Dès 1669, et lorsque Louis XIV menaçait de porter un des coups les plus funestes à la garantie des droits civils des réformés, en abolissant les chambres mi-parties, diverses députations lui avaient été envoyées, pour qu’il arrêtât le cours de ses persécutions ; et pour ne lui donner aucune arme nouvelle contre le parti, ces députations s’étaient adressées à lui avec une soumission dont le fragment de discours suivant pourra offrir un exemple.
« Au nom de Dieu, sire, écoutez, disaient les protestants au roi, écoutez les derniers soupirs de notre liberté mourante ; ayez pitié de nos maux, ayez pitié de tant de pauvres sujets, qui ne vivent presque plus que de leurs larmes : ce sont des sujets qui ont pour vous un zèle ardent et une fidélité inviolable ; ce sont des sujets qui ont autant d’amour que de respect pour votre auguste personne ; ce sont des sujets à qui l’histoire rend témoignage d’avoir contribué notablement à mettre votre grand et magnanime aïeul sur son trône légitime ; ce sont des sujets qui, depuis votre miraculeuse naissance, n’ont jamais rien fait qui puisse attirer aucun blâme sur leur conduite ; nous pourrions même en parler d’une autre manière, mais votre majesté a eu soin d’épargner notre pudeur et de louer dans des occasions importantes notre fidélité en des termes que nous n’aurions point osé prononcer5 ; ce sont encore des sujets qui, n’ayant que votre sceptre seul pour appui, pour asile et pour protection sur la terre, sont obligés par leur intérêt, aussi bien que par leur devoir et leur conscience, de se tenir invariablement attachés au service de votre majesté. »
Mais, comme on le voit, rien n’avait arrêté la trinité royale qui régnait à cette heure, et, grâce aux suggestions du père La Chaise et de Mme de Maintenon, Louis XIV allait gagner le ciel au milieu des roues et des bûchers.
Ainsi les persécutions sociales et religieuses prenaient, grâce à ces ordonnances successives, le protestant au berceau, et ne le quittaient qu’après la mort.
Enfant, il n’avait plus de collèges où s’instruire.
Jeune homme, il n’avait plus de carrière à parcourir, puisqu’il ne pouvait être ni concierge, ni mercier, ni apothicaire, ni médecin, ni avocat, ni consul.
Homme, il n’a plus de temple où prier, ni plus de registre d’état civil où inscrire son mariage et la naissance de ses enfants ; à chaque heure, sa liberté de conscience est opprimée ; il chante ses prières, une procession passe, il faut qu’il se taise ; une cérémonie catholique a eu lieu, il faut qu’il dévore sa colère, et laisse tendre sa maison en signe de joie ; il a reçu quelque fortune de ses pères, cette fortune, qu’il ne peut entretenir faute de position sociale et de droits civils, s’échappe peu à peu de ses mains, et va entretenir les collèges et les hôpitaux de ses ennemis.
Vieillard, son agonie est tourmentée ; car s’il meurt dans la foi de ses pères, il ne pourra reposer à côté de ses aïeux, et à l’exception d’un nombre fixé à dix, ses amis ne le pourront suivre à ses funérailles nocturnes, et cachées comme celles d’un paria.
Enfin, à quelque âge de sa vie que ce soit, s’il veut fuir cette terre marâtre sur laquelle il ne peut ni naître, ni vivre, ni mourir, il sera déclaré rebelle, ses biens seront confisqués, et la moindre chose qui pourra lui arriver, si jamais il retombe aux mains de ses persécuteurs, ce sera de passer le reste de sa vie sur les galères du roi à ramer entre un assassin et un faussaire.
Un pareil état de choses était intolérable ; les cris d’un seul homme se perdent dans les airs ; les gémissements de toute une population forment un orage : cette fois, comme d’habitude, l’orage s’amassa dans les montagnes, et l’on commença d’entendre gronder sourdement le tonnerre.
Ce furent d’abord des préceptes écrits par des mains invisibles, sur les murs des villes, sur les carrefours des chemins, sur les croix des cimetières ; ces préceptes, comme le Mane Thecel Phares de Balthasar, poursuivaient le persécuteur au milieu de ses fêtes et de ses orgies.
Tantôt, c’était cette menace : Jésus n’est pas venu pour apporter la paix, mais l’épée.
Tantôt, c’était cette consolation : « En quelque lieu que se trouvent deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je me trouve au milieu d’elles. »
Tantôt, enfin, c’était cet appel à la réunion, qui bientôt devait devenir un appel à la révolte : « Nous vous annonçons ce que nous avons vu et entendu, afin que vous communiquiez avec nous. »
Et les persécutés s’arrêtaient devant ces promesses empruntées aux apôtres, et rentraient chez eux, pleins d’espérance dans la parole des prophètes, qui, ainsi que le dit saint Paul, dans son épître à ceux de Thessalonique « n’est point la parole des hommes, mais la parole de Dieu. »
Bientôt ces préceptes s’incarnèrent et ces promesses du prophète Joël s’accomplirent :
« Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes ; je ferai voir des prodiges, et ceux qui invoqueront le nom de Dieu seront sauvés. »
En effet, dès 1696, on commença d’entendre dire que des hommes étaient apparus, qui avaient des visions, pendant lesquelles, soit qu’ils regardassent le ciel ou la terre, ils voyaient le ciel ouvert, et connaissaient ce qui se passait dans les lieux les plus éloignés. Tant que duraient leurs extases, on pouvait piquer également ces hommes avec une épingle ou avec un glaive, ils ne sentaient rien ; on pouvait les interroger après leurs extases, et ils ne se souvenaient de rien.
La première prophétesse qui apparut fut une femme du Vivarais dont nul ne connaissait l’origine ; elle allait de bourg en bourg et de montagne en montagne, pleurant du sang au lieu de larmes ; mais M. de Baville, intendant du Languedoc, la fit prendre et conduire à Montpellier ; là, elle fut condamnée au bûcher, et ses larmes de sang se séchèrent dans le feu.
Derrière elle s’éleva un autre fanatique, c’était le nom qu’on donnait à ces prophètes populaires ; il était né à Mazillon, se nommait Laquoite et avait vingt ans. Le don de prophétie lui avait été acquis d’une manière étrange. Voici ce qu’on racontait de lui : un jour qu’il revenait du Languedoc, où il avait été travailler aux vers à soie, il avait trouvé au bout de la descente de la côte de Saint-Jean un homme inconnu, couché à terre et tremblant de tous ses membres ; ému de pitié, il avait fait halte près de lui, et lui avait demandé la cause de son mal ; alors cet homme lui avait répondu : « Mettez-vous à genoux, mon fils, et écoutez-moi, s’il vous plaît : il n’est pas question de savoir si je suis malade ; mais il s’agit d’apprendre le moyen de faire votre salut et de sauver vos frères ; ce moyen n’est autre chose que la communication du Saint-Esprit ; je l’ai en moi, et par la grâce de Dieu je veux vous le donner ; approchez-vous, et recevez-le de moi, en recevant un baiser de ma bouche. » Et à ces paroles l’inconnu avait baisé le jeune homme sur les lèvres, lui avait serré la main droite, et avait disparu, le laissant tout tremblant à son tour ; car l’esprit de Dieu était en lui, si bien que de ce jour ayant reçu l’inspiration, il répandait la parole.
Une troisième prophétesse fanatisait encore dans les paroisses de Saint-Andéol, de Clerguemont et de Saint-Frazal de Vantalon ; mais celle-là s’attaquait principalement aux nouveaux convertis : elle disait, en parlant de l’Eucharistie, — qu’ils avaient avalé dans l’hostie un morceau aussi venimeux que la tête du basilic, qu’ils avaient fléchi le genou devant Baal, et qu’il n’y avait pas assez de pénitences pour eux. – Ses prédications inspirèrent une si profonde terreur, qu’au dire même du révérend père Louvrelœil, cet effort de Satan rendit les églises désertes aux fêtes de Pâques, et que les curés administrèrent les sacrements à moitié moins de personnes que l’année précédente.
Un pareil relâchement, qui menaçait de s’étendre chaque jour davantage, éveilla la sollicitude religieuse de messire François de Langlade de Duchayla, prieur de Laval, inspecteur des missions du Gévaudan et archiprêtre des Cévennes : en conséquence, il se décida à quitter Mende, sa résidence, à visiter les paroisses les plus corrompues, et à combattre l’hérésie par tous les moyens que Dieu et le roi avaient mis en son pouvoir.
L’abbé Duchayla était un fils puîné de la noble maison de Langlade, et, par le malheur de sa naissance, malgré l’instinct courageux qui veillait en lui, il avait été contraint de laisser à son aîné l’épaulette et l’épée, et de prendre le petit collet et la soutane ; aussi, en sortant du séminaire, s’était-il jeté avec toute l’ardeur de son tempérament dans l’église militante ; car à ce caractère de feu il fallait des périls à courir, des ennemis à combattre, une religion à imposer ; or, comme à cette époque tout était encore tranquille en France, il avait tourné les yeux vers l’Inde, et s’était embarqué avec la fervente résolution d’un martyr.
Le jeune missionnaire était arrivé aux Indes orientales dans des circonstances merveilleusement en harmonie avec les espérances célestes qu’il avait conçues : quelques-uns de ses prédécesseurs ayant porté trop loin leur zèle religieux, le roi de Siam, après en avoir fait périr plusieurs au milieu des tortures, avait défendu aux missionnaires l’entrée de ses états : cette défense, comme on le pense bien, ne fit qu’exciter le désir convertisseur de l’abbé ; il trompa la surveillance des soldats, et, malgré les défenses terribles du roi, commença de prêcher la religion catholique parmi les idolâtres, dont il convertit un grand nombre.





























