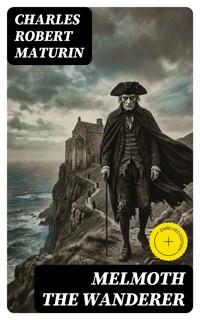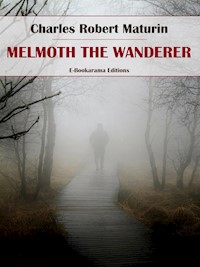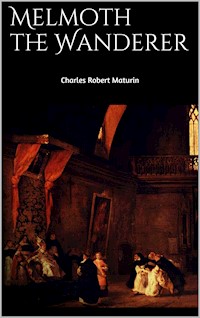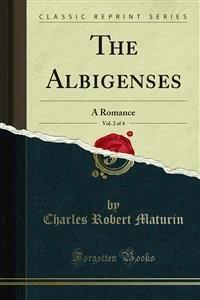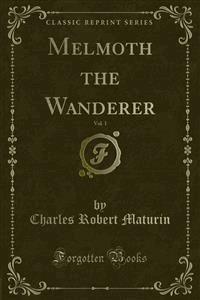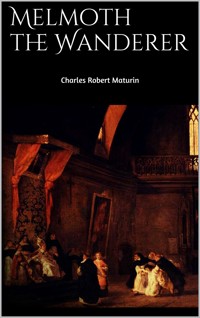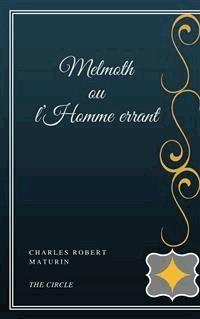
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Henri Gallas
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Le protagoniste de ce roman gothique est John Melmoth, un érudit qui a vendu son âme au diable en échange d'un sursis de cent cinquante ans sur la mort. Dans le présent de la narration, 1816, il cherche désespérément un homme qui reprenne le pacte en son nom. Le passé est révélé par une série d'analepses mises en abyme dans la narration repère, selon le principe du récit dans le récit, l'auteur ayant recours à des lieux communs tels que le paquet de lettres retrouvé dans un grenier.Karl Edward Wagner classait ce roman parmi l'un des treize meilleurs récits d'horreur et de fantastique, et H. P. Lovecraft le cite comme « un bond en avant dans l'évolution du récit macabre ».Le roman de Maturin, considéré généralement comme l'apogée du roman gothique, n'est pas qu'un simple récit fantastique. C'est une critique sociale de l'Angleterre du xixe siècle, une mise en accusation de l'église catholique (à travers notamment une critique de l'Inquisition), comparée au protestantisme dont l'auteur loue les vertus de réserve et de simplicité.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Melmoth ou l’Homme errant
Charles Robert Maturin
Charles Robert Maturin, also known as C.R. Maturin (born September 25, 1782 in Dublin; died October 30, 1824 in Dublin) was an Anglo-Irish Protestant clergyman (ordained by the Church of Ireland) and a writer of gothic plays and novels. Descended from a Huguenot family, he attended Trinity College, Dublin. Shortly after being ordained as curate of Loughrea in 1803, he married acclaimed singer Henrietta Kingsbury, a sister of Sarah Kingsbury, whose daughter, Jane Wilde, was the mother of Oscar Wilde. Thus Charles Maturin was Oscar Wilde's great-uncle by marriage. His first three works were published under the pseudonym Dennis Jasper Murphy and were critical and commercial failures. They did, however, catch the attention of Sir Walter Scott, who recommended Maturin's work to Lord Byron. With the help of these two literary luminaries, the curate's play, Bertram (staged at Drury Lane for 22 nights) saw a wider audience and became a success. Financial success, however, eluded Maturin, as the play's run coincided with his father's unemployment and another relative's bankruptcy, both of them assisted by the fledgling writer. To make matters worse, Samuel Taylor Coleridge publicly denounced the play as dull and loathsome, and "melancholy proof of the depravation of the public mind," going nearly so far as to decry it as atheistic. The Church of Ireland took note of these and earlier criticisms and, having discovered the identity of Bertram's author (Maturin had shed his nom de plume to collect the profits from the play), subsequently barred Maturin's further clerical advancement. Forced to support his wife and four children by writing (his salary as curate was £80-90 per annum, compared to the £1000 he made for Bertram), he switched back from playwright to novelist after a string of his plays met with failure. Maturin died in Dublin on 30 October 1824, after which rumours (none of them confirmed or proven) circulated that he had committed suicide. Honoré de Balzac and Charles Baudelaire later expressed fondness for Maturin's work, particularly his most famous novel, Melmoth the Wanderer.
Chapitre1
Dans l’automne de l’année 1816, John Melmoth, élève du collège de la Trinité, à Dublin, suspendit momentanément ses études pour visiter un oncle mourant, et de qui dépendaient toutes ses espérances de fortune. John, qui avait perdu ses parents, était le fils d’un cadet de famille, dont la fortune médiocre suffisait à peine pour payer les frais de son éducation ; mais son oncle était vieux, célibataire et riche. Depuis sa plus tendre enfance, John avait appris, de tous ceux qui l’entouraient, à regarder cet oncle avec ce sentiment qui attire et repousse à la fois, ce respect mêlé du désir de plaire, que l’on éprouve pour l’être qui tient en quelque sorte en ses mains le fil de notre existence.
Aussitôt que John eût appris la maladie de son parent, il se mit sur-le-champ en route. Son chemin passait par le comté de Wicklow, et la beauté du pays ne l’empêcha pas de se livrer à de tristes réflexions, dont quelques-unes avaient rapport au passé, mais dont un plus grand nombre regardaient l’avenir. Les caprices et le caractère morose de son oncle ; les bruits étranges qu’avait occasionnés la vie retirée qu’il menait depuis plusieurs années ; la dépendance dans laquelle sa fortune le mettait de cet homme singulier : toutes ces pensées pesaient sur son âme. Il s’efforçait de les repousser ; seul dans la diligence, il contemplait le pays, consultait sa montre ; ses pensées le quittaient pour un moment, mais ne pouvant les remplacer, il était forcé de les rappeler, pour diminuer au moins sa solitude. À mesure que la voiture approchait de la Loge, résidence du vieux Melmoth, le cœur de John devenait de plus en plus oppressé.
Il se rappelait tout ce qui, depuis son enfance, lui était arrivé dans la maison de cet oncle terrible : les leçons qu’on lui donnait avant de l’introduire en sa présence, les graves recommandations qu’on lui faisait de ne point être embarrassant, de ne pas approcher trop près de son oncle, de ne lui faire aucune question, de ne troubler, sous aucun prétexte, l’inviolable arrangement de sa sonnette, de sa tabatière ou de ses lunettes, de ne pas se laisser tenter par son éclat au point de toucher la canne à pomme d’or placée dans un coin ; enfin, de s’arranger de manière, en entrant et en sortant de la chambre, à ne point heurter contre les piles de livres, de globes, de vieilles gazettes, de têtes à perruques, de pipes à fumer, de bouteilles à tabac, sans compter les souricières et les vieux livres moisis qui occupaient le dessous des chaises. Après avoir évité tous ces écueils, il lui restait à faire un salut respectueux, à fermer la porte bien doucement, et à descendre l’escalier comme s’il avait eu des souliers de feutre.
Aux fêtes de Noël et de Pâques, le maigre bidet de son oncle paraissait devant la porte de la pension et devenait l’objet des sarcasmes de tous les écoliers. John le montait à regret pour se rendre à la Loge, où il n’avait d’autre passe-temps que de rester assis en face de son oncle, sans parler ou sans faire un mouvement, jusqu’à ce que le couple ressemblât à don Raymond et à l’esprit de Béatrix dans le Moine. Quand le dîner était servi, le vieillard, regardant attentivement son neveu, qui rongeait de maigres os de mouton, nageant dans un faible bouillon, lui recommandait surtout de ne pas trop manger. Le soir on se couchait avant la fin du crépuscule, afin d’épargner la chandelle, et John, que la faim tenait éveillé dans son lit, n’avait de consolation que quand à huit heures, après le coucher de son oncle, la vieille gouvernante venait lui apporter quelques bribes de son propre repas, en lui recommandant entre chaque bouchée de n’en rien dire à monseigneur.
Après s’être rappelé son enfance, John songeait aux années qu’il avait passées au collège. Il y habitait une petite chambre dans les combles, au fond de la cour intérieure et n’était jamais invité à venir à la campagne, son oncle ne voulant pas payer les frais de son voyage. Il passait l’été à parcourir les rues désertes de la ville, et tous les trois mois l’épître usitée lui portait une mince, mais ponctuelle remise, accompagnée de plaintes sur les frais de son éducation, de conseils d’économie et de lamentations sur les retards des fermiers et le bas prix des terres.
À tous ces souvenirs se joignit celui des dernières paroles de son père :
— John, mon pauvre enfant, je dois vous quitter. Il a plu à Dieu de vous enlever votre père avant qu’il ait pu faire pour vous ce qui aurait rendu cette séparation moins pénible. Désormais, John, il faut regarder votre oncle comme votre seul appui. Il a des infirmités et des bizarreries, mais il faut que vous appreniez à les supporter, comme tant d’autres choses que vous ne connaîtrez que trop tôt. Mon pauvre enfant, puisse celui qui est le père des orphelins avoir pitié de vous, et toucher le cœur de votre oncle en votre faveur !
La mémoire de cette scène remplit de larmes les yeux de John ; il s’empressait de les essuyer quand la voiture s’arrêta devant le jardin de son oncle.
Il descendit et s’approcha de la porte, tenant à la main un mouchoir noué dans lequel il avait renfermé un peu de linge blanc qui formait tout son équipage de route. La loge du portier tombait en ruine, et d’une cabane adjacente, il vit accourir, pieds nus, un petit garçon qui s’empressa de faire tourner, sur un seul gond qui restait, une barrière qui, jadis, avait été une porte, mais qui, pour lors, se composait de trois ou quatre planches, si mal attachées qu’elles se balançaient comme une enseigne quand il fait du vent. Ce ne fut pas sans peine que cette porte céda aux efforts réunis de John et du garçon, et tournant lourdement dans un mélange de boue et de gravier elle s’ouvrit enfin, et forma une large ornière. John, après avoir vainement cherché dans sa poche quelques sous pour récompenser son introducteur, poursuivit son chemin ; le jeune garçon marchait devant lui, s’enfonçant à chaque pas dans de larges mares, et se montrant aussi fier de son agilité que de l’honneur qu’il avait de servir un gentilhomme. À mesure que John avançait dans cette route boueuse qui avait été autrefois une avenue, il découvrait sans cesse de nouvelles marques d’une désolation qui s’était considérablement accrue depuis sa dernière visite. Tout annonçait que la rigide économie s’était changée en sordide avarice ; pas une haie, pas un fossé n’était en état ; ils étaient remplacés par un mur de pierres détachées, dont les nombreuses brèches étaient comblées de genêt et de chardons. Pas un arbre, pas un arbrisseau ne restait dans l’avenue qui avait été convertie par la nature en une espèce de prairie, où quelques moutons solitaires cherchaient les brins d’herbes qui croissaient difficilement à travers les cailloux, les chardons et la terre durcie.
La maison se dessinait fortement dans les ombres du soir : car il n’y avait ni ailes, ni offices, ni broussailles, ni arbres qui, en l’accompagnant, pussent adoucir la dureté de ses contours. John, après avoir jeté un regard douloureux sur le perron couvert d’herbes et sur les fenêtres fermées de planches, voulut frapper, mais il ne trouva pas de marteau ; à son défaut, il fut obligé de se servir de grosses pierres qu’il ne cessa de lancer contre la porte, comme s’il eût voulu l’enfoncer, que lorsque les aboiements réitérés d’un mâtin, qui semblait vouloir briser sa chaîne, et dont les cris aigus et les yeux étincelants indiquaient autant de faim que de colère, lui en eussent fait lever le siège. Il quitta pour lors la grande porte et se dirigea vers un passage qu’il connaissait et qui menait à la cuisine. En approchant il vit des lumières à travers les carreaux ; il leva le loquet d’une main tremblante ; mais quand il eut reconnu les personnes qui remplissaient cette cuisine, il s’avança d’un pas hardi et sans crainte d’être mal reçu.
Autour d’un feu de tourbe bien nourri et dont l’ampleur déposait de l’indisposition du maître, étaient assis la vieille gouvernante et deux ou trois suivants, c’est-à-dire des personnes dont la seule occupation consistait à manger, à boire et à bavarder dans toutes les cuisines du voisinage qui se trouvaient ouvertes par quelque événement heureux ou malheureux, le tout par amour pour monseigneur et à cause du grand respect qu’ils portaient à sa famille. Il y avait en outre une vieille femme que John reconnut sur-le-champ pour être le médecin femelle du village : sibylle ridée qui prolongeait sa misérable existence en tirant parti des craintes, de l’ignorance et des malheurs d’êtres aussi misérables qu’elle. Admise parfois dans les maisons honnêtes, par l’entremise des domestiques, elle y essayait l’effet de quelques simples, et ses tentatives n’étaient pas toujours sans succès. Dans le peuple, elle parlait souvent des pernicieux effets du mauvais œil, contre lequel elle assurait qu’elle possédait un contre-charme qui ne manquait jamais ; et en parlant elle secouait ses cheveux blancs avec tant de vivacité, qu’elle communiquait presque toujours à ses spectateurs moitié effrayés, moitié crédules, une partie de l’enthousiasme qu’elle ne laissait pas d’éprouver. Si cependant le cas passait les bornes de son art, si elle voyait s’évanouir à la fois l’espérance et la vie, elle engageait le malheureux malade à avouer qu’il avait quelque chose sur le cœur, et après cette confession arrachée à l’affaiblissement de la douleur ou à l’ignorance de la pauvreté, elle faisait un signe de tête et prononçait des paroles mystérieuses qui donnaient suffisamment à entendre aux assistants qu’elle avait eu à combattre des obstacles plus qu’humains.
Lorsque la santé régnant à la fois dans la cuisine de monseigneur et dans les cabanes de ses vassaux, menaçait de la faire mourir de faim, il lui restait encore une ressource : elle disait la bonne aventure.
Personne ne savait mieux qu’elle tordre l’écheveau mystique qu’il fallait faire descendre dans la carrière à chaux, au bord de laquelle la curieuse, intéressée à connaître l’avenir, s’arrêtait tremblante, jusqu’à ce qu’elle sût si la réponse à sa question : « Qui tient ? » serait faite par la voix d’un démon ou par celle d’un amant.
Personne mieux qu’elle ne connaissait le lieu où les quatre sources se réunissaient. C’était là qu’à une époque mystérieuse de l’année, il fallait tremper la chemise, qui devait ensuite être déployée devant le feu, au nom de celui que nous n’osons nommer, pour être avant le matin retournée par l’image de l’époux destiné. Elle seule, s’il fallait l’en croire, savait au juste dans quelle main il fallait tenir le peigne, tandis que de l’autre on portait une pomme à la bouche, afin que pendant ce temps le fantôme de l’époux se montrât dans la glace, devant laquelle se faisait l’opération. Personne n’était plus exact qu’elle à éloigner de la cuisine tout instrument de fer, pendant que ces cérémonies s’exécutaient par les dupes de son art, de peur qu’au lieu de voir un beau jeune homme avec une bague au doigt, une figure sans tête ne s’avançât vers la cheminée, et ne saisît ou la broche ou le fourgon, pour en assommer l’imprudent dormeur. En un mot, personne ne savait mieux tourmenter ou effrayer ses victimes, jusqu’à les persuader de la vérité d’un pouvoir qui plus d’une fois a mis les âmes les plus fortes au niveau des plus faibles.
Tel était l’être auquel le vieux Melmoth, en partie par crédulité et plus encore par avarice, avait confié le soin de ses jours. John s’avança au milieu du groupe, reconnaissant les uns, voyant les autres avec peine et se méfiant de tous. La vieille gouvernante lui fit l’accueil le plus amical. Voilà donc encore, dit-elle, ma petite tête blanche (notez que ses cheveux étaient noirs comme du jais) ; et en disant ces mots elle voulut porter à la tête de John sa main ridée, avec un mouvement qui tenait le milieu entre une bénédiction et une caresse : mais la difficulté qu’elle éprouva lui fit connaître que cette tête s’était élevée d’un pied depuis la dernière fois qu’elle l’avait caressée. Les hommes se levèrent tous à son approche avec les marques du respect que les Irlandais ne manquent jamais de témoigner aux personnes d’un rang supérieur. Ils souhaitèrent à monseigneur mille ans, et une longue vie en sus, et demandèrent si monseigneur ne voulait pas boire un coup pour calmer son chagrin ; au même instant cinq ou six mains rouges et décharnées lui tendirent à la fois des verres de whisky.
Pendant ce temps la sibylle, assise au coin de la cheminée, fumait sa pipe et ne disait mot. John refusa poliment la liqueur qu’on lui offrait, jeta à la dérobée un coup d’œil à la vieille ridée, et puis un autre sur la table, où s’étalait une chère copieuse, bien différente de celle qu’il avait coutume d’y voir jadis. La gamelle de pommes de terre aurait paru au vieux Melmoth devoir suffire pour huit jours ; et ce n’était pas tout : on y voyait encore du saumon salé, un plat de veau flanqué de tripes ; enfin, des homards et du turbot frit.
Pour humecter ce splendide repas, plusieurs bouteilles d’aile de Wicklow, apportées secrètement de la cave de monseigneur, étaient rangées le long de l’âtre, et leurs sifflements donnaient assez à connaître l’impatience que leur causait le bouchon ; mais le whisky, bien frelaté, qui sentait le roseau et la fumée, avait tous les honneurs du festin. Chacun en faisait l’éloge, et pour prouver sa sincérité, y buvait à longs traits.
John, en regardant autour de lui, ne put s’empêcher de se rappeler la mort de Don Quichotte, quand nonobstant son chagrin, sa nièce mangea comme à son ordinaire, la gouvernante but au repos de son âme, et Sancho lui-même crut pouvoir se délecter un peu. Après avoir rendu de son mieux la politesse de la société, John demanda comment son oncle se portait.
— Au plus mal, répondit l’un.
— Beaucoup mieux, dit l’autre.
John se retournant avec vicacité, semblait demander à qui il fallait ajouter foi.
— On dit que monseigneur a eu un saisissement, dit un grand gaillard de six pieds, qui, après s’être avancé d’un air mystérieux, cria sa confidence d’une voix de stentor, six pouces au-dessus de la tête de John.
— Oui, ajouta un second, en avalant le verre que John avait refusé, mais monseigneur a eu le temps de se remettre depuis.
À ces mots la sibylle, qui n’avait pas quitté son coin, tira lentement sa pipe de sa bouche, et se tourna vers la société. Jamais la Pythie sur son trépied n’avait excité plus d’effroi, n’avait commandé un silence plus profond.
— Ce n’est pas ici, dit-elle en posant son doigt décharné sur son front couvert de rides, ni là, ni là, en touchant successivement le front de ceux qui étaient près d’elle, et qui se baissaient à mesure comme pour recevoir sa bénédiction, buvant ensuite un coup pour en assurer l’effet. Tout est ici, tout est autour du cœur, et elle pressa ses doigts sur sa poitrine creuse, avec une force d’action qui fit frémir ses auditeurs. Tout est ici, répéta-t-elle, excitée sans doute par l’effet qu’elle avait produit ; après quoi elle retomba sur son siège, reprit sa pipe et ne dit plus rien.
Dans ce moment d’involontaire effroi et de silence, un son sinistre retentit dans la maison. Toute la société en parut électrisée. Ce son était celui de la sonnette de Melmoth. Ses domestiques étaient en si petit nombre et étaient toujours si près de lui, que le bruit de sa sonnette leur fit le même effet que s’ils lui eussent entendu sonner lui-même la cloche pour son enterrement.
— Il avait toujours l’habitude de frapper pour moi, dit la vieille gouvernante, parce qu’il ne voulait pas casser les cordons des sonnettes.
En attendant, ce son produisit l’effet qui devait naturellement en résulter. La gouvernante s’élança dans la chambre du malade, suivie de plusieurs femmes (pleureuses), prêtes à ordonner des médicaments s’il respirait encore, ou à pleurer pour lui s’il avait déjà rendu le dernier soupir. Elles battaient des mains et essuyaient leurs yeux arides. Ces vieilles sorcières entourèrent le lit, et à entendre la voix lamentable avec laquelle elles répétaient : — Oh ! il va partir ! Monseigneur va partir ; monseigneur va partir ! on aurait cru que leur vie était irrévocablement attachée à la sienne. Quatre d’entre elles se tordaient les mains et hurlaient autour du lit, tandis qu’une cinquième, avec une prestesse inconcevable, souleva la couverture pour sentir les pieds de monseigneur, et déclara qu’ils étaient froids comme de la pierre.
Le vieux Melmoth retira promptement ses pieds, et comptant d’un œil auquel les approches de la mort n’avaient rien ôté de sa justesse, le nombre de personnes qui étaient rassemblées autour de son lit, il se leva à moitié, s’appuya sur son coude aigu, et repoussant la vieille gouvernante, qui s’efforçait d’arranger son bonnet de nuit, il s’écria, d’une voix qui fit tressaillir tous les assistants :
— Que diable êtes-vous toutes venues faire ici ?
Cette interrogation dispersa pour un moment la société, qui néanmoins ne tarda pas à se rallier. On se parlait à voix basse, et on se disait, avec de fréquents signes de croix :
— Le diable ! que Jésus-Christ ait pitié de nous ! Le diable est le premier mot que sa bouche ait prononcé.
— Oui, cria de toutes ses forces le malade, et le diable est le premier objet que mes yeux aient aperçu.
— Quand ? Où ? s’écria la gouvernante effrayée et se cachant dans la couverture, dont elle dépouillait sans miséricorde, le moribond.
— Là, là, répéta-t-il, en montrant les femmes, réunies et surprises de s’entendre traiter de démons, tandis qu’elles venaient pour les chasser.
— Seigneur ! dit la gouvernante d’un ton radouci, ne les connaissez-vous pas ? N’est-ce pas là une telle et là une telle ?
Nous épargnons à nos lecteurs une foule de noms irlandais et barbares, qu’il leur serait impossible de prononcer, et nous ne leur en citerons qu’un seul, pour exemple, c’était Catchleen O’Mullighan.
— Tu mens, charogne, grommela le vieux Melmoth ; elles s’appellent légion, car elles sont en grand nombre ; qu’on les chasse d’ici, qu’on les chasse de ma maison ; si elles veulent pleurer à ma mort, je leur en donnerai un motif. Elles ne boiront point le whisky qu’elles auraient volé si elles l’avaient pu.
En disant ces mots il tira de dessous son chevet une clef, qu’il montra d’un air triomphant à la gouvernante, qui savait fort bien s’en passer.
— Et ne mangeront plus des viandes dont vous les avez régalées.
— Régalées ! Jésus ! s’écria la gouvernante.
— Oui, oui ; je sais ce que je dis. Et pourquoi y a-t-il tant de chandelles, toutes des quatre à la livre ; il y en a autant à la cuisine, je gage.
— En vérité, monseigneur, ce sont toutes des six.
— Des six ! Et pourquoi diable brûlez-vous des six ? Croyez-vous en être déjà à veiller mon corps ? Eh ?
— Non, monseigneur, pas encore, pas encore, s’écrièrent en chorus les sorcières, mais ce sera quand il plaira à Dieu. Monseigneur devrait bien songer à son âme.
— Voilà le premier mot de bon sens que vous ayez dit, reprit le moribond. Donnez-moi mon livre de prières. Vous le trouverez là-bas sous le vieux tire-bottes. Essuyez les toiles d’araignées ; il y a plusieurs années que je ne l’ai ouvert.
La vieille gouvernante lui apporta le livre. Il le prit, et tournant sur elle un regard de reproche, il lui dit :
— Qu’est-ce qui vous a fait brûler des six dans la cuisine, vieille prodigue ? Combien y a-t-il d’années que vous demeurez dans cette maison ?
— Je ne le sais pas au juste, monseigneur.
— Y avez-vous jamais vu de la prodigalité ou des dépenses inutiles ?
— Oh ! jamais, jamais, monseigneur.
— A-t-on jamais brûlé autre chose dans la cuisine que des chandelles de quinze à la livre ?
— Jamais, monseigneur, jamais.
— Ne vous a-t-on pas toujours tenue aussi serrée qu’il a été possible ? répondez-moi.
— Sans doute, monseigneur. Tout le monde vous rend justice, et sait qu’il n’y avait pas dans le pays de maison ni de main aussi serrées que les vôtres.
— Et puisqu’il en est ainsi, comment avez-vous osé les desserrer avant la mort ? J’ai senti l’odeur des viandes ; j’ai entendu le son des voix ; j’ai entendu tourner et retourner la clef dans la serrure. Oh ! que ne suis-je levé, ajouta-t-il en se roulant dans son lit, oh ! que ne suis-je levé, pour voir ce qui se passe… Mais non, cela me tuerait ; la pensée seule m’en tue.
Et il se rejeta en arrière sur son traversin, car il ne se servait jamais d’oreiller, qu’il regardait comme un luxe.
Les étrangères, abattues et déconfites, se retirèrent en se regardant et en parlant bas ; mais la voix aiguë de Melmoth les rappela.
— Et où allez-vous maintenant ? Retournez-vous à la cuisine pour me gruger encore ? N’y a-t-il pas une seule de vous qui veuille rester pendant qu’on lit une prière pour moi ? Vous pourrez en avoir un jour besoin vous-mêmes, vieilles sorcières.
Étonnées de ce reproche et de cette menace, la troupe revint en silence et se rangea autour du lit, tandis que la gouvernante, quoiqu’elle fût catholique, demandait si monseigneur ne voulait pas voir un ecclésiastique de sa croyance. Les yeux du moribond exprimèrent le mécontentement que lui causait la proposition.
— Et pourquoi faire ? pour qu’il faille lui donner une écharpe et un crêpe à mon enterrement. Lisez donc, vieille C… ; ce sera toujours autant d’épargné.
La gouvernante en fit l’essai, mais elle fut obligée d’y renoncer à cause du mauvais état de ses yeux. Le malade demanda s’il n’y avait pas parmi ces dames quelqu’une qui voulût la remplacer. Il s’en offrit une, qui avait plus de bonne volonté que de talent, et qui lisant toujours sans rien comprendre à ce qu’elle disait, acheva les prières des agonisants sans s’en apercevoir, et continuant toujours, lut celles des relevailles, qui, dans les liturgies anglaises, se trouvent placées à la suite des premières.
Elle lisait avec une gravité merveilleuse. On l’interrompit malheureusement deux fois. D’abord le vieux Melmoth dit à sa gouvernante :
— Descendez et couvrez le feu de la cuisine. Fermez ensuite la porte à clef, que j’entende tourner la serrure. Avant que cela ne soit fait je ne puis faire attention à rien.
La seconde interruption fut celle de John Melmoth, qui étant entré dans la chambre, entendit les paroles mal sonnantes que prononçait la vieille, et s’agenouillant devant le lit de son oncle, il prit le livre des mains de la lectrice, et lut à son tour à demi-voix les prières que l’église anglicane a consacrées à la consolation des mourants.
— C’est la voix de John, dit le vieillard, qui tout à coup se rappela le peu d’amitié qu’il avait toujours témoigné à ce malheureux jeune homme.
Il en fut touché. D’un autre côté, il se voyait entouré de domestiques rapaces et sans attachement, et quoiqu’il ne dût pas en espérer beaucoup d’un parent qu’il avait toujours traité comme un étranger, il sentit dans ce moment qu’il ne l’était pas, et s’attacha à lui comme à sa dernière planche de support.
— John, mon cher enfant, te voilà. Je t’ai tenu loin de moi pendant ma vie, et maintenant que je suis mourant, tu es à mes côtés. Va, John, lis toujours.
John, profondément affecté de la position où il voyait cet homme, pauvre au milieu de toutes ses richesses, ainsi que de la demande solennelle qu’il lui faisait de le consoler à ses derniers moments, continua sa lecture ; mais sa voix s’altéra bientôt par l’horreur que lui inspirèrent les hoquets du malade, qui néanmoins s’efforçait de temps à autre de demander à la gouvernante si elle avait bien couvert le feu.
John, qui avait de la sensibilité, se leva avec émotion.
— Allez-vous m’abandonner comme les autres ? dit le vieux Melmoth en essayant de se soulever dans son lit.
— Non, monsieur, reprit John en observant la physionomie changée du moribond ; mais j’ai pensé que vous pourriez avoir besoin de rafraîchissement, de quelque chose qui vous donnât des forces.
— Oui, oui, j’en ai besoin ; mais à qui puis-je me fier pour m’en aller chercher ? Elles – tournant les yeux sur le groupe qui l’entourait – elles m’empoisonneraient.
— Fiez-vous à moi, monsieur, dit John, j’irais chez l’apothicaire ou partout ailleurs, si vous le désiriez.
Le vieillard lui prit la main et l’attirant auprès de son lit il commença par jeter sur les autres personnages un œil à la fois menaçant et inquiet, puis il dit à l’oreille de son neveu : – Je voudrais boire un verre de vin, cela prolongerait ma vie de quelques heures ; mais je n’ose dire à personne de m’en aller chercher : on me volerait une bouteille.
John fut choqué de l’observation.
— Au nom de Dieu, monsieur, permettez-moi de vous aller chercher un verre de vin.
— Vous ne savez pas où, dit le vieillard avec une expression de physionomie que John ne put comprendre.
— Non, monsieur ; vous savez que j’ai toujours été à peu près étranger ici.
— Prenez cette clef, dit le vieux Melmoth, après avoir éprouvé un spasme violent. Prenez cette clef ; il y a du vin dans ce cabinet, du madère. Je leur ai toujours dit qu’il n’y avait rien là ; mais ils ne m’ont pas cru ; sans cela, auraient-ils pu me voler comme ils l’ont fait ? Une fois, je leur dis que c’était du whisky ; mais ce fut bien pis : ils en burent le double.
John prit la clef des mains de son oncle. Le moribond le pressa en la lui donnant, et John prenant ce mouvement pour une marque d’amitié, le pressa à son tour. Il fut détrompé par ces paroles que le vieillard lui dit à l’oreille :
— John, mon enfant, ne buvez pas de ce vin pendant que vous êtes là-bas.
— Juste ciel ! s’écria John en jetant avec indignation la clef sur le lit. Puis se rappelant que l’être misérable qu’il avait devant les yeux, ne pouvait être un objet de ressentiment, il lui fit la promesse qu’il demandait, et entra dans le cabinet où nul autre que le vieux Melmoth n’avait mis le pied depuis soixante ans. Il eut de la peine à trouver le vin, et il resta assez longtemps pour justifier les soupçons de son oncle ; mais son esprit était agité et sa main tremblante. Il n’avait pu s’empêcher de remarquer que le regard de son oncle, en lui accordant la permission d’entrer dans le cabinet, avait joint la pâleur de l’effroi à celle de la mort. L’horreur qu’avaient exprimée toutes les femmes quand il s’en était approché, ne lui avait point échappé, et enfin quand il y fut, sa mémoire fut assez cruelle pour lui rappeler vaguement quelques circonstances qui y avaient rapport, et qui étaient trop affreuses pour que l’imagination osât s’y arrêter. Il songea surtout que depuis un grand nombre d’années personne n’y était entré que son oncle. Avant de le quitter, il souleva la chandelle et jeta autour de lui un regard mêlé de crainte et de curiosité. Il y vit beaucoup de ces vieilleries inutiles que l’on doit s’attendre à rencontrer dans le cabinet d’un avare ; mais bientôt ses regards s’attachèrent malgré lui à un portrait suspendu contre la boiserie, et qui lui parut bien mieux fait que la plupart de ceux que l’on laisse moisir sur les murs des vieux châteaux. Il représentait un homme de moyen âge ; il n’y avait rien de remarquable dans le costume ou dans la physionomie ; mais les yeux étaient de ceux que l’on voudrait n’avoir jamais vus, et qu’il est impossible d’oublier.
D’un mouvement aussi douloureux qu’irrésistible, John approche du portrait avec la chandelle, et il distingue sur le bord ces mots : Jn. Melmoth, Ao 1646. John n’était ni timide ni superstitieux. Sa constitution n’était point nerveuse, et cependant il ne put s’empêcher de considérer ce portrait avec une muette horreur, jusqu’à ce que, réveillé par la toux de son oncle, il s’empressa de retourner auprès de lui. Le vieillard but son vin et en parut un peu ranimé. Il y avait longtemps qu’il n’avait rien goûté d’aussi restaurant ; son cœur s’épancha dans une confiance momentanée, et il dit :
— Eh bien, John, qu’avez-vous vu dans cette chambre?
— Rien, monsieur.
— C’est faux. Tout le monde ici veut me tromper ou me voler.
— Monsieur, je ne veux faire ni l’un ni l’autre.
— Dites-donc ce que vous avez vu de… remarquable.
— Rien qu’un portrait, monsieur.
— Un portrait, monsieur !… L’original existe encore !
Quoique John n’eût pas oublié l’impression que ce portrait lui avait faite, il ne laissa pas de paraître incrédule.
— John, lui dit son oncle à l’oreille, John, on prétend que je meurs de ceci ou de cela. L’un dit que c’est faute de nourriture, l’autre que c’est faute de drogues ; mais l’on se trompe.
Ici sa physionomie devint d’une pâleur hideuse.
— Oh ! John, je meurs d’une peur.
Puis étendant ses bras décharnés vers le cabinet, il ajouta :
— Cet homme, j’ai de bonnes raisons pour savoir qu’il existe encore.
— Comment cela se peut-il, monsieur, répondit machinalement son neveu, le portrait porte la date de l’an 1646 ?
— Vous l’avez donc vu, vous l’avez donc examiné ? reprit son oncle. Après avoir posé pendant quelques instants la tête sur son traversin, il saisit la main de John, et dit avec un regard qu’il est impossible de peindre :
— Eh bien, vous le reverrez, car il vit.
Le vieillard tomba ensuite dans une espèce de sommeil ou de stupeur, pendant laquelle ses yeux, toujours ouverts, s’étaient fixés sur son neveu.
Le silence le plus complet régnait dans la maison, et rien n’interrompait les réflexions du jeune Melmoth. Il s’élevait dans son esprit une foule de pensées qu’il aurait voulu écarter, mais qui revenaient sans cesse malgré lui. Il songea aux habitudes et au caractère de son oncle, et se dit à lui-même : « Il n’y a jamais eu personne de moins superstitieux que lui. Il ne s’occupait de rien que du prix des effets publics ou du cours de change, si ce n’est des frais de mon éducation, qui lui tenaient plus à cœur que tout le reste. Est-il croyable qu’un tel homme meurt d’une peur et d’une peur ridicule ? S’imaginer qu’un individu qui vivait il y a cent cinquante ans vive encore ! Et cependant… il se meurt. » John réfléchit encore, car des faits arrêtent le logicien le plus opiniâtre. « Toute la dureté de son esprit et de son cœur ne l’empêche pas de mourir d’une peur ! On me l’avait dit dans la cuisine ; il me l’a répété lui-même ; il ne peut s’être trompé. Si jamais j’avais entendu dire qu’il fût nerveux, fantasque, superstitieux ; mais son caractère est si contraire à tout cela ! Un homme qui eût vendu son âme et son sauveur ! Qu’un tel homme meure de peur… et cependant il est mourant ! » John, en disant ces mots, jeta un regard douloureux sur la physionomie de son oncle, qui offrait déjà tous les symptômes effrayants de la face hypocratique.
Le vieux Melmoth était, comme nous l’avons dit, dans une espèce de stupeur. John le croyant endormi, reprit la chandelle, et, poussé par une impulsion dont il ne put se rendre compte, il entra dans la chambre condamnée. Son mouvement réveilla le moribond qui se souleva dans son lit. John ne s’en aperçut pas, mais il entendit les gémissements ou plutôt le râle affreux qui annonce le dernier combat de la vie et de la mort. Il frissonne et se retourne, mais en se retourant il lui semble voir les yeux du portrait, sur lesquels les siens étaient fixés, se mouvoir. Il rentre précipitamment dans la chambre de son oncle.
Le vieux Melmoth mourut dans le cours de la nuit ; il mourut, comme il avait vécu, dans une sorte de délire d’avarice. John ne s’était jamais formé l’idée d’une scène aussi horrible que celle que présenta sa dernière heure. Il jura et blasphéma pour une différence de trois liards qui manquaient, disait-il, depuis plusieurs semaines dans un compte que son palefrenier lui avait fait pour le foin de son cheval qu’il affamait. Au même instant il saisit la main de John, et lui demanda les sacrements.
— Si j’envoie chercher un prêtre il me demandera de l’argent, et je n’en ai pas à lui donner : je n’en ai pas. On dit que je suis riche… regardez cette couverture ; mais cela m’est égal si je puis sauver mon âme.
Puis croyant parler à un ecclésiastique, il ajoutait dans son délire :
— En vérité, docteur, je suis très pauvre. Je n’ai jamais été à charge à l’église jusqu’à présent ; mais aujourd’hui, je vous demande deux grâces : Sauvez mon âme et tâchez de me faire enterrer aux frais de la paroisse, car il ne me reste pas assez pour cela. J’ai toujours dit que j’étais pauvre ; mais, plus je le disais, moins on voulait me croire.
John s’éloigna du lit avec la sensation la plus pénible, et s’assit dans un coin de la chambre. Les femmes y étaient entrées, et il y faisait très noir. Melmoth épuisé ne disait plus rien ; un morne silence régnait partout. Dans ce moment la porte s’ouvre ; un personnage entre, jette ses regards autour de la chambre et se retire tranquillement et sans parler. John, qui l’avait vu, reconnaît sans peine l’original du portrait. Sa première impression fut de pousser un cri ; mais la voix lui manqua. Il voulut ensuite se lever pour suivre l’inconnu, mais après un moment de réflexion, il s’arrêta. Quoi de plus ridicule que d’être effrayé ou surpris de la ressemblance entre un homme vivant et le portrait d’un mort ? Cette ressemblance était à la vérité assez forte pour l’avoir frappé, même dans une chambre mal éclairée, mais au fond ce ne pouvait être qu’une ressemblance ; et, quoiqu’elle eût pu effrayer un homme âgé et d’une mauvaise santé, John résolut de ne pas se laisser aller à une semblable faiblesse.
Mais tandis qu’il s’applaudissait de cette résolution, la porte s’ouvrit encore et le même personnage reparut, faisant à notre jeune homme des signes de la tête et de la main, avec une familiarité peu rassurante. John se leva précipitamment de sa chaise, déterminé cette fois à le suivre, mais il fut retenu par les cris aigus, quoique faibles, de son oncle, qui combattait à la fois contre la mort et contre sa gouvernante. Celle-ci, inquiète pour la réputation de son maître et pour la sienne, voulait à toute force lui passer une chemise et un bonnet de nuit blancs, tandis que Melmoth, qui avait encore tout juste assez de connaissance pour sentir qu’on lui ôtait quelque chose, s’écriait faiblement :
— On me vole, on me vole dans mes derniers moments ; on vole un pauvre homme qui se meurt. John, ne viendrez-vous pas à mon secours ? Je vais mourir sur la paille ; on m’enlève ma dernière chemise ; je meurs sur la paille !…
Et en prononçant ces mots l’Harpagon rendit le dernier soupir.
Chapitre2
Quelques jours après la cérémonie funèbre, le testament du défunt fut ouvert en présence de témoins, et John se trouva seul héritier des biens de son oncle, biens qui, peu considérables dans l’origine, étaient devenus importants par son excessive économie.
Quand le notaire eut fini sa lecture, il dit :
— Voici quelques mots au coin de ce document ; ils ne font point partie du testament ; ils ne sont point par forme de codicille ni même signés par le testateur, mais je crois pouvoir certifier qu’ils sont de son écriture.
Il les montra au jeune Melmoth qui reconnut en effet les caractères de son oncle, ces cratères perpendiculaires et étroits, pleins d’abréviations et qui ne laissaient aucune marge au papier. Le jeune homme lut, non sans émotion, ce qui suit :
J’ordonne à John Melmoth, mon neveu et mon héritier, d’enlever, de détruire ou de faire détruire le portrait marqué Jn. Melmoth 1646 et qui est suspendu dans mon cabinet ; je lui ordonne aussi de chercher un manuscrit qu’il trouvera, je pense, dans le troisième tiroir, c’est-à-dire le plus bas, de la commode en acajou, placée sous ce portrait. Il est serré parmi quelques papiers sans valeur, tels que des sermons manuscrits et des brochures sur l’amélioration de l’Irlande ; mais il le distinguera facilement, car il est noué d’un cordon noir, et le papier en est moisi et fort décoloré. Je lui permets de le lire s’il le veut, mais je crois qu’il ferait mieux de s’en abstenir. Dans tous les cas, je le conjure, par les égards que l’on doit aux volontés d’un mourant, de brûler ce manuscrit.
Quand John eut lu cette singulière note, on reprit l’affaire qui formait l’objet de la réunion. Le testament du vieux Melmoth était si clair et en si bon ordre que tout fut bientôt arrangé. Chacun se retira et John Melmoth resta seul.
Nous avons omis de dire que les tuteurs de John nommés par le testament, car il n’était pas encore majeur, l’avaient engagé à retourner au collège, afin d’achever son éducation le plus promptement qu’il pourrait ; mais John observa que le respect dû à la mémoire du défunt l’obligeait de rester pendant quelque temps dans sa maison. Ce n’était cependant pas là son véritable motif. La curiosité, ou bien un sentiment qui peut-être mérite un meilleur nom, s’était emparé de son esprit. Ses tuteurs qui étaient des personnages distingués dans les environs par leur état et leur fortune, et aux yeux desquels John lui-même avait acquis beaucoup d’importance depuis qu’il avait hérité des biens de son oncle, le pressèrent de loger chez eux jusqu’à son retour à Dublin. Il rejeta leurs offres avec politesse, mais avec fermeté. Ils firent donc seller leurs chevaux, serrèrent la main de leur pupille, partirent, et Melmoth resta seul.
Il passa toute cette journée dans des réflexions tristes et inquiètes. Il traversait la chambre de son oncle ; il approchait de la porte du cabinet et s’en éloignait aussitôt ; il regardait les nuages et écoutait le bruit du vent, comme s’ils eussent allégé au lieu d’augmenter le poids qui oppressait son âme. Vers le soir, enfin, il fit monter la vieille gouvernante de qui il espérait obtenir quelques éclaircissements sur les circonstances extraordinaires dont il avait été témoin depuis son arrivée chez son oncle. Cette vieille, fière de l’honneur qu’on lui faisait, se rendit immédiatement auprès du jeune seigneur ; mais elle avait peu de chose à dire. Voici en quoi consista à peu près sa déposition. (Nous épargnons à nos lecteurs ses éternelles circonlocutions, ses tournures irlandaises et les fréquentes interruptions qu’occasionnaient ou sa tabatière ou son verre de punch au whisky, que Melmoth avait eu soin de lui faire servir.)
— Monseigneur, c’était toujours ainsi qu’elle nommait le défunt, avait peu quitté depuis deux ans le petit cabinet qui était au fond de sa chambre à coucher. Des voleurs, sachant que monseigneur avait de l’argent et ne doutant pas que ce ne fût là qu’il le cachait y étaient entrés ; mais n’y ayant trouvé que des papiers, ils s’étaient retirés. En attendant, le défunt en avait eu une si grande frayeur, qu’il avait fait murer la fenêtre. Pour ce qui la regardait, elle était convaincue qu’il y avait quelque chose là-dessous, car monseigneur qui jetait les hauts cris quand on dépensait deux liards de trop, n’avait fait aucune difficulté pour payer les maçons. Plus tard, quoique monseigneur n’eût jamais aimé la lecture, on remarqua qu’il se renfermait souvent dans sa chambre, et quand on lui apportait à dîner, on le trouvait presque toujours lisant attentivement un papier qu’il cachait aussitôt que quelqu’un entrait. On parlait aussi beaucoup d’un portrait qu’il ne voulait montrer à personne. Sachant qu’il existait une singulière tradition dans la famille, elle avait fait ce qu’elle avait pu pour l’entrevoir ; elle avait même été une fois chez Biddy Brannigan, la sibylle dont nous avons parlé, pour découvrir ce qu’il en était ; mais Biddy s’était contentée de secouer la tête, de remplir sa pipe, de prononcer quelques mots auxquels elle n’avait rien compris et s’était remise à fumer. En attendant, deux jours avant que monseigneur tombât malade, il était le soir à la porte de la cour, quand il l’appela pour fermer cette porte, car monseigneur tenait beaucoup à ce que l’on fermât les portes de bonne heure. Elle s’empressait d’obéir, quand monseigneur impatienté, lui arracha la clef des mains en jurant. Elle se tint à l’écart voyant que monseigneur était fâché. Tout à coup elle l’entendit pousser un grand cri et tomber à la renverse. On arriva promptement de la cuisine pour le secourir. Elle était si effrayée, qu’elle ne savait ce qu’elle faisait ; elle se rappelle cependant que le premier signe de vie que son maître donna, fut de soulever le bras, et de l’étendre dans la direction de la cour. Ayant levé les yeux, elle vit un homme de haute taille traverser la cour et sortir par la grande porte, ce qui la surprit beaucoup car cette porte n’avait pas été ouverte depuis plusieurs années, et tous les domestiques étaient pour lors rassemblés autour de leur maître. Elle avait aperçu la figure de cet étranger, elle avait observé son ombre sur la muraille, elle l’avait vu traverser lentement la cour ; dans sa frayeur, elle avait crié : « Arrêtez-le » ; mais tout le monde étant occupé à secourir monseigneur, personne n’avait fait attention à ce qu’elle disait. C’était là tout ce qu’elle pouvait raconter. Pour le reste, son jeune seigneur en savait autant qu’elle ; il avait vu la dernière maladie de son oncle, il avait entendu ses dernières paroles, il avait été témoin de sa mort : comment pouvait-elle en savoir plus que lui ?
— C’est vrai, dit Melmoth, je l’ai vu mourir ; mais vous avez dit qu’il existait une singulière tradition dans la famille : en savez-vous quelque chose ?
— Pas un mot, quoique je sois déjà vieille : c’était longtemps avant que je fusse au monde.
— Je n’en doute pas. Mais avez-vous jamais remarqué que mon oncle fût superstitieux, fantasque ?
Melmoth fut obligé de se servir de plusieurs périphrases avant de pouvoir se faire comprendre. À la fin, la gouvernante donna une réponse claire et positive.
— Non, jamais, jamais. Quand monseigneur se tenait l’hiver dans la cuisine, pour ne pas allumer de feu chez lui, il se fâchait toujours des discours des vieilles femmes qui venaient de temps en temps allumer leurs pipes. Il fronçait le sourcil, et les bonnes vieilles étaient forcées de fumer leurs pipes en silence, sans oser faire la moindre allusion, même à voix basse, à l’enfant d’un tel, que le mauvais œil avait regardé, ou à l’enfant de tel autre, qui, bien qu’impotent et maussade pendant la journée, se levait régulièrement toutes les nuits pour aller avec les bonnes gens en haut de la montagne voisine, danser au son de la cornemuse, qui venait le soir l’appeler à la porte de sa chaumière.
Les pensées de Melmoth devinrent plus sombres quand il eut appris ces détails. Si son oncle n’était naturellement pas superstitieux, il avait peut-être été criminel. Peut-être sa mort subite et extraordinaire et l’événement étrange qui l’avait précédée, étaient-ils liés avec quelque tort que, dans sa rapacité, il avait fait à la veuve ou à l’orphelin. Il questionna la vieille gouvernante à ce sujet, mais d’une façon prudente et indirecte. Sa réponse justifia complètement le défunt.
— C’était un homme, dit-elle, dont la main et le cœur étaient également durs ; mais il était aussi jaloux des droits d’autrui que des siens. Il aurait laissé mourir de faim la moitié du monde, mais il ne lui aurait pas fait tort d’un liard.
Il ne restait plus à Melmoth qu’une ressource pour apprendre ce qu’il désirait savoir : c’était d’envoyer chercher Biddy Brannigan, qui se trouvait encore dans la maison, et de laquelle il espérait du moins entendre la tradition dont la vieille gouvernante lui avait parlé. Elle vint ; et quand elle parut dans la présence de Melmoth, on distinguait dans ses regards un mélange d’orgueil et de servilité assez curieux pour l’œil de l’observateur. Il provenait de son genre de vie qui se partageait entre une misère abjecte et d’arrogantes mais d’adroites impostures. Elle commença par se tenir respectueusement à la porte de la chambre, prononçant quelques mots entrecoupés, qui, selon toute apparence, étaient destinés à des bénédictions, mais auxquels son air et son ton donnaient une couleur toute contraire. Aussitôt qu’on l’eut interrogée sur le sujet de l’histoire, elle prit un air d’importance, son front s’élargit comme celui d’Alecton, qui, dans Virgile, est tantôt une vieille femme affaiblie par l’âge, et tantôt une furie. Elle traversa la chambre avec fierté, puis s’assit ou plutôt s’étendit sur les carreaux de l’âtre, et, chauffant sa main décharnée, elle se balança pendant quelque temps avant de commencer son discours. Quand elle eut fini de parler, Melmoth s’étonna de la situation extraordinaire dans laquelle les derniers événements avaient placé son âme, puisqu’il avait pu écouter avec des sentiments d’intérêt, de curiosité, de terreur même, un conte si incohérent, si absurde, si incroyable, qu’il rougit au moins de sa folie, s’il ne put la vaincre. En attendant, le résultat de ces impressions diverses fut la résolution de visiter le cabinet, et d’examiner le manuscrit dès le soir même.
Cependant quelle que fût son impatience, il se vit forcé d’y mettre des bornes : car, ayant demandé à la gouvernante des chandelles, elle avoua qu’elle avait brûlé les dernières la veille, auprès du corps de monseigneur. Un petit garçon fut expédié en toute hâte, pieds nus, au village voisin, pour en acheter : on lui dit en même temps d’emprunter, s’il le pouvait, une paire de flambeaux.
— N’y a-t-il donc pas de flambeaux dans la maison ? dit Melmoth.
— Il n’en manque pas ; mais nous n’avons pas le temps d’ouvrir la vieille malle pour retirer les flambeaux plaqués qui sont tout au fond, et quand à ceux de cuivre, il y en a un qui n’a pas de pied, et l’autre dont on a perdu la bobèche.
— Et comment faisiez-vous donc vous-même ? demanda Melmoth.
— Je fichais ma chandelle dans une pomme de terre, répondit la gouvernante.
Pendant que le garçon courait à perdre haleine au village, Melmoth eut tout le temps de réfléchir. La soirée d’ailleurs était propre à la méditation. Le temps était froid et triste ; d’épais nuages annonçaient que la pluie d’automne qui tombait serait de longue durée. Ils se succédaient avec promptitude, et Melmoth, appuyé sur la fenêtre délabrée que chaque coup de vent faisait mouvoir, n’apercevait au loin que la perspective la plus triste, le jardin d’un avare. Des murs en ruine, des allées couvertes d’herbe, des arbres dépouillés et rabougris, des chardons et des orties, remplaçaient partout les fleurs du parterre : c’était la verdure du cimetière, le jardin de la mort.
S’il quittait la fenêtre pour regarder la chambre, la chambre n’offrait pas un aspect plus consolant. La boiserie était noircie par la malpropreté et remplie de fentes ; le foyer était rouillé, et les chaises n’avaient plus de garniture. Sur la cheminée, on voyait pour tous ornements des mouchettes cassées, un calendrier en lambeaux, de l’an 1750, une pendule qui, depuis longtemps, ne montrait plus l’heure, faute des réparations les plus indispensables, et un vieux fusil de chasse sans chien. Il ne faut donc pas s’étonner si Melmoth aimait mieux se livrer à ses pensées, quelque pénibles qu’elles fussent, que de contempler un tel spectacle de désolation. Il récapitula mot à mot, la relation de la sibylle, du ton d’un juge qui fait subir un contre-interrogatoire à un témoin, et qui espère qu’il se coupera.
Le premier des Melmoth qui s’est fixé en Irlande, avait-elle dit, était un officier de l’armée de Cromwell, qui avait obtenu des terres confisquées sur une famille irlandaise attachée à la cause royale. Le frère aîné de celui-ci avait beaucoup voyagé, et il avait demeuré si longtemps sur le continent que sa famille l’avait en quelque sorte oublié. Rien n’engageait d’ailleurs ses parents à s’enquérir de lui. Les bruits les plus étranges couraient sur le compte du voyageur. Il avait, disait-on, appris les plus terribles secrets.
Il faut se rappeler qu’à cette époque la croyance dans l’astrologie et dans la magie était fort générale. Cette crédulité s’étendit jusque sous le règne de Charles II. Quoi qu’il en soit, on assure que vers la fin de la vie du premier Melmoth le voyageur lui fit une visite : au grand étonnement de sa famille, elle ne le trouva nullement vieilli depuis la dernière fois qu’elle l’avait vu. La visite fut courte ; il ne parla ni du passé ni de l’avenir, et ses parents ne lui firent aucune question : car on dit qu’ils ne se sentaient pas fort à l’aise en sa présence. Il leur laissa en partant son portrait, le même que Melmoth avait vu dans le cabinet avec la date de 1646, et il ne reparut plus. Quelques années après une personne arriva d’Angleterre chez M. Melmoth ; elle montrait la plus vive et la plus étonnante sollicitude pour avoir de ses nouvelles. On ne put lui en donner aucune, et, après quelques jours de recherches et d’inquiétude, il repartit, laissant après lui, soit par négligence, soit avec intention, un manuscrit contenant un détail fort extraordinaire des circonstances qui avaient accompagné sa connaissance avec John Melmoth, que l’on appelait communément le voyageur.
On avait conservé le manuscrit et le portrait, et s’il fallait en croire un bruit assez répandu, l’original vivait encore et avait été vu fréquemment en Irlande, même depuis la fin du dernier siècle ; mais on ne le voyait jamais que quand quelque membre de la famille était sur le point de mourir : encore fallait-il que les vices ou les défauts de cet individu répandissent sur sa dernière heure un intérêt morne et effrayant.
D’après cela la destinée future du défunt ne laissait pas d’inspirer des craintes à cause de la visite que ce personnage extraordinaire lui avait, ou paraissait lui avoir rendue.
Telle fut la relation de Biddy Brannigan ; elle y ajouta que selon son opinion personnelle, John Melmoth, le voyageur, existait effectivement encore, sans que, depuis le temps, un cheveu de sa tête ou un muscle de sa physionomie fût dérangé. Elle avait vu des personnes qui l’avaient vu, et qui étaient prêtes à l’attester sous serment, s’il était nécessaire. On ne l’avait jamais entendu parler ; il ne mangeait pas et n’entrait dans aucune autre habitation que dans celle de sa famille. Enfin, elle était convaincue que sa dernière apparition ne présageait rien de bon, ni aux vivants ni aux morts.
John réfléchissait encore à ses discours quand on lui apporta des chandelles ; et sans égard aux figures pâles et aux chuchotements prudents de ses domestiques, il se risqua témérairement dans le cabinet dont il ferma la porte après lui, et se mit à la recherche du manuscrit. Son oncle l’avait si bien désigné, que le jeune homme n’eut pas de peine à le trouver. Ce manuscrit vieux, décousu et décoloré, fut tiré du lieu même où le testament disait qu’on le trouverait. Les mains de Melmoth étaient aussi froides que celles de son oncle, quand il se mit à en déployer les pages. Il en entreprit la lecture ; un profond silence régnait dans la maison. Melmoth regardait les chandelles avec inquiétude ; il les moucha, et ne put s’empêcher de penser que leur lumière était obscurcie. Il crut même un instant, tel est le pouvoir de l’imagination, que la flamme avait une teinte bleuâtre. Il changea plusieurs fois de position, et il aurait changé de chaise, s’il y en avait eu une autre dans la pièce.
Il oublia pendant quelques instants tout ce qui l’entourait, quand la cloche en sonnant minuit le fit tressaillir. C’était le premier bruit qu’il entendait depuis plusieurs heures, et les sons produits par des êtres inanimés quand tous les êtres vivants sont comme morts, font, surtout durant la nuit, un effet singulièrement triste. John contemplait son manuscrit avec un peu de répugnance ; il l’ouvrit, s’arrêta sur les premières lignes, et comme le vent soupirait dans l’appartement désert, et que la pluie battait contre la fenêtre délabrée, il désirait… Que désirait-il ? Hélas, il lui eût été difficile de l’expliquer. Il eût voulu que le bruit du vent fût moins triste, et la chute de la pluie moins monotone. Il faut lui pardonner, car il était minuit passé et il veillait seul à trois lieues à la ronde.
Chapitre3
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, le manuscrit était décoloré, effacé, et qui plus est mutilé, au-delà de tout ce que l’on peut s’imaginer. Les plus fameux savants auraient perdu leur temps, s’il avait fallu le débrouiller en entier : Melmoth n’en put lire que quelques passages détachés. Il découvrit que l’écrivain était un Anglais, nommé Stanton, qui avait entrepris un voyage peu de temps après la Restauration. À cette époque, on ne voyageait pas avec autant de facilité que de nos jours ; et pour bien connaître les principaux pays du continent, il était nécessaire de consacrer plusieurs années à les parcourir.
Vers 1676, Stanton se trouvait en Espagne. Comme la plupart des voyageurs de son siècle, il avait de l’instruction, de l’intelligence et de la curiosité ; mais il ignorait la langue du pays, et il courait parfois de couvent en couvent, demandant l’hospitalité, c’est-à-dire un repas et un lit, qu’il obtenait sous la condition de soutenir une thèse en latin, sur quelque point de théologie ou de métaphysique, contre le premier moine qui voudrait s’offrir pour le combattre. Le plus souvent les religieux convenaient qu’il était bon latiniste et fort logicien, et ils lui accordaient volontiers son lit et son souper.
Il n’eut pas ce bonheur le 17 août 1677. Abandonné par un guide peureux qui, à la vue d’une croix érigée sur le bord de la route, en mémoire de quelque assassinat, s’était sauvé dans la crainte que l’hérétique qu’il accompagnait ne lui portât malheur, Stanton se trouva seul dans les vastes plaines du royaume de Valence, aux approches de la nuit, et par un temps orageux. La beauté sublime, mais douce, du paysage, lui avait causé une sensation délicieuse, et il jouissait de cette sensation à la manière anglaise, c’est-à-dire en silence.
Les débris magnifiques que les deux nations qui avaient successivement possédé ce pays y avaient laissés, environnaient de toutes parts notre voyageur. Il ne voyait autour de lui que des palais romains ou des forteresses moresques. Les nuages orageux qui s’élevaient lentement sur l’horizon, semblaient être les linceuls dont se couvraient ces spectres d’une grandeur évanouie. Ils approchaient, mais ne les cachaient pas : on eût dit que la nature elle-même respectait le pouvoir de l’homme. Au loin, l’aimable vallée de Valence rougissait de tout l’éclat du soleil couchant, comme une fiancée que son jeune époux vient d’embrasser pour la dernière fois le soir de ses noces. Stanton regardait autour de lui. Il fut frappé de la différence entre les ruines romaines et celles des Maures. Parmi celles-là, on voit des théâtres et des places publiques ; celles-ci n’offrent que des forteresses qui paraissent imprenables. Ce contraste avait quelque chose de frappant pour un philosophe. Les Grecs et les Romains étaient des sauvages, s’il faut en croire le docteur Johnson, car ils ne connaissaient pas l’imprimerie, et cependant on voit partout des traces de leur goût pour les plaisirs ou les commodités de la vie, tandis que les autres peuples conquérants n’ont laissé dans les pays qu’ils ont possédés que des vestiges de leur amour désordonné du pouvoir.
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!