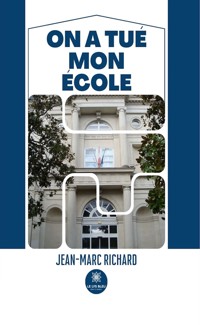
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
"On a tué mon école" explore la crise actuelle de l’éducation, analysant comment une fierté nationale, l’école républicaine, a sombré dans la décadence. Naviguant entre le quotidien de l’éducation et les coulisses politiques, cette histoire est celle d’un parcours ministériel et d’un engagement. À travers un état des lieux critique de la situation, le récit souligne la déconnexion entre théorie et pratique, idéaux et réalités factuelles. Cependant, une touche d’optimisme subsiste quant à la capacité de façonner une société plus juste.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Marc Richard a pris la décision de se consacrer à la rédaction de livres sur des sujets de société importants. Motivé par l’envie d’exposer les problèmes majeurs de l’humanité, il s’est choisi un style original, alliant le suspens à la profondeur puissante de personnages au premier abord anodins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Marc Richard
On a tué mon école
© Lys Bleu Éditions – Jean-Marc Richard
ISBN : 979-10-422-3180-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Préambule
Il est assez banal de dire qu’un système éducatif et ses évolutions reflètent assez parfaitement la nature et les mutations de la société dont il est issu.
L’un des objectifs de cet ouvrage est de montrer comment, en suivant l’évolution de notre école, depuis la fin des années soixante, notre société s’est progressivement éloignée des valeurs républicaines fondamentales.
Pour illustrer cette évolution ratée, j’ai choisi de puiser dans ma propre expérience les signes de la dégradation.
Au lieu et place de vastes considérations philosophico-pédagogiques, il m’a semblé plus utile de parler du terrain.
Celui de l’expérience développée en Nouvelle-Calédonie sous le nom d’ALEP (Annexes de Lycée d’Enseignement Professionnel) en constitue sans doute un axe important.
Mais, comme rien ne peut remplacer vraiment ce petit quotidien qui, au ras du sol, fait souvent douter de la compétence de certains décideurs, on parlera également des Centres de Documentation et d’information ou des réseaux de formation continue de l’Éducation nationale.
Au travers de ces exemples vécus, on peut mesurer la lourdeur de la machine, le conservatisme, voire l’aveuglement de trop d’acteurs.
Dans une autre dimension, il m’a été donné de « frôler », d’un peu trop près à mon sens, le monde politique, son système de fonctionnement, ainsi que la construction, parfois chaotique, des décisions finales.
Il s’agit donc d’une progression « sur le terrain » qui sert en quelque sorte de fil rouge à la réflexion. Une approche peut-être contraire au processus habituel : c’est de l’action que naît la recherche de solutions. De la pratique vient la théorie, et non l’inverse.
J’ai notamment appris cela avec les élèves de l’établissement expérimental que j’avais fondé dans l’archipel de Nouvelle-Calédonie.
Le caractère autobiographique de toutes ces expériences présente cependant quelques inconvénients : notre mémoire est sélective ainsi que trieuse, sa subjectivité est indéniable et sa propension à masquer les faiblesses ainsi que les erreurs est plus répandue que l’autocritique. Il faut avoir conscience de cela.
Cet éclairage spécifique, par le biais d’un système qui illustre si bien les évolutions de la société, nous mènera de manière naturelle au cœur des préoccupations très actuelles telles que le mauvais état de nos démocraties et le danger liberticide qui guette nos sociétés.
Dans cette optique, on pourrait peut-être utiliser cet ouvrage à l’inverse d’un entonnoir : par le petit embout commence une vie confinée et conditionnée par des réalités immédiates, ce qui est le lot du plus grand nombre. Ensuite, par la confluence des hasards, les choses s’élargissent progressivement, les certitudes s’appauvrissent et les doutes émergent : on débouche ainsi dans le pavillon principal de l’entonnoir.
La vue devient alors plus synoptique, c’est-à-dire moins radicale et normalement plus attentive aux réalités du monde.
C’est du moins ce que l’on peut espérer.
Partie I
Parcours et politique
Chapitre I
Dans le bain sans savoir nager
Ce jour de novembre 1967, pluvieux avec un ciel bas de nuages mêlés aux fumées des usines lorraines, nous mettions les pieds, Elisabeth et moi, chacun de notre côté, dans la première salle de classe où nous n’étions pas élèves.
Une réalité crue nous tombait alors dessus : il fallait enseigner en mimant la compétence et l’expérience.
Depuis les rives méditerranéennes, des escadrons d’étudiants en difficulté financière ou en rupture parentale venaient combler les orifices béants de l’encadrement pédagogique d’alors.
Provençaux, Aquitains ou Nord-Africains y trouvaient sans difficulté leur place.
Dans notre cas, le rectorat de Strasbourg s’étant trouvé dans l’impossibilité de pourvoir de très nombreux postes d’enseignants, lança un appel à candidatures, inséré dans « Nice-Matin » dans la première quinzaine d’octobre « Le midi viendra bien au secours de l’Alsace et de la Lorraine. »
Nous postulâmes donc.
Après avoir antérieurement obtenu onze postes divers sur cinq académies, nous pûmes enfin obtenir deux offres sur un même établissement. Cela nous convenait, sauf qu’Elisabeth et moi devions nous marier à la fin de ce même mois.
Notre double candidature fut retenue.
Mais il fallait immédiatement occuper les postes.
Lorsque nous fîmes savoir que notre proche mariage constituait un obstacle à cette action précipitée, on nous indiqua que les emplois seraient alors attribués à d’autres.
Que nenni, après notre mariage, le rectorat de Strasbourg nous contacta de nouveau pour savoir si nous étions toujours disponibles et confirma nos nominations.
La pénurie d’enseignants était telle que l’administration se montrait peu regardante sur les capacités et les diplômes.
Bien entendu, aucun de nous deux n’avait déjà enseigné et, quant à nos titres, ils se résumaient à deux certificats de licence de lettres classiques pour Elisabeth et un seul certificat de géographie pour moi.
Aucun de nous deux ne possédait donc une licence complète.
Nous avons même pu voir, une jeune maîtresse auxiliaire (même statut que nous), intronisée professeur de mathématiques alors qu’elle ne possédait… que le bac.
Bien entendu, aucune formation professionnelle n’était envisagée !
Tandis qu’Elisabeth obtenait tout de même d’enseigner les lettres, je fus baptisé professeur de lettres modernes alors que je préparais une licence d’histoire.
C’est Elisabeth qui me rappela qu’en classe de troisième, le professeur de français devait également enseigner la grammaire, matière dans laquelle je n’étais guère performant…
Nous fûmes ainsi plongés sans palmes ni bouées, dans ce grand bain de l’Éducation nationale dans lequel nous finîmes par nager jusqu’à la retraite en faisant nous-mêmes pousser nos propres nageoires.
Notre inexpérience et notre naïveté nous faisaient découvrir beaucoup de choses étranges et inattendues. Cela fut le cas notamment de « La salle des Professeurs », autre monde un peu particulier.
Le principe affiché était une solidarité sans faille entre les « Colllègues » (à prononcer de préférence avec 3 L, afin de marquer une culture non populaire).
Sous une fraternité de façade rôdait la curiosité des titres universitaires de chacun. L’agrégé était « quelqu’un », le sommet de la pyramide en quelque sorte, le Certifié (Lauréat du Concours de Certification d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire) se positionnait en second rang. Venaient ensuite les professeurs de collège (PEGC), sujets d’une condescendance à peine voilée de la part des deux castes supérieures.
Inutile de dire que pour la piétaille des maîtres auxiliaires, le regard était souvent ironique. Seuls peut-être les MA II, titulaires d’une licence complète, conservaient une certaine considération. Quant à nous, MAIII (Licence incomplète), notre existence ne semblait compter que si nous adhérions au SNES (Syndicat national de l’Enseignement Secondaire), et encore fallait-il qu’au sein de ce même syndicat, nous votions pour la liste « Unité et Action », mouvance contrôlée par un Parti Communiste alors au faîte de sa gloire.
Paradoxalement, en politique, ces mêmes personnes votaient plutôt dans l’autre sens. À chaque élection, les votes gaullistes écrasaient tous les autres.
Il semblait donc que les propos convenus de la salle des professeurs ne correspondaient pas tout à fait aux convictions profondes : le monde se divisait entre le corporatisme enseignant et la citoyenneté. Il y avait la « sphère » enseignante et le monde extérieur.
J’eus plusieurs fois, au cours de ma carrière, à constater cet étonnant phénomène.
Ignorants des codes et des termes utilisés, notre naïveté nous joua de méchants tours : ainsi lorsque, d’une voix (toujours suave) on nous demandait « Vous êtes certifié ? », comme nous ignorions totalement ce que signifiait ce terme et que nous possédions des certificats de licence, nous répondions « oui », ce qui nous faisait passer pour de sacrés menteurs.
Heureusement, la troupe des maîtres auxiliaires étant très abondante, nous pûmes trouver du réconfort auprès de cette génération de notre âge dont une partie significative provenait du sud, voire du grand sud, puisque deux Tunisiens en faisaient partie.
Nous nous appliquions également à entretenir dans la cantine, une joyeuse ambiance qui ne semblait pas du goût des « Titulaires ».
Les chants de salle de garde ainsi que les histoires de bas niveau choquaient cette humanité établie qui voyait son monde vaciller avant l’effondrement de 1968, évènement qui sera évoqué plus largement en fin d’ouvrage.
Ainsi, avec nos « collègues » statutaires, outre nos découvertes pédagogiques, nous avons fait l’apprentissage de la solidarité des réprouvés.
Et c’est là également que l’on a pu découvrir le décalage qui pouvait exister entre les titres acquis et les qualités pédagogiques : j’ai vu des enseignants « titulaires » se faire fortement chahuter par des classes qui ne bronchaient pas avec moi et qui manifestaient même une participation et une envie d’apprendre qui demeurent un joyau pédagogique dans mes souvenirs.
Il faut dire que les élèves d’alors avaient un niveau qui n’a rien à voir avec ce que l’on a connu par la suite. Je me souviens de certaines copies de français en cinquième, lesquelles, par la qualité rédactionnelle et l’orthographe, pourraient faire pâlir de honte bien des candidats au baccalauréat contemporain.
Malgré cela, des enseignants « titulaires » passaient parfois de mauvais moments en cours.
Visiblement, la soi-disant « Formation professionnelle » n’était pas au point et la formule de recrutement était non adaptée.
Néanmoins, j’en profitais, tout en travaillant (20 heures de cours par semaine) pour terminer la licence et passer une maîtrise d’histoire contemporaine à l’université de Metz, et ce, toujours avec des mentions, chose que je n’avais jamais connue auparavant.
En effet, les hordes de maîtres auxiliaires sans licence auxquels il avait fallu faire appel encombraient trop les lycées : il fallait qu’ils augmentent leur niveau d’études.
Donc, dans un effort peu imaginable aujourd’hui, les facultés rassemblèrent sur la journée du jeudi, tous les cours de la semaine à destination de ces étudiants en panne d’études et condamnés à un travail d’enseignement aléatoire pour simplement vivre.
De huit heures du matin à dix-huit heures, ces jours-là, nous planchions à la faculté.
Je profitais donc de cette aubaine, laquelle, bien qu’alourdissant ma charge de travail hebdomadaire, m’ouvrait d’autres perspectives. En parallèle, bien heureusement, les établissements ne prévoyaient pas de cours pour leurs maîtres auxiliaires le jeudi.
Cette période d’études fut, dans mon parcours scolaire chaotique et médiocre, une sorte de performance.
Qu’on en juge : je n’obtins le bac qu’à la veille de mes 21 ans après avoir redoublé la sixième, la première et la terminale. Étant passé par le « Cours complémentaire », il m’a fallu subir l’examen d’entrée en sixième, le Certificat d’études, le BEPC, l’examen d’entrée en seconde, le premier bac, le second bac, propédeutique, quatre certificats de licence puis un certificat de maîtrise, et finalement présenter un mémoire de recherches en histoire contemporaine intitulé sobrement : « Les républicains messins et la politique extérieure de la monarchie de Juillet. »
Bref, un parcours haché et peu reluisant, comme en rugby, un mauvais trois quart aile qui ne parvient à marquer son premier essai que juste avant sa retraite sportive.
Chose étonnante, c’est au moment où je travaillais à temps complet pour avoir un salaire que je franchissais le plus aisément les derniers barrages. Est-ce que la grande difficulté m’a donné l’énergie nécessaire ? Vaste débat philosophique et sociétal.
Ceux qui étaient nés dans un milieu culturel et aisé n’avaient sans doute pas besoin de cette contrainte. Pour moi, issu d’un milieu peu tourné vers la culture et l’envie d’apprendre, c’est cette contrainte quasi permanente qui m’a fait prendre le véhicule salvateur : l’ascenseur social.
Tout cela pouvant signifier également que le métier d’enseignant, à cette époque au moins, n’était pas éreintant.
Les élèves respectaient ceux qui méritaient de l’être et les parents faisaient confiance aux enseignants.
Époque révolue, semble-t-il, nous essaierons plus loin de voir pourquoi.
Chapitre II
Militantisme (1967-1970)
Pendant tout ce temps d’incertitude sur l’avenir, je m’impliquais localement dans la construction du nouveau Parti Socialiste avec tous les revers que pouvait comporter une telle attitude sur une terre essentiellement conservatrice.
C’était une forme d’apprentissage politique aux côtés de notre approximatif auto-apprentissage pédagogique dans ce lycée de Lorraine.
S’agissait-il là d’une échappée provisoire destinée à fuir les réalités du quotidien ?
La suite démontrera peut-être que ce ne fut pas le cas.
Tous les militants de tous les partis peuvent se poser plus tard ce genre de question, car les difficultés du quotidien peuvent facilement vous entraîner à vous soulager quelque peu de vos préoccupations du moment en faisant appel à quelque rêve social et donc politique.
Dans ces années qui précèdent l’irruption de mai 1968, les offres politiques pour faire rêver sont nombreuses.
Quelque peu instruit par l’histoire, je me gardais des attitudes prétendues « révolutionnaires ». C’est donc vers la remise en ordre de marche du courant social-démocrate qu’allaient mes préférences. Il fallait que la vieille SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) se modernise, autant dans ses idées que dans ses pratiques.
Dans ce fourneau lorrain digne de Zola, entre les dominants et ceux qui obéissaient aux sirènes des usines toutes les huit heures, l’attentisme n’était guère permis si un soupçon de révolte vous habitait.
Nous avons ainsi pu rencontrer des personnes exceptionnelles, engagées auprès des plus humbles et qui, aveuglées par le prêt à penser qu’on leur infligeait, finirent par servir des causes concrètement étrangères à leurs propres aspirations.
Ce sont les militants du parti Communiste et des groupuscules gauchistes qui payèrent le plus lourd tribut dans cette forme de lobotomisation.
C’était sans doute là, pour nous, un inattendu complément de formation.
On découvrait tout un monde, avec ses bassesses et ses grandeurs, ses médiocrités et ses générosités.
C’est ainsi qu’un jour, lors d’une assemblée réunissant parents d’élèves et enseignants, un échange aujourd’hui à peine imaginable amena l’un des parents d’en traiter un autre de « sale juif ».
Révoltés, nous fîmes de ce « sale juif » et de sa famille des amis pour longtemps.
Juifs ashkénazes déposés par l’histoire de l’entre-deux-guerres sur un territoire lorrain avide de main-d’œuvre, leurs parents avaient déposé les valises sur le quai de quelque gare alentour. Après les efforts que l’on peut imaginer, lui était devenu médecin et elle diplômée de l’université.
Tous les deux, membres d’un Parti Communiste puissamment implanté dans le secteur, ils s’engagèrent dans un militantisme que le temps et la suite des évènements, me font aujourd’hui juger déraisonnable.
Cependant, toute cette générosité humaine, trahie par une idéologie manipulatrice, ne peut que renforcer l’estime et même l’affection que nous pouvions leur porter.
Ils ont sacrifié leur vie à leur idéal politique. Ils étaient rentrés là comme on entre en religion.
Le revers de cette médaille consistait en une avalanche de certitudes que nul ne pouvait entamer : sur le pacte germano-soviétique, l’écrasement de la révolte de 1953 à Berlin Est et celle de 1956 à Budapest, ils avaient toujours la réponse. Pour celle de 1968 à Prague, je pense ne plus avoir eu l’envie d’entendre l’explication du Comité Central français, simple relais de celui du Kremlin. Les « camarades » et le « Parti » avaient toujours raison.
Et pourtant ! Que ces personnes méritaient le titre « d’humains ». Toujours tournés vers les plus humbles et les plus misérables, ils ne s’apercevaient pas, qu’eux aussi d’une autre manière, faisaient partie des exploités : on utilisait leur générosité et même leur vie afin de maintenir en place un système qui broyait tout.
Nous avons retrouvé Claude et Eliane, car tels étaient leurs prénoms, une bonne vingtaine d’années plus tard, lors de notre retour de Nouvelle-Calédonie.
Ils n’étaient plus les mêmes.
L’heure de la retraite étant venue, ils s’étaient retirés près d’Arcachon et sans qu’ils ne disent rien, nous avions compris qu’ils avaient compris.
Claude me fit une allusion à l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques et ce fut tout.
Nous passâmes un réveillon ensemble et, le lendemain, il me demanda de l’accompagner au golf. Trop éloigné de cette pratique, je me contentais du rôle de caddy et trimbalais les ustensiles nécessaires.
Le petit tour terminé, mon ami m’entraîna au Club House où il commanda huîtres et champagne. Il parla peu, mais ses yeux s’étaient mouillés lorsqu’il évoqua sa vie trahie.
Il avait choisi de vivre les dernières années de cette vie sur un mode qu’il avait toujours combattu.
Il me fut impossible de trouver les mots pour tenter d’apaiser ce flot de désespoir que je sentais venir de si loin.
En me souvenant de ces instants, me revient en mémoire la dure vérité énoncée par Rachid Benzine « Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance, ce sont les certitudes ».
C’est donc au cours de cette période que je plongeais dans un militantisme socialiste peu enclin à épouser les thèmes radicaux de la vague qui engendrait alors les maoïstes, les trotskistes et autres anarchistes.
L’histoire démontrait trop que chaque révolution mangeait ses propres enfants.
Je participais également au combat d’une association qui tentait d’alerter l’opinion publique, sur la montée, réelle à cette époque, de la faim dans le monde.
Le présidence en était assurée par Etienne Crémieu-Alcan, personnage de haute valeur, co-fondateur des Presses Universitaires de France (PUF) et dit-on, à l’origine des fameux petits : Que sais-je ? Par la suite, cet homme d’exception deviendra un ami proche que nous avons beaucoup apprécié, mon épouse et moi-même, jusqu’à son décès. Par la suite, c’est un de ses fils, Francis, ainsi que sa famille qui prit le relais de son amitié et donc, nous avons pu connaître trois générations de Crémieu-Alcan.
Lors de la première réunion du comité directeur de cette association (ASCOFAM) à laquelle je participais, et fis la connaissance de l’abbé Pierre et de Robert Buron.
Ce dernier, ancien ministre du général de Gaulle, avait quitté les rives d’un centre qu’il trouvait trop statique et s’employait à préparer les élections présidentielles prévues en 1972 avec son mouvement : « Objectif 72 ».
Les analyses très novatrices de cette instance me séduisirent immédiatement : cela jetait les bases d’une sociale démocratie sereine, capable d’équilibrer justice sociale et dynamisme économique.
Le départ prématuré du général de Gaulle en avril 69 bouleversa le calendrier électoral et Objectif 72 se mua en Objectif Socialiste avant de rejoindre le parti Socialiste auquel j’avais déjà adhéré par le biais du « Nouveau Parti Socialiste » après le congrès d’Issy-les-Moulineaux.
Je plante un peu ici le décor pour placer une anecdote qui m’a beaucoup appris sur les pratiques politiques :
Dans les mois qui suivirent les évènements de mai 1968, l’effervescence politique perdurait dans les milieux d’extrême gauche.
Robert Buron avait prévu de tenir une réunion d’une certaine importance dans une salle située à Saint-Germain-des-Prés.
Dès l’intervention des premiers orateurs, on sentait une ambiance « révolutionnaire », il ne manquait que les piques, les fourches, et la guillotine.
Devant moi-même intervenir, j’étais assis au premier rang. Robert Buron, de l’estrade où il était assis avec quelques autres personnes, me fit signe de venir vers lui.
Je grimpais et m’approchais, il me chuchota :
— François Mitterrand doit venir, mais comme il est toujours en retard, il faudrait l’accueillir à l’arrivée.
L’homme qui avait mis le général de Gaulle en ballottage en 1965 méritait quelques égards.
Je me dirigeais donc vers le hall d’entrée et attendis, tout en gardant une oreille vers la salle.
Il arriva, en effet avec un certain retard et me tendit manteau, chapeau et écharpe comme on peut le faire avec un valet de pied stylé et me pose une simple question :
— Comment cela se passe-t-il ?
Je lui fais alors une relation rapide de la situation en décrivant l’ambiance pré révolutionnaire de la salle. Naïvement, je comptais sur son aura pour ramener tout ce petit monde à la raison.
Dans son intervention, point d’apaisement, mais une véritable surenchère : le capitalisme était écrasé sous les talons, les patrons promis à de belles taxations et le salaire minimum à un bel envol… bref, ovation assurée, mission accomplie, « en voilà qui ne me mettront pas les bâtons dans les roues » devait-il se dire.
Ma sortie ne concerne pas qu’une personne, car j’ai dû constater plus tard que la pratique était très répandue. Elle persiste encore largement avec des chapelets de vociférations qui laissent croire aux citoyens que l’on va « voir ce que l’on va voir ».
À l’aube de mon activité professionnelle, cet apprentissage m’a peut-être permis d’éviter bien des pièges ultérieurs.
Chapitre III
Des têtes bien pleines
(Algérie 1970-1973)
Les trois années d’apprentissage sur le tas dans cet univers lorrain si éloigné de nos repères furent sans doute salutaires puisque nous étions assez sûrs de nous pour postuler à deux emplois de coopération en Algérie.
Elisabeth, après ces années continentales dans un univers stressant pour elle, souhaitait constater que la Méditerranée existait toujours et quant à moi, c’était un retour vers mon cher pays après les déferlantes de l’histoire.
Nous étions en 1970, soit 8 ans après l’indépendance de ce pays.
L’une de mes arrières Grand-mère était née à Alger en 1847. Elle était fille de cordonnier, donc enfant de ces miséreux qui pensaient trouver sur ces terres nouvelles une issue possible à la disette de certaines zones de l’Europe d’alors.
De fait, au milieu des années cinquante, toute ma famille : parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines se retrouvèrent dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour d’Alger. Nul n’imaginait ailleurs son avenir.
Ce Pied noir de retour fut accueilli chaleureusement par la population la plus modeste et de manière plus méfiante par les nouveaux maîtres, mais je retrouvais vite mes marques.
Et ce surtout grâce à la gentillesse du petit peuple qui parlait souvent du « Temps de la France ».
Une nouvelle expérience pédagogique et humaine m’attendait. Ce qui fut également le cas, mais dans un univers inconnu, pour Elisabeth.
Et ce nouveau monde la séduisit bien davantage que les terrils lorrains.
Dans mon ouvrage Algérie, le retour amoureux : un pays sous fausse identité (L’Harmattan, 2021), je relate plus précisément cette nouvelle rencontre avec mon pays.
Ici, il s’agissait de poursuivre un itinéraire pédagogique bricolé sur le tas et corrigé au fur et à mesure par simple empirisme.
Il fallait que nous reprenions la suite de notre auto-formation.
À cette époque, une grande partie de la population algérienne ayant été scolarisée en français, cette langue était celle de l’administration et du langage courant en dehors de la cellule familiale, sauf pour les classes bourgeoises qui n’utilisaient pratiquement que la langue de Molière et tenaient à scolariser leurs enfants dans les établissements français ou directement en France.
Le discours nationaliste et arabophone officiel avait peu de prise sur une population qui se sentait souvent plus proche de cet arabe dialectal nourri de termes français, espagnols ou italiens que d’un arabe classique que peu de personnes ne comprenaient.
De plus, les professeurs égyptiens chargés d’enseigner cette nouvelle « langue nationale » étaient mal considérés. Ils avaient été envoyés par Nasser qui voulait s’en débarrasser, parce qu’issus de la mouvance des Frères musulmans, courant alors le plus rigoriste de l’Islam.
Leur culture générale était moquée par les Algériens passés par l’école française et leurs pratiques pédagogiques s’apparentaient peu ou prou à celles des écoles coraniques : on devait tout savoir « par cœur ».
Cela avait peu de choses à voir avec l’enseignement de conception française qu’avaient connu aussi bien les élites que beaucoup des plus modestes, même si, pour ces derniers, cela s’était arrêté au primaire pour beaucoup de garçons et parfois pas du tout pour trop de filles au gré de la volonté des parents.
Les élèves des lycées considéraient donc l’enseignement de ces Égyptiens avec quelques mépris et les professeurs « coopérants », Français, Belges ou Canadiens, par comparaison, bénéficiaient d’une véritable estime.
La pesanteur de cette pédagogie importée se faisait cependant sentir progressivement. Je voudrais illustrer cela par un simple exemple de cette lutte, perdue d’avance dans le temps, mais que j’ai tenté de mener contre le « prêt à penser » et le « parcoeurisme ».
Ce fut un mauvais tour que je jouais un jour à cette cinquantaine d’élèves de terminale, certes besogneux, mais dont l’esprit confondait trop réflexion et accumulation de connaissances mal digérées. J’étais en effet un petit peu las de corriger beaucoup de devoirs presque parfaits en termes de connaissances, mais assez plats, sans vie, sans avis et sans réflexion. Je savais que la majorité travaillait dur. Ainsi, même si quelques tricheurs que je connaissais voyaient leur note un peu cassée, la moyenne générale d’un devoir tournait autour de 13 – 14. J’entrepris donc lors d’une « composition » (trace de l’école française), de leur donner un sujet un peu tordu qui ressemblait à « productions et structures de l’agriculture italienne et de l’agriculture britannique » et, pour calmer leur montée d’angoisse, je proclame : « Vous pouvez utiliser vos livres et vos cahiers et, si nécessaire, vous rendre à la bibliothèque qui est mitoyenne. » Ce fut un ravissement général.
On se précipita sur livres et cahiers. J’avais tendu mon piège et cela semblait fonctionner. Bien évidemment, les résultats ne furent pas à la hauteur de leurs espérances. La moyenne de la classe se situa autour de 8. La plupart des devoirs n’étaient qu’une compilation de connaissances en deux parties : l’Italie et le Royaume-Uni, ou l’inverse. Un seul élève (brillant par ailleurs), avait fait un plan différent et, avec du recul, élabora un devoir qui comportait des comparaisons (différences et similitudes). Face à leur désespoir, je leur expliquais le but de l’opération, reconnaissais leur avoir tendu un piège « éducatif » et remontais toutes les notes de cinq points.
Certains avaient ainsi découvert que la connaissance brute n’était peut-être pas une fin en soi et, de mon côté, sans doute à mon insu, j’avais peut-être préfiguré ce que pourrait être l’enseignement qui accompagnerait l’intelligence artificielle lorsqu’elle surgirait après quelques décennies.
Bénéficiant de toutes les données qu’ils avaient pu trouver, les élèves devaient les évaluer et les organiser de manière à répondre le mieux possible à la question posée.
Deux ans plus tard, je me promenais rue Didouche Mourad (ex-Michelet) à Alger, dans le quartier des facultés, et un jeune homme m’arrêta : « Monsieur Richard, vous vous souvenez de moi ? » J’avais du mal à reconnaître. « Je suis M… j’étais en classe de terminale à Miliana ». Bien sûr, je lui demande ce qu’il fait et j’apprends ses succès universitaires. Mes félicitations reçues, il se penche vers moi et murmure presque : « Je me souviens très bien de la composition avec l’Italie et l’Angleterre et je veux vous remercier, vous m’avez appris à penser. »
Quelle meilleure récompense peut attendre un enseignant ?
C’est durant ce séjour algérien que je devins « titulaire » sans l’avoir vraiment demandé.
Le ministère de l’Éducation nationale, toujours à court d’enseignants, avait en effet décidé de créer un nouveau corps, sans concours, en intégrant comme « Adjoints d’Enseignement » à peu près tous les titulaires d’une licence qui étaient en fonction, afin de mieux les retenir. Le salaire, quoiqu’inférieur à celui des certifiés, était plus convenable et la sécurité de l’emploi permettait de renforcer la position du ministère sur un marché où, à l’époque, le chômage ne concernait pratiquement que les volontaires.
Au cours de ce séjour algérien, j’eus à enseigner de la sixième à la terminale et, au fur et à mesure de l’arabisation de l’histoire, il ne me restait plus que la géographie à administrer.
Cet état de fait, joint au constat désolant de voir mon pays dériver vers une forme étonnante d’islamo-marxisme, avec tout ce que cela comporte d’obscurantisme religieux, de montée de la corruption, de pénuries et de restriction des libertés, me décida, au bout de trois ans, à regagner la France, sans doute au grand dam d’Elisabeth qui avait retrouvé l’ambiance méditerranéenne de son enfance niçoise.
Chapitre IV
Un souvenir utile qui marque
Elle s’appelait Sœur Justine. Enfin je crois, puisque le temps m’a mangé bien des souvenirs.
C’était au milieu des années quarante et je devais me trouver en dernière année de maternelle ou en cours préparatoire dans cet orphelinat de la banlieue d’Alger où m’avaient plongé les aléas d’une vie familiale déchirée autant par la guerre que par quelques insignifiantes querelles.
Tenu par la congrégation des sœurs de Saint-Vincent-de Paul, cet établissement, noyé dans une pauvreté volontaire, souhaitait sauver les âmes avant toute chose.
Toutes les âmes, celles de ces jeunes sans famille réelle autant que celles de ces femmes qui semblaient avoir renoncé à toute vie personnelle pour se tourner vers Dieu.
Sœur Justine donc, notre maîtresse d’école, bien qu’encombrée d’une robe noire enveloppante et d’une large coiffe handicapante menait avec la plus grande rigueur ses cours d’apprentissage de la lecture.
Le principe essentiel qu’elle répétait sans relâche dès que nous avions quelque difficulté m’est resté en mémoire : « Faites un effort, vous verrez, comme la réussite donne du plaisir », car dans cet orphelinat, on vouvoyait les élèves.
Elle avait aussi une expression passe-partout du genre :
« Si vous ne savez pas vous adapter à cela, vous ne vous en sortirez jamais. »
En fait, je ne me souviens pas des propos exacts, mais j’en ai bien conservé le sens.
Il y avait aussi cette vertigineuse sentence qui me marqua pour longtemps :
« Si vous n’êtes pas capable de faire un effort, vous serez malheureux toute votre vie. »
C’est peut-être là aussi que j’ai pu apprendre qu’il ne fallait pas rire de tout.
Ainsi, je me souviens d’un certain fou rire : chose extrêmement rare et plutôt mal considérée en ce lieu en principe consacré à une religion débarrassée de toute distraction.
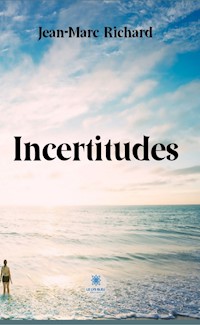














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













