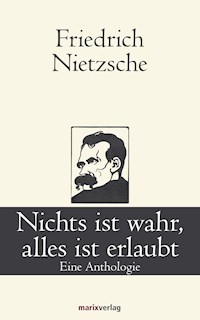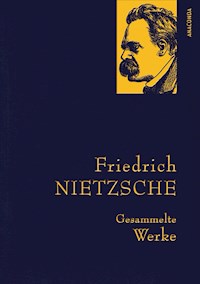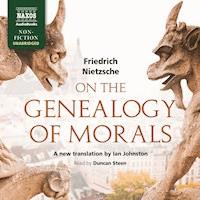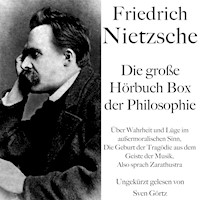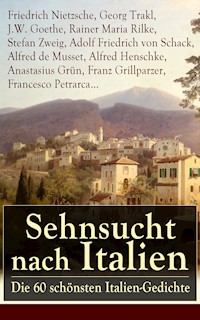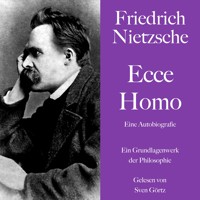Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Par-delà le Bien et le Mal est un ouvrage majeur de Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle. Publié en 1886, ce livre incisif et provocateur explore les notions de morale, de vérité et de valeur, remettant en question les fondements de la pensée traditionnelle.Dans Par-delà le Bien et le Mal, Nietzsche propose une critique radicale de la morale conventionnelle, affirmant que les valeurs morales sont des constructions sociales qui entravent le développement de l'individu. Il remet en question les notions de bien et de mal, soutenant que ces concepts sont relatifs et dépendent des intérêts et des perspectives individuelles.
L'ouvrage se compose de plusieurs aphorismes et de chapitres courts, dans lesquels Nietzsche explore une variété de sujets, tels que la volonté de puissance, la nature humaine, la religion et la culture. Il utilise un style d'écriture incisif et poétique, qui invite le lecteur à remettre en question ses propres croyances et à repenser les fondements de la morale et de la vérité.
Par-delà le Bien et le Mal est considéré comme l'un des textes les plus influents de Nietzsche, et il a profondément marqué la philosophie et la pensée occidentale. Son approche iconoclaste et sa remise en question des valeurs établies ont inspiré de nombreux penseurs et ont ouvert de nouvelles perspectives sur la nature humaine et la société.
Ce livre est un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la psychologie et à la critique sociale. Il offre une vision audacieuse et stimulante du monde, invitant le lecteur à remettre en question les idées reçues et à explorer de nouvelles voies de pensée. Par-delà le Bien et le Mal est un véritable défi intellectuel, qui ne manquera pas de susciter des débats et des réflexions profondes.
Extrait : "La volonté du vrai – qui nous égarera encore dans bien des aventures – cette fameuse véracité, dont tous les philosophes jusqu'à présent on parlé avec vénération : que de questions cette volonté du vrai n'a-t-elle pas déjà soulevé pour nous? Quelles singulières questions, dangereuses, et problématiques? C'est déjà une longue histoire, – et cependant il semble qu'elle ne vienne que de commencer?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En supposant que la vérité soit femme –, eh bien ! le soupçon n’est-il pas fondé que tous les philosophes, en tant que dogmatiques, aient été incompétents sur le chapitre de la femme ? que le sérieux tragique, l’insistance maladroite, qu’ils ont mis jusqu’à présent pour s’approcher de la vérité, n’étaient que des moyens maladroits et inconvenants, s’il s’agissait justement d’avoir prise sur une femme. Il est certain qu’elle ne s’est pas laissé prendre : – et toute dogmatique est aujourd’hui debout devant nous dans une attitude triste et découragée : si tant est qu’elle est encore debout ! Car il y a des railleurs, pour prétendre qu’elle est tombée ; – que toute dogmatique gît à terre, – pis encore, qu’elle agonise. Sérieusement parlant, il y a de bons motifs d’espérer que toute dogmatique en philosophie, – malgré une allure solennelle et quasi-définitive – n’a été qu’un enfantillage et un balbutiement ; – et peut-être le temps est-il proche où l’on concevra de nouveau ce qui en réalité a suffi à constituer le fondement de ces constructions philosophiques élevées, absolues, que les dogmatiques ont édifiées jusqu’à ce jour – une superstition populaire quelconque des temps les plus reculés (comme la superstition de l’âme, laquelle n’a pas cessé comme superstition du sujet, du Moi : – de produire le désordre) – un jeu de mots peut-être, – une équivoque grammaticale ou quelque généralisation téméraire de faits très restreints, très personnels, très humains, trop-humains. La philosophie des dogmatiques n’a été, espérons-le, qu’une promesse faite des milliers d’années d’avance : comme ce fut le cas, à une époque antérieure encore, pour l’astrologie, au service de laquelle on a dépensé peut-être plus de travail, d’argent, de perspicacité, de patience, qu’on ne l’a fait depuis pour une science véritable : – c’est à elle et à ses aspirations « supra-terrestres » qu’on doit en Asie et en Égypte le grand style de l’architecture. Il semble que toutes les choses grandes, pour graver dans le cœur de l’humanité leurs exigences éternelles, doivent errer d’abord sur terre, en revêtant un masque énorme, effroyable ; – la philosophie dogmatique fut, un masque de ce genre : par exemple, la doctrine des Védas en Asie, le Platonisme en Europe. Ne soyons pas ingrats : il faut avouer cependant que la plus grave, la plus persévérante, la plus dangereuse des erreurs a été une erreur de dogmatisme, à savoir la trouvaille par Platon de l’esprit pur – et du bien en soi. Maintenant qu’elle est surmontée ; que, délivrée de ce cauchemar, l’Europe respire, et, tout au moins, a droit de jouir d’un plus salutaire… sommeil, c’est nous, nous dont le devoir est la vigilance même, qui héritons de toute la force que les luttes, provoquées par cette erreur, ont fait grandir. C’était en effet poser la vérité, tête en bas, nier la perspective, condition fondamentale de toute vie ; – que de parler de l’esprit et du bien, à la façon de Platon ; – on peut, comme médecin, se demander ceci : « D’où vient une telle maladie chez le plus beau produit de l’antiquité, chez Platon ? Le méchant Socrate l’aurait-il corrompu ? Socrate aurait-il été vraiment le corrupteur de la jeunesse ? Aurait-il mérité sa ciguë ? » – Mais la lutte contre Platon, ou, plus clairement, pour parler pour le « Peuple », la lutte contre l’oppression christiano-ecclésiastique exercée depuis des milliers d’années, – car le christianisme est du platonisme à l’usage du « Peuple » – a créé en Europe une merveilleuse tension de l’esprit, telle qu’il n’en a pas encore paru sur terre : avec un arc si tendu, on peut tirer sur la cible la plus éloignée. – En vérité, l’Européen éprouve cette tension comme une misère ; deux fois déjà, on a tenté, dans le grand style, de détendre l’arc, une fois au moyen du jésuitisme, une autre fois par le rationalisme démocratique : – à l’aide de la liberté de la presse, de la lecture des journaux, il pourrait se faire qu’en réalité, on y obtînt ce résultat, que l’esprit ne se considérât pas à la légère, comme un péril ! – (Les Allemands ont inventé la poudre – tous nos compliments ! Mais ils se sont rattrapés depuis – ils ont inventé la presse). Mais nous, qui ne sommes ni Jésuites, ni démocrates, ni même suffisamment Allemands, – nous autres, bons Européens, et libres, très libres esprits, – nous l’avons encore, tout le péril de l’esprit, toute la tension de son arc ! Peut-être aussi la flèche, la mission, qui sait ? le but…
Sils-Maria, Oberengadin.
Juin 1885.
La volonté du vrai – qui nous égarera encore dans bien des aventures – cette fameuse véracité, dont tous les philosophes jusqu’à présent ont parlé avec vénération : que de questions cette volonté du vrai n’a-t-elle pas déjà soulevé pour nous ? Quelles singulières questions, dangereuses, et problématiques ? C’est déjà une longue histoire, – et cependant il semble qu’elle ne vienne que de commencer ? Quoi d’étonnant, si finalement nous devenons défiants, si nous perdons patience, si nous nous retournons impatients ? Si ce sphinx nous a enseigné, à nous aussi, à questionner ? Qui est-ce cela, au fait, qui nous pose ici des questions ? Quelle partie de nous-mêmes, au fait, tend « à la vérité » ? – En réalité, nous avons fait un long stage devant cette question : la raison de cette volonté, – et enfin nous sommes absolument restés en suspens devant une question plus fondamentale encore. Nous avons demandé la valeur de cette volonté. Supposé que nous veuillions le vrai : pourquoi pas plutôt le non-vrai ? l’incertitude ? même l’ignorance ? – Le problème de la valeur du vrai s’est présenté à nous, – ou est-ce nous qui nous sommes présentés au problème ? Qui de nous ici est Œdipe ? Qui le Sphinx ? C’est, semble-t-il, un rendez-vous de questions et d’indices de questions. – Et, doit-on le croire, il nous semble au fond que le problème n’a jamais été posé jusque-là, – comme si, pour la première fois, il était aperçu par nous, saisi par notre vision, hasardé ? Il y a là un risque à courir, et peut-être n’en est-il pas de plus grand.
« Comment une chose pourrait-elle résulter de son contraire ? Par exemple, la vérité de l’erreur ? La volonté du vrai – de la volonté du mensonge ? – Le désintéressement, de l’égoïsme ? La contemplation pure et rayonnante du sage, de la convoitise ? Un tel développement est impossible ; – celui qui conçoit ce rêve est un fou, peut-être quelque chose de pire ; les choses de la plus haute valeur doivent avoir une autre origine, qui leur soit particulière, – étant donné ce monde passager, trompeur, illusoire, misérable, ce labyrinthe d’erreurs et de désirs, elles ne peuvent en être issues ! Bien mieux, dans le sein de l’Être, dans l’éternel, dans la divinité occulte, dans la « chose en soi », – c’est là que doit se trouver leur raison d’être, nulle part ailleurs ! » – Cette façon d’apprécier constitue le préjugé typique auquel se reconnaissent bien les métaphysiciens de tous les temps : cette manière d’évaluation se dresse derrière toutes leur procédures logiques : en prenant pour base cette « croyance » qu’ils professent, ils font effort vers leur « savoir », vers quelque chose qui, à la fin, est solennellement proclamée « la vérité ». La croyance fondamentale des métaphysiciens est la croyance aux contradictions des valeurs. Les plus avisés n’ont jamais songé à douter des origines là où cela eût été le plus nécessaire : même s’ils en avaient fait vœu « de omnibus dubitandum ». On peut douter en effet, 1° si de façon générale il existe des contrastes, 2° si les évaluations et les oppositions que le peuple s’est créées pour apprécier les valeurs, reconnues par les métaphysiciens, ne sont pas seulement des évaluations préliminaires, des perspectives provisoires, peut-être même projetées du fond d’un coin, peut-être de bas en haut, – en quelque sorte des « perspectives de grenouille », pour employer une expression, familière aux peintres ? Quelque soit la valeur qui pourrait échoir à ce qui est vrai, véridique, désintéressé : peut-être faudrait-il reconnaître à l’apparence, à la volonté d’illusion, à l’égoïsme, au désir – une valeur plus haute et plus fondamentale pour tout ce qui concerne la vie. Il serait même encore possible que ce qui constitue la valeur des choses bonnes et révérées, consistât en ce qu’elles fussent parentes, liées et enchevêtrées d’insidieuse façon et peut-être même identiques à ces choses mauvaises, d’apparence contraire et opposée. Peut-être ! – Mais qui veut s’occuper d’aussi dangereux peut-être ? Il faut pour cela attendre la floraison d’une nouvelle race de philosophes, animés de goûts, éprouvant des affinités différentes, à rebours – philosophes d’un dangereux peut-être, sous tous les rapports. – Sérieusement parlant : je vois surgir de tels philosophes nouveaux.
Après avoir assez longtemps lu les philosophes entre les lignes, – après avoir eu longtemps l’œil ouvert sur eux, – je me dis : il faut compter la plus grande partie de la pensée consciente au nombre des activités instinctives, et, même dans le cas de la pensée philosophique, il faut désapprendre et réapprendre ici, comme on l’a fait pour l’hérédité et « l’héréditaire ». Tout comme l’acte de la naissance n’entre pas en considération dans l’entier processus et dans le développement ultérieur de l’hérédité : de même la « conscience », dans un sens décisif, n’est pas opposée à l’instinct, – la plus grande partie de la pensée consciente d’un philosophe est secrètement menée par ses instincts, contrainte de se diriger dans une voie tracée. Derrière toute logique et derrière l’autonomie apparente de ses allures il y a des évaluations de valeurs, plus clairement, des exigences physiologiques – pour le maintien d’un certain genre de vie. Par exemple, que le déterminé ait plus de valeur que l’indéterminé, l’apparence moins de valeur que la « vérité » : de pareilles évaluations – malgré toute leur valeur régulatrice pour nous, – ne sauraient être que des évaluations de premier plan, une certaine façon de niaiserie, telle qu’elle pourrait être nécessaire au maintien de l’existence, qui est la nôtre. Supposé que l’homme ne soit pas justement la « mesure des choses »…
La fausseté d’un jugement n’est pas pour nous une objection contre un jugement ; c’est en cela que notre nouvelle langue résonne peut-être le plus étrangement. La question est celle-ci : dans quelle mesure entretient-il, développe-t-il la vie ? maintient-il, développe-t-il même l’espèce ? Nous sommes foncièrement inclinés à affirmer que les jugements les plus faux (auxquels appartiennent les jugements synthétiques a priori), nous sont les plus indispensables, que sans quelque valeur accordée aux fictions logiques, sans mesurer la réalité à l’étiage du monde purement fictif de l’inconditionné, de l’identique à soi, sans une falsification constante du monde par le nombre, l’homme ne pourrait pas vivre, – que renoncer à de faux jugements serait renoncer à la vie, nier la vie. Reconnaître le non-vrai comme condition de vie : certes, c’est de dangereuse façon, opposer une contradiction aux sentiments habituels de la valeur ; et une philosophie, qui a cette hardiesse, se met par là même par-delà le bien et le mal.
Ce qui excite à considérer tous les philosophes moitié avec défiance, moitié avec ironie, ce n’est pas, qu’on découvre toujours à nouveau, combien ils sont innocents – combien ils se trompent, se méprennent, facilement et souvent, bref quel est leur enfantillage, leur puérilité, – mais c’est leur manque de droiture : tandis que tous ensemble mènent vertueusement grand bruit, dès que de loin seulement on affleure le problème de la véracité. Ils font tous semblant d’avoir découvert leurs opinions par le développement spontané d’une dialectique froide, pure, divinement insouciante (différents en cela des mystiques de tout rang, qui, plus honnêtement qu’eux et plus lourdement, parlent « d’inspiration ») : tandis qu’au fond une thèse anticipée, une idée, une « suggestion », le plus souvent un souhait du cœur, abstrait et passé au crible, est défendu par eux, appuyé de motifs laborieusement cherchés : – ce sont tous des avocats, qui ne veulent point de ce nom, défenseurs astucieux de leurs préjugés, qu’ils baptisent de « vérités », – très éloignés de l’intrépidité de conscience qui s’avoue cela, surtout cela, très éloignés du bon goût de la bravoure qui donne cela encore à entendre, qu’il s’agisse d’ennemi ou d’ami à avertir, que ce soit par audace et pour se moquer d’elle-même. La tartuferie, aussi rigide que prude, du vieux Kant, par où il nous attire dans les voies détournées de la dialectique, qui mènent à son « impératif catégorique », ou plutôt qui nous y induisent, – ce spectacle nous fait rire, nous autres délicats, qui ne trouvons pas un petit divertissement à découvrir les fines malices des vieux moralistes et des prédicateurs de morale. Ou cet hocuspocus, de forme mathématique, dont Spinoza a masqué sa philosophie – « l’amour de sa sagesse » enfin, pour interpréter nettement et justement le mot « philosophie », – dont il l’a armée comme d’une cuirasse, afin de prévenir, dès l’origine, l’entreprise des audacieux qui oseraient jeter un regard sur cette vierge invincible, cette Pallas Athénée : – combien cette mascarade révèle la timidité, le côté vulnérable de l’ermite malade !
Il m’est apparu peu à peu que toute grande philosophie se réduisait jusqu’ici à une confession de son auteur, comme en des mémoires involontaires et inaperçus ; puis aussi que les vues morales (ou immorales), en toute philosophie, formaient le véritable germe, d’où chaque fois la plante entière est éclose. On fait bien en effet (et l’on est sage) de se demander pour l’élucidation de cette question : comment les affirmations métaphysiques les plus abstraites d’un philosophe se sont-elles formées : à quelle morale tend cette philosophie, (ce philosophe) ? Je ne crois donc pas qu’un « instinct vers la connaissance » soit le père de la philosophie, mais qu’un autre instinct, là comme ailleurs, s’est servi de l’instrument de la connaissance (et de la méconnaissance). Quiconque examine jusqu’à quel point les instincts fondamentaux de l’homme peuvent avoir été de la partie, ici surtout, comme génies inspirateurs (démons et lutins peut-être, reconnaîtra qu’ils ont tous, déjà une fois, fait métier de philosophie, – que chacun d’eux aspirait à se présenter comme raison dernière de l’existence, comme souverain légitime de toutes les autres tendances. Toute tendance est impérieuse : comme telle, elle aspire à philosopher. – En vérité : chez l’érudit, chez l’homme de science proprement dit, cela devrait se passer autrement, « mieux », si l’on veut –, là il se peut qu’il y ait une vraie aspiration à la connaissance, un petit rouage indépendant, qui, bien remonté, y travaillerait activement, – sans que les autres tendances du savant fussent essentiellement intéressées. Les vrais « intérêts » de l’érudit sont donc en général ailleurs : dans la famille, dans la poursuite de l’argent, dans la politique : il est presque indifférent que sa petite machine soit placée à tel ou tel point de la science, que le jeune travailleur » d’avenir « devienne bon philologue, ou connaisseur de champignons, ou bon chimiste : – peu importe, pour le distinguer qu’il devienne ceci ou cela. Inversement, chez le philosophe, rien d’impersonnel ; en particulier, sa morale témoigne, d’une façon décisive, – de sa nature, c’est-à-dire de l’ordre dans lequel sont placées les intimes tendances de son être.
Combien méchants peuvent être les philosophes ! Je ne sais rien de plus perfide que la plaisanterie qu’Épicure s’est permise à l’égard de Platon et des platoniciens : il les appelait Dionysiokolakes. Cela veut dire tout d’abord, d’après l’étymologie, « flatteurs de Dionysios », auditeurs serviles, vils courtisans ; mais aussi ceci : des comédiens, rien de sérieux. (Dionysokolax était une désignation populaire des comédiens.) C’est là en somme la méchanceté d’Épicure contre Platon : il était fâché des manières grandioses, de l’habileté à se mettre en scène, à quoi s’entendaient Platon et ses disciples, – à quoi ne s’entendait pas Épicure, le vieux maître de Samos, caché dans son petit jardin d’Athènes, ayant écrit 300 livres, qui sait ? peut-être par dépit, par orgueil, pour faire pièce à Platon ? – Il a fallu cent ans à la Grèce pour se rendre compte de ce qu’était Épicure, ce dieu de jardin. – Si jamais elle s’en est rendu compte…
Dans toute philosophie, il y a un point où la « conviction » du philosophe parait sur la scène : ou, pour emprunter le langage d’un antique mystère :
C’est « conformément à la nature » que vous voulez vivre ! Ô nobles stoïciens : Quelle expression fallacieuse ! Imaginez une organisation telle que la nature : prodigue sans mesure, indifférente sans mesure, sans intentions, sans égards, sans pitié ni justice, à la fois féconde, stérile, incertaine, imaginez l’indifférence même érigée en puissance, – comment pourriez-vous vivre, en conformité de cette indifférence ? Vivre, – n’est-ce pas l’aspiration à être quelque chose d’autre que n’est cette nature ? Vivre, n’est-ce pas vouloir évaluer, préférer, être injuste, borné, différent ? Supposez que votre impératif « Vivre conformément à la nature » signifie au fond vivre « conformément à la vie », – comment ne le pourriez-vous pas ? Pourquoi, à quelles fins, faire un principe de ce que vous êtes vous-mêmes, de ce que vous devez être ? – En vérité, cela se passe tout autrement : tandis que, charmés, vous prétendez tirer de la nature le canon de votre loi, vous voulez le contraire, ô étonnants acteurs qui vous dupez vous-mêmes ! Votre orgueil voudrait s’imposer à la nature, même à la nature, y faire pénétrer votre morale, votre idéal ; vous demandez que ce soit une nature « conforme au Portique » – et vous souhaiteriez que toute existence fût à votre image – comme une glorification énorme, éternelle, une suprématie du stoïcisme uniformément imposée ! Avec tout votre amour du vrai, vous vous contraignez si longtemps, si tenacement, avec une telle rigidité hypnotique, à voir la nature faussement, c’est-à-dire stoïquement, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus la voir autrement, – un orgueil quelconque et insondable vous pousse finalement à concevoir cette espérance, digne de surgir dans un cerveau d’aliéné : que, parce que vous vous entendez à vous tyranniser vous-mêmes – le stoïcisme est une tyrannie infligée à soi-même –, la nature se laissera également tyranniser : le stoïcien n’est-il pas un morceau de nature ?… Mais c’est là une vieille, éternelle histoire : ce qui s’est produit jadis avec les stoïciens, se produit aujourd’hui encore, dès qu’une philosophie commence à croire à elle-même. Elle façonne toujours le monde à son image, elle ne peut faire autrement ; la philosophie est cette tendance tyrannique même, la volonté de puissance la plus intellectuelle, la volonté de « créer le monde », la volonté de la causa prima.
Le zèle et la finesse, je voudrais dire : la ruse que partout aujourd’hui, en Europe, on met à envisager, en son fond, le problème « du monde réel et du monde apparent » – fait réfléchir et donne lieu d’écouter : et qui dans l’arrière-fond entend parler seulement la « volonté du vrai », – rien de plus, – ne jouit certes pas de l’ouïe la plus perçante. Dans des cas isolés et rares, une telle volonté du vrai, quelque ardeur extravagante, quelque esprit d’aventure, l’orgueil de métaphysicien d’un poste perdu – peuvent avoir une part, et préférer finalement une poignée de « certitudes » à toute une charretée de belles possibilités ; il peut y avoir même des puritains fanatiques de la conscience, qui aiment mieux mourir sur la foi d’un néant assuré que sur la probabilité de quelque chose d’incertain. Mais cela, c’est du nihilisme, c’est le signe d’une âme désespérée, malade à en mourir : quelque soient les apparences de bravoure qu’une telle vertu puisse présenter. Chez les penseurs plus vigoureux, plus pleins de vitalité, possédés d’une soif plus intense de vie, la situation paraît autre : tandis qu’ils prennent parti contre l’apparence et prononcent, avec dédain, le mot « perspectif », – qu’ils estiment aussi peu le témoignage de leur corps que celui de leur œil, qui dit : « la terre est immobile », – que, avec un semblant de bonne humour, ils laissent échapper de leurs mains la possession la plus sûre (à quoi croit-on plus sûrement, maintenant, qu’à son corps ?) – qui sait ? si au fond ils ne veulent pas reconquérir ce qu’on a possédé autrefois plus sûrement encore, – quelque ancienne possession de la foi d’autrefois, – peut-être « l’âme immortelle », – peut-être « le Dieu ancien », bref, des idées fournissant une base de vie meilleure, plus forte, plus gaie – que celle fournie par les « idées modernes ». – Il y a là de la méfiance à l’égard de ces idées modernes, de l’incrédulité à l’égard de ce qui hier et aujourd’hui a été construit ; – s’y mêle-t-il peut-être un peu de dégoût et d’ironie, qui n’est plus apte à supporter le bric-à-brac de conceptions d’origine diverse, tel que se présente aujourd’hui sur le marché ce qu’on appelle le positivisme, une répugnance du goût affiné à l’égard de ce bariolage de foire, de ces haillons, déployés par ces philosophâtres de la réalité, chez lesquels il n’y a rien de neuf, de sérieux, sinon ce bariolage même. C’est en cela qu’on devrait donner raison à ces sceptiques anti-réels, à ces chercheurs au microscope de la connaissance : leur instinct, qui les pousse hors de la réalité moderne, n’est pas réfuté, – que nous importent leurs sentiers tortueux menant en arrière ! – L’essentiel, en eux, ce n’est pas qu’ils veuillent aller « en arrière » : c’est qu’ils veulent – s’en aller. Un peu plus de force, de courage, d’élan, de maîtrise : ils voudraient s’élever au dehors, – et ne point revenir en arrière !
Il me paraît, que l’on s’efforce maintenant partout, de détourner les regards de l’influence réelle que Kant a exercée sur la philosophie allemande, et surtout de glisser subrepticement sur la valeur qu’il s’est reconnue lui-même. Kant, avant tout, s’enorgueillissait de sa table des « catégories » : il disait, cette table à la main : « ceci est l’entreprise la plus difficile, qui jamais ait pu être tentée pour servir à la métaphysique ». – Qu’on comprenne bien cet « ait pu être », ce « werden konnte » ; il était fier d’avoir découvert, dans l’homme, une nouvelle faculté, la faculté des jugements synthétiques a priori. Supposez qu’il se fût fait illusion : mais le développement et la prompte éclosion de la philosophie allemande s’attachent à cette fierté, au zèle de tous les jeunes, aspirant à découvrir quelque chose qui enorgueillît davantage – en tous les cas, « de nouvelles facultés » ! – Mais réfléchissons : il en est temps. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? se demanda Kant. – Que répondit-il, au fond ? Au moyen d’un moyen : par malheur, non pas en trois mots, mais de façon si encombrante, si vénérable, avec une telle dépense de profondeur et de subtilité allemandes, qu’on n’entendit plus la plaisante niaiserie allemande, qui gît dans de telles réponses. On fut même hors de soi, à propos de cette nouvelle faculté, et l’enthousiasme alla à l’extrême, lorsque Kant découvrit encore une nouvelle faculté morale dans l’homme : – car alors les Allemands étaient encore moraux, et point « politiques-réalistes », « realpolitisch ». Alors se leva la lune de miel de la philosophie allemande : tous les jeunes théologiens du séminaire de Tubingue allèrent dans les buissons sacrés ; – tous aspiraient à des « facultés ». – Que ne trouvait-on pas – en cette époque, innocente, riche, juvénile, de l’esprit allemand, – où sonnait et chantait la fée maligne du Romantisme, où on ne connaissait pas la différence entre « trouver » et « inventer » ? Avant tout, une faculté pour les choses « transcendantes ». Schelling la baptisa d’intuition intellectuelle, c’est ainsi qu’il vint au-devant des penchants les plus intimes de ses Allemands des envies pieuses. À tout ce mouvement téméraire, et enthousiaste, qui était de la jeunesse, bien qu’affublé audacieusement dans des conceptions grises et vieillottes, on ne peut pas lui faire plus de tort qu’en le prenant au sérieux, qu’en le traitant même avec indignation morale ; assez, on vieillit, – le rêve s’envola. Il vint un temps, où on se frotta le front : on se le frotte encore. On avait rêvé : avant tout et en premier lieu – le vieux Kant. « Au moyen d’un moyen » – avait-il dit, – tout au moins voulu dire : Mais est-ce là une réponse ? Une explication ? Ou plutôt, n’est-ce pas une répétition de la question ? Comment l’opium fait-il dormir ? « Au moyen d’un moyen » – c’est-à-dire la virtus dormitiva – répond un médecin de Molière
De pareilles réponses conviennent dans la comédie, et il est enfin temps de remplacer la question kantienne : comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? – par une autre : pourquoi la croyance à ces jugements est-elle nécessaire ? – il est temps de concevoir que, pour le maintien de notre espèce, de pareils jugements doivent être tenus pour vrais : quoique pouvant être faux ? Ou, pour parler plus clairement, foncièrement, grossièrement : des jugements synthétiques a priori ne devraient pas « être possibles » : nous n’avons pas de droits sur eux : dans notre bouche, ce ne sont que des jugements faux. Évidemment, la croyance à leur valeur est nécessaire, comme croyance de premier plan, comme apparence, qui fait partie de la perspective de l’existence. – Enfin, pour tenir compte de l’énorme influence que la « philosophie allemande » – on comprend, je l’espère, son droit aux guillemets ? – a exercée dans toute l’Europe, qu’on ne doute pas qu’une certaine virtus dormitiva n’y a contribué : on était enchanté, parmi de nobles oisifs, vertueux, mystiques, artistes, chrétiens aux trois quarts, obscurantistes politiques de toutes nations, – d’avoir, grâce à la philosophie allemande, un contrepoison à opposer au sensualisme prépondérant, qui du siècle dernier, débordait, dans celui-ci, bref – « sensus assoupire »…
Pour ce qui concerne l’atomisme matérialiste : il appartient aux choses les mieux réfutées qui soient ; et peut-être, parmi les savants, n’en est-il aujourd’hui aucun en Europe, qui soit assez ignorant pour y attacher une importance sérieuse, en dehors de la commodité domestique, (pour abréger la terminologie) – grâce d’abord à ce polonais Boscovich, qui fut jusqu’à présent, avec le polonais Copernic, le plus grand et le plus victorieux adversaire de l’apparence. Tandis que Copernic nous a persuadés de croire, contrairement à tous les sens, que la terre n’est pas immobile, Boscovich a enseigné à abjurer la croyance à ce qui, en dernier lieu, était « resté debout » sur terre – la croyance à la « matière », à l’atome et au résidu terrestre : – ce fut jusqu’alors le plus grand triomphe sur les sens, remporté sur terre. – Il faut aller plus loin, déclarer la guerre au « besoin atomistique », qui survit toujours dangereusement, dans un domaine, où personne ne s’en doute, pareil à ce « besoin métaphysique » plus célèbre ; – il faut une guerre sans merci, au couteau : mais-il faudrait avant tout donner le coup de grâce à cet autre atomisme, plus fatal, que le christianisme a le mieux et le plus longtemps enseigné, – l’atomisme des âmes. Qu’il soit permis de désigner par ce mot la croyance qui considère l’âme comme quelque chose d’indestructible, d’éternel, d’indivisible, comme une monade, comme un atome : c’est cette croyance qu’il faut expulser de la science. Entre nous, il n’est nullement nécessaire de se débarrasser de « l’âme », et de renoncer à une des hypothèses les plus antiques et les plus vénérables : comme il arrive à la maladresse des naturalistes qui, dès qu’ils touchent à « l’âme », la perdent aussi. Mais la voie reste ouverte aux nouvelles vues et aux conceptions plus raffinées de l’âme : des conceptions, comme « l’âme mortelle », « l’âme, pluralité de sujets », « l’âme coordinatrice des penchants et des tendances », veulent avoir droit de cité dans la science. Tandis que le nouveau psychologue met fin à la superstition qui s’exerçait avec exubérance autour de la représentation Âme, il s’est égaré lui-même dans un nouveau désert et une nouvelle défiance : il est possible que les anciens psychologues s’en soient tiré avec plus de commodité et de gaîté : par là enfin, il se sait condamné à inventer – et, qui sait ? peut-être à trouver.
Les physiologistes devraient hésiter à considérer l’instinct de conservation comme tendance fondamentale de tout être organisé. Avant tout, un vivant veut répandre sa force, – La vie elle-même est volonté de puissance : la conservation de soi n’en est qu’une des conséquences indirectes les plus fréquentes. – Bref, là comme partout, prenons garde aux principes téléologiques superflus ! – tels que l’effort pour persévérer dans l’être (on le doit à l’inconséquence de Spinoza). Ainsi l’exige la méthode, qui doit être essentiellement la méthode d’économie de principes.
Cinq ou six cerveaux peut-être commencent à reconnaître que la physique elle aussi n’est qu’une interprétation, un arrangement, (d’après nous, cela dit avec votre permission) et non pas une explication de l’univers : mais, dans la mesure où elle repose sur la croyance aux sens, vaut-elle plus, et passera-t-elle longtemps encore, pour plus, c. à. d. pour explication. Elle a les yeux et les doigts pour elle, la vue et le toucher : c’est là une action féconde, à une époque douée de goûts foncièrement plébéiens, persuadée, convaincue par de tels moyens ; – c’est suivre instinctivement le canon de vérité du sensualisme, éternellement populaire. Qu’est-ce qui est clair ? qu’est ce qui « explique » ? – Ce qui se laisse voir et toucher, – c’est jusque-là qu’il faut pousser chaque problème. Inversement, dans la résistance contre le sensualisme, a résidé le charme de la pensée platonicienne qui fut une pensée noble, – peut-être parmi des hommes qui jouissaient de sens plus forts, plus exigeants que nos contemporains, mais qui connaissaient également un triomphe supérieur, à rester maîtres de ces sens : et cela, au moyen d’un réseau d’idées pâles, froides et grises qu’ils jetèrent sur le fouillis des sens, la tourbe des sens, comme disait Platon. Il y avait, dans cet assujettissement du monde, dans cette interprétation de l’univers à la manière de Platon, une jouissance tout autre que celle que nous offrent les physiciens d’aujourd’hui, de même les darwinistes, les adversaires de causes finales (antitéléologiens) parmi les travailleurs physiologistes, avec leur principe de « la force minima » – et de la bêtise maxima. – « Où l’homme n’a plus rien à voir, ni à saisir, il n’a plus rien à chercher », – c’est là un autre impératif que l’impératif platonicien qui, pour une race laborieuse et âpre, de machinistes et d’ingénieurs de l’avenir, n’ayant à faire que du gros ouvrage, pourra être l’impératif vrai.
Pour s’occuper de physiologie avec une bonne conscience, il faut insister sur ce fait, que les organes des sens ne sont pas des phénomènes au sens de la philosophie idéaliste : autrement ils ne pourraient être des causes ! Le sensualisme considéré au moins comme hypothèse régulatrice, pour ne pas dire comme « principe heuristique ». – Quoi ? d’autres disent que le monde extérieur est l’œuvre de nos organes ? Alors, notre corps, comme partie du monde extérieur, serait l’œuvre de nos organes ? Alors nos organes seraient eux-mêmes l’œuvre de nos organes ! – C’est, me semble-t-il, une profonde réduction à l’absurde : étant admis que la conception causa sui est quelque chose de profondément absurde. Conséquemment, le monde extérieur n’est pas l’œuvre de nos organes ?
Il se trouve toujours de naïfs observateurs de soi-même, croyant qu’il y a des « certitudes immédiates », par exemple « je pense », ou comme ce fut la superstition de Schopenhauer, « je veux » : comme si la connaissance parvenait à saisir son objet purement et simplement, comme « chose en soi » ; comme si, ni du côté du sujet, ni du côté de l’objet, il ne survenait de falsification. Que la « certitude immédiate », – la « connaissance absolue », la « chose en soi » renferment une contradictio in adjecto, je le répéterai cent fois : il faudrait enfin échapper à la magie fallacieuse des mots. Que le peuple croie que reconnaître soit connaître jusqu’au bout : le philosophe doit se dire : « quand je décompose le processus logique exprimé dans la phrase « je pense », j’obtiens une série d’affirmations hasardeuses dont le fondement est difficile, peut-être impossible à établir, – par exemple, que c’est moi qui pense, qu’en général il doit y avoir quelque chose qui pense, que penser est une activité, une action d’un être, considéré comme cause, qu’il y a un « Moi », – enfin, qu’il est déjà établi ce qu’il faut entendre par penser – que je sais ce que c’est que de penser. Car si je n’étais déjà décidé là-dessus dans mon for intérieur, sur quoi devrais-je me régler pour savoir si ce qui arrive, ne serait pas « vouloir », ou « sentir » ? En un mot, ce « je pense » présuppose que je compare mon état actuel à d’autres états que je connais en moi – pour établir ce qu’il est : à cause de cette référence à un « savoir » venant d’autre part, il ne donne certes pas pour moi de certitude immédiate. – Au lieu de la « certitude immédiate », à laquelle le peuple peut croire dans des cas donnés, le philosophe déduit une série de questions métaphysiques, véritables questions de conscience pour l’intellect, qui signifient : « D’où est-ce que je tire la conception penser ? Pourquoi est-ce que je crois à la cause et à l’action ? Qu’est-ce qui me donne le droit de parler d’un Moi, ou même d’un Moi comme cause, enfin d’un Moi comme cause des pensées ? » Qui a eu foi dans l’appel à une sorte d’intuition de la connaissance, pour répondre sur le champ à ces questions métaphysiques comme le fait celui qui dit : « Je pense, et sais que cela au moins est vrai, réel, certain », – celui-là trouvera aujourd’hui auprès du philosophe un sourire et deux questions ; « Monsieur, lui donnera peut-être à entendre le philosophe, il est invraisemblable que vous ne vous trompiez pas : mais pourquoi, à tout prix, la vérité ? »
En ce qui concerne la superstition des logiciens : je ne veux pas me lasser de souligner un petit fait, très bref, que ces esprits superstitieux n’avoueront qu’à contrecœur ; – à savoir, qu’une pensée survient, quand elle veut, non pas quand moi je veux ; de sorte que c’est fausser les faits que de dire : le sujet moi est la condition de l’attribut je pense. Il pense : mais que cet « il » soit justement cet antique et fameux Moi, cela est, pour parler avec ménagement, une hypothèse, une affirmation, nullement une « certitude immédiate ». Enfin, avec cet « il pense », on a déjà trop fait : cet il contient une interprétation du phénomène et n’appartient pas au phénomène même. On conclut ici, conformément à l’habitude grammaticale : « penser est une activité, à chaque activité appartient quelqu’un qui agit, par conséquent…… » À peu près, conformément au même schéma, le vieil atomisme ajoutait à la « force » qui agit – une parcelle de « matière », où elle réside, hors de laquelle elle agit, l’atome ; des têtes plus fortes apprirent enfin à se tirer d’affaire sans ce « reste terrestre », et peut-être même les logiciens s’habitueront-ils un jour à se passer de ce petit « il » (à quoi s’est réduit l’honnête et vieux Moi).
Ce n’est pas le moindre charme d’une théorie de prêter à la controverse : par là même elle attire les cerveaux plus subtils. Il semble que la théorie cent fois réfutée du « libre arbitre » doive sa durée à cet attrait même : il vient toujours quelqu’un qui se sent assez fort pour la réfuter.
Les philosophes ont coutume de parler de volonté, comme si c’était la chose la plus connue du monde ; Schopenhauer a donné à entendre que la volonté seule est connue de nous, entièrement connue, connue sans addition ni soustraction. Mais j’incline toujours derechef à penser que Schopenhauer, dans ce cas, n’a fait que ce que les philosophes sont d’ordinaire : il a pris, développé, exagéré, un préjugé populaire. Vouloir me semble quelque chose de compliqué, quelque chose qui n’est une unité que comme mot, – et c’est dans l’unité du mot que réside le préjugé populaire qui s’est rendu maître de la précaution des philosophes, de tous temps très faible. Soyons plus sur nos gardes pour une fois, soyons « non-philosophes », – disons : dans chaque vouloir il y a d’abord une pluralité de sensations, la sensation de l’état à partir duquel, – la sensation de l’état vers lequel, – la sensation de ce « va-et-vient » même, – ensuite une sensation musculaire concomitante qui, sans que nous mettions en mouvement « bras et jambes », commence son jeu, par une sorte d’habitude, dès que nous « voulons ». De même que des sensations de diverses sortes entrent à titre d’ingrédients dans la volonté, – de même aussi, en deuxième lieu, la pensée y entre : dans chaque acte de volonté, il y a une pensée maîtresse ; – qu’on ne croie pas pouvoir séparer cette pensée du « vouloir », comme s’il restait encore, après cela, de la volonté ! En troisième lieu la volonté n’est pas seulement un complexus de sensations et de pensées, mais avant tout un penchant, – un penchant de commandement. Ce qui est appelé « liberté du vouloir » est essentiellement le sentiment de supériorité vis-à-vis de celui qui doit obéir : « je suis libre, « il » doit obéir » – c’est là la conscience qui réside dans chaque volonté, – de même cette tension de l’attention, ce regard qui fixe exclusivement un objet, cette appréciation sans condition « de faire ceci, et rien autre », la certitude intime d’être obéi et tout ce qui appartient encore à l’état de qui commande. Un homme qui veut commande à quelque chose en soi qui obéit, ou qu’il croit obéissant. Qu’on observe ce qu’il y a de plus étonnant dans le vouloir, – cette chose si multiple pour quoi le peuple n’a qu’un seul mot : puisque, dans les cas donnés, nous sommes à la fois souverain et sujet, – puisque, en tant que sujet obéissant, nous connaissons les sensations de la contrainte, de l’obligation, de la pression, de la résistance, du mouvement, qui commencent à l’ordinaire immédiatement après l’acte du vouloir ; en tant que, d’autre part, nous avons l’habitude de nous mettre au-dessus de cette dualité, de nous faire illusion à son égard, au moyen de la conception synthétique « moi », toute une chaîne de conséquences erronées, de fausses appréciations de la volonté s’est encore soudée au vouloir, – en sorte que l’être voulant croit, de bonne foi, que vouloir suffise à l’action. Parce que, dans la plupart des cas, il n’y a eu volition, que quand l’efficacité du commandement, l’obéissance, donc l’action, pouvait être attendue, l’apparence s’est transformée en sentiment, comme s’il y avait là la nécessité d’un effet ; en un mot, le sujet voulant croit avec un degré de sûreté assez grand, que vouloir et agir sont un –, il escompte la réussite, la réalisation du vouloir, au bénéfice de la volonté même, et jouit d’un surcroît de sensation de puissance que toute réussite apporte avec soi. « Liberté de vouloir » – c’est là l’expression pour ce sentiment complexe du sujet voulant qui ordonne et s’identifie avec l’exécutant, – qui jouit du triomphe remporté sur les obstacles, mais qui juge, à part soi, que c’est sa volonté même qui, en réalité, triomphe des obstacles. De cette façon le sujet voulant ajoute aux sensations de plaisir que lui cause le commandement, les sensations de plaisir de ses organes qui exécutent et réalisent, ces sous-volontés secondaires, ou ces âmes subordonnées – notre corps n’est qu’une association, une colonie d’âmes – ses propres sensations de plaisir. L’effet, c’est moi :