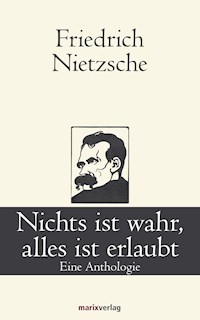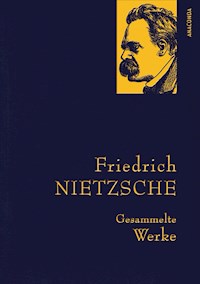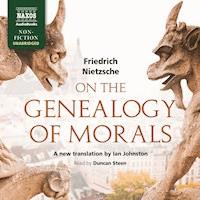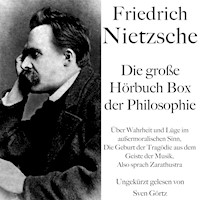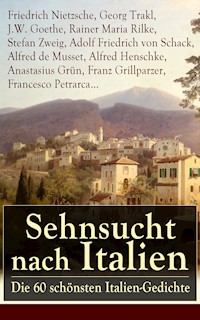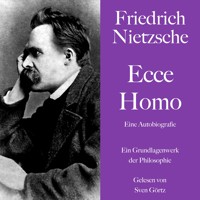Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Dans "Schopenhauer éducateur", Friedrich Nietzsche explore la figure de Schopenhauer non seulement comme philosophe, mais aussi comme un modèle d'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre une vie authentique et intellectuellement enrichissante. Ce texte, faisant partie des "Considérations inactuelles", se positionne comme une critique acerbe de la société et de la culture de son temps, tout en offrant une réflexion sur le rôle de l'éducateur et de l'éducation dans le développement de l'individu. Nietzsche admire Schopenhauer pour sa capacité à penser indépendamment des courants dominants, à valoriser la volonté individuelle et à vivre selon ses propres principes. L'ouvrage est une invitation à embrasser une éducation qui favorise l'épanouissement personnel et l'autonomie intellectuelle, plutôt qu'une simple transmission de connaissances. En décrivant Schopenhauer comme un éducateur, Nietzsche ne se contente pas de louer ses idées philosophiques, mais il met également en avant son intégrité personnelle et sa résistance aux pressions sociales. Le texte est une critique des institutions académiques et de la manière dont elles peuvent étouffer la créativité et la pensée critique. À travers une prose passionnée, Nietzsche incite ses lecteurs à chercher des maîtres qui inspirent la pensée libre et à cultiver un esprit critique face aux conventions établies. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Friedrich Nietzsche, né le 15 octobre 1844 à Röcken, en Prusse, est l'un des philosophes les plus influents du XIXe siècle. Fils d'un pasteur luthérien, il montre très tôt un intérêt pour la littérature et la philologie, qu'il étudie à l'Université de Bonn puis à Leipzig. À seulement 24 ans, il devient professeur de philologie classique à l'Université de Bâle, une position qu'il quitte en 1879 en raison de problèmes de santé persistants. Nietzsche est connu pour sa critique radicale de la religion, de la morale et de la culture occidentale. Ses oeuvres majeures, telles que "Ainsi parlait Zarathoustra", "Par-delà bien et mal" et "La Naissance de la tragédie", ont profondément marqué la pensée moderne. Sa philosophie est souvent associée au concept de "volonté de puissance" et à la notion de "surhomme", bien que ces idées aient été fréquemment mal interprétées. Nietzsche a passé les dernières années de sa vie dans une quasi-obscurité, souffrant de troubles mentaux, avant de mourir en 1900 à Weimar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
1. Chapitre
2. Chapitre
3. Chapitre
4. Chapitre
5. Chapitre
6. Chapitre
7. Chapitre
8. Chapitre
1.
Ce voyageur, qui avait vu beaucoup de pays et de peuples, et visité plusieurs parties du monde, et à qui l’on demandait quel était le caractère général qu’il avait retrouvé chez tous les hommes, répondait que c’était leur penchant à la paresse. Certaines gens penseront qu’il eût pu répondre avec plus de justesse : ils sont tous craintifs. Au fond, tout homme sait fort bien qu’il n’est sur la terre qu’une seule fois, en un exemplaire unique, et qu’aucun hasard, si singulier qu’il soit, ne réunira, pour la seconde fois, en une seule unité, quelque chose d’aussi multiple et d’aussi curieusement mêlé que lui. Il le sait, mais il s’en cache, comme s’il avait mauvaise conscience. Pourquoi ? Par crainte du voisin, qui exige la convention et s’en enveloppe lui-même. Mais qu’est-ce qui force l’individu à craindre le voisin, à penser, à agir selon le mode du troupeau, et à ne pas être content de lui-même ? La pudeur peut-être chez certains, mais ils sont rares. Chez le plus grand nombre, c’est le goût des aises, la nonchalance, bref ce penchant à la paresse dont parle le voyageur. Il a raison : les hommes sont encore plus paresseux que craintifs, et ce qu’ils craignent le plus ce sont les embarras que leur occasionneraient la sincérité et la loyauté absolues. Les artistes seuls détestent cette attitude relâchée, faite de convention et d’opinions empruntées, et ils dévoilent le mystère, ils montrent la mauvaise conscience de chacun, affirmant que tout homme est un mystère unique. Ils osent nous montrer l’homme tel qu’il est lui-même et lui seul, jusque dans tous ses mouvements musculaires ; et mieux encore, que, dans la stricte conséquence de son individualité, il est beau et digne d’être contemplé, qu’il est nouveau et incroyable comme toute œuvre de la nature, et nullement ennuyeux. Quand le grand penseur méprise les hommes, il méprise leur paresse, car c’est à cause d’elle qu’ils ressemblent à une marchandise fabriquée, qu’ils paraissent sans intérêt, indignes qu’on s’occupe d’eux et qu’on les éduque. L’homme qui ne veut pas faire partie de la masse n’a qu’à cesser de s’accommoder de celle-ci ; qu’il obéisse à sa conscience qui lui dit : « Sois toi-même ! Tout ce que tu fais maintenant, tout ce que tu penses et tout ce que tu désires, ce n’est pas toi qui le fais, le penses et le désires. »
Toute jeune âme entend cet appel de jour et de nuit, et il la fait frémir, car elle devine la mesure de bonheur qui lui est départie de toute éternité quand elle songe à sa véritable délivrance. Mais ce bonheur elle ne saurait l’atteindre d’aucune façon, tant qu’elle demeure prisonnière dans les chaînes des opinions et de la crainte. Et combien, sans cette délivrance, la vie peut être désespérante et dépourvue de signification ! Il n’y a pas, dans la nature, de créature plus morne et plus répugnante que l’homme qui a échappé à son génie, et qui maintenant louche à droite et à gauche, derrière lui et partout. En fin de compte, on ne peut plus même attaquer un pareil homme, car il est tout de surface, sans noyau véritable ; il est comme un vêtement défraîchi, mis à neuf et que l’on fait bouffer, comme un fantôme galonné qui ne peut plus inspirer la crainte et certainement pas la pitié.Si l’on dit à juste titre du paresseux qu’il tue le temps, il faut veiller sérieusement à ce qu’une époque qui place son salut dans l’opinion publique, c’est-à-dire dans la paresse privée, soit véritablement une fois mise à mort ; je veux dire par là qu’elle doit être rayée de l’histoire de la délivrance véritable de la vie. Combien grande devra être la répugnance des générations futures, lorsqu’elles auront à s’occuper de l’héritage de cette période au cours de laquelle ce ne furent pas des hommes vivants qui gouvernèrent, mais des apparences d’hommes pensant publiquement. À cause de cela notre époque passera peut-être, aux yeux de quelque lointaine postérité, pour la tranche la plus obscure et la plus immense de l’histoire, parce que la plus inhumaine.
Je parcours les nouvelles rues de nos villes et j’imagine que de toutes ces affreuses maisons construites par la génération de ceux qui pensent publiquement il ne restera plus rien dans un siècle et qu’alors les opinions de ces constructeurs de maisons se seront probablement écroulées elles aussi. Combien, au contraire, ceux qui n’ont pas le sentiment qu’ils sont les citoyens de ce temps ont le droit d’être pleins d’espérance. S’ils étaient de ce temps ils contribueraient à sa destruction et périraient avec lui, tandis qu’au contraire ils veulent éveiller le temps à une vie nouvelle, pour se perpétuer dans cette vie même.
Mais, lors même que l’avenir ne nous laisserait rien espérer, la singulière existence que nous menons, précisément dans cet « aujourd’hui », nous encourage le plus fortement à vivre selon notre propre mesure, conformément à nos propres lois. N’est-il pas inexplicable que nous vivions en ce moment, alors qu’un temps infini nous a formés, que nous ne disposions que de notre brève existence actuelle, au cours de laquelle nous devons montrer pourquoi et dans quel dessein nous sommes nés précisément aujourd’hui ? Nous avons à répondre de notre existence devant nous-mêmes ; c’est pourquoi nous voulons être aussi les véritables pilotes de cette existence et ne pas permettre que notre vie ressemble à un hasard sans idées directrices. Il faut la traiter avec quelque peu d’audace et l’envisager dangereusement, d’autant plus qu’au meilleur comme au pire des cas, il ne peut nous arriver que de la perdre. Pourquoi s’attacher à cette glèbe, pourquoi tenir à tel métier, pourquoi tendre l’oreille pour écouter ce que dit le voisin ? C’est bien « petite ville » que de s’engager à des opinions qui ne comptent plus à des centaines de lieux de distance. L’orient et l’occident n’ont d’autre valeur que celle de quelques traits à la craie que quelqu’un dessine devant nos yeux pour se moquer de notre poltronnerie.
« Je veux faire l’essai de parvenir à la liberté », se dit la jeune âme ; et elle devrait en être empêchée parce que le hasard veut que deux nations se haïssent et se combattent, ou qu’il y ait une mer entre deux parties du monde, ou qu’autour d’elle on enseigne une religion qui, pourtant, il y a quelques milliers d’années, n’existait pas encore. « Tout cela, ce n’est pas toi, se dit-elle. Personne ne peut te construire le pont sur lequel toi tu devras franchir le pont de la vie, personne hormis toi seul. » Il est vrai qu’il existe d’innombrables sentiers et d’innombrables ponts et d’innombrables demi-dieux qui veulent te conduire à travers le fleuve ; mais le prix qu’ils te demanderont ce sera le sacrifice de toi même ; il faut que tu te donnes en gage et que tu te perdes. Il y a dans le monde un seul chemin que personne ne peut suivre en dehors de toi. Où conduit-il ? Ne le demande pas. Suis-le. Qui donc a prononcé ces paroles : « un homme ne s’élève jamais plus haut que lorsqu’il ne sait pas où son chemin peut le conduire ? » Mais comment pouvons-nous nous retrouver nous-mêmes ? Comment l’homme peut-il se connaître ? Ce sont là des questions difficiles à résoudre. Si le lièvre a sept peaux, l’homme peut s’en enlever sept fois septante sans qu’il puisse dire ensuite : « Cela est maintenant véritablement toi, ce n’est plus seulement une enveloppe. » De plus, c’est là un geste cruel et dangereux que de fouiller ainsi soi-même sa chair pour descendre brutalement, par le plus court chemin, dans le fond de son être. Comme il arrive facilement qu’on se blesse, sans qu’aucun médecin puisse nous guérir ! À quoi cela servirait-il, en outre, si tout témoigne de notre être, nos amitiés et nos inimitiés, notre regard et nos serrements de mains, notre mémoire et ce que nous oublions, nos livres et les traits de notre plume ? Mais il y a un moyen pour faire cette enquête importante.
Que la jeune âme jette un coup d’œil sur sa vie passée et qu’elle se pose cette question : Qui as-tu véritablement aimé jusqu’à présent ? Qu’est-ce qui t’a attiré et, tout à la fois, dominé et rendu heureux ? Fais défiler devant tes yeux la série des objets que tu as vénérés. Peut-être leur essence et leur succession te révèleront-elles une loi, la loi fondamentale, de ton être véritable. Compare ces objets, rends-toi compte qu’ils se complètent, s’élargissent, se surpassent et se transfigurent les uns les autres, qu’ils forment une échelle dont tu t’es servi jusqu’à présent pour grimper jusqu’à toi. Car ton essence véritable n’est pas profondément cachée au fond de toi-même ; elle est placée au-dessus de toi à une hauteur incommensurable, ou du moins au-dessus de ce que tu considères généralement comme ton moi. Tes vrais éducateurs, tes vrais formateurs te révèlent ce qui est la véritable essence, le véritable noyau de ton être, quelque chose qui ne peut s’obtenir ni par éducation ni par discipline, quelque chose qui est, en tous les cas, d’un accès difficile, dissimulé et paralysé. Tes éducateurs ne sauraient être autre chose pour toi que tes libérateurs.
C’est le secret de toute culture, elle ne procure pas de membres artificiels, un nez en cire ou des yeux à lunettes ; par ces adjonctions on n’obtient qu’une caricature de l’éducation. Mais la culture est une délivrance ; elle arrache l’ivraie, déblaye les décombres, éloigne le ver qui blesse le tendre germe de la plante ; elle projette des rayons de lumière et de chaleur ; elle est pareille à la chute bienfaisante d’une pluie nocturne. Imitant et adorant la nature, lorsque celle ci est maternelle et compatissante, elle accomplit l’œuvre de la nature lorsqu’elle prévient ses coups impitoyables et cruels, pour les faire tourner au bien, lorsqu’elle jette un voile sur ses impulsions de marâtre et ses tristes déraisons.
Certes, il existe d’autres moyens de se retrouver, de revenir à soi-même de l’engourdissement où l’on vit généralement comme enveloppé d’un sombre nuage, mais je n’en connais point de meilleur que de revenir à son éducateur, à celui qui nous a formés. Et c’est pourquoi je veux me souvenir aujourd’hui de ce maître et de ce censeur dont je puis me glorifier, d’Arthur Schopenhauer, quitte à rendre plus tard hommage à d’autres encore.
2.
Si je veux décrire quel événement ce fut pour moi lorsque je jetai un premier coup d’œil sur les écrits de Schopenhauer, il faut que je m’arrête un peu à cette image qui, dans ma jeunesse, se présentait à mon esprit, fréquente et impérieuse, comme nulle autre. Lorsque je me laissais aller jadis à vagabonder à plaisir pour formuler des souhaits, je me disais que le terrible effort et l’impérieux devoir de m’éduquer moi-même pourraient m’être enlevés par le destin s’il m’arrivait de trouver à temps un philosophe qui serait mon éducateur, un vrai philosophe à qui l’on pourrait obéir sans hésitation parce qu’on aurait plus confiance en lui qu’en soi-même. Il m’arrivait alors de me demander quels seraient les principes en vertu desquels il m’éduquerait, et je réfléchissais à ce qu’il penserait des deux principes d’éducation en usage aujourd’hui. L’un exige de l’éducateur qu’il reconnaisse immédiatement les dons particuliers de ses élèves et qu’il dirige ensuite toutes les forces et toutes les facultés vers cette unique vertu pour l’amener à la maturité véritable et à la fécondité. L’autre maxime veut, par contre, que l’éducateur discerne et cultive toutes les forces pour établir entre elles un rapport harmonieux. Mais faudrait-il contraindre celui qui a un penchant décidé vers l’orfèvrerie à cultiver, à cause de cela, la musique ? Devrait-on donner raison au père de Benvenuto Cellini, qui obligea son fils, à retourner toujours au « doux cornet », alors que celui-ci ne parlait de son instrument qu’en l’appelant « ce maudit sifflet » ? On n’approuvera pas un pareil procédé en face de dons qui s’affirment avec tant de précision. Cette maxime du développement harmonieux ne devrait donc être appliquée que sur des natures plus faibles, qui sont peut-être un repaire de besoins et de penchants, mais, si on les prend isolément, ou en bloc, ne signifient pas grand’chose.
Or, où donc trouvons-nous l’ensemble harmonieux et la consonance de plusieurs voix en une seule nature, où donc admirons-nous davantage l’harmonie, si ce n’est précisément chez des hommes tels que Cellini en était un, des hommes chez qui tout, la connaissance, le désir, l’amour, la haine tendaient vers un noyau, vers une force originelle et où naît précisément, par la prépondérance impérieuse et souveraine de ce centre vivant, un système harmonieux de mouvements ? Il se peut donc que les deux maximes ne soient pas du tout en contradiction. Peut être l’une affirme-t-elle seulement que l’homme doit avoir un centre et l’autre qu’il doit avoir aussi une périphérie. Ce philosophe éducateur, dont je rêvais à part moi, ne se contenterait probablement pas de découvrir la force centrale, mais il saurait éviter aussi qu’elle exerce une action destructive sur les autres forces : la tâche de son œuvre éducatrice devrait être, à mon sens, de transformer l’homme tout entier en un système solaire et planétaire, vivant et mouvant, et de reconnaître la loi de sa mécanique supérieure.
Toujours est-il que ce philosophe me manquait et je continuai à tâtonner ça et là. Je me rendis compte à quel point nous sommes d’aspect misérable, nous autres hommes modernes, si on nous compare aux Grecs et aux Romains, ne fût-ce que par rapport à la compréhension sévère et sérieuse des tâches éducatrices. On peut parcourir toute l’Allemagne avec le cœur animé d’un pareil besoin, on peut aller d’une Université à l’autre sans trouver ce que l’on cherche ; des désirs infiniment moindres et beaucoup plus simples n’y trouvent pas leur réalisation. Celui qui, parmi les Allemands, voudrait par exemple faire sérieusement son éducation d’orateur, celui qui aurait l’intention de se mettre à l’école de l’écrivain, ne trouverait nulle part ni maître, ni école. On ne paraît pas encore avoir songé ici que parler et écrire sont des arts qui ne peuvent être acquis sans la direction la plus attentive et l’apprentissage le plus laborieux.
Mais rien ne démontre, d’une façon plus marquée et plus humiliante, le sentiment de satisfaction prétentieuse que les contemporains éprouvent à l’égard d’eux-mêmes, si ce n’est la médiocrité, moitié parcimonieuse, moitié étourdie, des prétentions qu’ils imposent aux éducateurs et aux maîtres. De quoi se contente-t-on, même parmi les gens les plus distingués et les mieux éduqués, sous le nom de « précepteur » ! Quel ramassis de cerveaux confus et d’organisations démodées est souvent désigné sous le nom de « gymnase » et trouvé bon ? Qu’est-ce qui nous suffit à tous comme établissement supérieur d’instruction publique, comme Université, quels conducteurs, quelles institutions, quand on songe à la difficulté de la tâche qui consiste à éduquer un homme pour qu’il devienne un homme ? Même la façon tant admirée dont les savants allemands se jettent sur leur tâche montre avant tout que ceux-ci pensent plus à la science qu’à l’humanité, qu’on leur inculque le désir de se sacrifier à la science comme une troupe perdue, pour dresser ensuite de nouvelles générations à ce sacrifice. La fréquentation de la science, si elle n’est dirigée et endiguée par les maximes les plus élevées de l’éducation, mais si on la déchaîne toujours davantage, d’après le principe que « plus il y en a, mieux cela vaudra », cette fréquentation est certainement aussi dangereuse pour les savants que le principe économique du « laisser faire » pour la moralité des peuples tout entiers. Qui donc se souvient encore que l’éducation des savants, chez qui l’humanité ne doit être ni abandonnée ni desséchée, est un des problèmes les plus difficiles ! Et pourtant on peut en apercevoir la difficulté si l’on fait attention aux nombreux exemplaires qui ont été déformés par un abandon trop précoce à la science et qui ont conservé de cette occupation même une gibbosité. Mais il existe encore une preuve plus importante, qui témoigne de l’absence de toute éducation supérieure, une preuve plus imposante, plus dangereuse et, avant tout, plus générale, s’il apparaît, dès l’abord, clairement pourquoi un orateur, un écrivain, ne peuvent être éduqués aujourd’hui, – parce qu’il n’y a pour eux point d’éducateurs – ; s’il apparaît presque tout aussi clairement pourquoi un savant s’altère et se tortille maintenant forcément l’esprit – parce que c’est la science, c’est-à-dire une abstraction inhumaine qui doit l’éduquer, – on peut se demander un jour où se trouvent au fond, pour nous tous, savants et ignorants, nobles et vilains, les modèles moraux, les célébrités parmi nos contemporains qui seraient l’incarnation visible de toute morale créatrice de ce temps ? Où donc a passé toute réflexion au sujet des questions morales dont se sont préoccupées de tous temps les sociétés les plus évoluées ? Il n’existe plus d’hommes illustres qui cultivent ces questions ; personne ne se livre plus à des méditations qui s’y rattachent ; de fait, on se nourrit sur le capital de moralité que nos ancêtres ont amassé et que nous ne nous entendons pas à augmenter au lieu de le gaspiller ; dans notre société, ou bien on ne parle pas de pareilles choses, ou bien on en parle avec une maladresse et une inexpérience naturalistes qui provoquent forcément la répugnance. C’est au point que nos écoles et nos maîtres font maintenant abstraction de toute éducation morale ou qu’ils se tirent d’affaire avec des formules : et le mot vertu est un mot qui ne dit plus rien ni au maître ni à l’élève, un mot de l’ancien temps dont on sourit ; et c’est pis encore lorsqu’on ne sourit pas, car alors on fait l’hypocrite.
L’explication de cette mollesse et de l’étiage inférieur de toutes les forces morales est difficile et compliquée. Mais nul ne peut considérer l’influence du christianisme victorieux du monde ancien, sans tenir compte aussi de la répercussion qu’exerce la défaite du christianisme, c’est-à-dire le sort qui l’attend à notre époque avec une certitude de plus en plus grande. Le christianisme, par l’élévation de son idéal, a tellement renchéri sur les anciens systèmes de morale et sur le naturel qui régnait également dans tous ces systèmes, qu’en face de ce naturel les sens se sont émoussés jusqu’à l’écœurement ; ensuite, tout en admettant encore cette qualité supérieure sans être capable de la réaliser, on n’était capable, quoi qu’on en eût, de revenir au bien et à la grandeur, c’est-à-dire à cette vertu antique. Dans ce va-et-vient entre le christianisme et l’antiquité, entre un timide et mensonger christianisme de mœurs et un goût de l’antiquité tout aussi découragé et tout aussi embarrassé, vit l’homme moderne et il s’en trouve fort mal ; la crainte héréditaire du naturel et encore le charme renouvelé de ce naturel, le désir de trouver un appui quel qu’il soit, la faiblesse de la connaissance qui vacille entre le bien et le meilleur, tout cela engendre dans l’âme moderne une inquiétude et un désordre qui la condamnent à être stérile et sans joie. Jamais on n’avait davantage besoin d’éducateurs moraux et jamais il ne fut plus improbable qu’on les trouverait. À des époques où les médecins sont le plus nécessaires, dans les cas de grandes épidémies, ils sont aussi le plus exposés au danger. Car où sont les médecins de l’humanité moderne, assez bien portants et assez solides sur leurs jambes pour pouvoir soutenir quelqu’un d’autre et le conduire par la main ? Il y a un certain assombrissement, une sorte d’apathie qui pèse sur les meilleures personnalités de notre temps, un éternel mécontentement provoqué par la lutte entre la simulation et la loyauté qui se livre au fond de leur être, une inquiétude qui leur enlève la confiance en eux-mêmes, et c’est celle qui les rend tout à fait incapables d’être à la fois les conducteurs et les censeurs des autres.