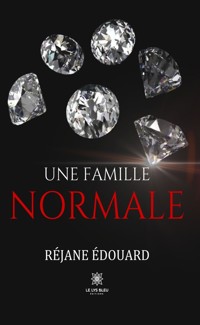
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mariette découvre que la mort de ses parents n’était pas accidentelle. Avec l’aide de Paul, un officier de police, elle enquête pour démêler le mystère. Seulement, leur quête les entraîne dans le monde obscur du banditisme, les confrontant à des défis inattendus.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Fervente lectrice d’auteurs comme Joël Dicker, Bernard Werber ou Dawn Brown,
Réjane Édouard tisse dans son premier roman, "Une famille normale", une intrigue où secrets et mystères s’entrelacent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Réjane Édouard
Une famille normale
Roman
© Lys Bleu Éditions – Réjane Édouard
ISBN : 979-10-422-2358-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Partir, c’est mourir un peu. Écrire, c’est vivre davantage.
André Comte-Sponville
Écrivez ! Noircir le papier est idéal pour s’éclaircir l’esprit.
Aldous Huxley
Première partie
Chapitre 1
Vendredi 6 avril 2012
Dans le quartier de la Croix Rousse, à Lyon, Mariette attendait son mari. Assise sur le bord du canapé, ses deux mains serrées entre les genoux lui faisaient mal, elles étaient rouges tellement elle les triturait, les frottait, croisait les doigts, tordait ses paumes. Sa tête se balançait régulièrement de l’avant vers l’arrière, sans interruption, comme pour anesthésier sa douleur, elle se berçait, se saoulait pour ne plus pleurer.
Elle se souvenait de ses parents lorsqu’il y a un peu plus de dix ans, elle leur avait présenté Philippe.
Un samedi soir de l’année mille neuf cent quatre-vingt-douze, Mariette accompagnée de ses amis d’alors avait pris place au cinéma Le Majestic de Lille pour une rediffusion du film Fame. Ce cinéma d’art et d’essai passait régulièrement d’anciens films pour les passionnés.
Sur le rang de fauteuils rouges, devant elle, un groupe de garçons s’était installé. L’un d’eux, pendant la bande-annonce, ne cessait de se retourner, c’était Philippe.
Il n’avait rien de ce qu’elle aimait chez un garçon, il était brun, très grand, fin et long comme une cigogne et son front était déjà un peu dégarni. Il lui avait fallu faire mieux sa connaissance pour apprécier son humour et son regard rieur. Elle apprit qu’il était danseur et travaillait depuis sept ans à l’opéra de Lille. La rediffusion de ce film avait donc, pour lui, un tout autre intérêt que le sien. Il semblait absorbé par l’image, son pied battait le rythme. Le quotidien des élèves de la High School of Performing Arts, une école artistique très célèbre de New York, ne l’intéressait pas. Il était là pour la danse.
Mariette était loin de ce monde du spectacle, elle qui était en école de commerce.
Il leur avait fallu six mois à peine pour ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre. Philippe était pour elle la joie et la bonne humeur, et elle représentait pour lui le calme et la tendresse.
Pour leur mariage, en mai 2008, ses parents étaient venus de Douai. Sa mère avait tenu à être là pour aider aux préparatifs, et elle avait bien fait, ça avait été une semaine folle et son aide avait été la bienvenue. Son père, lui, avait profité de cette semaine à Lyon pour visiter la ville. Chaque soir, il leur racontait ce qu’il avait vu, les traboules, la basilique de Fourvière, l’escalier à vis de la maison du Chamarier… C’était bien, car il visitait seul ce que ni Mariette ni Philippe n’avaient le temps de lui faire découvrir. Charles reviendrait avec sa femme Francine passer une semaine de vacances et il comptait bien que la prochaine fois, le couple se rendrait disponible.
Mariette était hébétée, elle n’arrivait pas à l’admettre, elle les avait eus au téléphone hier soir et ce matin, ce coup de fil horrible, elle ne voulait pas y croire. C’était insensé, la tête lui tournait, elle ne le voulait pas.
L’enterrement était mardi. Philippe serait là. Pour lui aussi, ça allait être difficile, son père et lui s’entendaient à merveille. Ils passaient leur temps à rire, à se faire des blagues. Quand ensemble, ils allaient voir les grands matchs de foot, ils partaient peinturlurés des couleurs de leur club préféré. Son père se moquait de « l’allure d’oiseau » de Philippe, comme il disait. Il l’avait surnommé le héron et n’arrêtait pas de leur demander quand naîtraient les petits héronneaux. Ça faisait rire Philippe. Mariette, elle, le rabrouait gentiment en lui demandant de s’occuper de ses affaires.
Ils désiraient un enfant, mais les allers-retours de Philippe ne leur semblaient pas opportuns à la naissance d’un bébé. Mariette savait qu’il ne fallait plus trop attendre et que ses parents avaient raison.
Assise sur le canapé, des larmes coulaient sans bruit, sur les joues de Mariette, elle revoyait tous ces moments de bonheur, pensait à ses parents, à Philippe…
Ils ne connaîtront pas leurs petits-enfants, ils étaient partis avant.
Chapitre 2
Mauvaise nouvelle
L’avion venait d’atterrir à l’aéroport Lyon-Satolas, le long tuyau translucide était venu comme une ventouse se scotcher à la carlingue. On ne voyait que des jambes, noires pour la plupart, au même rythme, le pas allongé, que des bras, droits, souvent, armés d’une sacoche noire, au même rythme, rapide et saccadé que les jambes, on ne remarquait pas les visages. C’était une troupe d’hommes d’affaires pressés qui débarquait. Du même pas, ils allaient s’engouffrer dans les taxis à qui ils allaient demander d’aller plus vite. Philippe n’avait pas envie de se battre pour arriver le premier, il laissait le flot noir partir à l’avant et tranquillement, il tirait sa valise dans les couloirs froids de l’aéroport. Il revenait de Londres où il avait eu des séances de travail avec des danseurs et une troupe de comédiens-Chanteurs pour une émission de télévision. Les journées avaient été bien remplies et avaient duré parfois tard dans la nuit. Il était satisfait de la relation qu’il avait établie avec les compositeurs et avec le producteur de l’émission sur laquelle il travaillait. Tout en pensant aux personnages, en recomptant les pas dans sa tête, il avançait, léger, presque en dansant vers la file de taxis. Philippe était très affable et communiquait facilement, ça l’aidait pour négocier avec les commerciaux. Son plaisir, c’était de partager sa vision chorégraphique avec les danseurs, il n’avait aucun mal, il se mettait à danser, et là, tout devenait clair. Heureusement, qu’il maîtrisait parfaitement l’anglais, car depuis quatre mois, il faisait l’aller-retour Lyon/Londres, passait la semaine là-bas et le week-end à Lyon.
Philippe voulait évoluer et l’opéra de Lyon lui avait donné la possibilité de devenir premier danseur. Il y avait passé onze années enrichissantes, mais avait fini par en partir, lorsqu’un chorégraphe lui avait proposé de devenir son assistant et ainsi d’apprendre le métier. Il lui avait beaucoup appris, et à quarante-sept ans, il se décidait à voler de ses propres ailes, ou plutôt de ses entrechats. Il voulait être libre de créer, libre de choisir.
Il était fatigué et il était à la fois content et angoissé de rentrer chez lui. Aujourd’hui, son retour à Lyon était différent. Depuis le coup de fil que Mariette lui avait passé ce matin, il était comme sonné. Il était inquiet pour elle. La mort de ses parents l’avait ébranlée.
Son perfecto noir tombait négligemment sur son jean. En dessous, malgré le froid de Londres, il ne portait qu’un simple tee-shirt gris. Une épaule plus haute que l’autre, dû au poids de son bagage qu’il portait en bandoulière, le bras droit tendu tirant sa valise, la chevelure brune flottant à l’arrière et légèrement dégarnie sur l’avant, il marchait léger, comme si le sol était une piste de danse.
Le taxi avait mis plus de temps qu’à l’ordinaire, les routes étaient embouteillées et la circulation ne désemplissait pas.
Philippe ne s’en était pas aperçu, il pensait à Mariette, sa femme. Depuis deux ans, elle s’était habituée à vivre seule la semaine et à le voir rentrer chaque vendredi. Mais aujourd’hui, c’était différent.
Comment allait-elle supporter le décès de ses parents ? Il faudrait la soutenir pendant toute cette période, mais il n’était hélas pas très disponible. Ce n’était pas le moment d’interrompre les répétitions. Et pourtant, il faudrait bien qu’il prenne quelques jours, au moins le temps des funérailles.
Il savait que dès qu’il franchirait la porte de leur appartement, il devrait faire face et que Mariette aurait besoin de lui pour surmonter cette épreuve.
Chapitre 3
Lyon – avril 2012
Le lendemain de l’accident
Soudain, la sonnette de la porte retentit. Philippe avait ses clefs. Qui cela pouvait-il être ?
Mariette allait ouvrir et tombait nez à nez avec deux hommes vêtus de noir.
« Vous êtes bien Mariette Fournier, née Vandword ? »
« Oui », répondit-elle, étonnée.
« Bonjour, officier de la police judiciaire de Douai », dirent-ils en tendant leur insigne.
Mariette, prudente, regardait ces deux hommes en civil et inspectait les badges dorés.
« Nous voulons nous entretenir avec vous à propos de vos parents. »
Mariette, hébétée, leur répondit :
« Mes parents, oui, je viens d’apprendre leur décès. Ils ont eu un grave accident de la route » le plus grand des deux hommes s’avança et demanda s’ils pouvaient entrer. L’autre plus âgé, ventripotent, s’avança également. Mariette leur indiquait la salle de séjour où elle les fit asseoir.
« Que puis-je pour vous et quelle est la raison de votre visite ? Mon mari ne va pas tarder à rentrer. Il arrive de Londres et son avion a atterri il y a maintenant une demi-heure. »
Mariette aurait voulu que Philippe soit là.
Le policier, voyant son désarroi, prit une voix douce. Il était gêné de l’annonce qu’il avait à lui faire. Elle semblait au bord de la crise de nerfs. On voyait qu’elle avait beaucoup pleuré.
« C’est justement au sujet du décès de vos parents », lui dit-il.
Puis il continua :
« L’accident ne semble pas naturel. Le garagiste qui a inspecté la voiture dit que la durite du système de freinage aurait été sabotée. Pour une voiture de moins d’un an, cela semble peu probable qu’il y ait de l’usure. »
Mariette sentait ses jambes se dérober.
« Quelqu’un en voulait-il à vos parents ? »
« Non, bien sûr que non ! Mes parents étaient des gens simples qui ont travaillé toute leur vie pour profiter enfin d’une retraite heureuse », cria presque Mariette.
« Votre père était représentant de commerce, il rencontrait beaucoup de monde ! »
À ce moment-là, elle entendit le bruit d’une clef dans la serrure ! Philippe était enfin arrivé ! Elle se sentait rassurée de le savoir à ses côtés pour répondre aux questions des deux policiers.
Philippe, étonné, lâchait sa valise, accrochait son blouson sur le porte-manteau de l’entrée, et venait les rejoindre. Il tirait vers lui une chaise après s’être penché vers Mariette et déposé un bisou sur sa joue.
« Que se passe-t-il ? »
Philippe avait immédiatement remarqué le visage inquiet de sa femme.
« Pouvez-vous m’expliquer votre présence », dit-il aux policiers qui lui tendaient leur insigne.
Ils répétèrent ce qu’ils venaient de dire à Mariette. Philippe qui était fatigué de sa semaine et qui ne voulait pas inquiéter Mariette, balança la tête et dit :
« Le garagiste a pu se tromper ! »
Les policiers firent comme s’ils n’avaient pas entendu sa réflexion. Ils se levèrent lentement et d’un même pas rejoignirent la porte. Avant de partir, ils se retournèrent et dirent :
« Nous souhaitons visiter la maison de vos parents dès que possible. »
Philipe les avait accompagnés. Ils convinrent de s’y retrouver mardi matin, lendemain de l’enterrement.
Le plus grand des deux hommes tendit une carte de visite et dit : « Appelez-moi quand vous y serez, nous vous y rejoindrons. »
L’église, le convoi qui allait à pied au cimetière, la mise en terre, le monde et puis la solitude après le monde. Ils étaient partis, comme s’ils n’avaient jamais existé. Seule Mariette était la preuve de leur passage. La grande maison familiale était vide, tout ici était souvenir pour Mariette. Ses parents avaient changé la cuisine depuis plusieurs années, mais n’avaient pas pu se séparer de la table en formica jaune pâle. Le salon sentait la même odeur que celle de son enfance, certainement à cause des papiers d’Arménie que sa mère s’ingéniait à brûler en affirmant que ça purifiait l’atmosphère. Dans sa chambre, Mariette retrouvait son lit, fait, comme si elle venait de rentrer de l’école. Ils avaient conservé le papier peint psychédélique qu’elle leur avait imposé dans les années soixante-dix. Tout était resté identique à ses souvenirs et Mariette eut l’impression de revivre le passé. Ça lui faisait mal.
Chapitre 4
Mariette se souvient
Ce mercredi du mois de juin, mille neuf cent soixante-dix-sept, Mariette se levait tranquillement. C’était un mercredi comme un autre, rien de spécial n’était prévu, à part bien sûr le cours de judo qu’elle prendrait à 15 h 30 au dojo, à l’autre bout de la ville. Elle descendait l’escalier encore un peu endormie, ses cheveux blonds chiffonnés, son pyjama rose pâle tombant sur ses petites pantoufles, où à chaque pied deux oreilles de lapin dodelinaient à chaque fois qu’elle faisait un pas.
Sa mère était déjà partie travailler et Giselle, sa nounou, n’était pas encore arrivée. Elle ouvrait la porte du meuble en formica jaune pâle et en sortait avec difficulté la boîte de Banania et son bol avec son prénom marqué dessus, celui que ses parents lui avaient offert lors de leurs dernières vacances. Elle en était très fière, aucune de ses amies n’en avait un comme le sien, car elle était une des seules à partir à la mer l’été. Les autres n’allaient pas en vacances ou parfois, uniquement chez leurs grands-parents. Elle habitait un de ces quartiers populaires d’une petite ville du nord de la France et la plupart de ses voisins étaient ouvriers ou anciens mineurs. Elle avait eu la chance, elle, d’avoir des parents plus aisés. Sa maman, Francine, était secrétaire de mairie et son papa Charles était représentant pour une grande marque de jouet et sillonnait la région pour proposer ses produits aux magasins. Parfois, elle aurait aimé qu’ils fassent un métier plus simple, comme ça, elle les aurait vus plus souvent. Quand elle dormait chez une de ses copines, au réveil, la maman était là et le petit-déjeuner les attendait. Souvent un gâteau tout chaud, venant juste de sortir du four était sur la table.
La porte s’ouvrait dans l’entrée. C’était certainement Giselle, sa nounou. Elle était gentille, mais Mariette avait des difficultés à la comprendre. Elle parlait avec un accent terrible et utilisait un drôle de vocabulaire, le même que celui que l’on entendait à la sortie de l’école quand les mères appelaient leurs enfants. C’était du patois, un patois bien écrasé qui donnait une espèce de vulgarité aux personnes qui le parlaient.
À la maison, Mariette n’avait pas le droit d’en dire un seul mot. Elle en connaissait quelques-uns, ses copines lui en avaient appris. L’autre jour, son père l’avait grondé lorsqu’en tirant la chaise vers elle, elle avait dit en riant « Viens ici, petite Cayelle ». Elle trouvait que c’était un joli mot, plus chantant que chaise et n’y voyait pas de mal. À la maison, on parlait comme à l’école, sans gros mots et sans patois et la nounou avait bien du mal à se faire comprendre par la petite fille. Giselle s’approcha du porte-manteau de l’entrée, Mariette la regardait de loin, essayant de deviner quelle boule elle allait choisir, la jaune, la rouge, la verte ou la bleue. Perdu ! Elle a couvert la belle boule verte avec son vilain manteau de laine caramel. La préférée de Mariette, c’était la jaune, elle brillait plus que les autres et contrastait mieux avec le fer forgé noir des barres sur laquelle elle était fixée.
Giselle posait, sur la grosse cuisinière à charbon, une casserole remplie de lait et doucement y mélangeait le Banania. Elle coupait deux belles tartines dans le pain de sept cents grammes et étalait une grosse couche de beurre sur chacune. La journée allait être longue. Depuis Noël l’année dernière, il y avait la télé dans le salon, mais Mariette n’avait pas le droit de l’allumer, elle devait attendre que ses parents soient là et ils la regardaient tous ensemble, assis dans le canapé, dès que le repas du soir était terminé. Juste après « Bonne nuit, les petits », au moment où Nounours rejoint son petit nuage et qu’une pluie de sable doré tombe sur les enfants endormis, Mariette devait aller se coucher.
Ce matin, le ciel était gris et il pleuvait, c’était normal pour un mois de mars, mais Mariette désespérait de ne pas pouvoir aller dans le petit jardin derrière la maison. Elle ne pourrait pas, par-dessus le grillage, parler à Jean-Pierre, le petit voisin. Il était gentil, mais lui aussi parlait patois et sa mère n’aimait pas qu’elle joue avec lui. Souvent, on entendait crier les voisins au travers du mur de la maison, son père gêné augmentait le volume de la télé pour qu’elle n’entende pas les insultes qui fusaient.
Il va falloir passer la journée avec Giselle, faire semblant de comprendre son jargon, jouer à la bataille avec elle quand elle aurait terminé la vaisselle. Heureusement qu’il y avait le cours de judo pour la faire sortir un peu. Mariette était impatiente de rencontrer ses amis du Dojo, il y avait plus de garçons que de filles et elle trouvait ça rigolo, ils étaient tous à ses petits soins et faisaient très attention de ne pas lui faire mal lors des prises que le professeur leur apprenait. En attendant, Mariette remontait dans sa chambre, faisait son lit et s’asseyait par terre au milieu de ses jouets. Elle en avait beaucoup. Celui qu’elle préférait c’était son ours marron, il était très gros. Elle le trouvait beau, avec ses yeux comme deux billes noires et son museau en cuir. Elle l’aimait, c’était son confident, elle lui racontait ses malheurs, ses histoires avec ses copines d’écoles, elle le serrait dans ses bras et pleurait sur son poil rêche quand ses parents la disputaient. Il comprenait tout, écoutait patiemment et ne lui en voulait jamais même quand elle le délaissait un peu pour lire ou pour faire ses devoirs. Son rêve, c’était d’avoir une de ces belles poupées Barbie qu’elle avait vue en vitrine du grand magasin de jouets de la rue de Lille. Elle rêvait de la maison au toit rose, avec la chambre à coucher, le meuble de cuisine… Elle en parlait souvent à sa maman, mais il allait falloir attendre Noël et c’était loin, encore neuf mois sans être certaine que ses parents lui achèteront. « Si tu es sage, on verra. »
Ça allait être difficile de rester sage aussi longtemps « il y avait bien une ou deux bêtises que je ferais d’ici là », pensait la petite fille tout en jetant au loin sa vieille poupée Corolle qui en tombant retournait ses yeux.
Charles, son père était fatigué, il était sur la route depuis le matin, certes il était content de sa journée, il avait vendu dix cartons de camion de pompiers, huit boîtes de jeux de société, vingt consoles Atari, et il avait de nombreuses commandes de ces nouvelles figurines du film Star Wars qui venait de sortir au cinéma… Le chiffre d’affaires allait être bon.
Il engageait sa voiture dans la rue d’Arras, ralentissait avant le passage à niveau, mettait son clignotant et prenait la grande rue qui menait au centre-ville. C’était son dernier client à visiter aujourd’hui.
Ensuite, il passerait à la Poste avant la fermeture, car il avait reçu un colis et devait aller le retirer.
Il fallait se dépêcher, il ne restait plus qu’une heure avant la fermeture. Sa vieille Peugeot 404 faisait un drôle de bruit quand il accélérait, il allait falloir la passer en révision et ça ne l’enchantait pas. Il se méfiait des garagistes, si la réparation était trop chère, il préférerait presque en acheter une nouvelle. Il faisait énormément de kilomètres et ça ne valait peut-être pas le coup. Le dernier modèle qu’il avait vu à la publicité lui plaisait bien, c’était la Renault 20, mais elle était trop petite pour ses livraisons, la 504-break de chez Peugeot était idéale.
Voilà, le dernier client, un petit magasin poussiéreux au fond d’une impasse. Il n’était pas très visible, heureusement qu’il était connu pour sa spécialité en modélisme. Sa vitrine était remplie de boîtes de Mécano, de petites voitures Majorettes en métal semblables à des vraies, de maquettes de bateau et d’avion.
Mariette était assise dans la cuisine avec sa maman quand Charles mit la clef dans la serrure. Toutes les deux tournèrent la tête pour le voir rentrer. Il portait, comme chaque jour, depuis qu’il faisait froid, son pardessus gris, son chapeau beige chiné et son pantalon bleu marine. Ses chaussures à gros bouts étaient mouillées et maman courut rapidement avec la serpillière essuyer l’eau qui s’était répandue depuis la porte.





























