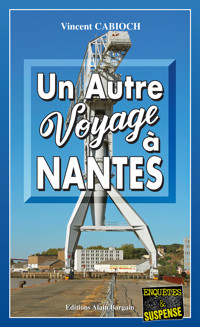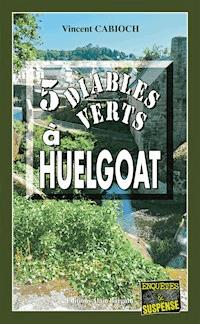
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Neïrem de Kerbidoc’h
- Sprache: Französisch
Lorsque le passé refait surface...
Au cœur de l’été, à quelques kilomètres d’Huelgoat, trois vieillards sont découverts morts, nus, emmurés dans une crypte d’une ardoisière abandonnée.
Le commandant de police de Brest, Neïrem de Kerbidoc’h, jolie épicurienne, moderne et truculente, parfois légère mais opiniâtre et entêtée, va tout faire pour tenter de résoudre le mystère de ce triple homicide hors du commun. Les talons aiguilles bien plantés dans le Chaos, elle nous raconte son enquête, une course contre la montre, noire et rose, entre la Bretagne, l’Allemagne et l’Italie, qui réveillera les fantômes du passé.
Une enquête captivante menée par une policière au caractère bien trempé !
EXTRAIT
Elle lui demanda de patienter, lui dit que je terminais ma série.
— Neïrem, il me demande de te dire que c’est assez urgent !
— « Assez urgent » ? C’est ce qu’il a dit ?
— Oui, il a dit « assez urgent ».
— Tu peux lui demander ce que ça signifie « assez urgent » ?
Monotone et lasse, elle lui dit que je demandais ce que signifiait « assez urgent ».
— Il me dit « urgent comme triple trépas »…
Je posai la corde et rejoignis l’accueil en m’épongeant délicatement le visage. J’avais quand même un peu hâte de savoir ce qu’entendait Gwendal par « triple trépas ».
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
On visite Huelgoat comme si l’on y était. Et la personnalité de son héroïne-narratrice (une jeune femme au caractère bien trempé et particulièrement en phase avec son époque et sa ville) contribue au rythme de ce roman, par ailleurs bien écrit et qui s’achève de façon… peu banale pour ce genre littéraire. -
Actu
À PROPOS DE L'AUTEUR
Vincent Cabioch vit à Brest où il travaille dans le secteur du spectacle pour une compagnie de théâtre et à l’Université de Bretagne Occidentale.
5 Diables verts à Huelgoat est son premier roman. Il l’a écrit en hommage à son arrière-grand-père, Henri Cabioch, abattu par des soldats allemands, le 5 août 1944, avec quatorze autres habitants de cette commune.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vous pouvez consulter le site internet de l’auteur : www.neirem.com. Vous y trouverez des infos autour de l’histoire, les lieux, les personnages…
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Annaig et KorneliÀ Édith, Danielle et Jean.
REMERCIEMENTS
Merci à Gaël D., Marie-Pierre B., Alain-Michel P., Arnaud S., Tanguy B., Gisèle et Patrick M., Gabrielle P. pour leurs précieux avis.
Je reconnais ta tignasse, Steffen, je sais que c’esttoi, je suis sûr que c’est toi. Avec un tarin comme ça,ta tignasse et ton tarin… Pardonne-moi ce que je vaisfaire… j’ai faim, je crève de faim. Je vais devoir tebouffer, Steffen, je sais que tu comprends. Je vais tebouffer pour m’en sortir. Steffen, grâce à toi je vais sortir de ce trou à ratset j’irai buter le monstre qui nous a foutus là.
PROLOGUE
J’ai décollé de Cagliari avant-hier, un peu avant midi. Je retrouve Brest après deux semaines d’isolement volontaire, des vacances en solo qui m’ont fait du bien. La côte ouest sarde est toujours aussi belle, rurale, paisible.
Je n’étais pas très loin d’Oristano et de ses mines abandonnées qu’on longe en lacets sur un chemin de terre difficilement praticable. Au bout, la plage est immense, tellement peu fréquentée. C’est là que j’ai reposé mon corps superbe, je l’ai baigné, je l’ai désac-coutumé des innombrables petits excès du quotidien.
J’aime l’île au printemps et en été. La Sardaigne, à l’exception de la petite partie vouée au luxe par le richissime Aga Khan, c’est comme la Bretagne.
Je ne saurais vous affirmer si ce sont ses menhirs qui m’ont inspirée, mais dans l’avion au retour, l’idée m’est venue de consacrer cette dernière semaine de tranquillité à ma généalogie. À vrai dire, j’envisage régulièrement de compléter l’arbre familial, c’est l’un de mes marronniers, mais voilà, chaque fois je m’y colle et je n’avance pas, me contentant du plaisir enfantin de redécouvrir tous les feuillets collectés par mes aïeux au fil du temps, comme on se replonge dans la lecture de son roman d’aventures favori.
Arrivée à la maison, j’ai vidé mes valises avant de téléphoner à Colbert1 pour prendre quelques nouvelles des affaires en cours. Tout va bien, c’est tranquille en ce moment. J’ai ensuite appelé mon père pour lui demander le numéro d’Erwann Le Her, un petit génie de la généalogie, un découvreur de premier ordre.
Je l’avais rencontré à l’occasion d’une enquête un peu glauque que nous avions résolue en grande partie grâce à ses talents, la toute première affaire intéres sante que j’avais eu à diriger après ma prise de fonc tion à Brest. Lui et mon père avaient fait connaissance à ce moment-là. Ils sont immédiatement devenus de très bons amis, pour des raisons qu’il n’est pas utile de vous détailler ici. Je peux simplement vous dire que mon père et ma mère ne vivaient déjà plus sous le même toit, depuis un bon moment.
En milieu d’après-midi, j’ai pris la route pour rejoin dre la petite crique que je fréquente assidûment à la belle saison. C’est un paradis inconnu, une étroi te bande de sable nichée au pied d’une falaise, à l’ex trême ouest du Finistère, quelque part entre Le Con quet et la pointe Saint-Mathieu.
Seule au monde, alanguie sur une immense serviette noire et rose, j’ai appelé Le Her. Il n’a pas répondu, je lui ai laissé un message. Il m’a envoyé un sms, quelques minutes plus tard, me proposant de le retrouver le lendemain pour déjeuner aux “Quatre Vents”, un bar sur les quais où l’on ne mange pas trop mal le midi et où l’on boit parfois trop le soir. J’aime bien cet endroit, j’ai simplement répondu « OK », puis je me suis assoupie.
Hier matin, avant de le rejoindre, j’ai quitté la maison un peu en avance, bien décidée à flâner dans ma cité adorée pour voir ce que proposaient les vitrines.
La ville est très calme, très chaude, on a une fin d’été magnifique. J’étais comme blottie dans une petite boîte remplie de coton, tournée sur moi-même comme on peut l’être, j’imagine, dans une grotte du comte Henri Russel, avec le corps en douce extase, apaisée, les idées toujours en voyage.
Je me suis laissée tenter par un maillot de bain minuscule, j’ai lu la presse devant un café, dans un boui-boui discret, puis j’ai rejoint le port en suivant de temps en temps du regard des papillons blancs courant sur la rade.
Ce cher Le Her m’attendait attablé en terrasse. Le visage à l’ombre de son chapeau sans forme, le nez dans un vieux livre dense et sombre comme un cigare, il noircissait calmement les feuillets d’un petit carnet.
— Bonjour Erwann, lui dis-je en posant mon sac au pied de la table.
— Neïrem, salut, comment ça va ? répondit-il en refermant doucement le bouquin sur un doigt pour conserver sa page.
Je pris place en face de lui.
— Ça va bien, je rentre tout juste de vacances.
— Laissez-moi deviner… La Sardaigne, je parie !
— Eh oui, comme presque chaque été, que voulez-vous, c’est un pays qui me fait du bien.
— Ça se voit, votre mine est une preuve absolue, vous êtes resplendissante.
— Merci Erwann, c’est gentil. Bon, pour les recherches que je vous demande, vous pensez avoir besoin de combien de temps ?
— Assez peu a priori, ce matin, j’ai déjà repris toutes les bases que vous m’avez envoyées cette nuit, et puis vous êtes de la petite noblesse bretonne, j’ai facilement déroulé le fil des de Kerbidoc’h2. Votre père m’a dit qu’il me transmettrait toutes ses données. Il possède pas mal d’éléments, semble-t-il, un peu en désordre, entassés dans « trois classeurs gonflés de fiches et d’anecdotes ». Il ne m’avait jamais parlé de ça.
— Vous savez bien comment il est…
— Effectivement.
— Je connais bien tout ce stock. J’y jette un œil de temps en temps ; petite, je m’en faisais déjà des histoires. Ce n’est d’ailleurs pas mon père mais mon arrière-grand-père qui avait réuni le tout, à la fin de sa vie. Vous verrez, c’est cocasse, une petite œuvre baroque où chacun a mis du sien, année après année, sans jamais rien mettre en ordre ! En revanche, ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est que vous vous serviez de toute cette matière pour produire un véritable rapport d’expert. J’aimerais qu’on puisse enfin disposer d’un document exhaustif, bien rangé, fluide, lisible. Et surtout, j’aimerais vraiment avoir le plus d’infos possible sur les branches parallèles, les cousinages éloignés, vous voyez ?
— Je vois. Ça prendra un peu plus de temps, mais je pense pouvoir vous remettre le tout, disons… fin octobre au plus tard.
— Ça marche.
— Alors, Commandant de Kerbidoc’h, puisque vous connaissez ma discrétion, dites-moi, que fait la police en ce moment ?
— Ah ! Comme vous êtes curieux, mon cher ami…
Nous avons tranquillement laissé traîner le déjeuner. Je lui ai raconté sans trop de détails les affaires en cours, dont l’histoire amusante du joueur du club de foot pro de Brest. On a beaucoup ri aussi à propos de la généalogie locale de Sylvester Stallone3, des histoires de fesses4 en quelque sorte, puis, naturellement, le délicieux vin rouge et le soleil aidant, nous avons fait le tour des potins de la cité, au son des balances de la scène de concert où se préparait l’avant-dernière soirée des “Jeudis du port”, la grande fête musicale organisée chaque été par la municipalité.
Erwann parti, j’ai flâné le long des quais, j’ai papoté avec deux ou trois connaissances, puis je suis remontée tranquillement jusqu’à la maison, par des chemins de traverse.
Après une longue douche rafraîchissante, accompagnée en musique par l’Ensemble Matheus puis Daft Punk, j’ai fait l’ingénue dans mon dressing, avant de me poser au cœur du jardin, simplement vêtue de mon maillot tout neuf, pour savourer un thé au citron et des gâteaux à la cerise. J’ai zappé sur Google, j’ai téléchargé une application pour reconnaître et soigner les fleurs du jardin – il va falloir que je me décide à faire tondre la pelouse – et « pop », j’ai reçu le mél d’Erwann.
Je ne sais pas comment il fait. Nous nous étions quittés cinq heures plus tôt et il me proposait déjà un arbre très complet.
Je suivais d’abord les ramifications principales, puis m’attardais sur les branches de cousinages plus anciens. C’est là, en remontant une lignée biscornue à quelques encablures des de Kersauson de Pennendreff que je vis un nom que je ne m’attendais pas à retrouver un jour, pas comme ça…
Ce patronyme dans ma généalogie ? Cette famille liée à la mienne ? Aux de Kerbidoc’h ?
Ce nom – que j’ai promis de ne pas dévoiler ici – est celui d’une famille originaire de Huelgoat, une commune touristique du Centre-Finistère. Ce simple patronyme lu là, fit immédiatement ressurgir le souvenir d’une très jolie rencontre et de l’une des affaires les plus hallucinantes de ma jeune carrière.
C’est cette histoire que je vais de vous raconter aujourd’hui.
1 Siège du commissariat de police de Brest.
2 Prononcer Kerbidor.
3 Le grand-père maternel de l’acteur Sylvester Stallone était brestois.
4 La mère de Sylvester Stallone pratique la rumpology, qui consiste à lire l’avenir dans les fesses…
I
Comme à chaque fois c’est arrivé sans prévenir.
C’était au début de l’été, à la mi-juillet, un été breton beau et chaud comme en ce moment, comme rarement. Ça doit faire cinq ans, si mes souvenirs sont bons, oui, c’est ça, cinq ans presque jour pour jour.
Un samedi en fin d’après-midi, Gwendal – l’un de mes lieutenants – était venu me chercher au club de sport où je cultive l’harmonie de mes formes en pratiquant la savate et d’autres sports désuets. Il avait une bonne raison d’interrompre ma séance : des post-ados venaient de mettre au jour un truc glauque, bien caché dans un trou très profond.
Ils avaient quitté Brest au petit matin pour aller se balader dans la région de Huelgoat. Ils étaient partis avec tout le matériel qu’il faut pour une bonne séance d’alpinisme ou d’escalade, je ne sais pas quel terme convient, je ne suis pas spécialiste de cette grimpette-là.
Pour ceux qui connaissent un peu Huelgoat, c’est étonnant, car il n’existe pas vraiment de site reconnu pour pratiquer ces sports dans le coin ou, en tout cas, pas de spot qui nécessite un équipement aussi important que celui qu’ils avaient emporté avec eux.
En fait, nos bonshommes étaient fans d’URBEX, d’exploration urbaine pour faire plus simple. Si vous ne connaissez pas, retenez simplement que les adeptes de l’URBEX se passionnent pour l’exploration de tout ce qui est secret et inaccessible : les bâtiments administratifs, les sites industriels, les ouvrages d’art, les trous, les grottes, les caves et les greniers…
Pendant leur audition, le surlendemain de leur découverte, ils m’expliquèrent qu’ils étaient membres d’un groupe cataphile qui se faisait appeler “Penn Ar Kata”. Ils arpentaient régulièrement les catacombes parisiennes, ces centaines de kilomètres de galeries creusées dans le calcaire, normalement interdites au public, dédale labyrinthique qui court presque partout sous la capitale, le Paris “sub-muros”.
Ils y organisaient de temps en temps des festoùnoz1, des soirées réunissant plus d’une centaine de personnes dans des salles gigantesques, avec musiciens de bagad, danseurs, fûts de bière, bouteilles de cidre et billigs2. On ne soupçonne pas ce qui se passe sous Paris.
Avec ces fêtes traditionnelles bretonnes underground qui duraient jusqu’au petit matin, ils faisaient un pied de nez à la France, à la capitale, et la colonisation bretonne du bassin parisien par le dessous, ou plutôt par le dedans… Pourquoi pas ?
Quand ils m’avaient raconté leurs histoires, j’avais d’abord eu un peu de mal à les croire, voyant là une invention un peu grossière pour tenter d’expliquer leur présence dans une mine abandonnée du Centre-Finistère, un samedi après-midi de juillet. Mais j’avais vaguement entendu parler de tout ça quand j’étais en poste à Paris, et Gwendal avait fini par glisser sur mon bureau le rapport des RG que je lui avais demandé.
Si leurs casiers étaient vierges, ils avaient tous un petit chapelet de contraventions. Ils s’étaient fait choper plusieurs fois par l’ÉRIC, l’Équipe de Recherche et d’Intervention en Carrière, pour une infraction peu banale : « Pénétration et circulation dans les carrières de Paris. »
L’un d’eux se distinguait tout particulièrement, son CV de cataphile était long comme mes fines jambes. Il occupait une place de choix dans la hiérarchie de cette caste mystérieuse et protéiforme et s’y faisait appeler Bran. Dans le vocabulaire vernaculaire, Bran était une « catastar », autrement dit, l’une des figures majeures du microcosme, un ponte.
En plus d’être reconnu par ses pairs, je pus lire qu’il était bien identifié par mes collègues de l’ÉRIC et j’appris avec étonnement, en parcourant le rapport, que c’est en fait un jeu complice du chat et de la souris qui s’organise entre les fonctionnaires de police de ce service très spécialisé et les cataphiles. Ça n’est pas très connu, mais la présence quasi constante dans les méandres du sous-sol parisien, d’une société finalement sympathique et surtout bien structurée, favorise une surveillance efficace à moindres frais, sécurise ce réseau infini contre une présence moins amusante, criminelle ou terroriste. Ils veillent sans le savoir – ou sans en avoir l’air – sur ce qui se passe et sur qui passe, sur le foncier aussi, les fondations des bâtiments, les soubassements des institutions, les gigantesques réserves d’eau potable, les réseaux de communication…
Ce samedi de juillet donc, en début d’après-midi, loin de Paris, les cinq aventuriers allaient explorer un trou dans la Bretagne, une ancienne ardoisière abandonnée au milieu des années 90, vestige industriel presque oublié, posé au milieu de nulle part, en périphérie de Huelgoat.
Ils avaient d’abord fait une petite halte au Rocher de l’Impératrice, à Plougastel-Daoulas, pour offrir une rapide formation de descente en rappel aux deux d’entre eux les moins expérimentés. Le puits d’exploitation qui devait leur permettre de visiter l’ardoisière faisait soixante mètres de haut, il fallait s’y lancer sans appui, le long d’une simple corde, et remonter à la force des bras, ça ne s’improvise pas ! Par la suite, on nous indiqua un accès plus praticable. Je ne me serais pas vue descendre de la même façon qu’eux, en tailleur et stilettos, je tiens plus de la guêpe que de l’araignée.
Une fois en bas, ils visitèrent tout, passant de salles en galeries, déambulant au milieu de véhicules et machines d’extraction abandonnés sur place, feuilletant les rapports d’activité encore posés sur le bureau du contremaître… Tout était figé, en ordre de marche, les ouvriers auraient pu reprendre le travail dans l’instant.
Ils eurent même le plaisir de découvrir un petit stock d’explosifs, encore conditionné dans sa boîte, posé sur l’étagère métallique d’une armoire blindée dont la porte avait été laissée entrouverte. Je vous signale ça parce que c’est toujours aujourd’hui une blague qui hante les couloirs de la SRPJ. Les explosifs firent l’objet d’une enquête parallèle à la mienne, menée par la section antiterroriste de la Crim’ parisienne car, malgré les affirmations répétées de l’ancien propriétaire exploitant qui en confirmait l’origine, le préfet s’était mis en tête qu’il pouvait s’agir d’une cache d’armes de l’ARB3.
Dans l’un des recoins d’une galerie en cul-de-sac, à plus de trois cents mètres de fond, l’un d’eux remarqua une forme étrange se dessiner sous la lumière de sa torche.
C’était une toile de jute imprégnée de glaise. Elle masquait l’accès d’un boyau étroit. À quelques mètres derrière ce camouflage grossier, un mur de briques supportait une lourde porte en bois verrouillée par quatre barres métalliques.
Il appela ses potes, ils firent sauter les cadenas.
La crypte cachait trois cadavres, des vieillards, nus.
1 Littéralement « fête de nuit » en langue bretonne.
2 Plaque ronde en fonte utilisée pour la cuisson des crêpes.
3 Armée Révolutionnaire Bretonne.
II
Je rebondissais souplement entre les sifflements de la corde à sauter, en faisant semblant de compter quand Sofiya, la propriétaire du club de sport, m’appela bien fort depuis la fenêtre d’angle de sa guérite d’accueil.
— Neïrem, téléphone pour toi !
— C’est qui ?
— C’est ta police, Mademoiselle la commandante de !
Toujours beaucoup d’humour, Sofiya, un corps de femme, le tempérament d’une femme qui joue à l’homme, et tout ce qui va avec.
— C’est Simon ? demandai-je.
Elle reprit le combiné et demanda qui c’était.
— Non, c’est pas Simon, c’est Gwendal !
— Tu peux le faire patienter deux secondes, s’il te plaît ? J’arrive à la fin de ma série…
Elle lui demanda de patienter, lui dit que je terminais ma série.
— Neïrem, il me demande de te dire que c’est assez urgent !
— « Assez urgent » ? C’est ce qu’il a dit ?
— Oui, il a dit « assez urgent ».
— Tu peux lui demander ce que ça signifie « assez urgent » ?
Monotone et lasse, elle lui dit que je demandais ce que signifiait « assez urgent ».
— Il me dit « urgent comme triple trépas »…
Je posai la corde et rejoignis l’accueil en m’épongeant délicatement le visage. J’avais quand même un peu hâte de savoir ce qu’entendait Gwendal par « triple trépas ».
— Oui, Gwendal, c’est moi, que se passe-t-il ?
— Bonjour Commandant, désolé de te déranger pendant ta séance, mais on a un truc bien chaud qui vient d’arriver, des jeunes ont découvert trois corps dans une mine à proximité de Huelgoat, en fin d’après-midi.
— Trois corps ? C’est un homicide ?
— On ne sait pas bien pour le moment, probablement, mais c’est bizarre, enfin… heu… disons que ça sort de l’ordinaire. Je ne sais pas trop quoi te dire. Je suis là, dehors, je suis garé devant le club, t’es attendue sur place.
— J’arrive.
Je courus me rafraîchir et me changer, puis je rejoignis la voiture. Nous quittâmes Brest sans sirène ni lumière. La ville était calme, le vide et la langueur des vacances d’été.
Nous étions sur place après une bonne heure de route. Une première équipe de mon service était déjà là, interrogeant l’un des jeunes explorateurs du trou, celui qui se faisait surnommer Zat – c’est pratique, les pseudos cataphiles, ça me permet de préserver leur véritable identité sans avoir à inventer de faux noms. Vous verrez qu’au fil de cette histoire, lorsque la confidentialité le nécessitera, je serai obligée d’utiliser différents artifices pour masquer les identités.
Zat donc, était le seul à être remonté à la surface, les quatre autres étaient toujours au fond. C’est lui qui avait appelé les secours.
Quand j’arrivai sur le site, il était au bord du puits d’accès, discutant avec Antoine et Simon, deux autres de mes lieutenants que je vous présenterai plus tard, ça en vaut la peine.
Antoine m’avait fait un compte rendu au téléphone pendant que nous roulions. Nos cinq explorateurs n’avaient pas hésité longtemps avant d’appeler la police, même si leur situation pouvait paraître un peu équivoque.
C’étaient des aventuriers du quotidien, souvent en jeu avec les limites de la légalité, mais ils étaient sérieux quand il fallait, et, ce jour-là, parfaitement conscients de l’exceptionnel de leur découverte. Du coup, plutôt que de laisser un simple message anonyme avant de disparaître, ils étaient sagement restés nous attendre.
Je pense qu’ils voulaient profiter de l’adrénaline du début des investigations, nous aider au mieux et, pourquoi pas, participer au truc. On prend vite goût à une aventure comme celle-ci, l’excitation du chercheur d’or qui sort une belle batée est longue à retomber.
En apparence, Zat était parfaitement calme. Il me raconta les circonstances de la découverte très précisément. Il jugea utile de me dire tout de suite que la scène était préservée, qu’ils avaient fait bien attention de ne toucher à rien, le moins possible, en tout cas.
Antoine était en relation continue avec le fond. L’oreillette d’un portable qu’il avait emprunté à l’un des jeunes, vissée dans une oreille, il faisait désormais le relais entre eux et moi. La liaison n’était pas bonne du tout, mais suffisamment pour faire passer l’essentiel.
Simon, de son côté, restait en contact avec le bureau où l’on cherchait à identifier et à joindre le propriétaire de la mine. On nous préviendrait dès qu’il serait informé et en route.
Une équipe spécialisée dans la logistique des investigations périlleuses venait également de quitter Brest, complétée par un duo de la “scientifique” et une équipe de pompiers. Le dispositif se mettait doucement en place, j’avais une bonne heure devant moi pour découvrir les environs.
C’était la première fois que j’arpentais un paysage comme celui-là. Je n’aurais jamais imaginé qu’on puisse en trouver en Finistère. Un peu comme tout le monde, je savais qu’il y avait des carrières dans la région, je savais vaguement qu’on avait exploité des mines d’argent à Huelgoat autrefois, mais là, c’était différent.
Perdue au milieu de la campagne, la zone était accidentée, un désert minéral posé dans la forêt, espace brut, pelé.
Tout n’était qu’ardoise, un fouillis de cailloux noirs, anthracite, des blocs énormes, des plaques massives posées aléatoirement, mille-feuille monstrueux sur un tapis d’agrégats concassés du moyen au petit, mélange pierreux et poudreux.
Le puits était planté au milieu de ce champ noir. Il était surmonté d’une grande structure métallique vieillissante, teintée par la rouille.
Le soleil commençait à taper bas, irisant le tout d’une onde variant doucement vers l’orangé. Imaginez une peinture de Pierre Soulages rehaussée des touches vives du peintre brestois Frank-E-Rannou.
À une cinquantaine de mètres du puits, un petit bâtiment en ligne abritait les anciens ateliers de taille des ardoises et les bureaux de la direction. Le site travaillait autrefois la pierre de l’extraction à la finition, le stock encore disponible sur place aurait permis de couvrir plusieurs dizaines de maisons.
Je me souviens m’être dit que l’ardoise est un matériau qu’on ne vole pas, car à l’exception d’une simple barrière cadenassée et flanquée d’un petit panneau « Propriété privée, entrée interdite », aucune protection particulière ne venait interdire la visite de ce coin étrange aux curieux.
III
Je prenais des notes sur ma tablette, je faisais aussi quelques photos, avec enregistrement des coordonnées GPS – je collecte systématiquement le plus de données possibles sur les scènes de crime, pour pouvoir m’y replonger tranquillement plus tard et extraire les détails qui, inévitablement, passent inaperçus sur le moment.
Quand le site fut prêt à être inspecté, la nuit était presque tombée. Le gérant de la mine n’avait pu se rendre disponible, il était en vacances quelque part au Sénégal. Nous avions retrouvé l’ancien contremaître et l’avions fait venir. Par chance, il n’habitait pas trop loin.
Il nous mena jusqu’au fond par un accès plus praticable que le puits : un peu en contrebas de la zone principale, à l’ouest, les extérieurs de la mine se terminaient par un bassin immense entouré d’une haute clôture grillagée. Cette eau était essentielle au travail de la pierre. On longeait ce lac artificiel par un large chemin caillouteux qui, bordé par la paroi, ouvrait de temps en temps sur des tunnels permettant d’atteindre les filons.
Le contremaître, septuagénaire petit et sec comme un cycliste pro, était dans un drôle d’état, c’est le moins qu’on puisse dire. Il nous expliqua d’un joli accent cornouaillais que lorsque nous l’avions fait chercher, il terminait un barbecue commencé bien avant midi, une grande fête familiale généreusement pourvue. Normalement, il aurait dû faire sa sieste à l’heure qu’il était, une sieste pour la nuit !
Ça faisait près de dix ans qu’il n’était pas revenu ici, mais tous ses gestes étaient automatiques. Il aurait trouvé son chemin dans le noir complet, même avec trois grammes dans chaque poche, et je suis bien en dessous de la réalité. Nous le suivions dans le réseau, moi, Gwendal, Zat, un pompier, ainsi que le gars et la fille de la scientifique. Tous les autres étaient restés en surface.
Nous arrivâmes dans la salle principale, vaste, formée comme la croisée du transept d’une cathédrale, exactement à l’aplomb du puits.
L’image était impressionnante, les spectres inertes des anciens véhicules de chantier et de tout le matériel encore entreposé là jetaient dans le prolongement de nos lampes des ombres grandioses sur les hautes parois. La corde utilisée par les ados coupait l’espace d’un long trait bleu ondulant mollement sur toute la distance. Les puissants spots qu’achevait d’installer l’équipe technique en haut du puits complétaient cette fantasmagorie, et puis il y avait le son sourd et régulier du groupe électrogène un peu dans le lointain, l’écho réverbéré des discussions, le grésillement des talkies-walkies… J’avais l’impression que nous remplissions bien mal le vide de cette grande endormie.
Bran nous avait rejoints. Lui et Zat nous indiquèrent le chemin. Nous approchâmes avec précaution, calmement, méthodiquement. J’avais demandé que chacun enfile une tenue de protection, charlotte sur les cheveux, petits chaussons aux pieds et masque sur la bouche. Mathurin, Bouille et Damok, les trois autres inventeurs du macabre, nous attendaient, assis à l’entrée du court tunnel qui menait à la cellule.
Entre un hoquet et un rot au fumet atroce, le contremaître jura que cet endroit n’existait pas quand la mine avait fermé.
— Voilà Madame, c’est ici, derrière la toile de jute, tout au fond, dit Bran.
Je lui précisai de m’appeler « Commandant ou Mademoiselle ».
Je demandai à la jeune fille de la scientifique de m’accompagner. Nous nous enfonçâmes prudemment dans le boyau.
Il faisait environ quinze mètres de long, en légère courbe sur la droite, un mètre de large sur un mètre soixante de haut, pas plus. Il débouchait sur une sorte de sas de même hauteur – mais plus large – qui révélait un mur de parpaings grossièrement cimenté.
La porte était désormais entrouverte, je l’écartai doucement. Elle tourna vers nous parfaitement sur ses gonds. Tout cela n’était pas très ancien, ou parfaitement entretenu, les deux peut-être. C’était une cellule creusée dans la roche, trois mètres carrés environ, la même hauteur que le sas, aucune lumière, aucun aménagement particulier.
Nous restâmes toutes les deux, un moment, interdites dans l’entrée, nos lampes découvrant le spectacle de ces trois corps nus, une scène hors du commun. C’étaient des vieillards de sexe masculin. Ils m’apparurent momifiés, prostrés, d’un gris terne parfois marbré. Le premier, tout près de nous, au coin droit immédiatement près de la porte, était couché sur son flanc gauche. Il avait le dos contre le mur, la tête à dix centimètres de mon pied. C’était un homme de forte corpulence, beaucoup de plis gras, moustachu, avec une généreuse chevelure blanche. Le deuxième, à un mètre cinquante devant, ne nous présentait que son dos et la plante de ses pieds. Recroquevillé sur ses genoux, il formait une masse anguleuse et décharnée, le corps long, tourné contre la pierre noire comme pour chercher à s’y fondre, les côtes très dessinées, creusant des sillons sur son dos voûté, très maigre. Le dernier vieil homme était allongé à gauche, lui aussi tourné partiellement vers la paroi, le flanc droit vers le plafond, tête retournée. Il nous regardait de ses yeux fixes d’un bleu passé.
Pas d’odeur. Plus d’odeur.
Ils devaient avoir au moins quatre-vingts ans, probablement plus. Les deux visages que nous pouvions apercevoir, bien que d’expression différente, gardaient, figé, le masque d’une mort atroce, lente. Ils avaient été enfermés vivants, puis étaient morts de soif, d’épuisement… Il fallait attendre l’autopsie pour en savoir plus. Sur eux, aucun signe distinctif n’était visible à cet instant, pas de bague, pas de vêtement, aucun objet annexe, rien ! Nous regardions un tombeau, voilà tout, un tombeau où l’on avait enfermé trois vieillards en vie, pour les y laisser mourir.
Ma collègue croisa mon regard.
— Il faut faire un relevé précis de chaque élément en place, dis-je, rassembler les équipes et réfléchir à la méthode. Au point où ils en sont, nous avons un peu de temps n’est-ce pas ?
Elle répondit à ma proposition d’un hochement de tête, à mon humour d’un sourire.
Je sortis la minuscule caméra qui ne me quitte jamais et filmai une séquence détaillée dans un mouvement très lent, puis nous rejoignîmes les autres.
— Gwendal, tu restes ici avec le pompier, dis-je, nous, on remonte à la surface, il faut que j’organise la logistique. On reste en relation audio, je redescends plus tard, si c’est nécessaire, il faut que j’informe tout de suite le procureur et le préfet.
Je devais faire vite, je voulais être sûre qu’on me charge de cette affaire. Vous comprendrez que tout cela m’intriguait absolument, un cas comme ça n’est pas si fréquent. Et puis surtout, il y avait un petit problème : nous n’étions pas totalement en règle avec les procédures. Normalement, ce sont les gendarmes de la brigade territoriale de Huelgoat qui auraient dû être présents. Nous étions sous la juridiction de Morlaix, je devais donc faire immédiatement le nécessaire auprès de ma hiérarchie pour garantir que l’on me nommât malgré tout responsable des investigations.
Ma chance, c’était que quasiment toutes les forces de gendarmerie du Centre-Finistère étaient mobilisées par le festival des Vieilles Charrues et que, dans le même temps, un duo d’imbéciles s’était mis en tête, ce samedi après-midi là, de braquer le maximum de supérettes dans la région pour financer je ne sais quelle excursion à Ibiza. Le reste des forces disponibles leur courait après dans toute la région.
Il existe également une cause moins officielle, que je n’ai jamais vraiment pu vérifier, un bruit de couloir selon lequel le premier interlocuteur de Zat, quand ce dernier appela les secours en composant le 17, relaya vers un gendarme qui ne prit pas vraiment au sérieux son histoire et, croyant ses explications tout droit sorties de l’esprit acide d’un festivalier délirant, choisit de relayer à son tour vers le commissariat Colbert à Brest, espérant ainsi l’encombrer des bla-bla du plaisantin.
La guerre des polices est plus ténue que dans les années 70, heureusement ! Mais il en reste toujours un petit quelque chose, et un petit quelque chose souvent un peu mesquin.
Sans toutes ces concomitances opportunes, jamais la SRPJ de Brest n’aurait été appelée in fine pour aller voir ce qui se passait au fond de cette mine d’ardoise. Je devais donc blinder le dispositif et avancer le plus loin possible dans les démarches initiales pour m’assurer la suite de l’affaire, car il ne faisait aucun doute que tout enquêteur digne de ce nom, informé de la nature de la découverte, aurait tout fait pour me chiper mon bout de gras.
Enfin, une dernière chose me motivait, plus abstraite… Je crois pouvoir vous le dire sans avoir l’air d’une illuminée : lors de l’échange de regards avec le troisième cadavre, quelque chose était passé. Je ne peux pas vous décrire exactement cette sensation, disons qu’une sorte de vibration nous avait liés. J’ai la faiblesse de croire en ces choses-là.
IV
Nous avions improvisé un petit espace de travail dans l’ancien bureau de la direction. La nuit était maintenant bien tombée, une belle lune, un ciel constellé. Soulages et Rannou avaient laissé la toile à Magritte.
L’équipe scientifique procédait aux relevés dans la cellule et le tunnel d’accès. J’avais autorisé nos cinq aventuriers à rentrer à Brest avec un rendez-vous fixé pour une audition dès le lundi après-midi.
Le reste de mon équipe fouillait certaines zones de la mine minutieusement, un périmètre que nous avions sélectionné, s’étendant depuis le trou d’accès caché par la toile de jute jusqu’à la salle principale au-dessous du puits d’extraction. Il aurait été impossible d’inspecter tous les méandres de ce labyrinthe géant.
Nous avions rédigé les premiers procès-verbaux sur place et, notamment, la première audition du contremaître. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, encore embué par ses excès de l’après-midi.
Ma discussion téléphonique avec le procureur était achevée depuis une dizaine de minutes quand le commandant de gendarmerie de Huelgoat arriva, immédiatement suivi des trois véhicules de pompiers mobilisés pour le transport des corps. Le service de médecine légale de Brest les attendait, le légiste allait avoir de la viande sur l’inox.
Avec tout ce que j’avais pris soin de mettre en place et compte tenu du caractère exceptionnel de l’affaire, le procureur n’avait pas eu d’autre choix que de confirmer ma désignation. J’étais soulagée. Comme je savais que les choses ne seraient pas simples avec les gendarmes, je lui avais fait part de ma volonté de m’appuyer sur les forces locales. J’avais donc de solides arguments pour assouplir la relation avec celui qui n’allait pas tarder à débouler pour me demander ce que nous faisions sur ses terres…
Je l’entendais déjà s’agiter au dehors, toiser l’équipe technique qui finalisait tout juste l’installation des palans qui permettraient bientôt de remonter les corps :
— C’est quoi ce bordel, putain de merde ! Qu’est-ce que vous foutez sur ma juridiction ! Il suffit que je sois occupé à courir après deux zozos débiles tout l’après-midi, pour que tout Brest débarque chez moi fouiller dans des trous de granit ! De l’ardoise ? Comment ça, de l’ardoise ? …Bien sûr que je sais que c’est de l’ardoise !
C’était le commandant Lamiral. Le gaillard jouait souvent le chaud et le froid, mais au fond, c’était un sympathique bonhomme, un bon vivant. Il portait toujours fort la voix, fier de son timbre profond. Il en imposait par sa corpulence haute, ronde et massive, difficilement rangée dans des uniformes taillés sur mesure à la façon gendarme, les bras rebondissant sur son buste barrique. Un ogre adouci.
Je le connaissais un peu, nous avions sympathisé lors de la précédente garden-party du Préfet de Département. Ce jour-là, je lui avais très vite été présentée par une collègue qui savait que je l’aurais passionné avec mes histoires de la BRP Parisienne, la Brigade de Répression du Proxénétisme, la Mondaine, où je venais de passer cinq années avant de rejoindre Brest. J’avais joué le jeu en lui racontant quelques histoires croustillantes, mon charme avait fait le reste, nous étions restés deux bonnes heures à discuter en nous empiffrant discrètement près du buffet.
Cette fois-ci, j’étais chez lui. Il risquait de se montrer moins tendre. Après un bruyant pataquès autour du puits, passé à pérorer en brassant l’air, on lui avait indiqué où me trouver. Il franchit la porte du bureau de fortune en continuant sa logorrhée, marmonna deux ou trois trucs incompréhensibles et m’interpella enfin :
— Commandant de Kerbidoc’h ! Allons bon ! C’est donc vous ! Vous n’avez rien de mieux à foutre, un samedi soir de juillet, que de vous échapper de la cité du Ponant pour venir en terre magique élucider je ne sais quel mystère affreux ?
— Bonsoir Commandant, lui répondis-je, amusée et légèrement détachée, pour dégonfler la baudruche. Que voulez-vous, vous étiez, m’a-t-on dit, bien trop occupé, il ne restait donc plus que nous pour faire le sale boulot. Mais dites-moi, comment allez-vous ?
Il s’assit d’un coup en bout de table, tout en me serrant la main d’une des énormes siennes. Deux de ses gendarmes l’entouraient comme des porte-flingue leur parrain, l’œil un peu surpris par notre soudaine complicité.
— Pas trop mal, je viens tout juste de coincer deux voleurs de bonbons qui ont voulu nous échapper en pédalo sur le lac de Huelgoat après un gymkhana vivifiant dans les coulées des Monts d’Arrée. Vous auriez apprécié probablement, il y avait un peu de ce que doit être la chasse à courre… Vous devez connaître ça, les cerfs et les renards, n’est-ce pas, Madame la comtesse…
— Commandant, moquez gentiment mon aristocratie, si vous voulez, mais malheureusement, je ne crois pas que les de Kerbidoc’h aient jamais eu ni l’esprit ni les moyens de chasser à courre.
— Ah bon ? Eh bien, vos aïeux ont certainement pris leurs taxes sur les gibecières des braconniers alors ! Comment mange-t-on sinon, quand on ne travaille pas ?
— Mon cher commandant, c’est possible, mais comment travaille-t-on, si l’on ne mange pas ?
— Ah, ah ! À qui le dites-vous ! D’ailleurs, je commence à avoir un petit creux, moi… rajouta-t-il en posant ses mains sur son énorme ventre. Sérieusement, ma chère, qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui ? J’ai eu le procureur au téléphone, il y a quelques instants, juste après que vous l’avez appelé, semble-t-il… Il m’a parlé de trois corps, des vieillards, emprisonnés ici dans un recoin de la mine. Vous avez trouvé quoi, au fond de ce trou ?
— D’abord, Commandant, je souhaite mettre notre relation au clair. Effectivement, nous sommes sur votre juridiction, mais le déroulement de la procédure d’alerte a sollicité la SRPJ de Brest, c’est comme ça… Le procureur vous en a certainement informé, je resterai donc responsable des investigations, mais je voudrais que nous puissions travailler conjointement pendant toute l’enquête, sous mon autorité évidemment ! Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ?
— Rassurez-vous, je ne vais pas m’engager contre vous dans une bataille administrative, au beau milieu de l’été ! Puisqu’il en a été décidé ainsi, je m’incline ! Si ce que vous me proposerez s’avère raisonnable, comptez sur moi, je suis avec vous aux conditions que vous formulerez.
Il était en pleine forme, Lamiral ! Sa journée n’avait pas dû être de tout repos, il avait perçu la volonté de mon engagement au moins autant que mon subtil décolleté, il était surtout impatient d’en savoir plus.
— Allons, mademoiselle de Kerbidoc’h, maintenant qu’on est d’accord, dites-moi donc, qu’est-ce qui se passe ici ?
Je lui racontai la découverte faite par les cinq jeunes garçons, puis lui montrai la séquence que j’avais filmée dans la cellule, en lui décrivant les premières constatations. Il resta bouche bée.
— Comment diable ces pauvres hommes ont-ils pu se retrouver là ?
— C’est ce que nous devons découvrir. Malheureusement, on n’a pas grand-chose pour le moment, aucune matière évidente en tout cas, rien ne permet de savoir de qui il s’agit. Nous aurons du mal à découvrir qui a pu faire ça, si on n’élucide pas d’abord ce mystère. On a déjà vérifié, ces trois individus ne correspondent à aucune disparition signalée en Bretagne dans les douze derniers mois. Il va falloir élargir. Nous transférons les corps au service de médecine légale de Brest, je compte beaucoup sur le légiste pour nous en dire plus, les dents peut-être, et nous continuerons à fouiller toute la mine et les environs demain. Vu la qualité du travail et la minutie apportée à la fabrication de la cellule, je doute qu’on trouve beaucoup de choses, mais qui sait… Et puis il faut du temps et des outils pour creuser un truc pareil, quelqu’un aura peut-être aperçu quelque chose… Sans vous commander, Commandant, est-ce que vous pouvez vous charger d’une première approche du voisinage demain ?
— Demain dimanche ? Ça va être un peu difficile, nous sommes encore très occupés avec le festival des Vieilles Charrues, mais dès lundi, oui, on s’en charge.
Nous restâmes quelques minutes autour de la table à échanger des hypothèses, à évoquer la façon dont nous pourrions nous organiser.
Les corps furent remontés assez vite, je n’avais finalement pas eu le temps de redescendre. Les scientifiques me firent leur premier compte rendu, c’était sans grande surprise, en tout cas pour le moment. Ils avaient minutieusement collecté différents éléments organiques, tout quadrillé, depuis les abords immédiats de l’entrée cachée jusqu’au fond de la cellule, mesures, photos, relevés en tous genres, du sol au plafond. La toile de jute était sous scellés, je leur avais également demandé de faire ici ou là des moulages de la paroi. La façon de travailler la pierre pouvait peut-être nous donner des indications sur celui ou ceux qui avaient creusé ce trou. Rien de significatif ou de parlant à cette étape, il fallait analyser, extraire les ADN, tout mettre en ordre pour tenter d’y voir clair… Je comptais sur ce que pourraient nous dire ces détails une fois mis en corrélation avec les constats du légiste, il faudrait attendre un peu. Je jugeai qu’il était inutile de laisser quelqu’un sur place. Nous avions marqué tous les accès de notre jolie signalétique. Nous quittâmes le site un peu après trois heures, le laissant dans la solitude et le silence de la nuit.
Quand Gwendal stoppa la voiture après la barrière, je sortis pour la refermer derrière nous. J’en profitai pour jeter un rapide dernier coup d’œil aux alentours, essayant de deviner le regard du monstre, peut-être caché, ici, là, en lisière, nous regardant quitter les lieux du crime, ses cadavres sous le bras.
V
Le dimanche matin, je me levai doucement, la fenêtre entrouverte sur la vie du jardin ; le voile de tissu blanc ondulant en petites vagues barrait le chemin de ma chambre à un bourdon. J’observais leur jeu quelques minutes. Ça me parut long pour un bourdon, d’habitude plus malin que la mouche, elle-même plus maline que la poule.
Je n’avais pas eu de mal à m’endormir, je n’ai jamais eu aucun souci pour faire la part des choses entre mon métier et le reste, et je ne crois pas me souvenir d’une nuit qui fût agitée par les flashs d’une enquête.
J’avais invité deux amies à déjeuner. J’étais bien décidée à ne pas laisser cette enquête remettre en cause ce rendez-vous calé depuis un moment. Le planning était fixé pour le lendemain à la SRPJ : un point avec mon staff, en fin de matinée, puis les auditions, l’après-midi. Le compte rendu du légiste n’était finalement prévu que pour le mercredi.
Tout marchait un peu au ralenti, soit ! J’allais devoir faire avec – nous avons tous le droit de vivre l’été en léger sous-régime…
Pomponnée à la “citadicampagnarde”, le visage frais et subtilement rosé aux joues, belle comme un cœur, vêtue d’une robe à grands motifs vert pomme, je prenais la direction du marché Saint-Louis, heureuse d’avoir osé le chapeau de paille. J’entendais ma grand-mère me dire qu’il était inenvisageable de sortir en ville sans chapeau autrefois. Alors voilà, j’étais un peu dans la norme d’autrefois.
Presque chaque dimanche à la belle saison, avant de commencer mes zigzags erratiques entre les étals du marché, je m’attable à la terrasse d’un café pour prendre un petit-déjeuner, survoler Le Télégramme, Le Figaro et Libération, en regardant les passants. Ces moments d’habitudes sanctuarisées sont importants à mes yeux, j’en ai quelques-uns dans ma besace, et puis au fil du temps, je les remplace un à un par d’autres. Petit à petit, de nouveaux plaisirs s’enchaînent ainsi à la vie.
Aucun mot dans la presse locale au sujet de la découverte de la veille, tout le monde avait gardé sa langue, ou n’avait tout simplement pas eu l’info avant le bouclage, ça ne durerait pas.
Le maire de Brest passa tout près, je le connais un peu, nous discutâmes un instant.
Sympathique.
Mes courses faites, je rentrai à la maison puis préparai mes assiettes. Nous passâmes un superbe après-midi avec Nadja et Lucile, dans le jardin, assises tout d’abord, pour aborder confortablement tous les sujets de circonstance au fur et à mesure que la carafe de vin se vidait, puis allongées à même l’herbe juste matelassée souple quand tout fut dit, chacune à l’ombre de quelque chose, pour une sieste dominicale absolument délicieuse.
J’aime le dimanche, ou les jours qui en font office quand celui-ci s’est décalé, car, vous vous en doutez, dans mon métier, il n’existe pas de formalisation figée de la semaine, on s’endimanche quand on peut.
La journée s’était étirée d’un même rythme, pleine d’un vide essentiel qui me permit de capter le repos nécessaire pour affronter les trois semaines d’enquête qui allaient suivre.
VI
Reposée donc, déterminée à tout faire avancer très vite, j’arrivai le lundi au commissariat un peu avant dix heures, sans toutefois avoir trop imaginé ce que devait contenir la journée. J’ai toujours considéré que trop préparer son travail rend idiot, ça limite beaucoup l’acceptation de la contradiction, l’empathie pour son équipe et pour son sujet. Selon moi, un officier de police doit avoir une matrice d’esprit rigoureuse, certes, mais surtout pour ce qui relève du procédural, le reste pouvant être abordé avec souplesse et relativité. On n’avance pas enfermé dans le labyrinthe des certitudes, on n’écoute pas, on ne s’écoute pas. Il faut un cadre qui bouge au fil de l’eau sans se déstructurer.
Gwendal était déjà là. Il avait commencé à organiser les premières pièces du dossier, mis tout en bon ordre pour garantir une procédure sans faille. Au vu de la confusion du samedi, il valait mieux agir ainsi.
Tout le monde arriva petit à petit, le briefing commença à onze heures précises, comme prévu, avec Gwendal donc, Antoine et Simon. J’enchaînai directement.
— Bonjour à tous, j’espère que vous avez pu vous reposer un peu hier car on a du pain sur la planche, Messieurs ! Voilà comment je vois les choses : le plus important en attendant les retours du légiste mercredi, c’est d’essayer de découvrir l’identité de ces trois hommes. Les avis de disparition en Bretagne n’ont rien donné, il faut élargir au territoire national ; Simon, tu t’y colles ?
— Ouais.