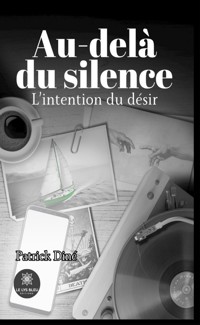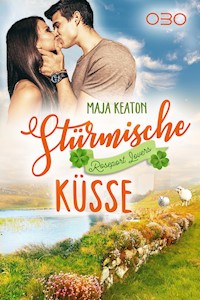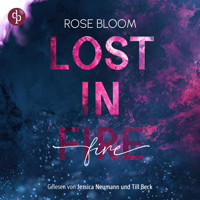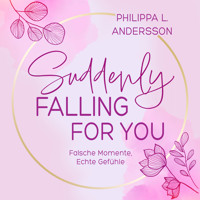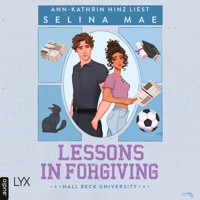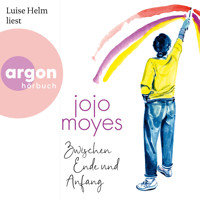Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Condamnée pour homicide, Sandrine fait la connaissance de Karine, une visiteuse de prison. Peu à peu, une amitié sincère et inattendue se forme. Cependant, cet équilibre vacille lorsque Karine rencontre Isabelle, la fille de Sandrine. Cette confrontation révèle une vérité troublante, menaçant de détruire la relation fragile qui unit ces trois femmes. Un secret enfoui depuis longtemps refait surface, ébranlant leurs vies et bouleversant leurs certitudes. Ce passé tourmenté brisera-t-il définitivement leur lien ? Entre non-dits et révélations, chacune devra affronter ses propres peurs.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après la parution de son recueil de poèmes "Pour vous… émois" en 2018 aux éditions Saint-Honoré,
Patrick Diné a éprouvé l’élan d’explorer de nouveaux territoires littéraires en s’orientant vers le roman. Ce projet, né de son aspiration profonde à enrichir son univers créatif, témoigne de sa volonté d’offrir à ses lecteurs une expérience captivante, à travers une plume qui sait toucher et émouvoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Diné
7 m2
(Les innocences coupables)
Roman
© Lys Bleu Éditions – Patrick Diné
ISBN : 979-10-422-5181-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Pour vous... émois, Éditions Saint Honoré, 2018 ;
Yasmyna... une vie derrière le rideau, Le Lys Bleu Éditions, 2023 ;
Au-delà du silence, Le Lys Bleu Éditions, 2023 ;
Le poète de sept ans, Le Lys Bleu Éditions, 2024.
À Sandrine…
Merci d’être passée,
Merci d’être venue…
De m’avoir tant aimé
Et pour m’avoir tant ému.
Prologue
Y a-t-il des innocences coupables… ?
Existe-t-il des culpabilités finalement innocentes… ?
L’innocence est un terme emprunté à une connotation religieuse ancienne qui fonde une composante culturelle encore présente dans nos civilisations occidentales.
Au fil des siècles, elle fut également une « empreinte », telle l’influence d’une marque quasiment indélébile tatouée dans l’inconscient collectif et la spiritualité individuelle des âmes européennes : une sorte d’état de pureté présumée, dans lequel se trouvait l’humain, avant que le Christianisme lui inflige le douloureux symbole du péché originel !
Ce fut autant un repère temporel et une injonction morale, qu’une invention perverse : une caste s’arrogeait la bienséance afin de pouvoir désigner les impies qui n’en faisaient pas partie. L’innocence serait l’état de l’être qui n’était pas souillé par le mal, tel que « l’homme » l’était avant ce péché originel.
Cette doctrine qui persiste après plus de vingt siècles a même désigné « la femme » en tant qu’Être qui a invité et incité l’homme… au péché.
Il fallait un coupable : on en a désigné une !
On a fabriqué l’Être indigne à condamner (il y a « damné » dans le verbe), au nom d’une hérésie intolérante, vis-à-vis de celles et ceux qui ne cherchaient qu’innocemment à s’approprier leur individualité, en osant se rendre eux-mêmes illicites par des pensées reconnues délictueuses et incongrues, face aux opinions admises… ou plutôt imposées !
On est même allé jusqu’à s’inventer des sorcières ; dans différentes cultures les hommes-sorciers guérissent le mal par des remèdes plus ou moins fiables : les femmes-sorcières, elles… le répandent par des magies dont on est sûrs qu’elles rendent malade, en contaminant l’esprit jusqu’à gangrener l’âme !
Et deux mille ans plus tard, après en avoir brûlé et torturé des milliers à partir du XIIIe siècle lors de l’inquisition, voire même avant, on parle de la condition féminine : ne devrait-on pas plutôt évoquer le conditionnement féminin au cours du temps et de l’histoire ?
Ne devrait-on pas réviser la condition des femmes dans le rang social, déconstruire et revisiter le sort qu’on leur a attribué, et définir la destinée qu’on devrait leur offrir après tant d’années d’injustice, où elles ne pouvaient toujours pas voter en France il y a à peine cent ans, et que l’autorité parentale ne fut partagée qu’à partir de 1970 (il n’y a que cinquante-quatre ans), avant de l’avoir appelée « puissance paternelle ». Il était question d’une exclusivité exercée par le « pater familias » (c’était celui qui détenait la patria potestas, c’est-à-dire le pouvoir de vie ou de mort sur ses enfants, sa femme et ses esclaves, qui étaient dits « sub manu », c’est-à-dire « sous sa main »… dans les maisonnées romaines ; le pouvoir absolu sur ses enfants, sa femme et ses esclaves. Autrement dit : sur ses enfants et ses esclaves !).
La condition de la femme…
Le pouvoir inconditionnel des hommes et de leur puissance absolue, mais tellement relative…
Leur impuissance de mammifères à pouvoir s’en débarrasser après plus de vingt siècles de règne… animal, dont ils ont eux-mêmes du mal à se délester après tant d’années d’ancrage !
Voici l’histoire de Sandrine Deulent, femme parmi les femmes… dans un milieu carcéral.
Deulent… « de l’an dix mille » se plaisait-elle à répéter souvent, comme pour faire entendre que son statut de femme, et que celui de toutes les femmes… sera peut-être enfin pleinement reconnu certes…
… mais dans dix mille ans : si tout va bien !
Chapitre 1
« Deulent… parloir : vous avez de la visite ! »
Elle semblait sympa, Karine ; on eut dit dès le départ qu’elle ne jugeait pas. J’étais étonnée que des gens, comme elle, veuillent consacrer un peu de leur temps à d’autres, comme moi ; à des gens incarcérés, à des déviants de la société.
J’étais étonnée que quelqu’un de « bien » comme elle, fasse cette démarche d’aller au-devant de ceux qui ont commis le « mal » irréparable : le mal qu’on ne peut apparemment ni pardonner, ni comprendre sauf lorsqu’on en est autant l’auteur que la victime comme moi.
Elle avait le regard tellement affable que dès le début de notre rencontre, j’avais l’impression de pouvoir me libérer un peu de ma geôle en plongeant dans ses beaux yeux bleus : ils m’invitaient « au dehors », ou m’incitaient du moins à ne pas rester en dedans.
Son timbre m’apportait une douceur si rare que j’avais l’impression de ne plus entendre les mots, hormis celle que je gardais dans mes rêves, si toutefois il est encore possible de rêver en prison, ou celle de ma fille Isabelle, lorsqu’elle venait me voir.
Moi, je réussissais à préserver cette part de rêveries, car elle était ma seule évasion possible. Mais rapidement, Karine devint au fil du temps et de ses nombreuses visites, une sorte d’échappatoire régulière ; une porte de sortie dans cet univers clos, avec ses bruits de serrures pleines d’échos de plus en plus insupportables dans mon quotidien. Grâce à elle, je m’échappais de ma prison ; du moins de celle que la société a créée pour punir ses déviants.
Mieux que quiconque parmi toutes les personnes que j’ai connues, elle savait se « rendre » à l’écoute ; je devrais dire se « donner » par son écoute attentive. Une forme d’altruisme inconditionnel, de par sa condition de femme libre… libre de penser, et libérée par son courage à être authentique, dans l’harmonie dont elle s’empourprait afin de farder ses épanouissements.
Moi, j’étais enfermée ; elle… elle était ouverte : elle avait su se construire indépendamment de ce qu’on demande encore aux femmes aujourd’hui. Insoumise, elle était le cumul de ses choix, l’accumulation des contraintes dont elle avait eu le courage de se libérer.
Dès le début, je l’ai aimée sans vraiment m’en apercevoir : j’avais cru seulement l’apprécier, mais ce que j’appréciais, c’est le fait qu’elle me redonnait le goût d’aimer quelqu’un de nouveau !
Elle me suscitait l’envie d’un renouvellement dans les rites de ma quotidienneté : le quotidien en prison est un ensemble de rythmes réguliers, restreint par des habitudes limitées et la répétition compulsive de repères dont on ne peut faire fi, car ils nous permettent de tenir le coup.
C’est ce qui fonde l’emprisonnement de l’esprit, et pas seulement l’incarcération du corps !
On apprenait à se connaître au fil de ses visites, elle venait une fois par semaine et m’apportait un peu d’air du dehors… celui que je ne pouvais plus respirer, sauf à travers quelques barreaux d’acier, ou entre quatre hauts murs, lors des heures de promenade dans la cour.
Durant tout le reste de mon incarcération, elle est venue chaque vendredi sans faillir, pendant de nombreuses années : elle devenait mon amie, ma confidente, presque une sœur alors que j’étais fille unique… comme on dit !
Je me sentais effectivement unique en mon for intérieur, tellement j’ai toujours tenu à cultiver ma singularité, mais jamais je ne me suis vraiment sentie la fille de mes parents, même s’ils étaient assurément mes géniteurs. Je n’ai d’ailleurs jamais trop su pourquoi ; peut-être est-ce parce qu’ils m’ont donné la vie que je ne voulais pas, puis une existence que je n’ai jamais appréciée : dès le début, j’ai senti que je n’avais pas le désir de naître ! Ma mère me reprocha souvent une grossesse longue et tardive, puis un accouchement difficile et douloureux : je ne voulais pas sortir, disait-elle. Elle n’a jamais compris que je ne voulais simplement pas venir !
Elle m’avait raconté que j’étais le fruit de leur rencontre : l’amour les avait rapprochés lorsqu’ils étaient très jeunes, et de la naïveté des cœurs, j’ai été conçue très vite quand elle eût dix-neuf ans, et mon père tout juste vingt. Elle disait que j’avais été « fabriquée » un peu trop tôt, et beaucoup trop vite dans la fougue des passions du corps : c’était à mon avis pour cela que j’ai tardé à naître ; il fallait venir le plus tard possible… au monde. Un enfant précoce est un enfant qui est né avant le terme : moi, j’ai été conçue si précocement, que j’ai dû m’obliger à naître tardivement, car il fallut déclencher l’accouchement tellement je devais me retenir moi-même d’arriver parmi mes semblables auxquels je n’ai jamais eu envie de ressembler du tout, sans trop savoir pourquoi.
Tout cela, je le racontais à Karine qui finalement, au cours de ces nombreuses années, a passé plus de temps à m’écouter qu’à me parler : on eût dit qu’au départ, elle venait pour me connaître, et qu’au fil du temps, elle revenait pour me comprendre.
Elle acceptait de considérer progressivement au fil des échanges et du temps, que malgré ma transgression, j’avais une part d’innocence qui venait en tout cas questionner son pardon, après avoir entendu mon histoire.
Certains appellent ça des circonstances atténuantes, mais en fait rien n’atténue : par contre, tout s’explique !
Chapitre 2
Dès notre deuxième rencontre, j’ai commencé à me présenter à elle. Je lui expliquais ainsi, sans trop m’en rendre compte, mon parcours et tout mon cheminement. Je lui racontai que j’étais la maman d’une fille, Isabelle qui avait à ce moment-là vingt-quatre ans, et qui venait me voir elle aussi, autant que l’autorité carcérale ne nous l’autorisait.
Elle était née rapidement d’un mariage lorsque j’avais vingt ans. Une union qui avait rapidement capoté deux ans après, et qui aboutit à un divorce à l’amiable. Comme mes parents, j’étais allé un peu trop vite dans mes choix et mes décisions : pourquoi faut-il toujours reproduire ce que ceux à qui on n’a pourtant pas envie de ressembler ont commis ? Peu importe… mais comme beaucoup, j’avais perpétué la tradition familiale, alors que je ne souhaitais à ce moment-là, qu’à m’en défaire en quittant hâtivement ce milieu. Et pour cela, je me suis mariée rapidement ; j’ai voulu m’éloigner… et pourtant, je me suis rapprochée de ce qu’ils avaient eux-mêmes fait, comme par répétition !
J’eus l’opportunité de pouvoir rencontrer un homme un an plus tard, après mon divorce, lorsque j’avais vingt-trois ans, et Isabelle, trois : Dany. Il devint le « beau-père » d’Isabelle, comme on dit : faut-il croire que certains sont laids ?
En tout cas, celui-ci devint un jour… l’horreur de ma vie !
Dany l’accepta facilement et la considérait comme sa fille : une jolie petite fillette de trois ans qui appréciait ce nouveau venu dans notre vie affective, d’autant plus que son véritable père la voyait de moins en moins, et se rendait plus distant, même lorsqu’il l’accueillait chez lui lors de ses droits de visite. Elle avait besoin d’une présence masculine étayante pour compenser l’absence de son papa, et comme Dany assumait merveilleusement bien cette fonction compensatrice, nous décidâmes rapidement de vivre ensemble, ce qui renforça l’éloignement de son véritable père. Il ne supporta pas de me voir refaire aussi bien ma vie, tandis que la sienne stagnait dans ses domaines professionnels et amoureux.
Les années passèrent et Isabelle reconnaissait de plus en plus Dany comme son papa, plus que mon ancien mari. Lui l’aimait comme sa propre fille, et envisagea rapidement de lui offrir un « demi-frère » ou une « demi-sœur » : moi, j’avais envie d’un second enfant… en entier !
La destinée ne put nous permettre de réaliser ce projet : des analyses révélèrent la stérilité de Dany. Il se doutait déjà de ce fait, n’ayant pas réussi à faire un enfant avec une précédente compagne, mais aucune confirmation médicale ne lui avait encore imposé cette fatalité : il ne pouvait pas faire d’enfant !
Nous ne désirâmes pas passer par les protocoles médicaux permettant de régler cette situation. Dany, qui avait si facilement adopté Isabelle, envisageait adopter un autre enfant, mais j’avais du mal à concevoir d’élever ce qui n’aurait pas été le fruit de mes entrailles. Finalement, Isabelle resta ce que ma jeunesse avait connu : une enfant unique, et elle ne semblait pas souffrir de cet état de cause. Mais là aussi, une certaine répétition s’opérait…
C’est à elle que nous donnions tout notre amour, elle n’avait pas le souci de devoir le partager avec quelqu’un d’autre, mais nous veillâmes à lui donner le goût de l’échange en invitant souvent ses copains et ses petites copines à la maison, afin de ne pas faire de sa condition présente, un handicap social ultérieur.
Je veillais ainsi à ne pas recréer là aussi la réitération de mon passé : j’étais enfant unique et solitaire, et partager la misérable ambiance familiale avec un frère ou une sœur ne me tentait pas, car il aurait été plus difficile pour moi de devoir la subir à deux. J’étais plutôt solitaire, et n’avais pas la vocation à me confier à quelqu’un d’autre, tellement j’avais déjà du mal à me parler à moi-même. J’aimais assumer seule ce qui pouvait me faire défaut, ou du moins créer l’impression du manque dans mes espoirs innocents… innovants et parfois naïfs. C’est pour cela que j’ai eu le courage, et peut-être le tort d’oser régler « cette histoire » à ma manière jusqu’à commettre l’irréparable… lorsque j’ai dû constater un jour, qu’il n’y avait plus rien à réparer : quand c’est foutu… c’est foutu !
Karine avait donc au début quelques éléments afin de reconstituer le puzzle morcelé de mon parcours : elle savait que j’avais 44 ans, que j’avais eu un enfant à 20 ans ; que j’avais commis un homicide à 37 ans lorsque ma fille en avait 17, dans cette étape où l’adolescence encore un peu naïve, et la maturité adulte se confondent pour se défier, afin d’imprégner dans l’âme, un début de dualité dans une même chair, dans laquelle s’immiscent les élans d’une sexualité encore naissante.
Elle avait donc conscience que cela faisait sept ans que j’étais dans ce milieu carcéral, dans lequel seule ma propension à la solitude était comblée.
Pour le reste, tout était compliqué !
Karine se présenta à moi, probablement pour tenter de me mettre en confiance : mais qui était cette personne qui avait envie de passer un peu de son temps libre dans une prison, pour permettre à quelqu’un comme moi de pouvoir s’échapper un peu… du moins de mon quotidien ?
Elle me raconta qu’elle avait été récemment licenciée de son job : elle était caissière dans une grande surface. Une restructuration entraîna une compression de personnel. Elle faisait partie des derniers arrivés, elle se retrouva parmi ceux qui furent « remerciés ».
« Tu parles d’un remerciement… ! » me disait-elle dépitée. La formulation est effectivement inappropriée jusqu’à en devenir perverse !
Elle avait besoin d’occuper son temps et de se sentir encore « utile », même si elle était avant tout « utilisée » dans le cadre de son précédent emploi dans lequel on congédie les gens pour les remercier ; ou alors on remercie les gens en les congédiant !
« Prenez-le dans le sens que vous voulez, ça marche dans les deux cas ! » osait-elle dire avec un sourire approximatif, mais insoumis dans l’idée de devoir se résigner à sa destinée.
Elle ne croyait pas au hasard Karine, elle ne voulait pas s’en remettre au destin : elle me confia dès le début de notre rencontre qu’elle pensait néanmoins que ce n’était pas pour rien que notre rencontre s’opérait, et que si nous cherchions à faire autant connaissance l’une de l’autre, c’est qu’il devait y avoir une raison dont nous ne pouvions pas encore être conscientes.
Et l’avenir lui donna raison : deux voies comme les nôtres ne pouvaient que se rencontrer afin de ne faire plus qu’un chemin commun dans nos pensées. Il n’y a jamais de hasard dans la destinée des rencontres, mais encore faut-il savoir déchiffrer ce qui amène deux êtres à se croiser pour se rapprocher un peu plus tard.
Faut-il croire que c’est le contenu singulier de son histoire, et la teneur originale de la mienne qui ne pouvaient que s’harmoniser ?
J’en suis aujourd’hui convaincue !
Chapitre 3
Elle me raconta son histoire, un peu comme pour ne pas m’obliger trop rapidement à devoir lui narrer la mienne : elle ne voulait pas me brusquer, et devait se dire qu’en se dévoilant devant moi, elle me mettrait en confiance pour que j’ose plus facilement me confier un peu plus tard.
Les visites dans le milieu carcéral ont cet avantage que l’on ne retrouve pas forcément dans la quotidienneté extérieure des relations : elles font fi de la banalité des propos. Lorsqu’on voit peu de personnes, on va droit à l’essentiel, même lorsqu’on ne sait pas trop quoi se dire… c’est pour cela que parfois, l’essentiel est dans le silence !
Karine savait toujours offrir la répartie : elle était tellement spontanée qu’elle avait la réplique rapide, et elle était tellement en quête d’exactitude, qu’elle avait toujours le propos juste et précis. Elle me mettait en confiance naturellement, sans finalement chercher à le faire trop sciemment : elle me laissait le choix entre le fait de m’ouvrir à elle, ou de me préserver dans une retenue qu’elle tolérait parfaitement. Mais elle était tellement naturelle qu’elle suscitait simplement le désir de la confidence, jusqu’à m’exposer à des aveux dépassant même les non-dits de mes introspections. On va toujours un peu plus loin dans sa réflexion lorsqu’on ose la confronter à celle de l’autre, elle nous permet des regards plus nuancés, là où l’on invitait notre vision à une cécité relative dans nos pensées sombres, et parfois obscurcies par le déni ou l’illusion.
Elle avait vingt-sept ans, me confia-t-elle. C’était une très jolie femme, avec l’esthétique d’un mélange harmonieux d’assurance et de timidité. Elle semblait suffisamment assurée pour me mettre en confiance, et suffisamment réservée pour ne pas m’amener à l’appréhension d’une intrusion potentielle, envahissant l’intimité dont j’avais encore besoin face à une inconnue. La communication passait naturellement, au début par des sourires avant tout, des regards sincères, des intonations chantantes. Puis, au fil du temps… par la profondeur des petites phrases qui s’amplifiaient d’elles-mêmes lorsqu’elles me revenaient toutes seules un peu plus tard, au détour d’une pensée ou par le biais d’une réminiscence instantanée, ravivant une sensibilité croissante lorsqu’elles réapparaissaient en moi.
Voilà ce que j’appréciais des échanges avec Karine : ils laissaient en moi une trace possible, et me permettaient de prolonger nos discussions en les poursuivant seule, lorsqu’ils surgissaient sans que mon intériorité n’ait à faire appel à ce qu’on s’était dit. Karine avait installé la présence de sa nature en moi lorsqu’elle n’était pas là, et lorsque je ne pensais pas à nouveau aux propos que nous avions partagés, c’était simplement à elle que je songeais. Elle était reliée à moi, laissant ainsi présager une amitié possible, au-delà de ce que j’avais conçu lorsque je fis la demande de pouvoir bénéficier de la visite de quelqu’un qui se propose toujours bénévolement pour une telle démarche.
J’avoue qu’il m’arrivait de plus en plus d’attendre impatiemment sa prochaine visite : elle avait le talent de visiter également mes moments de solitude lorsque je pensais à elle, ou quand je songeais à nouveau à quelques idées que nous avions échangées auparavant.
Elle commençait à faire partie intégrante de mon univers élargi, car l’univers en prison… c’est très petit, et ça n’a pas forcément de firmament la nuit !
Mais parfois dans mes songes nocturnes, lors d’insomnies de plus en plus fréquentes, elle me permettait de mieux rêver jusqu’à pouvoir contempler des étoiles dans l’infini du plafond de ma cellule.
Plus les visites se déroulaient, et plus elle osa se me parler d’éléments de sa vie privée, non pas forcément parce qu’elle souhaitait se raconter, mais simplement parce qu’elle acceptait de répondre à des questions, qui pour ma part, devenaient de plus en plus indiscrètes tellement je me sentais me rapprocher vraiment d’elle. J’avais tellement envie de mieux la connaître que je me permettais de l’interroger sur des aspects intimes qu’elle aurait pu préférer maintenir sur un plan personnel. Mais elle semblait n’avoir rien à cacher, car elle n’évitait jamais mes interrogations parfois un peu trop osées, et je me souviens que c’est lorsque je lui demandai un jour, si elle avait un « petit ami » que je vis pour une première fois, son regard se détourner du mien…
Elle n’esquiva pas la question en me répondant spontanément que non : elle vivait seule, mais je pus constater qu’elle ne répondait presque qu’à moitié, et je ne voulus pas insister, pensant que l’autre moitié viendrait peut-être un peu plus tard, au cas où elle aurait souhaité l’approfondir avec moi. Mais j’avais du mal à croire qu’une jeune femme aussi jolie puisse être seule, à moins me disais-je qu’elle sorte d’une histoire qui vient de se terminer récemment ; de se terminer peut-être mal pour elle, ce qui ne pouvait qu’expliquer pourquoi elle n’avait pas voulu en dire plus lorsque je l’avais questionnée à ce sujet.
Son ouverture d’esprit, sa beauté physique ravivée par une élégance naturelle quelle préservait discrètement, son intelligence, la clarté de son regard franc et la luminosité de ses sourires sincères me laissaient penser qu’elle devait être souvent courtisée, et que sa pudeur devait fréquemment esquiver des avances un peu trop faciles, car elle ne semblait pas frivole et colportait constamment avec elle la propension à se délester du futile.
Les conditions de visite dans le milieu carcéral dans lequel je me trouvais commençaient à s’humaniser de plus en plus : fini les anciennes cabines avec une vitre de séparation, et la voix déformée du visiteur dans le micro. Nous avions droit à une pièce pour les visites, et la proximité d’un surveillant supervisait le bon déroulement des choses, mais l’intimité des échanges était respectée. Ce qui se disait n’appartenait qu’à nous, et ce qui me semblait m’appartenir à nouveau, était la réappropriation de mon humble personne en tant que sujet. À travers la qualité de nos échanges et la limpidité de la prunelle de ses yeux, elle me permettait d’avoir un regard renarcissisé, permettant d’atténuer une dévalorisation qui s’était opérée en moi depuis quelque temps.
Elle redonnait sens à ma vie, et redorait l’image blafarde que j’avais de moi. La confiance qui émanait des ondes diffuses, rayonnant autour d’elle, parvenait à rétablir une assurance qui s’était évaporée de mon être. L’intérêt qu’elle me portait me portait vraiment là où mon esprit avait chaviré sans que je ne m’en aperçoive. J’étais consciente de tout ce qu’elle représentait pour moi, mais elle avait la finesse de me faire sentir que j’étais importante pour elle aussi, qu’elle venait me voir autant pour moi que pour nous, presque autant pour elle que pour moi… dans une démarche altruiste prônant l’échange et l’humanité.
En plus de sa présence, elle m’apportait des tas de petites choses qui font du bien : des chocolats pour adoucir la petitesse de mon espace, des gâteaux afin de sucrer un peu l’amertume de mon emprisonnement, des produits de beauté que je ne mettais plus depuis longtemps et qui me redonnaient l’envie de me faire belle à l’occasion de ses visites et de celles d’Isabelle. Je reprenais plaisir à colorer discrètement mes lèvres et à maquiller modérément mes paupières. Elle me redonnait le goût d’être femme, de me sentir bien dans ma peau, de me ressentir mieux dans ma chair. Sa tendance à vouloir toujours bien faire les choses l’amenait à ne m’offrir que des produits de haute qualité, des produits de marque qu’elle n’achetait peut-être même pas pour elle, suite à sa condition pécuniaire de chômeuse. Mais pour moi comme vis-à-vis du reste, elle offrait le meilleur, tant d’elle que du reste. C’était sa générosité inconditionnelle qui lui conférait ce charme subtil, tellement pur qu’il a le tact de ne pas vous configurer dans une obligation de redevabilité : si le don implique la dette, tout ce qu’elle offrait ne suggérait aucune demande en retour !
Je la louangeais tellement auprès d’Isabelle, que naturellement l’idée qu’elles puissent se rencontrer et se connaître parvint naturellement à nos esprits au bout de quelques mois. Mes parents ne venaient plus me voir, préférant condamner mon passage à l’acte plutôt que de chercher à le comprendre, alors il ne me restait plus qu’elle et ma fille, et chacune des trois avait envie de tenter de constituer une petite famille, du fait que Karine, elle aussi, était plutôt en mésentente vis-à-vis de ses parents. Une mésentente sans conflits, mais avec des rapports limités au strict minimum, et sans grandes affinités. Chacune de nous était enjouée d’une telle idée : Isabelle avait vingt-quatre ans, Karine en avait vingt-sept, elles auraient pu être sœurs… elles avaient envie de le devenir !
Chapitre 4
Les mois passèrent et permirent à Isabelle et à Karine, tout d’abord de se rencontrer : chacune me fit part d’un engouement commun, et d’un désir de donner suite à leur rencontre. Isabelle confirmait les valeurs que j’appréciais chez Karine, et dont je lui avais fait part.
De son côté, Karine était ravie de cette nouvelle amie dont j’étais la maman, et un peu comme une sœur aînée, elle prenait soin d’Isabelle, jusqu’au point de me rassurer que ma fille soit si bien accompagnée… sur l’extérieur. Je savais qu’elle allait pouvoir faire ce dont mon incarcération me privait : veiller sur ma fille, et pouvoir lui offrir une présence constante afin d’intervenir en cas de nécessité.
L’étape des présentations terminée, une relation amicale s’installa rapidement entre elles. Elles s’invitaient au restaurant, se téléphonaient souvent, allaient faire du lèche-vitrine, ou au cinéma. Chacune, au cours de leurs visites respectives, me racontait à tour de rôle ce qu’elles échangeaient. Elles me confiaient leur plaisir de cette union récente, vis-à-vis de laquelle je ne pouvais pas imaginer un tel dénouement, lorsque Karine vint me rencontrer pour la première fois à la maison d’arrêt.
Les visites ne permettent qu’une personne à la fois, et j’avoue que j’aurais apprécié de pouvoir les retrouver ensemble, côte à côte, cœur à cœur…
J’avais écopé d’une peine de 22 ans, j’avais déjà fait 7 ans : il me restait donc 15 ans à attendre afin de pouvoir les retrouver ensemble… à l’âge de 59 ans ! Cette projection m’était pénible, je supposais même que je ressortirais probablement grand-mère si Isabelle faisait un ou plusieurs enfants entre temps.
Entre-temps : le temps… voilà ce qui m’obsédait ! Qui a-t-il entre le temps et l’immobilité, sinon l’attente… ? Qu’est-ce qui existe entre deux secondes, hormis l’impatience abasourdie par le tic-tac effrayant d’une montre ? Je me souviens de ce maudit balancement d’une horloge comtoise chez mes grands-parents, qui comme Brel le racontait, disait oui, disait non… Le temps semble souvent bien long en prison, et « ça dit » toujours non : il faut chercher à s’occuper, ou du moins à occuper son esprit pour ne pas trop penser.
Si la liberté de penser fonde l’individu et sa sérénité, en prison c’est la liberté de ne plus pouvoir penser qui adoucit les songes, tellement ils peuvent se révéler parfois insupportables. Ce sont eux qui venaient au cours de mes insomnies de plus en plus fréquentes, m’empêcher de trouver le sommeil et la quiétude, et qui encombraient le peu de tranquillité que je tentais d’entretenir lors d’instants où des pensées apparaissaient sans vraiment prévenir, afin d’imposer leur charge de ruminations négatives. Moi, contrairement aux bovins qui digèrent les aliments qu’ils ramènent dans la bouche après avoir séjourné dans leur panse, j’avais plutôt envie de vomir ce que j’avais sur le ventre, mais rien n’y faisait : les pensées me tenaillaient les tripes et semblaient bien longues à digérer !
J’avais confié cette difficulté à Karine, tout en la cachant à Isabelle afin de ne pas l’inquiéter : elle m’avait conseillé de m’inscrire dans les ateliers permettant une occupation utile par de petits travaux rémunérés permettant l’achat de mes cigarettes et du minimum vital, malgré la générosité de ma fille, qui elle également, m’apportait tout ce dont j’avais besoin en espérant que je ne manquais de rien, même si elle était consciente qu’en prison… on manque forcément un peu de tout.
Karine m’avait suggéré un jour de trouver une occupation plus artistique à laquelle je pourrais m’adonner même lorsque je me retrouvais dans ma cellule : contrairement à moi, c’était une lectrice assidue et passionnée de littérature. Elle pensait m’orienter vers de bonnes lectures qui lui permirent à elle… de s’évader, en m’apportant des livres qu’elle avait appréciés. Mais rapidement, elle put comprendre que plus que d’évasion… j’avais avant tout besoin de m’exprimer.
Elle me suggéra alors de « passer de l’autre côté » : de lectrice que je n’étais pas vraiment, elle me suggéra d’écrire. Non pas seulement mes « mémoires », mais de raconter mes instants présents ou mes espoirs « à-venir ». Elle se proposait de pouvoir les lire afin que mon écriture puisse aboutir à l’intérêt de quelqu’un qui superviserait son contenu, et donnerait de l’importance à ma fibre littéraire.
J’avoue que l’idée ne m’était jamais venue, et je ne pouvais pas anticiper jusqu’où elle se réaliserait plus tard en faisant autant partie de ma quotidienneté et du sens que j’attribuais à ma vie. Mon existence se réappropriait une valeur essentielle que j’avais un peu écartée au cours de ces sept dernières années : le goût de vivre à nouveau et surtout… de me sentir exister !
Mieux que ça, j’avais la sensation de me sentir non pas seulement en vie, car ceci ne concerne qu’un aspect physiologique de l’être qui se « décomposera » un jour, mais de me sentir vivante… et non plus vivant en prison. De fait, je me « recomposais » grâce à cette idée de Karine, qui finalement était avant tout une invitation à l’art de l’écriture pour ma part, et à celui de me lire en ce qui la concernait, tellement elle désirait se rapprocher encore plus de moi.
Jamais je n’aurais pensé que tout cela m’amènerait à l’élaboration de ce livre, tellement elle sut me susciter le goût d’écrire.
Je décidai de l’intituler : « sept mètres carrés de solitude » lorsque je compris qu’au-delà de l’espace restreint des dimensions de ma cellule, l’écriture allait me permettre de voyager, et de permettre à mon côté solitaire de me relier plus tard à d’autres, sans le savoir, au moment où ils liraient éventuellement mon livre si toutefois l’opportunité de pouvoir le publier se présentait à moi, et s’il pouvait bien sûr intéresser quelqu’un jusqu’à l’idée de le parcourir.
Chapitre 5
Plus que tout ce que j’avais espéré dans l’entreprise de cette démarche, je pus comprendre rapidement que le véritable avantage dans l’écriture de ce livre résidait, non plus dans l’idée lorsqu’elle se cantonne encore à l’étape d’un projet un peu flou, mais au fait de pouvoir raconter concrètement mon histoire. Il m’importait de rétablir des vérités qui, selon moi et mon sentiment d’injustice… ou plutôt d’injustesse qui m’animait, n’avaient pas été prises en compte à mon procès par manque de considérations et d’exactitude.
Bien sûr que mon geste était intolérable, et je ne demandais à personne de me pardonner : j’espérais simplement qu’on le comprenne, et qu’ainsi on me reconnaisse non pas seulement dans mon méfait, mais pour la cause qui m’avait amenée à commettre l’irréparable ; ou du moins l’acte dans lequel il est quasiment impossible de se réparer soi-même après, parce que les pseudo-excuses, que d’autres appellent « circonstances atténuantes », ne pourront en fait jamais nous excuser vraiment !
Je décidai finalement d’intituler mon roman ainsi : « Sept mètres carrés » afin de le rendre plus épuré, peut-être un peu plus énigmatique aussi, et de le commencer ainsi :
Je m’appelle Sandrine…
Tel un préambule à mon histoire : celle qui fit qu’un jour, mes parents durent s’interroger sur un prénom à donner à l’enfant qu’ils attendaient lorsqu’une échographie vint leur confirmer qu’ils allaient avoir une petite fille. Ma mère me confiera plus tard que j’étais une enfant attendue, plus par elle que par mon père, car ce dernier l’aimait certes, mais l’aimait mal.
Elle éprouva rapidement un sentiment de manque affectif en elle : les hommes, à cette époque, étaient trop affairés pour consacrer du temps à leur couple. La culture masculine ne le favorisait d’ailleurs peu : un homme, c’était avant tout fait pour travailler, puisqu’en ce temps-là, peu de femmes avaient l’accès à l’emploi. Il leur fallait avant tout ramener un salaire gagné si péniblement que dès le retour à la maison, le but était de manger et de se reposer, plutôt que d’apporter les éléments qui cimentent un couple : beaucoup de tendresse, un peu de sorties afin d’offrir à celles qui restaient à la maison quelques égayements par le fait d’aller voir un film au cinéma, ou pour le plaisir simple d’un petit restaurant de temps en temps, afin de ne pas demeurer une cuisinière à domicile.
Mais comme chez beaucoup, le salaire ne permettait pas de telles frivolités, la culture ne le concevait pas non plus. J’étais une enfant née dans les années 70 : la révolte culturelle de Mai 68 offrait des perspectives nouvelles, mais on ne parlait pas encore vraiment du statut de la femme hormis dans sa fonction habituelle de maîtresse de maison… ou de « maîtresse » tout court lorsque cela arrangeait. La pilule était arrivée « sur le marché », mais pas encore vraiment dans la tête des hommes lorsque je suis née. On n’avait pas encore mentalement formalisé le fait qu’une femme pouvait avoir un rapport sexuel sans forcément devoir se considérer dans une démarche de procréation. N’en déplaise aux bonnes mœurs et à la pseudo bienséance d’une morale chrétienne qui ne pouvait toujours que concevoir au vingtième siècle, que la maman de Jésus, rejeton du seul dieu respectable qu’elle avait imposé, n’avait pu concevoir son fils que par une intervention divine excluant le péché de chair.
Moi, je considérais déjà à mon adolescence, que c’était pécher que d’accepter d’encombrer son esprit par de telles inepties, et je considérais que la « croyance relative » était moindre par rapport à la « conviction réfléchie » émanant de la liberté de penser ! Plus tard, j’ai eu à me confronter avec des personnes tellement convaincues, et non seulement en tant que simples croyants, qu’elles ne parvenaient même plus à voir jusqu’où l’esprit peut être culturellement conditionné au point de discriminer et discréditer l’autre tout simplement parce qu’il ne pense pas comme elles… sous prétexte qu’il ne sait pas !
Le savoir, ça peut être un piège pour les ignares !
Bref, ils décidèrent de m’appeler Sandrine : la signification de mon prénom vient du grec Sandre, lequel est un diminutif d’Alexandre. Elle veut dire « celle qui repousse l’ennemi » ou « celle qui aide les hommes » : il y est question de repousser pour protéger. J’avais réussi à mêler les deux significations en une seule qui me convenait, tellement je trouvais qu’elle me ressemblait : celle qui aide en repoussant l’ennemi… que chacun colporte en lui, puisque la première personne dont il faut apprendre à se méfier n’est autre que soi-même !
De fait, et très naturellement, j’ai toujours été la confidente de ceux qui avaient des tas de choses à dire, dans l’aveu de leurs plaintes… ne considérant que l’illusion visant à se persuader que la cause de leurs maux ne pouvait qu’être extérieure à eux ! Ma mission était de les sensibiliser au fait qu’ils avaient peut-être une part de responsabilité dans leurs malheurs, en exemptant l’option du bien ou du mal : c’est vous dire combien ont pu m’en vouloir de tenter une approche et une voie différente de ce qu’ils espéraient de moi, lorsqu’ils m’auraient préférée plutôt compatissante et complice. De meilleure amie, j’en devenais la pire ennemie !
On dit que toute vérité n’est pas forcément bonne à dire : elle est sûrement essentielle à exprimer, mais je confirme qu’effectivement, elle n’est pas souvent « bonne » à dire tellement celle ou celui qui la reçoit peut l’entendre avec le filtre de ce qu’il a de plus « mauvais » en lui !
Mais quand je me sens sereine et en harmonie avec moi, je le revendique : oui, je suis une provocatrice, je cherche avant tout à provoquer une réflexion chez l’autre. Il faut parfois oser la dualité avec autrui pour trouver l’harmonie, l’unicité singulière et authentique en nous. Les choses, tout comme les gens, sont ainsi faites.
Bref ! Née Sandrine… celle qui repousse l’ennemi pour aider les femmes et les hommes, je vécus une enfance plutôt heureuse. J’étais née à Saint-Claude en 1979, et nous vécûmes mes six premières années dans un petit village du Jura à sept kilomètres de cette ville. De ces premières années me restent la quiétude du village avec l’impression que tout le monde vous connaît et vous protège par la bienveillance adulte qui reliait encore les gens, en ces temps-là. Ont subsisté des parfums de campagne ; de vaches reconduites à chaque fin d’après-midi, après leur pâture dans les prés, dans les étables pour la traite, et qui n’étaient pas toutes polies, car certaines faisaient caca sur la route ; les effluves de vergers pleins de senteurs de fruits ; le son du clocher rappelant régulièrement l’heure et le fait que le bon Dieu nous surveille à chaque heure du jour.
Toute petite, j’entendais que le petit Jésus coupait la langue des enfants lorsqu’ils racontaient des mensonges, et le tintement régulier du clocher de l’église me rappelait à cette menace !
Je me souviens que nous pouvions jouer dans la rue parce qu’une seule voiture passait chaque heure, et que nous devions éviter les tracteurs plus fréquemment que les automobiles. Je me souviens de l’école, pas loin de chez moi, du mari de la maîtresse qui revenait en fin d’après-midi avec une trique de noisetier pour corriger les mauvais élèves dissidents, de ma petite copine Mireille avec laquelle je jouais tout le temps, de l’ombre rassurante des sapins dans la forêt avoisinante, comme si elle nous recouvrait d’ondes protectrices, de l’odeur agréable de la sève collante, suintant de leurs troncs en été ; de nos vieux voisins, Madame et Monsieur Mérichard qui étaient si bons avec moi et qui m’offraient souvent le pain et le chocolat du goûter lorsque j’étais encore trop petite pour aller en classes ; les têtards foisonnant dans l’eau de la rivière traversant ce petit village, et que je ramenais chez moi pour les voir se métamorphoser tranquillement en grenouilles ; le bruit frais de l’écoulement de la fontaine tout près de ma maison ; ce petit café de village sans flipper ni juke-box, où l’on pouvait jouer aux quilles ; ces chiens sans laisse qui vagabondaient dans la rue sans ne jamais aboyer sur quiconque, hormis ces drôles de machines à quatre roues qui passaient parfois et qu’il fallait signaler par manque d’habitude du bruit des moteurs, et de la drôle d’odeur qui s’échappait d’un pot à l’arrière, avec de la fumée à hauteur de truffe. La vie s’écoulait paisiblement dans cet autre siècle qui ne pouvait prévoir l’accroissement si rapide des technologies ultérieures qui imposèrent aux gens plus tardivement, sans qu’ils ne s’en aperçoivent par le doux conditionnement feutré de la publicité, de devenir de plus en plus des consommateurs passifs, plutôt que des individus engagés à cultiver leur humanité.
La télévision s’était imposée quasiment dans tous les foyers, et plutôt que d’avoir la vocation de cultiver ou de distraire ses spectateurs, elle poursuivait insidieusement sa fonction soporifique : plutôt que d’éveiller les gens, elle les endormait petit à petit en leur créant des besoins pernicieux. La baguette coûtait moins d’un franc, et on m’envoyait acheter le pain à la boulangerie avec une pièce permettant de m’acheter des bonbons avec le reste de la monnaie. Nous étions loin de nous imaginer que quelques quarante ans plus tard, elle vaudrait un euro, donc six fois plus !
J’étais innocente et naïve, je croyais en la beauté inaltérable de la vie et des choses. Je découvrais chaque jour quelque chose de nouveau, et tentais de l’assimiler toujours positivement afin de mieux m’accommoder à la réalité à laquelle on s’adapte toujours tant bien que mal lorsqu’on est enfant. Moi, je m’adaptais souvent plutôt bien avec une stratégie de déni qui perturba ultérieurement ma vie d’adulte tellement elle restera imprégnée en moi tel un réflexe de protection : lorsque quelque chose allait mal ou ne me convenait pas, je m’imaginais renaître à la seconde d’après, en faisant fi du fait… jusqu’à oublier ce qui venait de se produire, et que je ne supportais pas, en préférant le bannir instantanément de moi. J’extrayais l’événement et prélevais la circonstance afin d’en faire sortir la teneur nocive que je parvenais toujours à retirer de mon intériorité mentale, tout comme on peut le faire physiquement en faisant sortir le pus d’un bouton infecté, ou l’écharde s’introduisant brusquement dans la chair. Ma crédulité ne provenait pas du fait de croire à outrance aux affirmations d’autrui, mais de me persuader que mes vaines illusions n’étaient autre que la vérité pure et dure. Elle était pure dans cette option de mécanisme de défense, car quand on est enfant, on se défend comme on peut de ce que le monde a de compliqué et qu’on ne comprend pas. Mais la « mécanique », quand ça s’enraye… ça devient plus dur que pur, car on doit la réparer pour continuer d’avancer. Mon protocole était simple : j’effaçais avec mon annulaire la substance de mon tourment en la localisant symboliquement au creux de la paume de ma main gauche. Je parvenais spontanément à me persuader que j’avais le pouvoir d’abolir ainsi la teneur de ma peine, j’arrivais à me convaincre que j’avais la capacité d’anéantir mon trouble, que j’étais pourvue d’une potentialité quasiment magique d’annihiler l’effet de ce qui venait de me perturber. Alors je balayais de mon doigt le contexte comme pour faire le ménage en moi, et je renaissais instantanément comme si de rien n’était… du moins comme si cela ne s’était pas passé !
Ma propension au déni alimentait l’amnésie dont j’avais besoin : j’oubliais subitement ce qui avait fait frissonner ma chair ! Au-delà d’une renaissance spontanée, je me retrouvais dans une réincarnation protocolaire dans laquelle je restais toujours la même personne, le même sujet d’une même histoire, mais débarrassé de ce qui venait de faire obstacle à mon équilibre et à ma sérénité. Je croyais en l’équanimité, ou du moins j’avais besoin de ce sentiment d’imperturbabilité constante que d’autres pouvaient interpréter parfois, à tort, comme une indifférence. Mais prendre du recul lorsqu’on est encore qu’une enfant qui a besoin d’avancer chaque jour, pas à pas afin de se sentir grandir et plus neutre face aux tergiversations adultes, n’est pas chose facile !
Mon enfance se déroula donc bien, puisque j’étais capable de réduire promptement le mal à néant, jusqu’à m’anéantir plus tard, quand j’eus à comprendre que l’étincelle du souvenir que l’on parvient instantanément à oublier, se stocke dans un recoin du cerveau, pour ne jamais s’éteindre et nous brûler de mille feux un jour ou l’autre : plutôt un jour que l’autre !
Mon adolescence m’avait naturellement amenée à m’intéresser aux concepts de la psychanalyse, et aux pensées de la philosophie : la psychologie m’inculqua le principe du refoulement, et me sensibilisa donc à ceux de ma jeunesse ; la philosophie me sensibilisa aux pensées dépassant le propos courant afin de donner un peu de panache à mes songes, et de me permettre de me singulariser, en me différenciant des autres, parfois dans l’opposition, souvent par détachement.
Mon éducation m’avait inculqué la valeur de l’amour du prochain, ma vie me sensibilisa plus tard, à une forme d’objectivité dont la lucidité croissante m’amenait à penser que tout dépendait « du prochain » : je n’ai jamais aimé inconditionnellement quelqu’un ! J’en suis encore incapable aujourd’hui, et je pense que je ne le souhaiterai d’ailleurs jamais…
Puis, à l’âge de sept ans, mes parents ont déménagé, car mon père eut une promotion en tant que directeur de fromagerie : nous nous retrouvâmes dans le département proche de la Haute-Marne, et je pus connaître une approche différente et complémentaire de mon environnement habituel. De la campagne, je connus la ville : il y avait beaucoup plus de monde, ce qui contrastait avec cette impression d’être connue de tous dans mon petit village de campagne. La ville était grande jusqu’à ne pas connaître par là où l’on rentre dedans, ou repérer l’endroit où on en sort. C’était différent pour moi, l’espace plus large aurait pu me paraître insécurisant, mais j’y voyais là un avantage me donnant l’impression d’accroître tous les possibles : le fait de m’être retrouvée en prison m’a permis en effet de comprendre que plus l’espace est petit autour de vous, moins vous pouvez élargir vos champs d’action. La ville était grande, le nombre de gens autour de moi devenait incalculable et favorisait une sorte d’anonymat. On n’était plus obligé de dire bonjour à quelqu’un qu’on croisait dans la rue, et je trouvais cela autant plus agréable par le fait que ça annulait une contrainte, que dommageable, car ça minimisait la fraternité naturelle que je connaissais parmi tous ceux de mon village. On ne me disait plus dans la rue : « alors, comment va notre petite Sandrine aujourd’hui… » ?
L’école était bien plus grande aussi, et était particulière en ce sens qu’un grillage séparait la cour de récréation des garçons, avec celle des filles. Je ne comprenais pas bien pourquoi : les garçons se courraient après en jouant aux gendarmes et aux voleurs, mais je considérais déjà malgré mes sept ans qu’une gendarmette aurait pu courir après un voleur, voire même un gendarme après une voleuse, car mon esprit de jeune enfant concevait déjà l’égalité entre les deux sexes, et je considérais ce grillage, comme un outrage, car je me sentais offensée dans mon humanité. C’était symboliquement ma première incarcération : j’aurais voulu retrouver « un petit copain » pour parler avec lui, mais ce grillage faisait office de barreau matériel et de limite mentale. On n’osait même pas se parler à travers, de peur d’être déjà considérés comme des impies, des déviants ou des obsédés sexuels précoces. Alors, je le regardais de loin ce petit copain : il jouait aux billes et aux osselets avec ses camarades dont j’étais un peu jalouse parce qu’ils me le volaient. Quitte à le voir courir, j’aurais préféré que ce soit après moi !
Je me souviens de la baguette de noisetier du mari de l’enseignante, lorsque j’étais encore dans mon village, réservée pour les cancres en fin d’après-midi, lorsqu’elle lui désignait dès son arrivée l’élève à sanctionner par un ou deux coups de trique, ce qui entraînerait de nos jours un procès d’office ! Le directeur de ma nouvelle école, lui… s’appelait Monsieur Klin : un grand sec d’une cinquantaine d’années qui ne souriait jamais. Après la cloche qui sonnait la fin de la récréation, il arrivait. Nous étions rangés par deux : un coup de sifflet pour poser la main droite sur l’épaule de celle qui était devant nous afin de prendre les distances. Moi… de la distance, j’en prenais surtout vis-à-vis de ce genre de protocole puant encore l’ancien temps. J’avais l’impression de vivre dans un temps auquel je n’appartenais pas ! Un second coup de sifflet de notre mélomane autoritaire pour poser la main gauche sur l’épaule gauche de celle de devant ; un dernier coup de sifflet pour reposer nos mains sur nos hanches, les bras bien droits afin de suivre l’enseignant, chef de ces files bien alignées pour remonter « en classe ». Des classes… effectivement comme à l’armée ! Des classes, sans grande classe en effet, si je m’en réfère au côté hideux que je lui prêtais, derrière ses allures de général, jubilant du pouvoir sonore de son sifflet, et de cette stature où je l’invitais mentalement en silence à apprendre la musique avec un véritable instrument à vent, plutôt qu’à travers cette maudite petite bille qui rythmait le cérémonial de réintégration des cours ! Mais lui… il préférait jouer la sérénade de son autorité, il avait l’art d’être un vrai con : c’est vrai qu’il en existe des faux… !
J’avais quelques copines, et contrairement à celle des garçons, la cour de récréation des filles était plus calme : ça courait moins, ça criait peu, ça ne se battait quasiment jamais. Nous étions plus dans le plaisir de parler entre nous, de nous confier nos petits secrets de fillettes, témoins que « le sexe d’en face » était plus turbulent que nous. Mais nous considérant un peu trop sages, j’avoue que nous les envions un peu. Nous osions parfois nous polariser sur un garçon, en l’observant discrètement afin de ne pas passer pour des voyeuses, tellement ce système peut créer de lui-même de la culpabilité, ou du moins l’impression de fauter, alors que notre Apollon attirait notre attention tout simplement parce qu’on le trouvait plus gentil et plus calme que les autres. C’est à travers ce drôle de contexte où la discrétion était de mise, que j’appris à observer les autres à travers leurs attitudes et leur comportement. Parce que nous ne pouvions pas nous parler, parce que nous ne nous autorisions même pas à converser à travers ce maudit grillage par crainte d’un péché, tellement la notion chrétienne imprégnait encore la bonne morale laïque de l’école publique !
Alors, j’apprenais à observer…