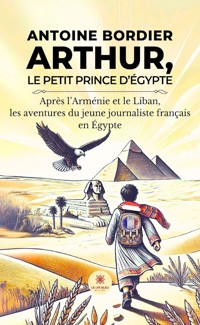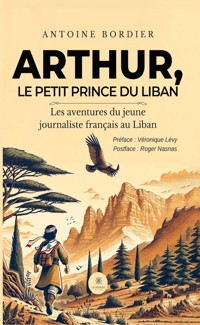
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une petite fille dénote avec sa jolie robe rouge et son t-shirt blanc sur lequel flottent les couleurs du drapeau du pays des cèdres. Quelle beauté, quelle fraîcheur, quelle innocence ! On dirait une fée colorée qui se faufile entre les camions, les voitures et les scooters. Elle me fait penser à Esmeralda, devant Notre-Dame de Paris. Elle danse. Elle me regarde en souriant et me parle. Je lis sur ses lèvres : “Soyez le bienvenu au Liban. Vous allez aimer la Perle du Levant”.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Écrivain-journaliste-voyageur,
Antoine Bordier a découvert sa passion pour la littérature dès son enfance en Afrique de l’Est. En 2021 et 2022, après des débuts dans le journalisme et diverses expériences en finance et dans l’entrepreneuriat, il séjourne en Arménie pour développer ses activités de conseil et de communication. Il y écrit son premier roman, Arthur, le petit prince d’Arménie, paru aux éditions SIGEST. En 2023, après des voyages au Liban, il termine la rédaction de cette deuxième œuvre littéraire, dans le cadre de sa trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoine Bordier
Arthur, le petit prince du Liban
Les aventures du jeune
journaliste français au Liban
Roman
© Lys Bleu Éditions – Antoine Bordier
ISBN : 979-10-422-3620-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Préface
Avec Arthur, le petit prince du Liban, Antoine Bordier signe le deuxième acte d’une épopée fantastique. Il nous enlève en deçà de l’histoire officielle, au cœur de sa genèse, et de son articulation, au lieu de sa gestation, avant que la violence du monde n’infléchisse sa trajectoire vers la mort…
Tisser la paix. Tel est l’appel du chevalier Arthur, sa quête, son Graal, son combat.
Arthur de La Madrière est orphelin. Il a vingt ans. Ce jeune journaliste abrite une identité mystérieuse : il est le compagnon d’un aigle royal, Aroso. La reine Anahit l’a sacré petit prince d’un royaume accompagnant silencieusement le nôtre, de sa nuée lumineuse… Le royaume d’Heradis.
Mais en deçà du verbe virtuose, tourbillonnant, sous l’écriture virevoltante d’un conte moderne, couve une énigme, clef sertie au corps du récit. Braise incandescente, une autre conception affleure. Arthur est le pèlerin convoqué par-delà le tissage du langage, par-delà l’espace et le temps, en ce lieu ultime où parle l’éternité, où elle se dit, nous épelle car dans ce triptyque littéraire, trois trames s’entrelacent : celle du mythe se tresse au tableau historique. Elle fait irruption dans la chair narrative, dévoilant soudain, la tapisserie ultime : l’Ordre mystérieux, soulevant l’espace, le temps, réorientant l’histoire, vers sa guérison. Et son accomplissement.
Dans l’ombre des pas des héros mythologiques, avant d’affronter la grande convocation surnaturelle, Arthur de La Madrière revient au château familial, en terre d’Anjou, berceau ancestral. Il est la fine fleur d’une sève de haute lignée, fleur vive de la tradition chevaleresque la plus pure. Mandaté pour une nouvelle mission, il reprend les armes. Il est appelé au Liban où coulent le lait et le miel des cèdres millénaires, mêlés au sang des martyrs de la guerre. Il y est dépêché par son journal, Le monde des bonnes nouvelles, pour y lancer sa version orientale. Ce titre étincelle, telle une arche de paix, au milieu du risque de la guerre, de l’effroi, de la dévastation, des cendres et des ruines.
Gracié de dons surnaturels, Arthur remonte le temps. Il sauve le port de Beyrouth de l’anéantissement et empêche l’escalade de la guerre civile de 1975-1990.
Mais avant de rejoindre le Liban, Arthur s’envole pour l’Arménie, dans le Haut-Karabagh où gronde la menace d’un nettoyage ethnique. Là, il accomplit des miracles, restitue à l’Arménie ses terres d’antan. De nouveaux chefs d’État reconnaissent ses frontières ancestrales. L’hémorragie du sang de ses enfants, de ses martyrs, convoque et infléchit le cours de l’histoire, et la guerre se résout pour 1000 ans. La mission d’Arthur est couronnée par la reine Anahit, à l’immense banquet où l’histoire est conviée, retissée au canevas de la paix.
En même temps que l’onction de chevalier du royaume d’Heradis, Arthur a reçu le don d’ubiquité. Il traverse le maillage de l’écriture des hommes et ouvre le sceau d’un autre royaume. Il n’est pas de ce monde, mais le porte vers sa transfiguration. Les cœurs purs le devinent.
Pour eux, pour eux seuls, il se dévoile.
Arthur ressemble au petit prince de Saint-Exupéry, réfugié d’une planète invisible, gravitant aux interstices de l’histoire, réparant ses manquements, ses blessures, portant la voix des vaincus afin que les scribes ne recouvrent pas leurs cris, de la geste officielle et glorieuse des vainqueurs.
Errant chérubinique, Arthur est aussi Sinbad le marin, chevauchant mille et une nuits initiatiques. Au bout de l’ultime nuit, celle de la guerre totale, celle de la barbarie, celle de l’inhumanité, surgit l’outre-monde d’une naissance, nouvelle aube, graciée. Dans la paix.
Le nouveau roman d’Antoine Bordier s’ouvre sur cette vision : la flèche de la cathédrale de Chartres transperce le ciel pour y planter la foi. Enveloppant l’arche silencieuse, arche des supplications et de la litanie des pauvres, le voile de la Vierge déploie l’histoire. Arthur prend le large. La flèche de la cathédrale enflamme le Ciel et tisse, de clocher en clocher, le martyrologe des saints. Elle s’enlace à la flèche de Tsitsernakaberd, mémorial du génocide arménien, à Erevan.
Marie est l’espérance des damnés de l’Histoire. La consolation des réprouvés et celle de ses martyrs exultent en son Magnificat. Pour Arthur, la reine Anahit est sa manifestation.
Le soleil s’élève à l’Orient, l’aigle immaculé, Aroso, fixe son cœur de flammes. Il emporte Arthur, vers son appel, sa vocation. Au Liban, être un artisan de paix, le chevalier de l’ultime combat. Et aux portes du Royaume, Arthur murmure la devise inscrite sur les armoiries familiales : « Au fil de l’épée, l’épreuve nous rend plus forts. »
Véronique Lévy1
1
Préambule
Ce 28 mai 2021, il est 9 h, quand mon avion atterrit sur le tarmac de l’aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle. Alors que je récupère mes bagages, je relis la lettre de la reine Anahit :
Chevalier Arthur, mon petit prince,
L’Arménie est un message de paix, d’unité et de valeurs. Son peuple martyr est debout, il se souvient et regarde vers l’avenir. Il se souvient de vous. Et nous qui sommes leurs gardiens, allons leur redonner l’espoir. L’Arménie a besoin de vous, de sa diaspora du monde entier, pour l’aider à construire la nouvelle Arménie dont elle rêve. Ce sera votre prochaine mission.
N’oubliez pas !
Vous qui êtes le dernier chevalier du Royaume d’Heradis, le petit prince d’Arménie.
À bientôt,
Reine Anahit
Je la relis une troisième fois. Comme si je doutais, encore, de ce que j’avais vécu. Comme si cela n’avait jamais existé. Un rêve. Un rêve de ce monde merveilleux, qui a fait de moi son petit prince. Un rêve…
Comme je suis heureux. Je vais retrouver mes grands-parents, Hubert et Elisabeth, mes oncles et tantes. Je pense, particulièrement, à Jacques et Jean. Je pense à mes frères et sœurs, Joseph, Marie, Pierre, Sophie, Gabriel et Sarah. Mon Anjou familial, mon petit château niché dans son écrin de verdure, avec ses bois, son lac, sa petite rivière. Je vais revoir mes amis. Mon cœur palpite. Je pense à mes parents. Comme, ils me manquent.
Je sors de mes pensées quand je vois mes bagages arriver. Deux valises, dont l’une est remplie de cadeaux et de souvenirs arméniens.
À la sortie, rien à déclarer. Enfin, presque, car je ne suis pas seul. J’ai dans mes bagages ce minuscule petit aigle qu’Aroso m’a confié juste au moment où je montais dans l’avion. Il y a, aussi, cette petite licorne, cadeau de la reine Anahit. Et ce petit perroquet. Ils sont tous invisibles aux yeux du monde. Et ils sont comme miniaturisés pour entrer dans mon sac à dos. C’est magique. Dès qu’ils en sortent, ils reprennent leur taille normale. Donc, je n’ai rien à déclarer. Mais je tiens fortement fermée la poche de mon sac. Car, je les sens remuer à l’intérieur. Je suis les seuls à voir ces trois petits anges gardiens qui viennent d’Heradis. Je vais, bientôt, vivre des aventures incroyables avec eux…
Je sors, enfin, de la salle de débarquement. J’emprunte un long couloir et, là-bas, de l’autre côté, derrière la barrière douanière, ils sont tous là : mes grands-parents, mon oncle Jacques (mon oncle Jean est resté au château), mes frères et sœurs.
Sarah et Gabriel, les deux plus petits, ont échappé à la vigilance des plus grands et se sont mis à courir vers moi. Ils ont réussi à passer le portillon de sécurité, et à esquiver le policier en faction, qui essaie de les rattraper. Ils bousculent un ou deux passagers et se jettent sur moi. Je tombe à la renverse. Nous éclatons tous les trois de rire sous les regards, à la fois éberlués et enchantés, des autres passagers.
Nous restons à terre une longue minute à nous câliner et à nous embrasser. Puis le policier m’aide à me relever.
Gabriel, qui a fêté ses 7 ans le 1er mai (Sarah ses 5 ans le 13), répond d’abord :
Sarah m’agrippe fortement la main et regarde bizarrement mon visage.
Une glace est juste derrière-moi. Je regarde mon front et je vois cette marque que je n’avais pas auparavant. Elle est à moitié cachée par mes cheveux qui forment une grande mèche. Je distingue une sorte de A majuscule.
Après les embrassades de mes autres frères et sœurs, de mon oncle et de mes grands-parents, nous mettons une heure pour sortir de l’aéroport. Direction Paris, où nous allons passer deux nuits avant de partir pour l’Anjou, pour le château de La Madrière. Il est situé dans le village du même nom, à une demi-heure au sud-ouest d’Angers.
Nous dormons tous chez oncle Jacques, un ancien navigateur de haut vol. Son appartement est suffisamment grand pour loger une dizaine de personnes. C’est un triplex. Il est situé aux trois derniers étages, avec ascenseur, d’un immeuble haussmannien de l’avenue de Suffren, au numéro 13. Cet endroit de près de 300 mètres carrés, avec ses 7 chambres, est majestueux. Il ressemble à la proue d’un navire posée sur les toits de Paris.
Mon oncle, qui est à la retraite depuis peu, est un ancien pilote de chasse et un ancien navigateur. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, en avion et en bateau. Il a 67 ans. C’est un vieux célibataire endurci. Avec sa barbe blanche, qui arrondit un visage carré surmonté de ses yeux verts rieurs et d’un front massif, il ressemble vraiment à un vieux loup de mer. Il a pris l’habitude de toujours porter sa casquette bleue, à l’extérieur, comme à l’intérieur. On l’appelle le Capitaine Haddock, car il dit souvent de gros mots. Mais il a un grand cœur.
Sa casquette bleue ? Elle lui a sauvé plusieurs fois la vie. Fabriquée en Asie, dans un lieu qu’il a toujours voulu garder secret, elle est sur mesure. Sa matière est une toile en coton ultra-maillée, mélangée avec une fibre en toile d’araignée, qui lui apporte une résistance supérieure à celle du blindage. On peut y voir, d’ailleurs, quelques traces de balles, qui n’ont pas réussi à percer son blindage. À tel point que lors de son naufrage en 2012, dans les mers des Philippines, lors du super-typhon Rao, son navire, la frégate amirale Dugay-Trouin, a été balayé comme un fétu de paille. Il avait réussi à sauver tout son équipage avant de guider son bateau vers une crique où, seul, il a fait naufrage. La vitesse des vents du typhon a été tellement puissante (supérieure à 200 km/h) qu’une partie du radar s’est décrochée et a atterri à ses pieds en touchant sa tête. Sans sa casquette, la pièce du radar s’y serait enfoncée. Elle n’a fait que rebondir.
C’est la sonnette de l’ascenseur. Nous sommes arrivés au 5e étage. Aucun voisin à l’horizon. Son appartement démarre au 5e étage, puis continue au 6e et au 7e. Il n’a pas de voisin. La double porte d’entrée s’ouvre. Et je revois avec ravissement la pièce qui ressemble au hall de l’hôtel du Louvre, place André-Malraux, dans le 1er arrondissement de Paris. S’y mélangent les œuvres d’art rapportées de ses nombreux voyages en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Il y a des statues en bronze et en terre cuite. Il y a des marines et des maquettes de voiliers. Il a une copie de la goélette de Jacques Cartier, la Grande Hermine. Dans le long et large couloir, des mappemondes trônent. Certaines viennent de Londres, où il s’était engagé comme simple matelot dans la Royale. Il n’avait pas 18 ans. Depuis, il en a fait sa collection.
Le parquet craque sous nos pieds. Sarah et Gabriel se mettent à courir devant nous. Ils s’engouffrent dans le couloir de gauche qui se rétrécit et qui mène aux premières chambres. Le couloir de droite desservant la bibliothèque, les deux salons, la salle à manger et la cuisine. Ils sont suivis de près par Pierre et Sophie.
Puis, un jeu de cache-cache s’improvise.
Joseph et Marie n’y participent pas. Ils sont beaucoup plus calmes et plus âgés.
C’est l’heure du déjeuner. J’entends la vieille horloge sonner les treize coups de 13 h. Je fais mine à mon oncle que je suis fatigué.
Tout au fond du couloir, j’ouvre la lourde porte en bois massif. Ma chambre est située à côté de l’un des escaliers qui mènent à l’étage. Sur la porte a été ciselé le mot Tonkin. Au-dessous du nom, une carte sculptée représente ce pays où je rêve de mettre les pieds, depuis ma plus tendre enfance. Je rentre. À l’intérieur… j’esclaffe en riant, car je vois mon petit aigle, ma petite licorne et mon petit perroquet sur la terrasse. Ils se sont échappés du sac. Ils devaient en avoir marre d’attendre. Ils sont en train de regarder la tour Eiffel. Mon aigle s’appelle Tondor, ma licorne Scarlett, et mon perroquet Ara. Il faut que je m’habitue à eux, à leur présence. J’ai remarqué que quand je suis seul, je les vois. Sinon, ils disparaissent. J’imagine qu’ils ont reçu l’ordre d’Aroso, le prince des aigles de la reine Anahit, de se faire des plus discrets.
Aroso ? Il me manque mon grand aigle. C’est un géant ! Il fait près de trois fois ma taille. Ara, Scarlett et Tondor, eux, ont des tailles normales, qui s’ajustent en fonction de l’environnement.
Dans ma grande chambre tonkinoise, je tombe littéralement sur mon lit. Et je m’endors d’un seul trait.
Une demi-heure plus tard, je me lève en sursaut. On tambourine à ma porte.
J’ai reconnu la voix de Joseph. Je me lève d’un bond. Je regarde par la fenêtre restée entr’ouverte. Les amis d’Heradis ont disparu.
Je regarde de nouveau par la fenêtre. Je l’ouvre en grand et monte les marches de la grande terrasse, à, l’étage supérieur, personne. Les amis d’Heradis se sont, bel et bien, éclipsés. Je ne m’inquiète de rien.
Dans la salle à manger familiale, la grande table ovale est dressée. Elle peut contenir une vingtaine de convives. Cela tombe bien, nous sommes douze. Nous avons de la place. Pour me faire plaisir, mon oncle a fait préparer par Georges des plats typiquement arméniens. Georges est un peu son protégé, son alter ego. D’ailleurs, il l’a adopté juste avant de quitter le Vietnam. Il l’a recueilli aux portes de la ville, quand il était un jeune aspirant, en avril 1975, au moment où il a dû quitter Saïgon. Jeune officier de Marine, oncle Jacques travaillait comme aide de camp à l’ambassade de France. C’était le seul Français qui restait, en tant que militaire. Il y en avait d’autres, mais c’étaient des journalistes. Il avait été choisi parce qu’il parlait plusieurs langues, comme le vietnamien, le tay et le chinois. Il s’est occupé de Georges, devenu orphelin, après avoir perdu ses parents lors d’un attentat, qui a eu lieu au moment où l’armée de libération entrait dans la ville.
Georges a 17 ans de moins que mon oncle. Ici, c’est l’homme à tout faire. Mais il est plus que cela. C’est l’ami, le confident, le grand frère. Il a des doigts d’or. Il sait tout faire. Il est un cuisinier hors pair. Il déjeune, d’ailleurs, avec nous. Je lui adresse la parole.
Je me lève, un verre rempli de Karas, le célèbre vin d’Armavir.
Un silence traverse la pièce, tous me regardent.
Gabriel et Sarah se sont levés de table. Leurs chaises tombent à la renverse.
Tous m’applaudissent. Les questions fusent. Le brouhaha familial monte d’un cran. Les plats typiquement arméniens sont servis par deux jeunes filles qui sont en formation à l’école hôtelière, qui se trouve juste à côté de l’immeuble de mon oncle. Au menu : en entrée des beureks, des dolmas, des houmous aux aubergines et du taboulé. Puis viennent en plat principal des brochettes de bœuf, de poulet et d’agneau, accompagnées d’aubergines, de riz et de frites. Je regarde autour de moi, tout le monde cale, déjà. Je m’en amuse. La cuisine arménienne est généreuse. En désert, nous avalons des loukoums et des yaourts.
Mon grand-père, Hubert, se lève lentement de table au moment où les desserts sont déposés sur la table.
Ma grand-mère, Elisabeth, se lève, difficilement, pour embrasser tendrement sur la joue son mari.
Une larme fine coule de son œil droit. Elle ne l’essuie pas et la laisse glisser. Tous se lèvent et s’embrassent.
Le café arménien est devenu ma spécialité. Tout le monde parle du café turc, mais en fait, il s’agit bien du café arménien.
Tous m’ont suivi dans la cuisine. Sur l’îlot central, je leur montre comment faire.
Nous repartons dans la bibliothèque. En passant devant le salon de musique, où je vois dans l’entrebâillement de la porte Joseph s’installer au piano à queue pendant que Marie prend son violon. Pierre est avec eux. À 15 ans, il est un jeune apprenti chanteur d’opérette. C’est un ténor.
Mon oncle Jacques ouvre la porte de la bibliothèque et nous nous installons pour prendre le café. Cette bibliothèque est immense. Elle doit faire une trentaine de m2. Il y a des livres jusqu’au plafond. Il y en a plus de 9 000. Elle a été conçue pour faire tout le tour de la pièce.
Tous me regardent avec des yeux éberlués. Ils éclatent de rire. Puis un silence d’ange passe.
Sarah qui s’est assise en tailleur au milieu du grand tapis couleur abricot, que mon oncle a ramené du Tibet, interrompt ce long silence.
Tous éclatent, de nouveau, de rire.
Pierre, Marie et Joseph entrent au même moment dans la pièce. Joseph prend la parole :
Sarah m’interrompt :
Les plus grands éclatent de rire. Je m’assieds à côté d’elle sur le tapis.
Le monde d’Heradis
Mon grand-père reprend la parole.
Je continue de raconter mon histoire.
Au même moment où il débute sa phrase, les deux portes-fenêtres de la bibliothèque s’ouvrent avec fracas. Un énorme halo de lumière s’engouffre dans la pièce et nous aveugle. Je suis le seul à distinguer des silhouettes qui s’avancent vers nous. Je reconnais Ara, Scarlett et Tondor.
Les portes-fenêtres se referment derrière eux, le halo de lumière diminue. Tous, nous pouvons voir ces êtres de lumière venus d’ailleurs. Je suis le seul à m’avancer vers eux. Les autres ont reculé, presque pétrifiés, jusqu’à l’extrémité de la pièce.
La peur se lit sur leurs visages. Je tranche, par ma faconde.
Oncle Jacques reprend la parole :
À peine sa phrase terminée, mes amis d’Heradis – ce monde parallèle de la reine Anahit, qui a fait de moi son petit prince – redeviennent invisibles.
Tout le monde éclate de rire. Georges, qui a entendu tous ces bruits entre, à son tour, dans la pièce. Oncle Jacques intervient :
Nous filons dans la pièce d’à-côté, dans le salon. Il est, suffisamment, grand pour y accueillir une mini-estrade sur laquelle a été posé le piano à queue, un Steinway de 1939, qui appartenait à mon arrière-grand-mère, Anne-Elisabeth de Bussy (son nom de jeune fille). C’est Vladimir Horowitz, le grand pianiste en personne, qui lui avait offert à son retour des États-Unis, où il avait eu ses premiers triomphes. Je n’ai jamais su quelles relations ils avaient entretenues. Étaient-ils amants ?
Dans la pièce, des chaises confortables ont été installées. L’instant semble solennel. Oncle Jacques monte sur scène, accompagné de tous mes frères et sœurs.
À ce moment-là, Joseph joue au piano le célèbre morceau Prélude 5 en G mineur de Rachmaninoff. Je me retourne, surpris. Au fond de la pièce, les portes, qui donnent sur le couloir, s’ouvrent alors en grand. Et je vois rentrer une vingtaine de personnes, mes autres oncles et tantes, une dizaine de cousins, et mes amis. Ils sont tous déguisés. Je bondis de ma chaise et me précipite vers eux.
J’ôte les masques des premiers, d’oncle Jean et de tante Angèle, d’oncle Michel et de tante Henriette. Puis, les cousins se démasquent d’eux-mêmes. Et les amis sont là : Pierre, Cécile, Anne, Paul, Thomas…
Je me souviendrai longtemps de ses retrouvailles et de cette nuit blanche. Une soirée, où les frères et sœurs ont joué leur petite comédie musicale. Ensuite, nous sommes sortis, en fin d’après-midi. Un grand rallye avait été organisé par les amis de Sciences Po au champ de Mars. Il s’agissait de retrouver des objets dissimulés, sous une statue, dans un arbre, sous un banc, dans un pot de fleurs… à partir d’énigmes et de rébus remis à chacun.
Puis, la soirée s’est terminée par un dîner. Les deux salles à manger étaient pleines à craquer. En tout, nous étions une cinquantaine. Avec le reste de cousins et d’amis venus nous rejoindre. J’ai terminé la nuit blanche avec mes plus fidèles amis, mon cousin et ma cousine préférée, Jérôme et Delphine. Ils sont tous repartis vers 6 h du matin. À cette heure-là, je me suis endormi à même le tapis de ma chambre.
Le Monde des Bonnes Nouvelles
Le lundi, je me réveille en sursaut. C’est Ara, mon perroquet qui me tapote l’épaule avec son petit bec crochu.
Ah, mince, j’avais oublié. Je suis tête en l’air ! Oui, c’est vrai, mon rédacteur en chef, Paul Roderre m’a invité à déjeuner au journal.
Je m’habille en quatrième vitesse et je pars vers midi. Le journal se situe place de la Bourse, dans le 2e arrondissement de Paris. Porte à porte, je mets à peu près une demi-heure pour y aller. Mais cette fois-ci, j’ai un avantage : je ne prends pas le métro. Je prends Scarlett ! En bas de l’immeuble, mes fidèles compagnons m’attendent. Je regarde autour de moi. Personne ! En montant sur le dos de Scarlett, je deviens à mon tour invisible. Scarlett galope à toute allure. Elle traverse le Champ de Mars à une vitesse de près de 100 km/h. C’est époustouflant. À tel point que je suis en avance.
C’est incroyable qu’elle connaisse l’Arc-de-Triomphe. Je n’ai pas fait attention, mais cette fois-ci elle galope à contresens, et emprunte les sens interdits. Nous sommes, déjà, avenue Marceau. Cela ne change rien, finalement. Car, nous restons invisibles.
Scarlett se prend de plein fouet une Tesla rouge, qui en plus de la latence et du ralenti, a pour effet de la stopper net. La BMW derrière elle n’a pas le temps de freiner et défonce son pare-chocs arrière-gauche.
Nous arrivons place de l’Étoile. L’Arc de Triomphe est magnifique. C’est là, à son sommet, sur sa terrasse que nous avions fêté notre diplôme de Sciences Po.
D’un bond, je me dirige vers le tombeau du Soldat inconnu. Je suis, toujours, invisible. La flamme de la France est éteinte. Je pense à mes parents, à ma généalogie. À mon arrière-grand-père, qui était présent dans le wagon de la signature de l’armistice, le 11 novembre 1918, à Rethondes.
Il était le secrétaire de séance. Il finira général 5 étoiles et terminera sa carrière comme Gouverneur militaire de Paris, juste avant la Seconde Guerre mondiale.
À mon arrivée, je vois le cœur du foyer s’enflammer tout seul comme par magie. Je pose un genou à terre et je me recueille. Au même moment, un fort coup de vent s’engouffre par l’arrière et traverse tout l’Arc. Il me projette en avant. Je me retrouve comme suspendu au-dessus de la flamme. Après un cri d’effroi, marqué par la chaleur vive, c’est un froid glacial étrange qui me fige.
Je ne suis plus à Paris. Je ne sais pas où je me trouve. La place de l’Arc-de-Triomphe a disparu, je suis entouré d’arbres. Le silence a succédé aux bruits des voitures. C’est l’hiver. C’est la nuit. Heureusement, c’est la pleine lune. Et je vois presque comme en plein jour. Le givre s’est emparé des ramures des branches nues. Les cimes forment une toiture végétale naturelle qui tamise la lumière lunaire. Le silence est interrompu. J’entends au loin des bruits mécaniques, comme des chenilles. Je me mets à courir. Ma respiration s’accélère. Je traverse la forêt épaisse, je m’arrête à sa lisière. Une route non goudronnée me fait face. Une vieille traction noire passe, alors, devant moi. À l’intérieur, j’ai reconnu des militaires habillés avec de vieux uniformes qui me rappellent les uniformes de la Première Guerre mondiale. Ils portent tous une moustache et un képi reconnaissable à mille lieux : il est rouge. Ce rouge que portaient les Poilus.
La traction est suivie d’autres véhicules, de vieilles automitrailleuses Citroën à chenilles.
On se croirait dans un vieux film de guerre.
Scarlett, Ara et Tondor m’ont rejoint.
1918, 11 novembre 1918. Je répète cette date à haute voix. Je la crie même.
L’ivresse me prend. Je vais vivre un moment historique. L’un de ceux qui ont marqué le 20e siècle. C’est dingue. J’aimerais qu’Aroso… j’aimerais que la reine Anahit soit là. Ils me manquent.
J’agrippe Tondor, qui est quand même deux fois plus petit qu’Aroso, même s’il mesure plus de 2 mètres de haut. Et nous survolons, effectivement, la clairière, puis le train de Foch. Vers 5 h, je me retrouve à l’intérieur de l’un des wagons. Il est splendide, habillé de bois, lambrissé avec finesse, et marqueté d’exotisme, avec une grande table au milieu où sont assis les belligérants qui se font face.
Les Alliés d’un côté, les Allemands de l’autre. Une porte s’ouvre, c’est mon arrière-grand-père, le capitaine Jules de La Madrière. Je saute de joie, et j’entends craquer sous mes pieds, le parquet en vieux chêne. Heureusement personne ne peut ni me voir ni m’entendre.
Vers 5 h 13, je vois une larme couler sur la joue du capitaine Von Oberndorff. Les 6 signataires s’exécutent. Ils signent la fin de la guerre, le début d’un temps de paix qui sera des plus courts : 21 ans, une génération, bientôt mon âge ! L’ambiance restée glaciale fige les fronts et les visages émaciés par l’épreuve de la défaite. Elle se réchauffe sensiblement à la fin.
Tout le monde sort du wagon.
Invisible, je me précipite pour voir la convention d’armistice, l’exemplaire du Maréchal Foch. Après lui, les signataires sont l’amiral Wemyss, de la couronne d’Angleterre, le secrétaire d’État Erzberger, de la délégation allemande, le comte Von Oberndorff, le général-major Von Winterfeldt et le capitaine de vaisseau Vanselow.
J’en profite pour prendre ce document historique d’une dizaine de pages en photo, avec mon smartphone. J’ai bientôt fini, lorsque, je ne sais pas pourquoi, l’application photo se met sur la position flash et en émet à répétition. Tout le wagon s’illumine. J’entends des ordres donnés et des pas se précipiter et grimper le marchepied du wagon. Deux soldats entrent, le fusil à la main.
À l’instant même, je me retrouve sur le dos de Tondor à survoler la Place de la Concorde. Je comprends qu’en plus du pouvoir ou du don d’ubiquité, j’ai, toujours, la possibilité de me translater. C’est-à-dire de me téléporter dans l’espace-temps et de changer d’époque.
Je quitte 1918. Je me retrouve à Paris. Il est 12 h 30. Tondor me dépose au pied de l’immeuble du journal. En entrant dans le hall, je redeviens visible. L’hôtesse d’accueil me salue.
Au passage du tourniquet, mon badge d’accès ne fonctionne plus. J’aperçois Paul au loin qui me fait un signe de la main.
Nous prenons l’ascenseur, direction le 5e étage où se trouve toute la rédaction, les 50 journalistes attitrés. À l’ouverture des portes, j’entends une musique qui ne m’est pas inconnue. Et je vois tous mes collègues se lever et se tourner en direction de moi. L’immense plateau en open-space occupe tout l’étage. Les baies vitrées, qui courent le long de la façade, lui confèrent une atmosphère lumineuse des plus futuristes, comme si nous étions à bord d’un vaisseau spatial. J’ai, toujours, pensé que l’architecte Stark Young, un Américain vivant à Paris, s’était inspiré de la trilogie de Star Wars pour le réaliser. Nous avons une vue imprenable sur le monde, sur le quartier de la Bourse. Je me sens flotter et me retrouve comme en apesanteur, dans mes pensées.
Je reconnais Laurence, Caroline, France, Jean-Paul, Eddy, Thomas, Samuel, etc. Ils sont tous là.
Le bureau de Paul Roderre se situe à l’extrémité de la salle de rédaction. Nous traversons l’allée principale. Au passage, je récupère des enveloppes que me tendent les collègues et des petits cadeaux. La musique et les chants montent d’un cran. Certains dansent même sur les tables de bureau.
Quel accueil ! Je m’en souviendrai de mon retour. J’ai l’impression d’être la petite star du jour. Arrivés au bureau de Paul, nous sommes bloqués par l’imposant Robert, le responsable de l’administration et du secrétariat général. Il pèse plus de 120 kg. On lui a donné le petit nom de sumo.
Nous nous engouffrons dans le bureau de Paul, où un déjeuner nous est servi. Il abaisse un des stores à moitié. Avant de m’asseoir, je me dirige vers les grandes baies vitrées. La vue est splendide et donne directement sur la Bourse.
J’ai toujours sa lettre sur moi, dans la poche intérieure de ma saharienne. Je la lui tends.
Je la lui reprends et je comprends qu’il ne peut lire, effectivement, ce qui est écrit dessus.
Nous nous regardons 3 secondes, droit dans les yeux. Et Paul éclate de rire. Moi aussi…
Nous nous asseyons dans le canapé. Il me pose des questions sur mes 111 jours passés en Arménie.
Un ange passe… Nous nous regardons. Nous sourions. Je finis par avaler mon sandwich au thon ; et Paul, sa tranche de saucisson. Puis, il termine son verre de vin rouge.
Il me donne une bonne tape dans le dos. Et nous éclatons de rire tous les deux.
Avant de repartir. Il ouvre les stores de sa porte-fenêtre, qui donne sur l’open-space de la rédaction. Le nez collé à la vitre, Robert regarde tous les journalistes, qui se sont levés. Nous sortons. Un Joyeux Anniversaire est de nouveau entonné. Paul s’arrête et me dit, l’air enjoué :
Une soirée au Lido
Heureusement que Paul a accepté mes 3 semaines de congés. Car cette soirée d’anniversaire s’est transformée en nuit blanche. Encore une ! Les collègues avaient fait les choses en grand. Après le déjeuner et le gâteau d’anniversaire, tout le 5e étage s’est vidé. Dans Paris même, Paul et Robert ont organisé un rallye découverte. Mon 2e, depuis mon retour ! Il s’est étendu de la place du Trocadéro, en passant par la place de l’Étoile, le Louvre, Saint-Germain-des-Prés et Montmartre. Ils avaient loué de vieilles voitures de collection. Je me suis retrouvé en tête de cortège à bord d’une vieille Rolls-Royce des années 50. C’était trop drôle de voir ce défilé d’une vingtaine de vieilles voitures, avec des 4 L, des 2 CV, des Coccinelles, des Panhards, des Tractions Avant, etc.
Et puis nous avons terminé la journée… au Lido. C’est la première fois que je mettais les pieds dans ce cabaret. À bientôt 21 ans, j’étais plutôt gêné de voir toutes ces danseuses plus ou moins habillées. Mais le spectacle était grandiose. Le thème de la soirée ? « Célébrons l’amitié franco-arménienne ». Un groupe de danseurs traditionnels arméniens (très habillés), les YERAZ (yeraz veut dire rêve en arménien) venaient directement d’Erevan. Puis, nous avons fini la nuit… blanche dans une boîte de nuit sur les Champs-Élysées.
Je déteste les boîtes de nuit… Impossible d’y parler.
Quand je suis rentré chez mon oncle, il était 5 h. Oncle Jacques était, déjà, réveillé. Il n’a pas eu l’air surpris de me voir dans cet état-là, tout débraillé.
J’ouvre délicatement la porte de ma chambre. Je retrouve l’atmosphère du Tonkin, ses malles, ses meubles. Sur le divan de ma chambre, je vois Sarah, qui dort sur Tondor, et Ara qui est perché sur le rebord de la fenêtre semble veiller sur eux. Je ne vois pas Scarlett.
Je m’effondre tout en douceur sur mon lit douillet. Je m’endors comme un trait de plume.
2
Un château en Anjou
J’ai dormi 24 heures d’affilée. Finalement, j’ai obtenu du journal tout le mois de juin en congé. Presque 5 semaines, c’est énorme !
Je retrouve Sarah et mon oncle dans le salon. C’est l’heure du déjeuner. Nous partons juste après. Oncle Jacques me prête l’une de ses voitures : une vieille Alpine Renault 130 RTS, qu’il a entièrement restaurée. En plus, il a changé le moteur thermique pour un moteur électrique, qu’il a conçu lui-même. Son autonomie est de 530 km, en mode sport ! C’est incroyable !
Oncle Jacques est à la fois un aventurier et un bricoleur de génie, un mécanicien hors pair. Il me fascine depuis mon plus jeune âge. Il me rappelle mon père. Il lui ressemble, même s’il est plus petit (c’est son aîné).
La porte automatique du garage se referme derrière-moi. J’enclenche très vite la seconde. Oncle Jacques doit être le seul à avoir gardé une boîte de vitesse manuelle sur cette voiture électrique.
Les pneus crissent sous mon coup d’accélération. Je dois faire attention. Cette voiture est une petite bombe. Mais je la maîtrise assez bien. Il est vrai que la conduite automobile est l’une de mes passions. Dès le plus jeune âge, vers 5 ans, mon père m’a mis sur un mini-kart. Lui-même était un pilote hors pair. Il a remporté plusieurs fois le Paris-Dakar. Au début, ce rallye, comme son nom l’indique, partait de Paris jusqu’à Dakar, la capitale du Sénégal. Quand mon père l’a fait pour la première, je devais avoir 9 ans. Et son co-pilote était… oncle Jacques ! C’était l’année où il s’est déroulait au Chili et en Argentine. C’était sa vie, son métier, sa passion. Il était pilote de course F1, justement chez Renault Sport. Puis, il a terminé sa carrière à 50 ans, comme pilote de rallye.
Ah, comme il me manque !
La route est facile. J’emprunte l’A6, qui est fluide. Les paysages d’Île-de-France défilent. Les étendues des cultures de blé, de colza, de maïs, d’orge et de seigle se multiplient et remplissent l’air des parfums de la terre. Nous entrons dans la Beauce et empruntons la sortie vers Chartres.
Elle étend autour de mon cou ses petits bras et m’embrasse avec tendresse. Je la regarde et lui souris. Nous sourions à la vie ! Avec ses petites bouclettes et son regard d’ange, elle me fait penser aux parents.
Finalement, elle s’endort sur son doudou, un joli mouton blanc. Je roule à travers les champs de blé. J’ouvre la fenêtre. L’air est agréable, imprégné de saveurs. Il diffuse une sorte de parfum de pain cuit au four. Dehors, la température avoisine les 25 °C. J’aperçois la cathédrale de Chartres au loin. Elle est majestueuse. Je comprends que les parents en soient tombés amoureux. Ses flèches, qui s’élancent si finement vers le ciel, sont les deux points les plus remarquables, visibles à des kilomètres. Une sorte de points d’exclamation, ou d’épis de blé, décortiqués de ses grains.
Cette fois-ci, ce n’est plus Dieu qui pointe son doigt vers la terre, c’est l’homme qui pointe son doigt vers le ciel. L’une de ses flèches, la plus ancienne (orientée sud-est) me fait, d’ailleurs, penser à celle de Tsitsernakaberd, à Erevan, en Arménie.
À celle du Mémorial du génocide des Arméniens, perpétré par les Ottomans entre 1915 et 1923. Elle m’a, toujours, fasciné cette flèche. Elle m’inspire et m’attriste à la fois. Tant par son histoire, que par sa beauté architecturale à la fois simple et mystique, comme si elle apportait un supplément d’âme. Je la trouve très moderne, cette cathédrale du 13e siècle. Car, elle attire, encore, de nombreuses foules. Il y a près de 2 millions de touristes, qui viennent à Chartres, chaque année.
Je me dis, intérieurement, alors que nous entrons dans la ville : peut-être que c’est elle qui va me réconcilier avec Dieu (?).
Je me gare au pied de la cathédrale. Je réveille tout doucement Sarah.
En montant sur mon dos, un grand frisson me traverse. Je me retrouve, à l’instant même, comme projeté sur le dos de Tondor. Jusqu’à notre arrivée à Chartres, je l’avais vu voler dans les airs, au-dessus des champs de blé. Et Scarlett galopait à côté de la voiture. Quant à Ara, il restait stoïque, debout, sautillant sur la banquette arrière. Tous restaient invisibles aux yeux de Sarah. De toute façon, elle dormait.
Sarah ne se rappellera pas ce moment de vie incroyable, des plus merveilleux. Elle gardera, cependant, en mémoire le souvenir de l’air frais qui plane à l’extérieur de sa peau, et qui par moment, quand Tondor fait ses virages aériens, s’engouffre dans son petit gilet rose. L’air fait virevolter sa longue chevelure. Nous devenons des êtres aériens.
Je cale Sarah dans les plumes de Tondor. Elles forment une sorte de cocon douillet, à l’abri des grands courants d’air. Puis, c’est le grand survol. Nous tournoyons autour des flèches de la cathédrale, dont la hauteur dépasse les 100 mètres. Des colombes et des cygnes sont venus nous rejoindre. Le ciel est bleu et les terres agricoles beauceronnes s’étalent à perte de vue. On dirait un immense tapis de blé, de colza et de féverolle.
Tondor se pose sur le toit de la cathédrale, qui ressemble à la coque renversée d’un bateau. C’est à ce moment-là que je me souviens de Péguy et de l’une de ses poésies. Cet amoureux de la marche, de la nature et du verbe, était un vrai poète-pèlerin. Il est venu souvent à Chartres, notamment peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes le 14 juin 1912. En trois jours, il va parcourir (en aller-retour) plus de 144 kilomètres. Il entreprend ce pèlerinage pour son fils qui est gravement malade. Depuis, ce sont des étudiants par milliers qui suivent son exemple, chantent, marchent et prient au milieu des champs. Chaque année, au moment de la Pentecôte, ils se retrouvent, avec leur sac à dos, sur les chemins de Chartres.
Je l’ai fait, il y a 3 ans, pour fêter mes 18 ans.
Dans l’un de ses poèmes, Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, Charles Péguy déclare sa flamme à la dame de pierre.
Un homme de chez nous, de la glèbe féconde
A fait jaillir ici d’un seul enlèvement,
Et d’une seule source et d’un seul portement,
Vers votre assomption, la flèche unique au monde.
Tour de David, voici votre tour beauceronne.
C’est l’épi le plus dur qui soit jamais monté
Vers un ciel de clémence et de sérénité,
Et le plus beau fleuron dedans votre couronne.
Un homme de chez nous a fait ici jaillir,
Depuis le ras du sol jusqu’au pied de la croix,
Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois,
La flèche irréprochable et qui ne peut faillir.
C’est la pierre sans tache et la pierre sans faute,
La plus haute oraison qu’on ait jamais portée,
La plus droite raison qu’on ait jamais jetée,
Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute.
Je connais ce poème par cœur. Je le récite à haute voix, presque en criant. Je suis debout sur le dos de Tondor, qui tourne sa tête vers moi et me regarde avec l’air très soucieux. Il a peur que je tombe ? Je me rassieds.
Puis il nous dépose sur le parvis. Je réveille tout doucement Sarah.
À l’intérieur, la cathédrale est sombre. Ses magnifiques rosaces aux couleurs bleu, rouge et violet, qui mesurent 10 m de haut, sont traversées, au moment où nous entrons, par des traits de lumière, qui normalement devraient s’obscurcir, comme filtrer par l’épaisseur sombre des vitraux. Est-ce l’effet du soleil ? Non, car le soleil ne peut baigner l’édifice de ce côté. Comment expliquer ce phénomène ?
Elle regarde tout autour d’elle. La nef est gigantesque et mesure plus de 130 m de long.
Elle me prend la main. Et m’entraîne vers la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame du Pilier.
Je ne termine pas la prière. Les rayons, que j’évoquais tout à l’heure, viennent de se rejoindre pour illuminer la statue de la Vierge à l’Enfant. Sarah prend peur. Elle agrippe ma main et nous sortons en courant.
Je m’arrête, je la sers fort dans mes bras. Je la repose à terre. Elle est jolie dans sa petite robe blanche, avec son gilet rose.
Comment lui dire que j’ai mis un coup de pied brusque sur le frein de ma foi et de ma pratique religieuse, suite au décès des parents ? Elle ne comprendrait pas. Elle, elle a vécu tout le contraire. Elle ne passe pas une journée sans parler de Dieu, des anges, des parents, de prières. Elle me touche le cœur. Qu’est-ce que je l’aime ma toute petite sœur !
Et puis ces rayons de lumière est-ouest, qui se rejoignent. Cela veut dire quoi, en plein midi ? Il faut que j’y retourne.
Je repars en trombe. Je grimpe quatre par quatre les escaliers, j’ouvre la grande porte du transept qui se situe juste à côté de la Vierge. Il n’y a plus personne. Toutes les bougies autour de la statue se sont éteintes à mon arrivée. Je regarde la statue. Je ne vois rien. Les rayons ont disparu. Je m’apprête à repartir quand une lumière, de nouveau, scintille. Cette fois-ci, elle provient de la statue. Je m’approche avec lenteur et précaution, et je vois le cœur que tient la Vierge dans sa main droite s’enluminer. Au même moment, au-dessus de sa tête, dont la couronne scintille, une main apparaît. J’ai un mouvement de recul. Je suis émerveillé et j’ai un petit peu peur. Elle tient une plume d’or qui écrit ces quelques lettres : À N A H I T.
Anahit est, ici, non ? Puis, les bougies se rallument, et des touristes viennent d’entrer. Ce sont des Chinois. Je ne suis plus seul. Tout est redevenu normal. Je ressors en courant. Anahit ?
À Tours, chez ma tante
Sarah n’a pas posé de question. Nous filons en direction de Tours. Je roule vite. L’alpine fait des bonds de géant. Je fais des pointes à 150 km/h. Grâce au GPS antiradar de mon oncle, qu’il a appelé Dauphin (une version améliorée de Coyotte), je les évite soigneusement.
Nous arrivons à Tours sans encombre. Avant de prendre la bretelle de sortie de l’autoroute, je suis flashé par un radar.