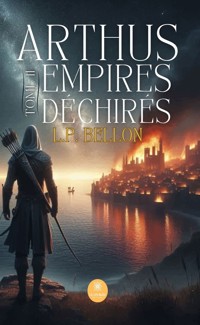Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arthus
- Sprache: Französisch
Février 1202. Après des années d’errance en Orient, Arthus, un aventurier courageux, est de retour dans sa Provence natale et espère enfin trouver la paix. Cependant, son passé tumultueux revient le hanter lorsque la comtesse Sancha du Roussillon le contraint à voler un document compromettant, révélant l’existence d’un héritier illégitime de noble lignée. Dans une Europe en ébullition, préparant une nouvelle croisade ordonnée par le pape Innocent III, Arthus se lance dans une quête épique pour retrouver cet enfant mystérieux. Parviendra-t-il à déjouer les pièges et à dévoiler la vérité avant qu’il ne soit trop tard ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
L.P. Bellon n’avait jamais envisagé une carrière d’écrivain auparavant. Toutefois, les auteurs tels que Follet, Eco, Druon, Calmel et de nombreux historiens médiévistes ont réussi à aiguiser sa curiosité pour la période des 12 et 13 siècles. Tout naturellement, l’inspiration pour ce premier roman lui est venue des zones d’ombre qui ont entouré le détournement de la croisade de 1204.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L.P. Bellon
Arthus
Tome I
L’héritier de l’ombre
Roman
© Lys Bleu Éditions – L.P. Bellon
ISBN : 979-10-422-2954-2
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Sylvie, ma sœur de cœur.
À Cherazade, ma plus belle rencontre.
À mes parents.
À mon fils.
Prologue
Une nuit sans lune noircissait le ciel depuis plusieurs heures. Sœur Speranza était agenouillée face à la fenêtre de sa modeste chambre. Elle achevait sa prière. Elle se signa puis se releva. Elle ramassa son chapelet qu’elle fixa à sa ceinture, attrapa sa longue cape dont elle se couvrit les épaules.
Il était temps de passer à l’action, et elle avait trouvé la force nécessaire dans la prière.
Elle sortit de sa cellule obscure et s’engagea dans le vestibule tout aussi insondable. Elle descendit rapidement l’escalier en colimaçon s’aidant de ses mains pour se diriger et ne pas tomber. Mais elle avait l’habitude, elle connaissait par cœur les vieilles pierres de son couvent.
Elle déboucha dans la grande salle sur laquelle donnait le dortoir. Elle dépassa l’ouvroir où, jour après jour, elle s’usait les yeux sur des travaux de couture, comme la plupart des sœurs.
Sans hésiter un instant, elle traversa le vestibule silencieux et sortit dans la cour. Aussitôt, la fraîcheur de la nuit d’octobre l’enveloppa comme une seconde peau. Elle frissonna un instant, puis se dirigea en trottant vers l’escalier qui descendait vers l’embarcadère.
En face, à quelques centaines de toises, sur la petite île de Megaride se dressait l’imposante prison du castel dell’Ovo dans la baie de Naples. Les remparts du château hérissés de créneaux étaient à peine visibles à cette heure de la nuit. On devinait seulement sa présence.
Sœur Speranza rejoint l’embarcadère où l’attendait la barque à chaîne qui faisait la liaison avec l’îlot.
Le ressac se brisant sur la berge offrait son murmure régulier et lancinant. La mer était calme, la traversée ne durerait que quelques instants.
Elle monta dans la barque, détacha l’amarre et s’empara de la chaîne sur laquelle elle tira vigoureusement. L’embarcation se mit en mouvement.
Une fois la barque immobilisée sur la berge opposée, la sœur monta vers les portes de la citadelle.
Elle frappa.
Un volet s’ouvrit. À la lueur de son flambeau, la sentinelle reconnut aussitôt sœur Speranza et la laissa entrer.
Il n’était pas rare que les religieux accèdent à la citadelle de jour comme de nuit pour porter secours à un prisonnier dans la souffrance ou sur le point de trépasser.
Depuis que la citadelle n’était plus qu’une prison, la garnison y avait été considérablement réduite. Connaissant parfaitement les lieux, sœur Speranza s’engouffra dans les couloirs du château sans rencontrer âme qui vive. Elle gravit les marches jusqu’à la cour intérieure principale menant à la prison.
Là, un groupe de soldats distraits comméraient à voix basse autour d’un flambeau. Sœur Speranza ralentit le pas et se cacha derrière une des colonnes du péristyle. Elle avait parfaitement le droit d’être à cet endroit, mais, si les gardes l’apercevaient, les longs bavardages qui inévitablement s’ensuivraient, la mettraient en retard.
D’un autre côté, esquiver les papotages la rendrait suspecte.
Elle décida qu’elle allait contourner le groupe de bavards en passant par le réfectoire. S’étant assurée que personne ne regardait dans sa direction, elle se glissa jusqu’à la porte d’entrée qu’elle ouvrit avec d’infinies précautions afin de ne pas faire grincer les gonds.
De nouveau à couvert, la sœur traversa la grande salle dans laquelle la garde avait l’habitude de prendre les repas sur de longues tables alignées le long de murs blafards.
À l’extérieur, les gardes, emmitouflés dans leurs tuniques à larges manches, étaient toujours occupés à leurs jacasseries.
Sœur Speranza se baissa et, telle une souris, passa benoîtement sous les fenêtres afin de ne pas être repérée.
Au bout du vestibule, elle bifurqua en direction d’une deuxième cour intérieure qu’elle parcourut en longeant les murs afin de toujours rester dans une relative obscurité protectrice.
Enfin, elle rejoignit sœur Giada qui l’attendait devant le mur qui les séparait de ce qui fut, il y a encore peu de temps, la cour d’entraînement de la garnison.
Sœur Giada… sa complice sans qui rien n’aurait été possible.
Les deux nonnes n’avaient pas besoin d’échanger la moindre parole, elles savaient exactement ce qu’elles attendaient l’une de l’autre. Elles s’embrassèrent puis se signèrent rapidement. Sœur Giada fit la courte échelle à sœur Speranza de sorte que celle-ci puisse franchir le mur.
Elles allaient très vite se revoir, si tout se passait bien.
De l’autre côté, la voie était libre. À mesure qu’elle se rapprochait de son objectif, sœur Speranza sentait l’angoisse la prendre à la gorge et au ventre. Cela devait s’apparenter, pensait-elle, à ce que ressentaient les soldats avant une bataille.
Elle dévala la volée de marches menant à la salle dans laquelle étaient encore entreposées les armes et les armures d’entraînement.
Bien que désert à cette heure, l’endroit n’était nullement laissé à l’abandon. À l’entrée se trouvait un foyer qui se prêtait toute la journée à de multiples usages. Sœur Speranza souffla sur les braises encore chaudes, témoins d’une longue journée de labeur qui venait à peine de s’achever. Aussitôt, les flammes ragaillardies jaillirent, elle plongea dans le foyer une torche qu’elle avait empruntée dans le râtelier attenant à la cheminée.
La sœur traversa d’un pas alerte l’immense salle d’armes. Elle était si imposante que la sphère lumineuse qui émanait de sa torche ne l’éclairait qu’en partie.
Elle ne s’attarda pas.
Arrivée à l’autre bout de la salle, elle tourna sur sa droite et s’avança devant une porte aux barreaux métalliques donnant sur un long couloir aux pierres massives.
La porte n’était pas verrouillée.
Bien que sœur Speranza prît toutes les précautions pour ne pas faire de bruit, la porte émit un grincement sinistre et impatient. Fort heureusement, personne n’était là pour l’entendre.
La sœur prit soin de refermer l’accès derrière elle et s’engouffra dans le long passage à l’issue duquel se trouvait une porte identique à celle par laquelle elle était entrée.
Sœur Giada s’était débrouillée pour en trouver les clés.
Sœur Speranza descendit un escalier étroit et tortueux.
Elle se trouvait à présent dans les sous-sols de la prison. Dans ce lieu étaient enfermés divers personnages qui avaient commis quelques erreurs de jugement ou de comportement sans grandes conséquences, mais que l’on souhaitait mettre à l’écart pour un temps plus ou moins long.
Les moines et les nonnes avaient accès librement à ce bâtiment, mais le seul moyen d’y entrer, sans franchir la porte principale et le peloton de soldats qui y montait la garde, était de passer par les caves de la citadelle, ainsi que venait de le faire sœur Sperenza.
La sœur se présenta devant une lourde porte métallique dont seule la moitié supérieure était ajourée.
Son rendez-vous était à l’heure : de l’autre côté, une femme aux longs cheveux châtains, au teint livide, se tenait debout, les yeux gonflés par le manque de sommeil et le chagrin. La femme vêtue d’une robe défraîchie donnait le sein à un nourrisson âgé de quelques jours.
Sœur Speranza ne savait presque rien de cette femme. Elle savait juste qu’il s’agissait d’une importante personne du Saint-Empire.
Elle avait été capturée en Sicile, puis elle avait été amenée jusqu’à Naples et emprisonnée ici depuis quelques mois sans que les nonnes ne sachent exactement pourquoi.
La femme se faisait appeler Constance. Elle était libre de ses mouvements dans la prison, mais ne pouvait en sortir.
Au fil des jours, sœur Speranza avait tissé des liens d’amitié avec Constance, suffisamment pour qu’elle lui annonçât qu’elle était enceinte et allait bientôt arriver à terme. Elle avait jusque-là parfaitement camouflé sa grossesse. Personne ou presque ne devait savoir. Seules les sœurs Speranza et Giada étaient dans la confidence. Elles se relayaient auprès du nouveau-né quand sa mère, épuisée par l’accouchement dans les profondeurs des caves de la citadelle et durant lequel elle avait retenu ses cris par peur d’attirer les curieux, tentait par un sommeil perturbé de récupérer quelques forces.
Il était urgent d’exfiltrer cet enfant, car il n’avait pas sa place en prison. Depuis cinq jours, sœur Speranza ciselait, peaufinait, perfectionnait son plan.
Cette nuit, le moment était venu.
Car qui d’autre pouvait remplir cette mission ? Elle qui avait vu naître l’enfant et lui avait donné son premier bain, dans le plus grand secret, au plus profond de la citadelle.
Lorsque le nourrisson eut fini de téter le sein de sa mère, elle l’emmaillota. Elle lui déposa un doux baiser sur le front, puis le présenta sur le passe-plat dont était équipée la porte. Elle le poussa vers sœur Speranza.
Celle-ci prit le petit corps dans ses bras et réalisa à quel point il était léger. Constance fit également passer à la sœur une lettre, qu’elle lui résuma en guise d’instructions.
Sœur Speranza savait maintenant exactement ce qu’elle devait faire. Elle fit un signe affirmatif sans pouvoir réprimer une larme.
— Partez en paix ma sœur, la rassura Constance. Je sais que vous allez réussir. Et ne vous inquiétez pas, car je fais le serment que nous nous reverrons bientôt.
Constance, après s’être signée, replongea aussitôt dans le noir de sa prison.
Le temps pressait, sœur Speranza se ressaisit et se dirigea de nouveau vers les caves.
Il n’était pas question de repasser par les portes principales de la citadelle avec le nourrisson. Même camouflé sous une cape, le risque était trop grand.
La seule manière de sortir de la citadelle sans attirer l’attention, à cette heure de la nuit, était de passer par les souterrains qui débouchaient à la pointe sud de l’île.
Mais la sœur se trouva confrontée à un obstacle qu’elle et sœur Giada n’avaient pas anticipé lorsqu’elles avaient élaboré leur plan.
Le souterrain passait sous une cour abandonnée de la citadelle au milieu de laquelle se trouvait un puits, aujourd’hui asséché. Un tunnel avait été creusé jusqu’à la colonne du puits à environ six toises sous la surface. Une corniche courait le long de la paroi intérieure du puits pour rejoindre un autre tunnel situé à l’opposé. Enfin, le tunnel continuait jusqu’à une barbacane qui débouchait à l’air libre.
Ces constructions souterraines avaient été conçues par les Normands refondateurs de la citadelle quelques décennies auparavant pour s’enfuir en cas d’éventuelles attaques par la terre. Mais, ces tunnels n’avaient en vérité jamais servi et avaient été quelque peu oubliés. Le manque d’entretien, les infiltrations d’eau de pluie avaient fait s’effondrer une partie de la corniche contournant le puits. Sur plusieurs toises, la plateforme avait disparu et avait laissé place à une brèche au sol friable et dangereusement incliné vers le fond de l’abîme.
Sœur Speranza était en nage. Elle sentit une goutte de sueur glisser le long de l’échine. Elle s’en voulut de ne pas avoir pris une corde ou un bâton. Mais pour quoi faire en fin de compte ? Il n’y avait aucune prise à laquelle s’accrocher et un bâton n’aurait fait que l’encombrer.
La sœur posa un pied sur la brèche.
Elle hésita.
Elle sentait que si elle mettait l’autre pied, le sol friable allait la faire glisser vers une chute mortelle. Chargée du nourrisson, son flambeau ne rendait pas les choses commodes.
Elle enfonça son flambeau dans une anfractuosité de la paroi du puits, suffisamment en hauteur, de façon à ce qu’il éclaire la corniche.
Elle eut alors l’idée d’enlever ses sandales.
Tenant d’un bras l’enfant et de l’autre sa paire de sandales, elle remit un pied sur la section ruinée. Le sable et les gravillons s’enfonçaient dans la plante du pied, mais elle sentit un meilleur contact avec le sol.
Elle progressait avec précaution, presque en équilibre sur le dévers, avançant le pied gauche, puis ramenant le pied droit, et ainsi de suite.
D’aucuns, ayant le cœur bien accroché, auraient sûrement franchi la brèche en courant, mais ce n’était pas le cas de sœur Speranza.
Tous ses muscles étaient tendus comme des cordes d’arc. Elle respirait bruyamment, chaque pas lui demandant un effort formidable, tandis qu’elle se concentrait pour réagir au moindre glissement du sol.
Elle avait parcouru la moitié de la brèche, il était maintenant impossible sinon inutile de faire marche arrière.
Elle commença à trembler de tous ses membres et être prise de vertige. Elle sentit que ses forces ne tarderaient pas à l’abandonner. Il ne fallait pas qu’elle cède à la panique et qu’elle continue à regarder devant elle.
Sœur Speranza fit une courte prière à Saint-Michel, ce qui lui redonna confiance et énergie.
Quand enfin elle atteint le trottoir ferme, elle tomba à genoux, épuisée, les muscles endoloris. Elle reprit son souffle. Après un moment, elle se releva et poursuivit sa marche vers la barbacane, mais cette fois dans le noir, car elle avait abandonné son flambeau.
Sœur Sperenza grimpa l’étroite volée de marches qui menait vers l’extérieur. Elle déboucha sur une terrasse de forme arrondie, au sol irrégulier envahi par les herbes, fermée par un mur fortifié. Il faisait encore nuit, mais l’aube ne mettrait plus longtemps à apparaître.
Elle se dirigea vers le mur sud que constituait la barbacane. Elle ramassa une pierre qu’elle jeta par-dessus.
Aussitôt, comme une réponse, une échelle de corde fut jetée depuis l’autre côté. La tête de sœur Giada apparut au-dessus du mur.
Sœur Speranza, soulagée, grimpa à l’échelle. Une fois en haut, sœur Giada lui prit l’enfant des mains le temps qu’elle franchisse le mur.
De l’autre côté, au pied de la paroi, une barque les attendait. Quelques instants plus tard, sœur Giada maniait l’embarcation en direction de la côte avec sœur Speranza et l’enfant à son bord.
Les deux sœurs débarquèrent sur une petite plage au pied du monastère. Sœur Speranza embrassa une dernière fois sœur Giada et se dirigea vers l’escalier qui montait vers le couvent.
Sœur Speranza n’en avait pas encore fini. Il était encore tôt et la seule façon de sortir du monastère sans passer par moult portes, qui de toute façon seraient fermées, était de passer par l’abbatiale. Elle seule restait ouverte en permanence pour accueillir à toute heure du jour et de la nuit fidèles et pèlerins.
Il fallait faire vite, car même si l’enfant était repu pour le moment, il ne tarderait pas à réclamer pitance.
Comme une ombre, sœur Speranza traversa le couvent encore endormi.
Elle entra dans l’abbatiale par le transept sud.
Des frères étaient déjà présents dans le chœur pour y célébrer laudes. Le jour n’allait pas tarder à poindre.
Il lui était impossible de traverser l’église maintenant sans attirer les regards, et sans qu’il lui soit imposé de se recueillir. Si elle patientait un moment pour prier, personne ne ferait attention à elle.
Elle camoufla l’enfant sous sa cape, celui-ci dormait encore. Elle s’agenouilla à la croisée du transept.
Les frères se mirent à entonner un chant.
Sœur Speranza se remettait doucement de ses émotions et commença à se détendre. L’enfant dut sentir le changement d’atmosphère. Au lieu de se calmer, il se mit à gigoter. Il était sur le point de se réveiller.
Sœur Speranza ne pouvait toujours pas sortir de l’église maintenant, elle aurait immédiatement attiré les regards. Mais si l’enfant se mettait à crier au beau milieu de l’église, c’était la catastrophe.
Elle mit son auriculaire dans la bouche du nourrisson qui aussitôt se mit à téter, ce qui eut pour effet immédiat de le calmer.
Lorsqu’elle estima qu’il était temps de partir, elle se leva et se dirigea sans précipitation vers la branche nord du transept. S’assurant que personne ne faisait attention à elle, elle ouvrit la porte et sortit de l’église.
Elle avait réussi et ne put réprimer un soupir de soulagement.
Sœur Giada couvrirait sa fuite pendant deux ou trois jours, au bout desquels on s’apercevrait de sa disparition, mais elle serait déjà loin.
Sœur Speranza se dirigea vers les portes de la ville qui seraient bientôt ouvertes avec la montée du jour. Pour l’heure, il fallait se mettre en quête d’une nourrice ou d’une ferme, car l’enfant ne tarderait pas à avoir faim.
1
Février 1202 – comté de Provence, environs de Salon
En ce début de matinée, en plein cœur de l’hiver, le ciel avait pris une teinte laiteuse. Les valeureux rayons du soleil, parvenant à peine à percer la couche nuageuse, avaient chassé les derniers instants d’une nuit froide et sans étoiles durant laquelle un vent du nord n’avait cessé de souffler. La campagne s’était drapée de blanc. Du tronc à la cime, les arbres étaient enveloppés d’une épaisse couche de givre comme s’ils avaient été transmutés en cristaux. Le végétal paraissait minéral.
Par le plus fortuit des hasards, ma première rencontre depuis mon arrivée dans le comté de Provence se fit avec une ancienne connaissance, à une lieue de mon but.
D’abord, j’ai distingué au loin une silhouette voûtée, juchée en amazone, sur la croupe d’une mule, seule tache sombre qui contrastait avec un paysage désespérément blanc. Le voyageur me tournait le dos, car nous nous dirigions dans la même direction. Tandis que je marchais d’un pas vif et que je rattrapais l’équipage, je compris qu’il s’agissait d’un moine. La mule zigzaguait sur le sentier tantôt de gauche, tantôt de droite. L’ânier devait sans doute somnoler, laissant sa monture avancer. Il la ramenait par intermittence dans le droit chemin d’un coup de baguette.
Lorsque j’arrivai à sa hauteur, nos regards se croisèrent. Je reconnus aussitôt le frère Tristan. Sa tonsure et sa barbe bien reconnaissables formaient comme un cercle pileux presque parfait autour de son crâne rond et luisant. Seule sa couleur avait viré du noir charbon au blanc des nuages d’orage d’été.
Le frère Tristan, après un court instant d’hésitation, me reconnut lui aussi. Une flamme éclaira son regard vitreux. Il descendit de sa monture, comme s’il s’agissait d’un simple tabouret, s’approcha et me fit l’accolade.
— Je n’aurais jamais cru te revoir un jour, Arthus, mon fils, dit-il doucement en me tenant par les bras. Qui aurait pu croire qu’après tant de temps, tu reviendrais à nous en un seul morceau ?
— J’ai pourtant laissé quelques lambeaux de viande au cours de mes voyages, lui répondis-je sans réprimer un rictus, alors que quelques douloureux souvenirs me revenaient en mémoire.
— Combien de contrées as-tu traversées ? Combien de villes as-tu visitées ?
Dès l’âge de quatorze ans, je m’imaginais déjà arpentant le monde. À l’écoute des récits des voyageurs et des marchands, je rêvais de découvrir de nouveaux espaces comme la plupart des adolescents de mon âge. À ceci près que je ressentais une profonde attirance, quasiment obsessionnelle, pour l’Orient sans que je ne puisse pouvoir l’expliquer. C’était comme une intuition, un doux murmure dans ma tête. Un jour, j’écoutais le récit d’un voyageur qui avait tracé sa route jusqu’à Samarcande. Il avait décrit la ville comme étant d’une beauté absolue. Samarcande, ou les portes d’Éden : J’avais enfin mis un nom sur cet appel irrésistible. Après avoir croisé et recroisé les témoignages de marchands et de pèlerins pendant deux années, et bien que je n’eusse aucune connaissance géographique de l’Orient, je savais que j’atteindrais mon objectif.
Si bien qu’à dix-sept ans, par un beau matin d’avril, je pris ma besace sur l’épaule, bien décidé à rejoindre mon paradis. J’embarquai à Marseille sur un navire marchand chargé de lopins de fer destinés à la fabrication d’armes pour les chrétiens d’Orient. Bon nombre des passagers étaient des croisés ou des pèlerins. Mis à part l’équipage, nous prenions la mer pour la première fois.
Une fois à Tyr, alors que la plupart d’entre nous étaient arrivés au terme du voyage, mon périple ne faisait que commencer. Je rejoignis Alep, puis Damas, me joignant à toutes les caravanes de marchands qui me conduiraient vers l’est. Mais les droits de passage qu’on me demandait étaient très largement supérieurs à ce que j’avais imaginé. Aussi, dussé-je me résoudre à travailler dans diverses échoppes pour poursuivre mon voyage. Tantôt pour un boulanger, là pour un charpentier, ici pour un tisserand. Je travaillais dur, m’acquittant des tâches les plus ingrates, me levant avant tout le monde, et me couchant le dernier. Mais je savais que chaque jour me rapprochait un peu plus de mon but.
Le travail le plus enrichissant pour moi fut celui que je réalisai pour un vieil armurier à quelques lieues de Bagdad. Il fabriquait des armes de toute sorte, mais l’archerie m’intéressa plus particulièrement. Auprès de lui, je perfectionnai ma connaissance de la langue arabe et j’appris la confection des arcs. Il me dit que si je trouvais le temps, je pourrais construire mon propre arc et qu’il serait à moi.
Ce que je fis.
Je fabriquai un arc composite dont le corps était constitué de deux lattes taillées dans les deux meilleures essences que l’on pouvait trouver dans la région, qui lui donneraient force et souplesse. J’ajoutai une plaque de métal sur la face intérieure pour accroître la puissance de tir, sur laquelle je gravai « Usque ad Victoriam » – jusqu’à la victoire. Enfin, la poignée ouvragée était agrémentée d’un manchon de cuir. Le vieil armurier en eut les larmes aux yeux, tant le résultat lui plaisait. Si je savais comment construire les arcs, je n’en demeurais pas moins un piètre archer, car si j’appris à manipuler quelques armes, nous n’avions pas le temps de nous entraîner convenablement.
Je restai une année à ses côtés, si bien que le vieil homme s’attacha à moi et me considéra comme son fils.
Mais l’appel de Samarcande fut le plus fort.
Je traversai plusieurs déserts, franchis plusieurs fleuves, gravis plusieurs montagnes. Je connus la soif, la fatigue, la chaleur, le froid, la faim. Je souffris mille morts, mais rien ne me fit renoncer.
Et malgré cela, Samarcande fut une déception pour moi.
Non pas que la ville ne fut pas magnifique et telle que les récits qui m’avaient fait rêver la décrivaient, mais je m’en étais fait une image trop idéale, trop magnifiée. La révélation que j’attendais depuis tant d’années n’eut pas lieu.
De dépit, je quittai la ville et je poursuivis mon voyage en direction du nord-est tant que mes pas me portaient, toujours en quête de mon paradis. Si bien qu’à court de vivres, je me retrouvai dans des montagnes désertiques sans le moindre espoir de survie.
Je fus sauvé in extremis par deux cavaliers vêtus de tuniques aux couleurs chaudes, à la peau couleur bronze et aux yeux bridés. Je n’avais jamais vu de tels individus et je pense que c’était réciproque. Ce fut la dernière image que je perçus avant que ma vue ne se brouille et que je sombre d’épuisement.
Je fus donc recueilli par une tribu qui avait migré depuis de lointaines contrées encore plus à l’est. Ils avaient fui un terrible chef de guerre impitoyable et sanguinaire qu’ils appelaient Gengis Khan.
Tout comme moi, ce peuple avait franchi bon nombre de contrées et fut confronté à des cultures et des coutumes qui leur étaient inconnues jusqu’alors, ce qui d’une certaine façon nous rapprocha.
L’homme sage de la tribu entreprit de faire mon initiation martiale. Le vieillard était déjà d’un âge respectable à trois chiffres, sa longévité exceptionnelle lui donnait une autorité formidable auprès de son clan.
Je restai dix années parmi eux, au cours desquelles je perfectionnai ma connaissance de l’archerie. J’en devins l’un des meilleurs archers. J’appris des arts martiaux totalement inédits pour moi, qui s’étaient transmis dans le clan de génération en génération depuis des temps immémoriaux. J’appris aussi quelques rudiments de médecine.
J’étais devenu l’un des leurs.
Mais, un jour, mon initiation fut achevée et le vieux sage mourut. Le mal du pays se fit alors sentir et je décidai de retourner en Occident.
— Et ensuite, tu es passé par la Palestine, interrogea frère Tristan de but en blanc ? Quelles sont les nouvelles d’outremer ?
— Les nouvelles que je ramène ne sont pas bien fraîches, frère Tristan. J’ai quitté la Palestine voilà plus d’un an maintenant et je viens à présent de l’Aragon.
— Dis toujours, m’encouragea-t-il.
— Pour autant que je sache, les nouvelles ne sont pas bonnes et les victoires des Sarrasins sont au moins aussi nombreuses que les appels à l’aide des chrétiens d’Orient.
Le frère Tristan réprima à peine un soupir ou un gémissement. Il se frotta les yeux avec ses paumes, ce qui fit un bruit semblable au crissement du sable.
— Le problème est qu’il faudrait maintenir une armée de dix fois dix mille hommes au moins, en permanence, en Orient, dit-il comme parlant à lui-même le regard fixé à l’horizon vers un point imaginaire.
— Je ne pense pas que le nombre d’hommes soit le problème, lui fis-je remarquer. C’est l’organisation et la motivation des troupes chrétiennes qui font véritablement défaut en Orient.
— Précise ta pensée.
— Les soldats chrétiens, pourvu qu’ils soient bien commandés, sont parfaitement aguerris pour prendre un territoire aux Sarrasins, l’armement, les techniques de combat sont maîtrisés, les charges de cavalerie sont puissantes, les archers précis, les chefs de guerre sont expérimentés. Pourtant, les croisés sont incapables de tirer les bénéfices de leurs victoires, soit par peur de prendre une décision, soit par cupidité. De si belles victoires se sont retournées en désastres en quelques heures au détriment des croisés.
— Tu penses à des événements en particulier ?
— Le siège de la forteresse de Thoron, par exemple.
— Ah, la forteresse de Thoron, soupira-t-il. Oui, je me souviens, cela avait créé des débats à n’en plus finir parmi les chrétiens ; aussi bien chez les soldats que chez les religieux. C’était il y a quatre années, je crois. Mais Conrad s’est fait soudoyer pour ne pas combattre, à ce que l’on dit ?
— Je n’étais pas sur place au moment du siège, mais pour avoir parlé avec des témoins à Tyr, je pense que c’est une légende.
— Qu’as-tu appris à Tyr ? interrogea le moine tandis que je l’aidai à se remettre en selle.
— Eh bien, voici, commençai-je alors que nous reprenions notre marche. Vous savez qu’Henri, l’empereur du Saint-Empire et fils de Barberousse, rêvait d’asseoir son autorité sur la Méditerranée et par là même de parachever l’œuvre de son père en Orient. Du fait de sa santé fragile, et peut-être à cause des événements politiques qui retardèrent son départ, il mena les opérations depuis la Germanie. Il divisa son armée en trois. La première, commandée par l’archevêque de Mayence, rejoint Constantinople pour faire voile vers Ptolémaïs. La seconde, commandée par le duc de Saxe et le duc de Brabant, s’embarqua depuis la mer Baltique pour contourner l’Espagne et le Péloponnèse. Enfin, la troisième commandée par le fameux Conrad, chancelier de l’Empire et de facto représentant de l’empereur, partit d’Italie.
Frère Tristan, hochant la tête tout en comptant sur ses doigts, m’écoutait avec la plus grande attention. Je poursuivis :
— La première armée sitôt arrivée en Palestine, bien en avance sur les deux autres, fut prompte à en découdre avec les Sarrasins. Ce n’était pas du goût des chrétiens d’Orient qui jusqu’alors vivaient en paix avec les autochtones et surtout espéraient que le nombre de croisés suffirait à forcer les belligérants à négocier plutôt qu’à courir aux armes. Malgré tout, l’armée de Mayence rompit la trêve en ravageant les terres des Sarrasins autour de Ptolémaïs. Les Sarrasins, jusqu’alors divisés, se rabibochèrent et s’attaquèrent à Jaffa, massacrant tout ce qui bougeait, brûlant tout ce qui ne bougeait pas. Conrad arriva en Palestine au moment où l’on déplorait la perte de Jaffa. L’armée croisée se dirigea alors vers Beyrouth et rencontra l’armée de Malek-Adel entre Tyr et Sidon. Les chrétiens furent sur le point de perdre la bataille, mais finalement triomphèrent. D’autres victoires suivirent, les Sarrasins abandonnèrent les villes côtières de Sidon, Laodicée, Giblet et Beyrouth. Il ne restait plus qu’une forteresse aux mains des Sarrasins, Thoron.
Je fis une pause, tout en m’assurant que le frère Tristan me suivait toujours.
— C’était un château surplombant la mer à l’extrémité de la chaîne du mont Liban. On y accédait par un chemin tortueux bordé de précipices et de rochers escarpés. Aucune machine de guerre ne pouvait y être installée. Les croisés eurent l’idée de creuser à même la roche des galeries souterraines afin d’atteindre les fondations de la forteresse. Le moral des Sarrasins assiégés commença à fléchir tandis que résonnaient des coups sourds dans la roche sous leurs pieds. Bientôt, ce travail colossal de sape porta ses fruits, car plusieurs brèches furent ouvertes dans les murs d’enceinte. Les Sarrasins furent pris de panique lorsqu’ils virent avec effroi des hordes de croisés sortir de galeries soudainement apparues au milieu de leur bastion réputé inexpugnable.
Le frère Tristan réprima à peine un grognement dont je ne savais s’il était de satisfaction ou de réprobation.
— Les Sarrasins décidèrent de déposer les armes et déclarèrent aux assiégeants qu’ils enverraient une ambassade au camp des croisés afin de négocier la paix. Mais Conrad, qu’il fût rongé par la maladie ou par le doute, n’assista pas au conseil des barons. Deux camps se déclarèrent dès lors au sein des rangs croisés. Ceux qui étaient pour un arrêt des combats et pour négocier avec les Sarrasins et ceux qui, au contraire, estimaient qu’une négociation aboutirait à une paix honteuse pour les chrétiens et préféraient finir par l’épée le travail qu’ils avaient entamé par l’épée. Le conseil fut houleux, les barons des deux camps en vinrent aux mains sous les yeux mêmes des ambassadeurs Sarrasins qui ne demandaient que la vie sauve en échange de la libération de la place forte. Les partisans de la paix allèrent s’enfermer dans leurs tentes, tandis que les porteurs de la guerre sommèrent les Sarrasins de retourner dans leur château pour se battre.
Frère Tristan fit un signe négatif de la tête, mais ne dit mot.
— Quelques jours plus tard, les croisés toujours divisés envoyèrent à leur tour une ambassade auprès des Sarrasins. Mais ceux-ci, écœurés par ce qu’ils avaient vu de leurs assiégeants, reprirent les armes, bien décidés à mourir jusqu’au dernier plutôt que de négocier avec un ennemi sans tête et par conséquent sans parole. Ils attaquèrent même les chrétiens à revers employant les souterrains que les sapeurs avaient eux-mêmes creusés quelque temps plus tôt. Le moral des troupes chrétiennes ne cessa dès lors de dégringoler. Les croisés décidèrent alors une attaque décisive. Mais, la veille de ladite attaque, Conrad, qu’une maladie tellement honteuse, probablement attrapée auprès de prostituées locales, ne se sentant pas en mesure ni de combattre ni de se faire entendre de ses hommes préféra fuir de nuit avec les principaux chefs d’armées. Au matin, au moment de donner l’assaut, les combattants apprirent que leurs chefs avaient fui vers Tyr. Se trouvant sans chef, le désarroi, puis la panique s’installèrent dans le camp chrétien. On vit des centaines de soldats fuyant dans toutes les directions, certains tombant sous les coups des Sarrasins, d’autres se rompant les os en chutant du haut des falaises. L’armée en désordre finit par rejoindre la ville de Tyr dans une fuite encore plus honteuse qu’une éventuelle paix qui aurait pu être signée avec les assiégés de Thoron.
2
Après un moment de silence, le frère Tristan, qui avait écouté mon récit sur l’échec de Thoron sans dire un mot, réagit.
— Oui, je comprends maintenant ce que tu veux dire quand tu dis que les chrétiens manquent de courage politique. Et dire que nous sommes si près de reprendre le tombeau du Christ. Et pourtant… J’avais entendu parler de l’échec de la prise de la citadelle de Thoron, mais pas avec autant de détails. Mais, tu avais parlé tout à l’heure de motivation ? Penses-tu que nos frères croisés aient le cœur entaché d’impuretés au point qu’ils feraient échouer leur mission ? Ce serait une accusation très grave.
— Ouvrons les yeux, frère Tristan. Vous savez aussi bien que moi que prendre la croix devient une sorte de rituel symbolique pour les chevaliers. Le voyage jusqu’en Palestine est long, beaucoup de croisés ne se rendent pas plus loin que Acre ou Chypre, ce qui coûte moins cher pour le même bénéfice moral. Pour finir, depuis que le roi Richard a investi les terres chypriotes, certains barons préfèrent se reporter sur ces positions à l’abri, plutôt que d’avoir à subir les attaques de modestes envergures, mais incessantes, des Sarrasins. Vous savez, cet « effort de guerre » qu’ils appellent jihad et qu’on traduit un peu rapidement par « guerre sainte ».
— Les croisades ne devaient pas avoir d’autres buts que de libérer les terres saintes. C’est mon point de vue et celui de l’Église. Cela dit, ces attaques incessantes, dont tu parles, de la part des Sarrasins, ne sont pas nouvelles et pourraient être empêchées par la présence d’une armée permanente et bien entretenue comme je le disais tout à l’heure.
— Alors pourquoi Richard d’Angleterre s’est-il investi à Chypre ? On dit que c’est pour former une base arrière. Et pourtant, il a négocié une trêve avec les Sarrasins. Il avait parfaitement compris que les chrétiens ne pourraient jamais assurer la sécurité de leurs territoires aussi loin en Orient.
— Au grand dam de Philippe Auguste et même d’Henri, soupira le frère Tristan. Pour un point, je te rejoins. Chypre était une erreur.
— Qui n’a vécu en Orient ne peut appréhender la situation, philosophai-je.
— Oui, je comprends. Cela étant dit, la croisade d’Henri nous a permis de reprendre les villes côtières de Syrie en fin de compte.
— Pour un temps seulement, rappelai-je. Les Germains débarquèrent dans un pays en paix, en ne laissant derrière eux que haine et rancœur, ainsi que des villes prises aux Sarrasins, mais laissées sans défense et presque sans habitants.
Le frère Tristan changea d’argument.
— Peut-être pourrions-nous faire de Byzance notre alliée ?
— Byzance ? L’empereur byzantin n’a-t-il pas été soupçonné de négocier avec les Sarrasins, il fut un temps ? En outre, je ne crois pas que les Grecs voient les armées croisées d’un bon œil après le passage de Barberousse. La campagne de celui-ci ne tient-elle pas son échec en partie à cause de la querelle entre Byzantins et Germains ?
— Les Byzantins n’aiment pas les armées indisciplinées qui causent autant de dégâts que les sept plaies d’Égypte réunies sur leur passage, s’emporta le frère Tristan dont le visage vira soudain au rouge. Mais, je maintiens qu’il faut garder Byzance comme alliée. D’abord parce que l’empereur grec est la clé de la réunification de nos deux Églises et par là même, le chemin vers Jérusalem. Ensuite, nous savons – tu viens de me le confirmer – que les chrétiens d’Orient sont en grande tourmente. Il nous faut un allié militaire et religieux dans la région.
— L’Empire byzantin, un allié ? répétai-je. Ce que vous dîtes là, frère Tristan est totalement contraire à ce que pense le pape.
— Pas tant que cela, tempéra frère Tristan. Les temps ont bien changé.
Le frère Tristan fit silence un moment.
— Notre bien aimé Saint-Père a maintes fois réitéré ses prêches pour une nouvelle croisade, tant il était ému par les récurrents appels à l’aide des chrétiens de Palestine.
— Des rumeurs allaient en ce sens quand j’ai quitté Chypre. Dois-je comprendre que la croisade n’est toujours pas lancée ? La réticence des barons à la suite des précédents échecs en serait-elle la cause ?
— En partie. Mais il y a d’autres raisons. Les Germains sont en pleine guerre civile, Notre Saint-Père, Innocent, ayant ouvertement préféré Othon de Saxe à Philippe de Souabe comme empereur, bien que ce dernier ait été élu. Les Anglais et les Français sont toujours en guerre même après la mort de Richard. Et enfin, Philippe-Auguste ne porte pas le pape dans son cœur.
— Ah oui ? Pour quelle raison ?
— Il y a quelque temps déjà, le roi de France a répudié sa femme, la fille du roi du Danemark, pour épouser Agnès de Méranie. Afin de le punir, puisqu’il se livrait à des amours illégitimes, notre bien-aimé Saint-Père lui ordonna de reprendre sa première épouse. Le roi refusa. Innocent jeta alors un interdit de cérémonies religieuses sur le royaume de France de sorte que pendant plusieurs mois toutes les cérémonies furent suspendues : mariages, baptêmes, enterrements. Les habitants du royaume furent plongés dans un immense désarroi. On comprend alors le peu de motivation du roi de France à inciter ses princes à prendre la croix pour Innocent.
Le frère Tristan, qu’une bouffée de colère alimentée par la frustration étouffait à nouveau, reprit son souffle un moment.
— Et pour rajouter aux contretemps du départ de cette croisade, Thibault de champagne qui devait prendre la tête militaire de l’armée croisée est mort au printemps dernier. À croire que Dieu s’oppose à cette campagne, comme si elle était les prémisses de terribles malheurs pour la chrétienté, ronchonna frère Tristan en se signant.
— Ne vaudrait-il pas mieux confirmer la trêve avec les Sarrasins ? demandai-je en partie à moi-même, plutôt que se rapprocher d’un allié dont la fiabilité est en question. Je parle des Byzantins.
— Pour ce qui est du premier point, les trêves ne sont pas du goût du pape. À ce sujet, il interdit à tous les chrétiens de pénétrer dans Jérusalem pour se recueillir sur le saint Sépulcre, ce qui était possible lors de la trêve signée par Simon de Monfort, tant que la ville ne sera pas reprise aux mécréants. Et les chefs de guerre se soumettent dorénavant à cette volonté. Mais, il ne faut pas y voir là une lubie. La raison profonde est, je crois, que tant que les hommes qui sont à l’origine d’un traité sont en vie, ça peut fonctionner. Une trêve est faite pour être rompue à un moment donné ou à un autre. Tu l’as bien vu par toi-même, celle de Richard avec Saladin est devenue caduque à la mort de ce dernier, celle de Simon de Montfort a été rompue par les armées d’Henri.
Pour ce qui concerne le second point, j’ai la ferme conviction que nous y viendrons à cette alliance avec Byzance. Nous n’aurons pas le choix, tu verras. Bref, quoiqu’il en soit, les préparatifs de la nouvelle croisade sont en cours. On dit que les barons participants souhaitent se rendre en Égypte d’où ils lanceront leur campagne pour reprendre Jérusalem.
— Hum, Jérusalem, fis-je dubitatif. Toujours au centre des prêches et des discours les plus enflammés, mais dans les faits, depuis combien de temps remonte la dernière campagne menée directement contre Jérusalem ? Jusqu’à présent, les croisés se sont tournés vers d’autres objectifs tout en prétendant que ceux-ci constituaient la pierre angulaire de la prise ultime. Mais cela pourrait tout aussi bien devenir la pierre d’achoppement, celle sur laquelle on trébuche. On peut le comprendre, car prendre Jérusalem est aujourd’hui plus facile à dire qu’à faire. La ville sainte d’aujourd’hui n’est pas celle de l’époque de Godefroi de Bouillon, elle est désormais triplement fortifiée.
— Nos armes ont évolué elles aussi, renchérit le frère Tristan. Mais, je vois que tu es opposé à ces grandes campagnes et je vois aussi que je ne te ferai pas changer de position aujourd’hui.
Je sentis le frère Tristan quelque peu froissé par mes positions. Afin de ne pas blesser davantage mon ami, je ne répondis pas. Nous nous réfugiâmes chacun dans nos pensées. Le silence se fit, seulement interrompu par le pas de la mule sur le sol gelé.
— Frère Tristan, demandai-je soudain. Ne seriez-vous pas plus à l’aise dans un conseil auprès des seigneurs de guerre, plutôt que dans un couvent ? C’est toujours étonnant d’entendre des propos martiaux dans la bouche d’un moine, à moins qu’il ne fût templier. Oui, à la réflexion, vous auriez dû être templier, frère Tristan ! m’exclamai-je.
Le frère Tristan fit comme s’il n’avait rien entendu.
— Et ensuite, tu es allé en Espagne et en Aragon ? As-tu rencontré les maures ?
— Oui, répondis-je.
— Comment sont-ils ?
Je ne répondis qu’après un moment.
— Ils sont très avancés sur le plan des sciences, de la médecine et de l’architecture et bien entendu de la guerre. Je dirais que leur point faible réside dans le fait qu’ils n’entretiennent pas leurs constructions, leurs bâtiments, les routes. Leur savoir est dispensé qu’à une élite très restreinte, leurs moyens de communication sont très réduits.
Le frère Tristan se racla la gorge et cracha de côté, puis enchaîna.
— C’est la difficulté de tous les peuples conquérants, soupira le frère Tristan. Toujours avancer au détriment des territoires acquis, laissés pour compte, qui subissent les inconvénients du perdant sans pour autant bénéficier des avantages du vainqueur.
Je ne souhaitai pas m’étendre davantage sur cette période qui remontait à quelques mois à peine, mais qui d’ores et déjà appartenait aux moments les plus troubles de ma vie.
À mon tour, je changeai de sujet.
J’appris que le frère Tristan revenait d’un voyage au cours duquel il avait rendu visite à sa sœur dont l’état de santé portait à inquiétude.
Sitôt le sujet épuisé, je lui demandai des nouvelles du monastère. Le frère Tristan haussa la paire d’os qui lui servaient d’épaules, signifiant qu’il n’y avait rien d’important à signaler. Cependant, il finit par dire :
— Dieu a rappelé à Lui l’abbé Godemar voilà quatre ans, emporté par la fièvre lente, paix à son âme. L’évêque d’Arles nous a envoyé l’abbé Anselme, un cistercien, pour le remplacer.
Cette nouvelle me toucha beaucoup.
— La mort de l’abbé Godemar m’attriste, dis-je. C’était un homme plein de sagesse et de bonté, un homme d’Église éclairé comme on en trouvait peu. J’aurais énormément souhaité le revoir.
— Je pense que lui aussi. Oui, nous regrettons tous l’abbé, soupira frère Tristan en se signant.
— Et donc, qui est l’abbé Anselme ?
Le frère Tristan fit une légère moue et se gratta la barbe comme il avait l’habitude de le faire quand il cherchait ses mots.
— Il est efficace et s’applique beaucoup dans la gestion du monastère. Pour ce qui est de ses projets, c’est une autre histoire. Il souhaite inviter notre Saint-Père pour un prochain concile et on dit qu’il aurait même comme ambition de le faire s’installer en Avignon. Pourtant, les marchands ne l’aiment pas beaucoup. Il s’immisce de trop dans les affaires de la ville.
— De la ville ? m’exclamai-je.
— Ah oui, sourit le frère Tristan. Tu verras que ces dernières années les choses ont bien changé à Salon, dit-il en riant. Mais, rassure-toi, la citadelle tient toujours debout et le vieux village existe encore.
3
Nous étions arrivés devant le sentier qui montait au monastère.
Après nous être embrassés une dernière fois et non sans que le frère Tristan ait insisté sur le plaisir qu’il avait eu de me revoir et d’avoir refait le monde un moment avec moi, nous partîmes chacun de notre côté. Je me remis aussitôt en route tandis que quelques flocons épars commençaient à tomber.
Alors que je montais le sentier familier, en pente douce jusqu’au village fortifié, une bouffée de souvenirs me revint à l’esprit.
Un peu avant midi, je franchis le mur d’enceinte par la porte ouest pour me retrouver dans la large rue principale de Salon. Ici, rien n’avait changé, si ce n’était la foule qui se pressait autour des étals des marchands installés au milieu de la voie.
Comme par un réflexe enfoui et soudainement retrouvé, mes pas me guidèrent sur ma droite, je retrouvai, non sans une certaine émotion, les rues et les façades le long desquelles on faisait sécher durant l’été les bouquets d’ail, de romarin ou de sarriette, et toutes ces maisons qui constituaient le monde dans lequel j’avais grandi.
Je reconnus la maison de Silena, ma nourrice, qui m’avait enseigné tout ce qu’elle avait pu depuis le berceau jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Alors que je n’étais au monde que depuis une ou deux semaines, elle m’avait recueilli sur les marches de l’église par un froid matin de novembre de l’an 1169, emmailloté de la tête au pied, un parchemin dans les plis de mes langes, sur lequel était inscrit « Arthus », signifiant par là même que j’avais été baptisé. Si Silena n’était pas passée par là à ce moment, je serais peut-être moine ou abbé aujourd’hui.
Nourrice, puis amante, je lui devais tellement de choses. La porte de la maison était grande ouverte.
J’hésitai.
Peut-être n’était-ce pas le bon moment ?
Alors que j’étais sur le point de remettre ma visite, la silhouette de Silena se dessina dans l’ombre bleutée de la porte, tenant un seau dont elle propulsa le contenu avec énergie dans le passage, et qui se répandit à moins d’une coudée de mes pieds.
Bien qu’elle se soit quelque peu épaissie, je l’ai reconnu aussitôt. Malgré quelques mèches blanches éparses dans ses cheveux châtains, malgré quelques rides qui n’étaient autres que celles de rire, malgré la dureté de la vie, elle respirait toujours autant la santé. Ce ne fut qu’après un court instant, plantant son regard vert au fond du mien qu’elle me reconnut étouffant à peine un cri de stupeur.
— Seigneur Dieu ! Arthus ? Mon Arthus ? s’exclama-t-elle.
Elle déposa lentement son seau à ses pieds, puis elle s’essuya les mains sur son tablier blanc, réajusta son bliaud, sa coiffe et s’approcha doucement. Nous tombâmes dans les bras l’un de l’autre. Elle tremblait d’émotions.
— Arthus, dit-elle d’une petite voix, quel beau jeune homme tu es devenu !
Puis elle ajouta, le sourire jusqu’aux oreilles :
— Tu es parti depuis des lustres, et je t’accueille en te jetant un seau de merde à la figure, s’esclaffa-t-elle, retrouvant sa haute voix stridente qui faisait pisser d’effroi sur place chiens et chats.
— Entre, viens te reposer.
En franchissant la porte, je retrouvai la pièce aux dalles grises, plates et polies au sol, où se mêlaient de douces odeurs de pain, de bois et de champignons. La cheminée centrale, dans laquelle rougeoyait un lit de braises qui ne demandait qu’à reprendre du service, n’avait pas changé. Mise à part la couche de suie au plafond qui s’était étendue, j’avais l’impression d’avoir quitté cette pièce à peine une lune auparavant. Les meubles étaient identiques, tout au plus les avait-on changés de place. En l’espace d’un instant, Silena sortit un tabouret, raviva le feu et m’offrit un pichet d’eau et une tranche de pain.
— Alors, raconte, me pressa-t-elle.
Tout en mordant dans la tranche de pain encore chaud, je lui racontai mon voyage, sans entrer dans tous les détails.
À son tour, elle résuma les faits marquants des quinze dernières années. Elle m’apprit la mort de son ami d’enfance emporté par une épidémie de fièvre lente quatre ans auparavant, celle du chien Tibur, de vieillesse.
Elle avait finalement épousé le Jeannot après mon départ. Ils eurent une fille Matilda, âgée de treize ans aujourd’hui, que je ne connaissais donc pas, et qui était employée à l’intendance de la forteresse où elle vivait désormais. Quant à elle, elle continuait à tailler des barbes.
— Veux-tu que je te la taille ? demanda-t-elle en lâchant un rire sonore. Quand tu es parti, tu n’avais encore que trois poils au menton !
Je ne pus évidemment pas refuser. Tandis qu’elle passait le savon sur ma barbe, une scène enfouie au plus profond de ma mémoire me revint à l’esprit. Cela s’était produit à cet endroit même. Alors que Silena me coupait les cheveux, elle s’était penchée vers moi. Sa tunique s’était ouverte et laissait entrevoir sa gorge et sa poitrine. J’avais alors porté la main dans l’échancrure et caressé son sein. Elle s’était figée, mais elle m’avait laissé la toucher. Elle avait passé sa main entre mes cuisses. Un moment plus tard, elle me chevauchait, son bliaud retroussé, mes mains agrippées à ses hanches, les siennes accrochées au dossier de ma chaise.
Une fois l’acte accompli, dans son regard, se disputait plénitude et culpabilité. Elle affirmait qu’elle irait se confesser et m’incita fortement à faire de même.
Je n’en fis rien.
Fut-ce la façon dont elle rapporta les faits à l’abbé Godemar ou, ce qui renforça mon ego, le plaisir que lui avait apporté notre relation charnelle, toujours est-il que sa pénitence avait dû être toute relative, car elle succomba au péché de fornication de nombreuses fois. À partir de ce moment, elle prit en charge mon éducation sexuelle, toutefois sous le sceau du secret.
Qu’elle se souvienne de ces moments, cela ne faisait aucun doute. Qu’elle prenne plaisir à se les remémorer, c’était une autre histoire. Bien qu’elle ne portât plus le deuil de son mari et qu’elle fut libre, nous avions tracé chacun notre route.
Le sujet du cœur fut cependant abordé au moment du repas.
— Alors, dis-moi, tu n’es toujours pas marié, je suppose ? m’interrogea-t-elle en me servant une miche de pain et une écuelle de bouillon.
— Non, mais j’ai mis en pratique que ce que tu m’as appris, lui répondis-je en souriant d’un air faussement coupable.
— Savoir s’y prendre avec une femme, c’est une chose. Être la bonne personne pour faire sa vie avec, c’est une autre. Je t’ai appris la première, à toi de savoir si tu as la seconde en toi.
— Je ne sais pas.
— En plus, quelle jeune fille à marier pourrait résister à un bel homme comme toi ?
— Si tu le dis. Mais, toi, où as-tu appris toutes ces choses de l’amour ?
— Ça, c’est mon secret à moi.
Elle baissa la voix,
— Si cela se savait, il faudrait que je passe des semaines à me confesser.
Elle éclata aussitôt d’un rire à en faire trembler les murs.
— Qu’ils aillent au diable tous ces moines, m’emportai-je. J’ai rencontré des peuples croyants et pour qui les relations charnelles ne posaient pas autant de problèmes que dans la chrétienté occidentale.
— Tiens ta langue ! chuchota-t-elle l’air fâché, si tu ne veux pas finir au pilori. Et puis, ces peuples barbares dont tu parles et auprès desquels tu as vécu ne connaissent pas les Saintes Écritures.
Elle se signa.
— Je ne parle pas seulement des peuples barbares. Et d’ailleurs, leurs textes religieux sont aussi très riches, répliquai-je.
— Croient-ils seulement en Notre Seigneur ?
— Notre Seigneur ? Dieu n’appartient à personne. C’est le dieu de tous les hommes sur terre.
— Bon, si tu préfères, croient-ils au même Dieu que nous ?
— Ce n’est pas si simple, je pense que c’est le même Dieu, mais avec un nom différent, une représentation différente.
— Blasphème, lança-t-elle avec un air de défi. Dieu est unique !
Elle se signa de nouveau.
— Cela n’empêche pas, il est peut-être unique et polymorphe à la fois.
— Poly… quoi ?
— Cela signifie qu’Il peut prendre plusieurs formes différentes, celle d’un être humain, d’un animal, d’un arbre, ou de toute autre chose, mais Il est la même Entité.
— Entité ? répéta-t-elle d’un air perplexe. Bah, peu importe, Il est toute-puissance.
— Veux-tu alors répondre à cette question ? Dieu peut-il concevoir une pierre qu’il lui serait impossible de soulever ?
Silena haussa les épaules, l’air dubitatif. Je poursuivis.
— Si la réponse est positive, Sa puissance est limitée : il existe une pierre qu’Il ne peut soulever. Si la réponse est négative, alors Son pouvoir de création est limité, dans tous les cas, Il ne peut pas être omnipotent.
— Tu blasphèmes encore, soupira-t-elle.
— Blasphémer serait s’appuyer sur cette logique pour mettre en doute Son existence ou me moquer de Lui, ce que je ne fais pas.
— C’est au cours de tes voyages que tu es allé chercher tout ça ?
— Chez certains peuples, qui ne vivent pas si loin d’ici, la pensée philosophique est très prolifique en ce moment.
— Oh, ce que racontent les philosophes, dit-elle en levant les yeux au ciel. Et alors, comment tes philosophes font-ils pour ne pas remettre en cause Son existence ni se moquer de Lui ?
— Je ne sais pas. Ils diraient par exemple que Dieu est partout au-dedans et au dehors de la matière puisqu’Il en est le Créateur. Par conséquent, Il n’a pas besoin de soulever quoi que ce soit.
— Ah, tu vois, le bon sens reprend le dessus, triompha-t-elle.
— Dieu n’est pas l’Être sévère, vengeur et impitoyable que le clergé veut bien souvent nous faire croire. Il est bon, bienveillant et surtout, Il ne juge pas les hommes. Tout ceci pour dire que dans certaines régions du monde la fornication, comme tu l’appelles, n’est pas répréhensible, parfois même encouragée.
— Dans certaines régions du monde peut-être. Ici, si, elle est répréhensible ! Surtout depuis que le père Anselme est notre abbé.
Silena resta silencieuse un moment.
Elle changea de sujet.
— Tu sais, je n’ai pas cherché à me remarier après la mort de mon Jeannot, me dit-elle doucement en chassant de son bliaud une miette de pain imaginaire.
— Les prétendants n’ont pas dû manquer.
Silence à nouveau.
— Tu restes longtemps ? demanda-t-elle, faisant mine de ne pas relever.
— Je n’ai pas encore trouvé une raison valable pour partir, dis-je en souriant.
— Bien. Sais-tu où dormir ?
— Je vais sans doute aller à l’auberge. C’est toujours le vieil Adémar qui la tient ?
— Son fils. Son père est trop vieux et sénile.
Le silence se fit de nouveau.
— Tu sais, tu peux t’installer à la chambre à l’étage.
— Tu ne t’y es pas installée ? demandais-je. Tu l’aimais bien pourtant.
Elle éluda à la question.
— Je m’installerai sur la paillasse dans la cuisine. Ce sera plus convenable. Alors tu restes ? me questionna-t-elle de manière purement rhétorique.
J’acquiesçai.
4
Si Salon s’était considérablement agrandi depuis mon départ, le vieux quartier n’avait que très peu changé. Ma seconde visite, après Silena, fut pour Melchion, le forgeron. Lui aussi il ne fut pas long à me reconnaître. Il posa son marteau pour me faire l’accolade.
Avec le temps, le forgeron s’était ridé et voûté, mais sa voix n’avait pas changé. Son geste était le même, toujours aussi mesuré et précis.
Étant enfant, je passais de longues heures à regarder le fer se tordre sous les coups répétés de son marteau. Melchion m’avait longuement expliqué son art. Le minerai de fer était d’abord fondu en lopins. Ces mêmes lopins étaient donnés aux forgerons qui, à force de bras, les transformaient en barres, en fer battu, puis en pièces plus ou moins menues. Il n’y avait aucun autre moyen, disait-il, que par un corroyage répété de faire acquérir au métal ténacité et souplesse, et surtout une bonne tenue au feu pour les ouvrages de soudure. Le secret, m’expliquait-il, résidait dans l’emploi du feu de charbon de bois qui permettait de transformer les barres en fer battu tout en leur donnant les qualités requises pour la forge.
Il m’aurait presque convaincu de devenir moi-même forgeron tant il parlait de son métier avec enthousiasme et passion. Jusqu’au jour où, Melchion m’ayant laissé seul un moment dans sa forge, il me prit l’irrésistible envie de saisir le fer du mauvais côté. La couleur rouge du métal chauffé m’avait pourtant paru bien engageante, même si le forgeron m’avait bien dit de ne jamais faire ça.
Je n’avais fait qu’appuyer la main sur le métal ardent, mais suffisamment pour que la peau de la paume y reste collée. Je me souvenais encore de la vive douleur qui ne cessait pas, bien que j’eusse retiré prestement ma main. Mes cris suffisaient à expliquer ce qui s’était passé.
À la douleur s’ajoutait la crainte de me faire vertement réprimander pour ne pas avoir écouté les consignes du maître des lieux. Au contraire, Lili, l’épouse de Melchion, m’avait réconforté avec des galettes aux amandes et au miel, non sans m’avoir fait passer la main sous l’eau glacée de la fontaine au milieu de la place du village pendant un temps qui m’avait paru aussi long qu’une messe.
Se sentant un peu coupable d’avoir relâché sa surveillance un moment, Melchion se justifiait. « C’est le métier qui rentre », expliquait-il aux passants attendris de voir un marmot se promenant avec une main enveloppée d’une bande de tissu et le pouce de l’autre dans la bouche. Cet incident mit un terme définitif à ma carrière de forgeron et j’évitai la forge pendant quelque temps.
Pourtant, quelques années plus tard, je revins passer du temps avec Melchion. Il s’était un moment intéressé à la serrurerie. Puis, il avait abandonné, car le corroyage du métal lui prenait trop de temps. Par ailleurs, la filière commençait à être très encadrée par les baillis, car posséder la clé de la serrure que l’on a soi-même fabriquée pouvait mener à des marchandages très douteux. Cependant, pour se faire la main, il avait fabriqué trois ou quatre spécimens dont j’étudiai le mécanisme avec attention.
Je racontai une fois de plus brièvement mon périple et m’enquis des nouvelles de la famille du forgeron. Lili lui avait donné une fille qui mourut à la naissance, puis un fils qui était aujourd’hui dans sa dixième année. Melchion espérait sincèrement qu’il prendrait un jour sa suite à la forge, si Dieu le permettait.
Les affaires étaient subitement devenues difficiles avec l’arrivée de l’abbé Anselme. Le village avait fortement grandi, et d’autres forgerons étaient venus s’installer, ce qui en soi n’était pas une mauvaise chose tant le travail ne manquait pas. Mais l’abbé souhaitait organiser les choses à sa manière.
Alors qu’il avait décidé de remplacer les pentures du portail de l’église, il était venu consulter Melchion, dont nul n’ignorait que toutes les pentures du village étaient passées par sa forge. L’abbé avait alors proposé de faire concourir les trois forgerons du village, ce à quoi Melchion n’avait rien trouvé à redire. Il trouvait même cela plutôt juste. Il s’était aussitôt mis au travail et avait esquissé à la craie son projet sur de grandes dalles en ardoise que Sauveur le charpentier lui avait prêté pour l’occasion.
Lorsque l’abbé était revenu le voir quelque temps plus tard, il avait trouvé le projet très abouti et remarquable dans sa finition. Les trois forgerons devaient présenter leur projet le jour de la réunion de la guilde des marchands en présence des huiles du clergé local. Mais la veille de la présentation, les planches de Melchion lui furent volées.
C’est donc les mains vides qu’il se présenta malgré tout devant son jury. Il plaida sa cause, expliqua qu’il avait été victime d’un vol, s’empêtra dans ses explications. Il ne réussit qu’à se disqualifier davantage. L’abbé Anselme alla jusqu’à douter de sa bonne foi en public. Melchion s’offusqua et jura qu’Anselme lui-même avait vu ses plans. L’abbé, piqué au vif, le prit de haut. Il accusa Melchion d’être mauvais joueur et de vicier l’esprit de la compétition en le faisant passer, lui l’abbé Anselme, pour corrompu. L’infortuné forgeron fut jeté hors la salle, non sans avoir essuyé rires et quolibets.
Seuls les anciens du village savaient qu’il disait vrai.
Mais, le comble était encore à venir. Lorsqu’il reconnut son propre dessin dans les pentures qui avaient été fraîchement installées sur le portail de l’église, Melchion rentra dans une colère folle. Il retourna à sa forge et se saisit de son marteau pour régler ses comptes avec son rival et l’abbé Anselme.