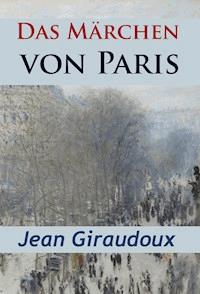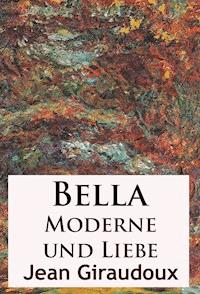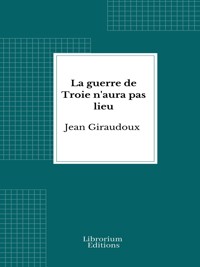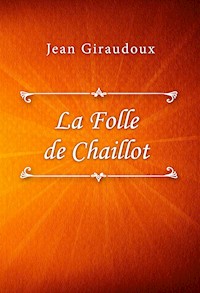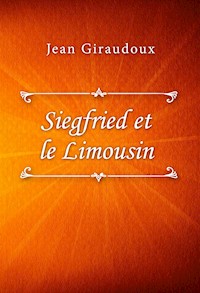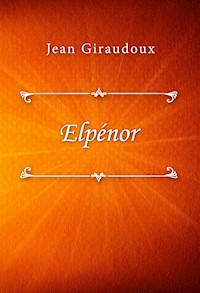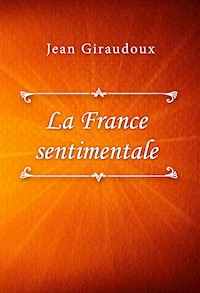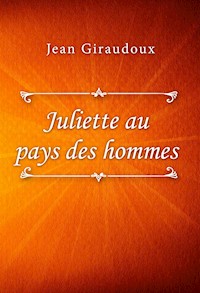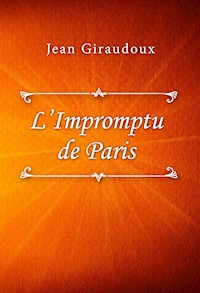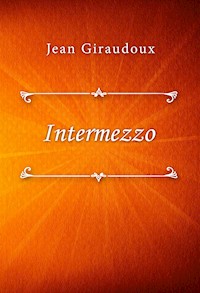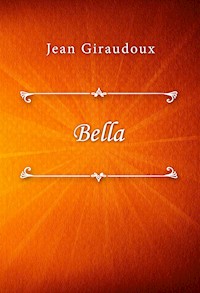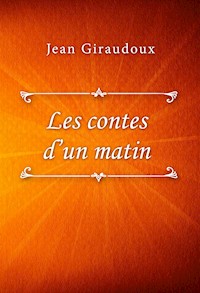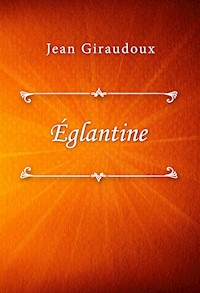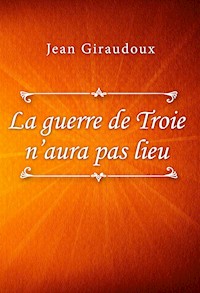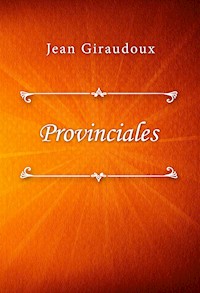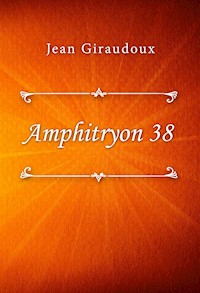1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Las de sa situation, de son tranquille bonheur conjugal, un bonheur ordinaire aux côtés d’une épouse ordinaire, las surtout de lui-même, homme ordinaire dans une existence ordinaire,
normale, besogneuse et tracée par les autres, Jérôme Bardini prépare soigneusement son évasion de la
normalité. Il décide de changer d’identité en abandonnant femme et enfant, travail et amis. Il part et n’emporte rien.
Basculant dans une autre existence, entre vagabondages et errance, il fait l’expérience d’une forme de liberté absolue, improvisant sa nouvelle vie, devenant par exemple
l’Ombre pour Stephy, rencontrée quelque part dans Central Park, à New York, qui a failli le considérer dès le premier abord comme un nouveau Messie… Dans une sorte de pacte tacite, ils parcourent les allées de Central Park, nagent dans l’océan, sans jamais révéler leur identité, presque sans paroles, chacun voulant garder intact le mystère de l’autre. Stephy protège sa liaison avec
l’Ombre, qui prend de plus en plus d’ampleur, par des subterfuges multiples et met au point un faux mariage avec le Jérôme Bardini nouveau, suivi d’un séjour paradisiaque au bord d’un lac canadien. Et Stéphy elle-même, au comble du bonheur, est prise par le démon de la fuite. Afin de préserver leur amour du poids de l’avenir et de l’usure du temps, elle quitte Bardini pour revenir à la
normalité qu’elle lui avait sacrifiée.
Le lecteur, à ce stade du roman, n’en est pas à sa dernière surprise, car Jérôme Bardini lui-même, du côté des chutes du Niagara, croira avoir rencontré un nouveau messie en la personne du Kid, enfant amnésique et en fuite lui aussi ; et il se demande si le temps est enfin venu de « l’homme qui nous libérera de l’homme »… Mais la réalité aura tôt fait de les rattraper.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1930
Copyright © 2022 Classica Libris
PREMIÈRE DISPARITION DE JÉRÔME BARDINI
Une voiture passa au grand trot. Bardini, qui dormait, ouvrit les yeux.
– C’est le courrier, pensa-t-il. Naturellement, il va prendre le galop au pont.
Il entendit en effet le cheval changer de pas, galoper, s’arrêter soudain…
– Évidemment Bavouzet lui a fait signe, pensa Bardini… Il veut lui vendre quelque gibier. Ce ne devait être que des cailles. Il repart déjà.
Un vent léger souffla. La girouette grinça.
– Elle grince. C’est un vent du sud, pensa Bardini.
Il essayait en vain, dans il ne savait quel dernier recours, de trouver autour de ce réveil – de son dernier réveil dans cette maison, c’était bien décidé – un bruit, un signe inconnu, un appel qui atteignît en lui autre chose que des habitudes. Mais la fatalité ne cherchait pas, par le minimum de fantaisie, à retenir Jérôme Bardini dans sa vocation de receveur de l’enregistrement et de Bardini. L’angélus sonnait. Chaque coup de cloche oblitérait de séculaire cette heure qui passe pour neuve. Un rayon de soleil, le même, le même depuis des années, tout luisant de la banalité de la lumière du monde, chargé de poussières dont chacune était reconnaissable, traversa la persienne. Bardini se leva. Il eut le désir de se lever autrement que les autres matins, d’un geste différent. Il crut y réussir… Un sentiment de découragement lui révéla que c’était bien son pied gauche, comme toujours, qui avait touché le premier le sol… le sol, si l’on peut appeler ainsi une descente de lit où la trace de ce premier atterrissage quotidien était marquée aussi profondément que des pas d’ours dans une cage. Il ouvrit les volets. L’aube crut lui livrer la campagne. En fait, ce n’était pas la campagne, c’était une espèce de récitatif, de motif immuable. La campagne n’attendait que le geste de Bardini pour réciter, et sans faute, ce monologue. La science qu’il avait de chaque arbre, de chaque champ, de chaque village donnait à la nature un caractère déclamatoire insupportable. Jamais cette satisfaction repue des choses ne l’avait atteint comme aujourd’hui. Pas une maison touchée par le soleil dont il ne connût le propriétaire. Pas un de ces propriétaires endormis dont il ne sût, puisqu’il était agent des finances, non seulement ce que l’on pouvait tirer de lui en argent, mais aussi en sympathie, en humanité, en larmes. De sa fenêtre, il voyait tout le cirque de la Seine naissante. Fausse naissance, quotidienne comme un journal… Vrai cirque, fermé ce soir, après une dernière et brève représentation, à tout jamais !
– C’est pour aujourd’hui, pensa-t-il.
Mais sa pensée lui semblait tenir à hier, à avant-hier, au passé, à tout ce qu’il voyait là par la fenêtre. Lui aussi redisait un monologue. Le temps et l’espace s’accordent admirablement pour retenir l’homme qui s’évade. Il eut recours à la parole, la pensée étant soudoyée par eux.
– C’est pour aujourd’hui, dit-il, tout haut.
Il avait raison. Sa parole était certainement ce qu’il avait le moins entendu, de soi-même, le moins écouté aussi, ce qu’il sentait de plus indépendant de sa vie. Il parla encore, face à la campagne, pour ne pas réveiller sa femme.
– Tout cela est fini, fini !
Il s’était entraîné à la pensée de son évasion, de son assaut sur l’inconnu, comme à celle d’un véritable assaut. Il s’était massé, soigné. Il avait évité tout rhume, toute égratignure. Il s’était rasé avec plus de précaution. Il ne voulait pas reparaître dans une nouvelle existence avec des tampons d’ouate ou du sparadrap apportés de l’ancienne. Il avait même fait quelques exercices de gymnastique. Sa femme s’en réjouissait. Elle lui avait souvent reproché de se laisser rouiller… Elle avait même voulu l’imiter. Mais voir cette femme s’entraîner pour répéter avec plus de force les mêmes gestes, dire avec plus de santé les mêmes éternelles phrases, serrer d’une étreinte plus vigoureuse les mêmes éternels parents, cela l’avait peiné et il avait abandonné l’exerciseur. Il avait voulu bien se nourrir ; peut-être que dans un avenir proche il allait avoir faim, soif ; il fallait prendre ses précautions. Mais Renée là encore l’avait suivi. Pour cette vie à laquelle elle ne prévoyait pas de variantes et qui se suffisait si bien du poulet et des pâtes, elle avait voulu prendre de la phosphatine, de la kola… Il avait cessé… Depuis vingt jours que sa décision de disparaître était prise, tout ce par quoi il s’entraînait à se séparer du passé, sa femme l’avait employé à s’y joindre. Jusqu’au bébé qui avait profité de ces nouvelles habitudes. Ce mimétisme confiant de Renée et de l’enfant dénaturait les gestes de Jérôme. Sa dissimulation n’était plus ainsi qu’hypocrisie. Il en aurait pleuré !… Même aventure en ce qui concernait son métier. Toute cette semaine, la mémoire de Bardini hésitait, distraite par la résolution prise ; il trouvait moins facilement les dossiers, écrivait moins bien les quittances. Sa signature se modifiait, présage heureux d’ailleurs pour qui veut changer de personnalité. Renée au contraire, qui remplaçait le premier commis en vacances, ne faisait plus aucune erreur, écrivait enfin, ce qui lui arrivait jadis uniquement pour les lettres du premier de l’an, d’une façon lisible. Tout le passé se cramponnait déjà à l’une des deux parts de ce couple, sans voir que sur l’autre il se desséchait. Bardini quitta la fenêtre, se retourna vers sa femme, la regarda. Elle s’était laissé glisser au milieu du lit abandonné par l’époux. Il la regarda longuement, ainsi qu’il avait regardé sa campagne. Il éprouvait la même peine, et la même satisfaction. Il avait tellement redouté qu’êtres et choses, ce matin fatidique, à ce dernier réveil, lui apparussent soudain dans une lumière fraîchement inventée, sous un aspect inusité. Pour la lumière, il était fixé, rassuré. À trois cent mille kilomètres à la seconde, l’immuable aveuglait les regards de Bardini. Voilà qu’il l’était aussi pour Renée endormie – on ne voyait pas les yeux, mais il en répondait – pour Renée sans fard, mais ointe et maquillée de connu, dont le souffle imperceptible atteignait le tympan de Bardini plus durement qu’un ronflement sonore. Pas un jour de sa chemise, pas un pli de ses paupières, pas un feston de son sommeil qui fût nouveau. C’était à douter du tréfonds du sommeil, à douter de l’inconscience… Ce qu’il y avait malgré tout de plus neuf dans cette maison, c’était encore ce qu’elle contenait de plus neuf par ordre chronologique, c’était l’enfant. Il le verrait tout à l’heure.
Il passa dans le cabinet de toilette, prit sa douche. Nu, il eut un sentiment de bonheur qui justifiait, lui sembla-t-il, sa conduite. Cette simple chemise de nuit, il s’en défit avec dégoût, il fut plus soulagé de l’avoir rejetée que de déposer, après un long combat, son armure. Fini le combat contre l’obscurité sue par cœur, contre les ténèbres hantées d’habitudes. Ah ! certes non, il n’emporterait aucun objet, aucun souvenir, aucun linge. Ainsi nu, il sentait déjà diminuer cette colonne d’airain qui pesait depuis des mois sur ses épaules. Sa chemise à terre, il jouit de cette naissance adulte. Il se frotta d’un savon acheté au hasard pour enlever de lui tout contact avec la veille, avec cette fougère et ce chypre dont Renée avait parfumé pour toujours, par lotions et par pâtes, leur union ; il frotta doublement ses mains qui avaient tellement touché le passé. Il s’assit nu sur une chaise, s’étendit nu sur le tapis, essaya à vide sa liberté, se réjouit de n’avoir aucun grain de beauté, aucun tatouage. Puis, pour quelques heures, il se rhabilla, négligeant de mettre son gilet, comme les jours où il allait au bain. Il était rassuré. Il avait eu l’appréhension ce matin de trouver son corps lui-même un objet trop familier, trop semblable, d’en être las. Cela eût été fâcheux. Cela lui eût donné à croire que son mal était simplement de la neurasthénie, et non point une ambition effrénée, l’ambition de changer l’aiguillage même que le destin avait donné à sa vie. Mais, tout à l’heure, quand il s’était vu dans la glace, rien ne lui avait paru plus neuf, plus ambigu même que ces yeux dont il connaissait chaque veinule, que ces dents, que ces morceaux insensibles d’ivoire dont chacun était lié à lui par des souvenirs et des souffrances. Il n’allait pas partir avec ce compagnon veule et traître qu’emportent les solitaires malades. Sa vie nouvelle éclatait déjà sur lui dans le miroir. Quel dommage que le miroir lui-même eût une histoire !… Juste celle de son mariage… Il s’y était vu fiancé ; il s’y était regardé, il s’était rasé devant lui, le lendemain de ses noces. Le premier poil, la première moisissure de sa vie de mari, il l’avait coupée devant cette glace… Voilà, il coupait la dernière…
Il passa dans son bureau, ouvrit là aussi les volets, répandit là aussi la suprême journée à pleins flots sur les papiers, la table. Il éprouvait un plaisir à accomplir pour la dernière fois ces actes quotidiens. Pour la dernière fois à ses oreilles, le crochet de la jalousie grinça. Le mot jalousie le fit sourire. Le mot jalousie allait sans doute changer de sens dans sa nouvelle existence. Ce calembour, ce mot qui se travestissait lui fut une promesse. Les servantes s’étaient absentées pour deux jours. Il regrettait d’abandonner Renée dans un moment où le personnel était ainsi défaillant, commis et bonnes ; les bourgeois en jugeraient deux fois plus sévèrement sa conduite, mais il était dispensé du moins de comédie suprême jusqu’à ce que sa femme fût levée. Il vivait dans cette maison comme un vagabond qui s’est introduit pour une heure dans une villa, avec une légèreté, une souplesse qu’il ne soupçonnait pas, presque sans bruit. Il écrivit sa lettre de démission au directeur de Chaumont. Il signa. C’était la dernière fois qu’il signait son véritable nom ; il le calligraphia, lui enlevant presque, malgré lui, l’aspect d’une signature. Un liseur d’écriture n’eût, à l’examiner, rien trouvé de personnel dans Jérôme Bardini. Il fut un peu honteux de ne pouvoir écrire à sa femme qu’une lettre banale. Tout ce qu’il avait habituellement d’émotion et d’invention paraissait avoir déjà émigré et rejoint dans l’arbre creux, près de la rivière, les vêtements qu’il prendrait tout à l’heure et qu’il n’avait pas voulu amener à la maison, pour qu’ils ne puissent prendre à aucun degré le relent de sa vie ancienne. Il termina quelques travaux de bureau en retard, collationna pour la dernière fois de sa vie les Rôles de Communes, numérota les Articles de Comptes, pour la dernière fois fit sa caisse. Il fut surpris de constater que c’étaient ces travaux, auxquels parfois il attribuait sa révolte et sa décision, qui justement lui paraissaient les moins insupportables. Puis le facteur arriva : pour la dernière fois il recevait le courrier de sa première vie.
Il y avait un nombre inhabituel de lettres. Le sort semblait avoir eu vent des intentions de Jérôme Bardini. Il se demanda s’il allait les déchirer sans les lire. Il examinait les enveloppes. Son cousin. Une amie de sa mère. Son marchand de vins. Une lettre aussi d’une écriture inconnue. Quel pouvait bien être ce personnage maladroit qui tentait de pénétrer dans la vie de Bardini juste le dernier jour ? Après tout il était plus loyal de lire, de n’abandonner qu’une vie bien tenue à jour. Son cousin venait d’avoir un fils : la zone d’existence que Bardini désertait assurait son peuplement. L’amie de sa mère, veuve d’un retraité, demandait un conseil pour ses douze cents francs de rentes. Elle ne connaissait que Bardini. Bardini seul pouvait la conseiller, disait-elle, lui éviter la ruine. Il répondait à chaque lettre avant d’avoir ouvert la suivante, en malade qui va mourir. Il passa à la vieille amie le secret de vingt ans d’études financières ; il pensa à Lazare se relevant du tombeau pour donner des tuyaux de bourse à une vieille dame. Le marchand de vins – ah ! il faut vraiment croire à l’éternité pour être marchand de vins – lui conseillait un médoc excellent dans dix années, et – comme s’il se doutait du danger – un vin de Sainte-Foy-la-Grande excellent dès l’arrivée de la barrique. Cela ne suffisait plus pour retenir Bardini, et il prit la dernière lettre. L’adresse était écrite par une femme, le papier était un parchemin, la femme le connaissait mal, il y avait un t à Bardini. Il la palpa, essaya en vain de la déchirer sans la lire, respira son parfum, vanillé. Il se méfiait de ce message que la fortune hypocritement et faussement habillait de liberté et de mystère, peut-être pour le retenir dans le non-mystère, dans le non-libre… Il ouvrit… Une cousine de Renée, de l’île Maurice, Maud de Frazier, qui venait pour la première fois en France, arrivait à Troyes, et passerait déjeuner avec elle et son mari le lendemain. Le péril était en retard d’un jour. Bardini respira…
Renée s’attardait dans son sommeil. C’était bien d’elle. Elle dormirait ainsi le matin de sa mort. Elle s’arrangeait pour diminuer d’une heure au moins, sur son horaire habituel, le dernier jour passé avec ce mari qu’elle adorait. L’enfant par contre s’agitait, d’une heure en avance. Il criait. Il poussait ses derniers cris d’enfant non orphelin. Bardini voulut le calmer ; dans son désir de voir se prolonger le sommeil de Renée, pour la première fois le prit, pour la première fois sentit sur ses mains les larmes de l’enfant. L’une d’elles coulait sur la joue, bien gonflée, pure. L’enfant souriait à son père, ne bougeait plus. La larme semblait née non plus du désespoir, mais du calme. Elle était devenue comme tout chagrin d’enfant au bout d’une minute, un signe de bonheur. Elle tremblotait. Elle allait glisser. Ce n’était pas une larme à boire en 1937 ou en 1929 ou demain. Larme salée, acidulée, une larme de grande personne. Peut-être que tout ce qu’il aurait eu de cet enfant eût été ainsi amertume. Il se sentit lâche, non point devant le bonheur qu’il abandonnait, mais devant les malheurs qui pouvaient surgir de ce fils… C’est du malheur, Bardini le sentait, qu’on se sépare avec le plus de peine. L’enfant était nu. Au fond de ses yeux, les couleurs broyées par les générations de Bardini et de Frazier s’étalaient, horizon familial libéré par les larmes de toute poussière ; le passé et l’avenir semblaient à un pas, à lire dans ces yeux clairs. La petite main avait le geste familier aux mains des Bardini, l’index et le pouce ouverts, les autres doigts fermés ; on avait toutes les peines du monde à faire croiser les mains aux Bardini décédés. Des ressemblances familiales balafraient à chaque mouvement le visage, et jusqu’à ces hanches, qu’il n’avait pourtant vues nues sur aucun autre membre de la famille. L’incisive de face poussait et c’était déjà la réplique de l’incisive de Renée. Déjà, dans cette chair à peine formée poussaient, aux places sacrées des gencives, ces petits dolmens de longévité. L’enfant maniait comme une arme déjà familière le doux et tranquille regard de Renée. Il avait déjà les cheveux de Jérôme… Ainsi c’était là celui qui allait désormais devant la carence de son père, poursuivre sur la terre le destin officiel des Bardini. C’était à cet être encore sans paroles, mais dont les cris avaient déjà l’accent de famille, qu’il léguait tout ce dont il ne voulait plus, ses anciennes richesses, ses anciens penchants et le portrait du colonel Bardini qu’aimait Bonaparte, et ce don des Frazier pour la comédie de salon, et ce goût des Lacoste, ancêtres maternels de Bardini, pour la musique du XVIIIe siècle… Fini Gluck… Fini Mozart… Finies les flûtes enchantées, les Papagéno, les Papagéna, les missives écrites à deux voix, les déclarations faites à huit cœurs…, excepté pour cet être vagissant… Quelles consignes donner à cette sentinelle du devoir familial qui ne savait pas marcher ? L’enfant le regardait, encore incertain de ce qui allait l’intéresser sur ce grand visage, d’un regard encore incolore contre lequel Bardini appuya son regard. Évidemment, une autre solution de la vie lui apparaissait, encore étendue sur cette mousse brune et verte des jeunes prunelles, comme un frai sur des algues. Pourquoi voulait-il faire de soi-même un fils, alors qu’il avait celui-là ? Pourquoi lancer contre le bonheur, sous un faux nom, de faux habits, en dérogation à toutes les règles de la chevalerie, dans une supercherie dont le sort d’ailleurs ne daignerait peut-être pas s’apercevoir, ce Bardini presque quadragénaire qui n’avait pas réussi dans son premier tournoi, alors qu’un autre était déjà là, tout prêt, de chair pure, et qu’il eût été passionnant de l’élever, de l’armer, de le sacrer. Peut-être, si son père à lui ne s’était pas spécialisé dans les collections de tabatières et l’étude des molécules du fer, disparition du premier degré, Jérôme aurait-il tiré meilleur profit de l’existence. En se précipitant dans la vie du geste de Parsifal, mais sans virginité, en se dirigeant vers les bons endroits du destin, avec l’expérience pour guide et non l’aventure, en offrant comme nouvelle à des printemps ignorants, à des villes ignorantes, sa jeunesse maintenant coriace, à des jeunes filles surprises sa passion pour toujours émoussée, il frustrait cet enfant dont la vue le convainquait d’hypocrisie vis-à-vis de soi-même. Car c’était là dans la maison, malgré tout, une nouveauté. Car tout de cet enfant chaque jour était neuf. La preuve, c’est que cela eût intéressé Bardini de partir avec lui ; aucune aventure d’homme n’est rendue impossible ou n’est diminuée par un enfant d’un an en surcharge. Il eût fallu en somme que ce qu’il rêvait, dans ces moments de cruauté qui changent tout d’un coup la chair des êtres en un métal ingrat, arrivât : que Renée mourût. Il aimait Renée, il se sentait coupable de lui vouloir le moindre mal, mais il sentait son amour même augmenter de l’idée de cette mort. Le plus malheureux des êtres, David Copperfield, qui perdit sa femme enfant avant d’avoir sa femme femme, ah ! qui pourra dire son bonheur ! Il avait passé des mois dans cette hantise, alors qu’il n’avait pas encore l’idée de sa disparition, donnant avec angoisse Renée au voyage et au train comme à un accident inéluctable, ne séparant plus aucun des actes de Renée de ses pires conséquences, la baignade de la noyade, l’excursion de la chute, la visite au Creusot de la glissade dans la cuve de fonte en fusion. Dès qu’elle s’absentait, il attendait le télégramme… Mais l’enfant maintenant s’agitait, appelait. Dans son désir de ne pas retirer Renée du sommeil, mort journalière, mort éphémère, il s’occupa de lui, donna le biberon, pour la première fois, le changea. Bientôt fatigué de cet écart dans un domaine maternel – non, jamais il n’userait plus tard du travesti – il reporta l’enfant dans le berceau, essaya doucement de lui fermer les yeux. En vain : les paupières se relevaient lentement ; les prunelles le suivaient, et comme il se retournait il vit aussi, qui le regardaient avec surprise, mais tendrement, les yeux vert et brun de Renée.
Quatre yeux qui vous regardent, c’est beaucoup pour qui trouve déjà les arbres, la maison elle-même trop clairvoyants. Quatre yeux qui vous admirent, qui sont pleins d’une reconnaissance infinie pour vous parce que vous avez pour la première fois, vous père, donné le sein à votre fils, c’est beaucoup pour qui a la conscience d’être traître et égoïste. Renée éclatait de cette beauté qui la saisissait brusquement dans toutes les périodes où le déclin envahit jusqu’aux jeunes femmes, au réveil, dans la fatigue, les départs, les malaises. Il avait adoré autrefois cette inversion de la beauté chez Renée, seule femme dont l’amour vieillissait le visage, puis s’en était lassé. Il s’était lassé de ce visage toujours si beau le jour des grosses erreurs de caisse, du croup de l’enfant. Quelle beauté n’allait pas le prendre cet après-midi ! Tout l’été pour Renée allait être malaise, croup, nostalgie : pas de laideur possible d’ici l’automne ! Les deux grands yeux ne le quittaient pas, s’étonnant du menton déjà si bien rasé, des cheveux coupés courts et frais, trouvant un air de fiancé à Bardini. Elle se sentait belle. Elle savait que Bardini n’aimait pas ces réveils triomphants de sa beauté. Elle essayait d’en atténuer l’éclat par des pensées de malheur.
– Il me trompe sûrement, se forçait-elle à penser. Il m’aime moins. Il doit s’occuper de son fils quand je dors et le dédaigne quand je suis réveillée. Il doit m’embrasser quand je dors. Je ne suis sa femme qu’une fois par mois à peu près. Il a fait de la volupté une simple preuve physique de notre mariage. Il m’a même oubliée le mois dernier : je suis enceinte de quelque divorce, de quelque séparation…
Mais chacune de ses tristes pensées posait du rouge sur ses joues, avivait ses regards, affinait ses longues mains, lui donnait à tel point ce vernis de tentation qui recouvre les mauvaises femmes dans les conflits avec les saints, les ermites, les croisés, que Bardini était saisi de défiance. Il se demandait s’il allait être brusque, lui répondre durement, l’insulter, par pitié, pour lui rendre la séparation moins pénible. Mais l’idée que ce soir elle serait recouverte d’une attitude qu’il ne lui avait jamais vue, de tristesse, de désespoir, lui donna de l’amour pour cette créature étendue qui était encore tout bonheur, et il lui obéit, il vint s’asseoir près d’elle.
Sur cette margelle d’une vérité qui n’était plus la sienne, au-dessus d’une nudité dont le charme ne l’atteignait plus qu’indirectement, par la vision qu’il avait de sa future femme ainsi étendue (et, car il ne limitait plus le nombre de ses futures existences, de sa future femme ainsi étendue le jour de sa seconde disparition), Bardini regardait Renée. La plus noble raison qu’il avait de partir n’était-ce pas de la laisser ainsi belle, ainsi jeune ? L’âme de Renée était intacte, son corps l’était plus encore, le mariage semblait avoir seulement changé sa virginité de jeune fille en virginité d’épouse. Les élans, les sacrifices, le don de sa dot dans les malheurs qu’il avait eus, le don d’elle-même dans le bonheur, ne provoquaient en elle aucun geste, aucune animation, à peine une douce chaleur. Ce matin, toujours avec cette réserve infinie qui ne lui avait jamais permis depuis ses fiançailles de saisir la première le bras de son mari, de demander ou de provoquer un baiser, elle attendait que Bardini lui prît la main. Ces demi-inclinaisons de tête, ces demi-glissements de la paupière, ce quart de sourire, qui étaient chez elle l’expression déchaînée de la volupté et de l’amour, elle ne se les était permis qu’à l’intérieur d’un édifice de tendresse construit tout entier par son mari. Elle attendait donc. Son mari allait partir pour jamais dans quelques heures ; impassible dans son élan, elle attendait qu’il se baissât vers elle, elle ne rapprochait pas d’un millimètre sa main. Son mari s’embarquait pour une nouvelle série de bonheurs, de malheurs, de désastres ; s’en fût-elle doutée, elle eût attendu qu’il la prît dans ses bras. Lui, pénétré maintenant du parfum de Renée, décidé à s’en laver l’après-midi par une baignade, puisqu’un second bain devenait indispensable, se sentait tenté de s’étendre près d’elle, de prendre congé d’elle comme le faisaient les croisés de leurs épouses, avant cette croisade sans croix vers l’inaccessible. Elle qui devinait tout ce qu’il y avait d’inhabituel dans cette attitude, ce remue-ménage, ce silence, elle, toujours soumise et reconnaissante, vers le corps de laquelle il n’avait jamais, quand il l’avait désiré, par on ne sait quelle merveilleuse habileté de Renée, trouvé d’obstacles, comme les malaises ou la proximité des domestiques, restait souriante, avec aussi peu de mouvement en elle qu’une femme déjà comblée. Le tout commandé par un mélange de doux défi, de dignité, de désir décent, de tous ces noms un peu provocants qui débutent par des dentales… Il s’agissait pourtant là, Renée, d’une séparation éternelle.
– À quoi penses-tu ?
Il dit cela avec un peu de gêne. Renée savait très mal voir les faits précis, mal tirer les conclusions d’événements évidents, mais elle avait en elle de la divination. Au temps où Bardini, au lieu, comme aujourd’hui, d’approfondir sa vie n’avait voulu que l’élargir, et avait eu des flirts, des maîtresses, dans la conversation de Renée apparaissaient à point nommé les noms propres de ses aventures.
– À quoi penses-tu ? Réponds-moi, Renée. Parlons.
Il avait dit ce prénom qu’il avait bien juré de ne plus prononcer. Il rougit.
– Mon prénom te fait mal, Jérôme ? Parlons.
Elle se dressa, n’hésita plus à mouvoir ce corps, puisqu’il s’agissait de parole, elle sentait seulement sa bouche, sa langue un peu endormie dès que la parole était en jeu. Elle se pencha sur Bardini pour cette conversation, elle s’offrit, seins et cou, et joues inclinées, pour cette discussion, donnant pour la parole ce corps qu’elle n’avait jamais approché d’une ligne pour l’amour.
– Tu t’ennuies ici, Jérôme ! Pourquoi ne pas revenir à Paris ? Bella est morte. Bellita ne revient jamais. Nous sommes riches à nouveau. Ne crois-tu pas que nous sommes faits plutôt pour Paris que pour la campagne, l’un et l’autre ?