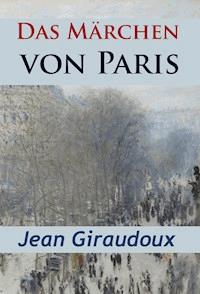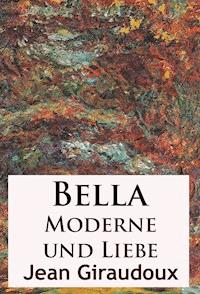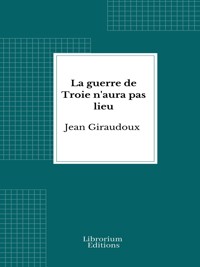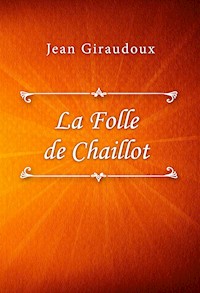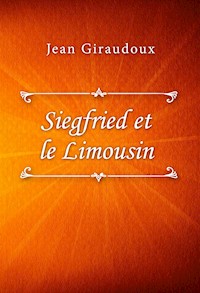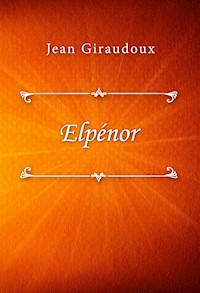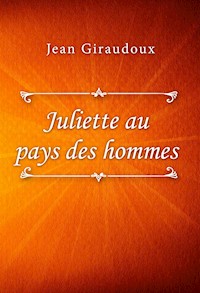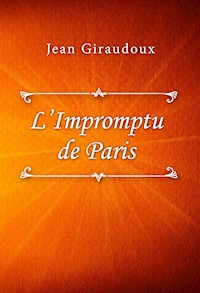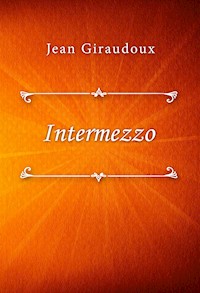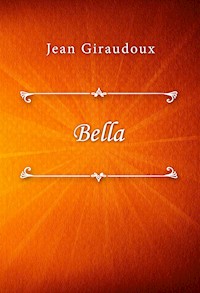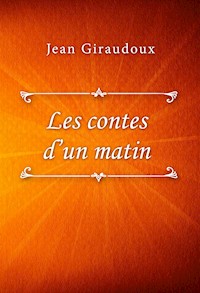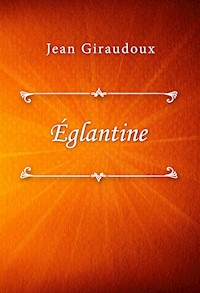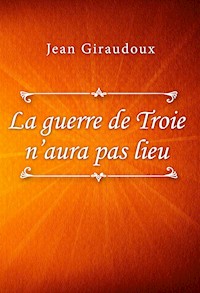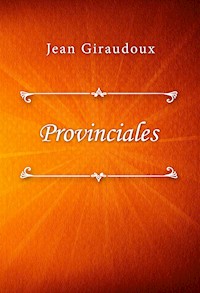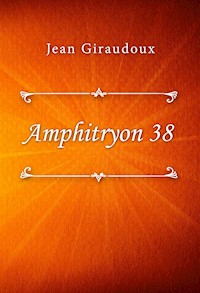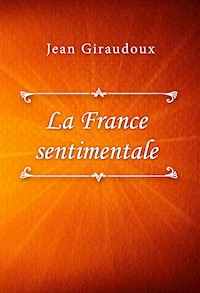
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je présente Bellita : Le pape est décédé. L’occasion, pour Bellita de visiter Gilbertin, le spécialiste des cultes, et le séduire.
Visite chez le Prince : Lors de l’annonce au prince de Saxe-Altdorf du fait que Siegfried est limousin, le prince présente sa revanche : trois descendants de protestants français devenus allemands. Et si la mort leur ôtait leur personnalité germanique pour retrouver un corps français ?
Hélène et Touglas ou les joies de Paris : Hélène la grecque présente Touglas le poète balte, retenu dans sa chambre parisienne par une facture du fémur
. Le Signe : La mort de Dumas, un amis de conscription, doit-elle apporter un signe de la nature pour marquer le deuil de l’auteur ?
Mirage de Bessines : Rémy, le peintre originaire de Bessines, est hanté par la vision de cette ville. Comment s’en débarrasser ?
Palais de glace : Quand tous les amis de sa génération sont morts à la guerre, faut-il se tourner vers plus jeune ou plu âgé que soi ?
Français amoureux aux Jeux Olympiques : Le défilé des jeux ammêne à s’interroger sur la pratique du sport de haut niveau ; laisse-t-elle place à l’amour ?
Attente devant le Palais-Bourbon : Attendre Bella est-ce une frustration ou le plaisir de l’attente ?
Le Couvent de Bella : Bella se refuse, pourquoi pas ne pas la retrouver dans le souvenir de ses années au pensionnat ? Les femmes apprennent-elle le savoir à l’instar des hommes ?
Fontranges au Niagara : Fontranges rend visite à Niagara Falls au fils de Jérôme en train de mourir. Comment arrêter le tapage infernal des chutes ?
Sérénade 1913 : Anne et l’auteur se perdent et se retrouvent par missives interposées.
Un recueil de nouvelles à l’écriture poétique et une errance qui revisite les précédents écrits de Jean Giraudoux.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1932
Copyright © 2022 Classica Libris
JE PRÉSENTE BELLITA
Vers la fin de septembre, les journaux annoncèrent que le pape était particulièrement bien portant, qu’il semblait la santé même, qu’il s’était remis à lire saint Thomas dans une édition à fins caractères, que les pèlerins avaient été frappés du contraste entre ses joues roses et sa robe blanche. Je devinai qu’il était malade. Quelques jours avant la mort de Benoît XV, nos évêques avaient été frappés également par son œil alerte, sa bonne mine, bref, comme avait dit Gasparri, sa bonne tenue terrestre. Il avait bu devant eux un doigt de Jurançon, d’une bouteille offerte par l’évêque de Bayonne, qui la tenait lui-même de Bolo pacha, juste un doigt, mais Henri IV à sa naissance n’avait pas bu davantage. Son teint, en particulier, était signalé vif… Le rose et le vif sont les couleurs de la mort pour les papes… Le pape allait très mal… Je voulus en avoir le cœur net et rendis visite à mon ami Pierre Gilbertain. C’est lui qui était rose, c’est lui qu’un surcroît de vie animait. Cette intempérance d’amour et d’amitié, cette liberté de pensée et de gestes dont il était possédé dans les rares intervalles où la chrétienté était sans chef, où chaque chrétien redevenait la pierre fondamentale de l’Église, pouvait s’appeler Pierre, où son prénom d’habitude incolore redevenait en lui son vrai noyau, il en était déjà envahi. Il m’embrassa. Il m’offrit du Chianti. Le pape était perdu !
C’était presque la première fois que j’avais Gilbertain à mon niveau. Au lycée, pendant les récréations où je le rejoignais, nos classes respectives finies, je le trouvais toujours perché sur la fourche d’un arbre. On n’attrapait pas Gilbertain, on le dénichait. Sa modestie, qui ne lui permettait pas de s’élever en pensée au-dessus du commun avait traduit physiquement son goût de l’élévation. Nous le trouvions installé commodément au faîte des grilles, à mi-hauteur des murs, vivant dans les pays les plus fermes une existence sur pilotis. À la Sorbonne, à l’école de Rome, je ne l’avais aperçu que travaillant dans les bibliothèques au dernier rayon des échelles, allant de Bembo à Machiavel par les corniches, dédaignant de descendre pour cette tâche sans mortier. J’avais l’habitude de lui parler de bas en haut, d’autant plus qu’il était d’une classe supérieure à la mienne, et que tous mes héros, toutes mes héroïnes, ma Bérénice, mon Pascal, étaient pour l’éternité d’un an plus jeunes et plus petits que les siens. Nous ignorions presque sa vraie stature, nous le trouvions toujours plus grand ou plus petit que nous ne l’imaginions. Aujourd’hui, en le voyant juste de ma taille, en serrant ses mains par un geste horizontal, il me semblait que c’était par un effort d’amitié qu’il avait adopté mon niveau. Il est particulièrement agréable en France, parce que cela y est si rare, d’avoir un ami qui pèse votre poids, qui respire l’air à votre hauteur, et d’éprouver cette joie d’égalité humaine que donnent seulement en ce monde des yeux et des regards situés au même plan. Il avait gardé aussi comme moi sa souplesse d’enfance. À travers les morts de pape, les disputes avec Rome, les flirts avec l’orthodoxie, il avait continué, comme moi dans la guerre, dans le journalisme, dans l’amour, à passer chaque soir sa jambe autour de son cou et à toucher son oreille droite de son bras enroulé autour de la tête. Un avenir de beau vieillard nous souriait à tous deux, dès la trentaine…
L’affection nous poussa à choisir – pour la première fois – deux sièges jumeaux.
– C’est exact, me dit-il… Le pauvre pape ne va pas. On me téléphone à chaque heure.
Le comte Vanelli, qui tenait les renseignements du second médecin lui-même, les téléphonait à un cousin de Turin, qui les téléphonait à Lyon, à un abbé gallican, par lequel Gilbertain était averti. La vérité, comme Napoléon, passait par le Mont-Cenis, cependant que les câbles de la Croix et de l’Écho de Paris, venus par Nice, se gonflaient de communiqués heureux et tous menteurs : – Le pape avait reçu son tailleur… Le pape apprenait l’esperanto… Pour quel vêtement, ô saint Père, pour quel dialogue… ! Quels câblogrammes optimistes n’eussent pas reçus de Jérusalem, l’après-midi de la Passion, la Croix et l’Écho de Paris : – Le Christ a obtenu une superbe couronne… – Le Christ a bu avec satisfaction, par un moyen nouveau, une espèce de Chianti… – Le Christ maintenant en croix (oui, c. r. o. i. x, justement comme le titre de notre journal), les bras horizontaux et pas du tout verticaux comme certains confrères le disent calomnieusement, est souriant, tout rose… Le mauvais larron a pour lui tant d’égards que beaucoup le confondent avec le bon larron… – Excellente tenue d’Hérode… etc… etc… Le pape allait mourir !
– Qu’a-t-il ?
Gilbertain devint triste. Le pape mourait d’une maladie terrible, maladie dont le père de Gilbertain était mort voilà deux ans. Gilbertain était préparé à tout, sauf à cette ressemblance finale. Le fait que ce pape médiocre, pour mourir, lui aussi, se faisait homme, qu’il était venu chercher dans la famille de Gilbertain des pâleurs, des soupirs, des cris que l’on n’avait pas encore eu le temps depuis la mort du père de ranger parmi les souvenirs ou de redonner à la république des mourants, qu’il se contentait, pour son agonie, de traduire par à peu près en italien les plaintes du père Gilbertain, et en latin, mot à mot, ses réflexions stoïques, que cette mort n’était que le spectacle amplifié de l’autre mort, que le pape avait le même teint cireux et qu’il avait fallu lui mettre du chrême rouge sur les joues, pour la réception des évêques américains venus lui imposer la T.S.F. – tout comme au père Gilbertain quand les Duranoud qu’il détestait étaient venus le voir on avait mis du rouge, qu’on avait également hésité à enlever pour le moment suprême, car il fallait frotter trop fort – tout cela donnait une sainteté rétrospective à la mort de Jules Gilbertain, à la mort du pape un caractère d’humanité que la plupart des morts de pape ont perdu depuis dix-neuf cent trente ans, depuis que les humains se chargent de mourir eux-mêmes. Nos frères sont ceux qui mangent notre pain, souffrent nos souffrances ; la fraternité est une affaire de boulanger et de teinture d’iode. Nos pères sont ceux qui meurent de la même mort. Les téléphones de Rome apportaient à Pierre un texte, un récit, un appel tellement semblables aux messages émis par les téléphones de Clermont-Ferrand, sa ville familiale, voilà deux ans, qu’il avait presque l’impression de devoir faire sa valise et partir. La morphine seule avait soulagé son père… Pourvu que l’on n’hésitât point à insensibiliser le pape, auquel ne pouvait que profiter, au moment de comparaître devant celui dont il avait été le peu habile régisseur, une certaine confusion dans l’explication et les idées… Mais c’était douteux… Gilbertain se rappelait avoir vu les médecins refuser l’opium et l’insensibilité comme un plaisir coupable au pauvre cardinal Rampolla, et l’entretenir douloureux jusqu’au dernier moment, pour un Dieu qui exigeait voir les cardinaux se débattre dans cette aventure, comme nous les écrevisses. Il redoutait par contre qu’on insensibilisât son âme, qu’on lui cachât les menées du Concile déjà proche. L’intrigue entre le primat des Gaules et l’Action Française, la rupture imminente avec Prague à propos de Jean Huss, tout cela lui était caché. C’était un ignorant qui allait dans quelques jours là-haut faire son rapport sur les événements de la terre. On n’avait rien caché au père Gilbertain de ce qui arrivait au poulailler, à l’étable. Il était mort juste après la lecture d’une lettre de son cousin Stéphane, l’administrateur, qui décrivait sa visite, à Tahiti, du bateau d’Alain Gerbault. Il avait appris tout ce qui concerne la navigation à voiles en Polynésie, et était mort… Pour le pape, on lui disait que tout allait bien dans la chrétienté, on lui réservait huit jours de tranquillité heureuse, une espèce de semaine de paradis ici-bas, à croire qu’aucun de ses médecins et de ses coadjuteurs ne croyait au vrai paradis. Il mourait au sein de cette hérésie suprême. Gilbertain eût été, au contraire, soulagé à la fois de lui démontrer que son pontificat n’avait été qu’une suite d’erreurs, de lâchetés, de brutalités, et en même temps de faire cesser ses bourdonnements d’oreilles… En fait, ce qui manquait le plus au pape, en ce moment, c’était un fils. Mais pourquoi cette expérience terrible qu’on acquiert au chevet de son père ne peut-elle plus jamais servir ?
Gilbertain, quoique tout jeune, était directeur des cultes au Ministère de l’intérieur. Ils étaient deux seuls directeurs, dans toute l’administration française, qui eussent à la fois du génie dans la direction, et de la compétence. L’autre était le vicomte de Vitranolles, directeur des haras. Devant les âmes et les chevaux, le régime démocratique avait douté de soi et délégué son omniscience à des sages et à des experts. À vrai dire, le vicomte de Vitranolles lui convenait mieux que Gilbertain. Dans son haras tenu comme un musée, avec des inscriptions au-dessus de chaque objet et chaque box, mais musée autrement prolifique que le Louvre et Cluny, Vitranolles, parmi ses écuyers audacieux et calmes, ses valets stylés et vêtus à la française, ses barrières ripolinées, ses étalons luisants qui procréaient pour la daumont du Président dans le décor Louis XIV, possédait toutes les qualités royales que les ministres d’aujourd’hui estiment à tort populaires. Il saupoudrait à leur insu les dames en visite d’une poudre qui agitait sur leur passage jusqu’au moins doué de ses pensionnaires, accumulait les plaisanteries douteuses sur la première syllabe de son titre et de son nom, et s’oubliait au dîner à dessein juste une seconde avant que sautât le bouchon de champagne. De tels actes semblaient à nos députés les hommages à quelque fête laïque, au 14 juillet, à eux-mêmes, alors qu’ils l’étaient au Grand Dauphin. La précision et la vigueur de ses appréciations ne laissait pas non plus de les impressionner. Eux, en qui remuaient sans arrêt Bouvard et Pécuchet, qui tentaient perpétuellement dans la politique des accouplements contre nature, prenaient d’une inspection dans les haras de Vitranolles une leçon de déterminisme absolu, et lui en étaient obligés. Ici le percheron ne transigeait pas avec le tarbais, comme au Sénat, ni le pur-sang avec le bouc, comme à la Chambre. Ils savaient gré à Vitranolles de cette inflexibilité de caractère, que confirmaient agréablement, dans le repas qui suivait, les unions aussi fatales, admirablement réussies d’ailleurs, des plats et des breuvages. Mais Gilbertain les laissait plus inquiets.
Gilbertain ne se croyait pas de mission divine. Il n’avait pas non plus le goût de la domination. Il était encore moins un ami des âmes ou un apôtre. Cet homme qui vivait dans un état voisin de la sainteté n’avait jamais eu, comme modèles, que des laïques, et surtout des laïques fonctionnaires de l’État, Colbert et Waldeck-Rousseau. Dans ses rapports avec les congrégations, il préférait le plus souvent avoir affaire à l’économe plutôt qu’au père visité par des extases. S’il visitait une Chartreuse, c’était le chemin le moins marqué dans les dalles qu’il suivait, celui qui menait au bureau du prieur et non à la chapelle, il décourageait les guides de Lourdes, en n’écoutant pas leurs descriptions des miracles de la veille et en les pressant d’expliquer le mouvement et l’horaire des pèlerinages. Des amis s’amusèrent à le mettre en présence d’un voyant. C’était un valet de chambre guéri d’une maladie mortelle par saint François, qui lui apparaissait dès qu’il s’étendait. Gilbertain resta debout et ne proposa pas de siège à l’autre, et encore moins de divan, tant il avait peur d’assister à une de ces scènes qui le concernaient si peu et choquaient sa pudeur de chrétien. Il faisait beau. Gilbertain parla du printemps, du ciel, mais en tant que ciel laïque, au croyant déconcerté et qui ne voyait rien d’ailleurs de ces miracles saisonniers. Ses amis, qui le lui avaient montré comme on montre un tableau découvert dans un grenier à un expert étaient déçus… Mais Gilbertain ne contestait rien, ne déniait pas, même dans ce cas, la signature de Dieu. Il ne niait pas les miracles. Les miracles sont l’ordinaire de la religion, mais ils sont l’ordinaire de toute religion, et il ne goûtait la catholique que dans ce qu’elle avait d’original. Elle lui semblait trop élevée au-dessus du sol pour pouvoir subsister intacte, comme ses cathédrales, sans une armée d’architectes intègres, sans une cohorte de ces administrateurs qui vivent naturellement à la hauteur des corniches et des combles, sans des fonctionnaires idéaux. C’est aux fonctionnaires de l’Église que Gilbertain réservait ses haines et ses louanges.
Il lui avait fallu plusieurs années pour arriver à trouver sa vraie mission, pour isoler et définir ce sentiment d’amertume et d’injustice qu’il ressentait dans toute cérémonie et devant tout spectacle religieux. Il s’était cru pessimiste : mais dès qu’il passait d’un spectacle chrétien à un spectacle laïque, sa gaieté revenait entière. Il s’était cru hanté, damné : mais il avait dû bientôt reconnaître lui-même que tout en lui était santé et raison. Il avait peu de rêves, il n’avait pas l’admiration de sa jeunesse, et, au contraire de ses contemporains qui rejetaient entre leurs cinq et leurs dix ans, dans ce lustre d’inconscience et de noblesse, tous les sentiments trop honnêtes ou trop naturels que n’accueillait plus leur vie gâtée, il ne traitait son enfance que comme un enfant. Il était la négation de Freud et de toute la littérature moderne. Autour des points où d’autres avant lui avaient fait le point humain définitif – je pense donc je suis, le spectacle d’une nuit étoilée prouve un créateur – il n’essayait jamais de discuter ces préceptes indéniables, non de la sagesse populaire mais de la sagesse géniale. Il s’était cru touché par l’hérésie, il avait cru que ce qui lui donnait, au centre de Notre-Dame ou de Saint-Pierre, cette impression d’injustice, c’était la cruauté de l’Église envers tous ceux qui se sont écartés tant soit peu, par amour ou par sacrifice, de ses dogmes. Il passa une année à rechercher et à fréquenter les derniers jansénistes, les derniers adeptes de Madame Guyon, mais il ne trouva chez ceux qu’il ne demandait qu’à croire, les bourgeons de la foi, que sécheresse, prétention et artifice. Même à Port-Royal il avait eu le sentiment d’avoir à se courber pour loger dans ce lieu immense, et, à Genève, à Marburg, il avait bien dû convenir que si rien n’est beau et sincère comme le profil d’un schismatique, rien n’est faux et orgueilleux comme sa face… Il s’était cru trop citoyen de son pays, trop petitement nationaliste ; mais après quelques années d’études et de voyages impartiaux, il était reconnaissant à la France d’avoir épuré la religion, d’en avoir retiré, comme elle le retirait aux races qui s’étaient mêlées à la race française, ce goût sui generis, si difficile à porter chez les chrétiens américains ou chez les Italiens eux-mêmes. Pays des agneaux sans suint, du langage sans hoquet, des Arméniens sans odeur, la France avait fait de la religion un levain de liberté, de poésie, d’esprit critique. La religion n’était en France un instrument de domination que sur soi-même. Là seulement elle n’était que civilisation, que perfection. Ce n’était pas par une rencontre fortuite que tous les vins de messe du monde entier se récoltaient dans le district qui avait vu naître Montesquieu et Montaigne, et que dans toutes les consécrations le même soleil qui avait attiédi de la tiédeur la plus humaine ces deux têtes, traversait le gosier du prêtre. Là, seulement, au lieu de le réduire, la religion amenait l’homme à une espèce d’aise terrestre, et, croyance suprême, au scepticisme vis-à-vis du doute. Chaque dimanche matin, lorsque Gilbertain ouvrait la fenêtre de la petite maison de campagne où il allait coucher le samedi chez son beau-frère, il rougissait d’avoir pu imaginer le moindre conflit entre la notion France et la notion Église. Il n’était encore que six heures, mais déjà, dans toute la plaine de Luzarches, les clochers pointaient leur paratonnerre dans le soleil, flèches moins destinées dans cette brume matinale à les protéger du feu céleste qu’à l’attirer, et qu’à s’attirer de Rome un radio de sagesse et d’honneur. Les villages s’éveillaient lentement et noblement. Jusqu’au rythme du lait et du pain par la gloire dominicale était ralenti. Sur les espaces retreints réservés par les hommes au repos et au plaisir, routes et places publiques, gens et voitures se pressaient, tandis que les champs restaient vides, permettant aux alouettes de monter enfin se placer devant le premier rayon selon la loi des alouettes et non celles des laboureurs, et offrant pour leur dimanche la solitude aux arbres et au froment. Gilbertain regardait avec délices la religion prendre le moule de cette belle province. Toutes les collines, les forêts étagées, les grands peupliers, les dolmens, étaient en observation devant les bourgs et les villes, et semblaient beaucoup attendre de cette réunion des hommes et des femmes aux environs des églises. Tous les champs dans leur mutisme, miracle hebdomadaire, tous les chemins dans leur vacarme jouaient leur part dans la cérémonie, et l’espérance de la nature était à ce point exprimée mais à ce point discrète qu’elle égalait en qualité l’espérance humaine. La foi était dans ce district d’une densité parfaite, elle n’étreignait pas, elle ne pesait pas ! Elle déclinait toute prétention, le souci divin était seulement l’habit dominical du souci terrestre quotidien. La vertu humaine était si vive dans les habitants de cette contrée que les animaux ne contenaient plus que leur sainteté animale et paraissaient être tués à juste titre par les membres du Nemrod-Parmain, ou par ce rentier de l’Isle-Adam que dénonçait son flocon de fumée, car il s’obstinait à user de la poudre non pyroxilée… Malgré le fameux plan encore orgueilleux et seul visible de la chrétienté ancienne, abbaye de Thirlemont, aujourd’hui aux Rothschild, couvent de Pont-l’Abbé, aujourd’hui à l’institut, prieuré de Thibaut, aujourd’hui loué aux danseurs russes, l’œil du spectateur le moins averti voyait que ces énormes monuments solitaires étaient sans vie, que les vraies sources de foi étaient au centre de chaque bourg, près de la mairie et de l’école. Tel était ce pays maintenu raisonnable et fidèle par la façon dont les fonctionnaires l’avaient administré depuis mille ans, non pas en l’asservissant par la force ou le prodige, mais en graduant sagement ce qu’il pouvait porter par siècle en impôts, en croyance et en adoration… Suger, Sully, Colbert, c’étaient eux qui avaient créé ces beaux bouquets d’arbres, ce soleil, cette gaieté inoffensive et pourtant proche de la sérénité. La forme de ce dimanche sans contrainte et sans fastes prouvait, comme la forme même de sa maison révèle un homme, la vertu inégalable de cette foi. Du moins Gilbertain le croyait. Pris d’amour pour ces grands hommes d’État dont le but était de rendre des âmes individuelles et non des masses indistinctes à ce Dieu qui donna à la vie l’homme isolé, tirant de Waldeck-Rousseau ou de Pie VII ces illuminations que ses confrères devaient à saint Augustin ou à sainte Thérèse, ayant ses recueillements sur les préfaces de droit canon, ses rêveries sur l’Atlas de la chrétienté, ses silences sur les décrets du Conseil d’État, il fut amené à comparer les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires de l’Église. Et un jour il comprit le malaise qui attristait sa vie : les fonctionnaires de l’État faisaient leur devoir envers les citoyens, les fonctionnaires de l’Église ne faisaient pas le leur envers les chrétiens… De cette constatation sa mission était née, et c’est pour cela aussi qu’à chaque mort de pape je le retrouvais frissonnant de l’espoir que le conclave donnerait enfin au grand royaume un régisseur et non un roi.
Le téléphone ne sonnait plus. Peut-être à cause de l’orage qui venait d’éclater, si violent qu’il nous avait attirés tous deux à la fenêtre. Des nuages se précipitaient droit vers la jeune lune. Nés de l’occident comme elle, ils la recouvraient de leur ouate, bientôt ruisselants de lumière, bientôt consumés. Les arbres remuaient frénétiquement, tirés sur leurs racines. Les oiseaux, qu’ils ne rassuraient plus, se réfugiaient sur ce qu’ont construit les hommes, les églises, les murs. Zéphirs et autans se heurtaient aux carrefours en véritables catastrophes. Les feuilles qui volaient étaient vertes, les branches qui cassaient étaient tendres et gonflées. C’était moins un ravage qu’un élan ; c’était un hiver fleuri. Un vent plus puissant que les autres soufflait d’un coup tous les becs de gaz et du fond de la terre résonnait un tonnerre sourd. Gilbertain regardait sans humeur cette vague de paganisme balayer nuit et gazons. Les gambades de la nature lui plaisaient. Ce n’est pas qu’il la considérât comme irresponsable, mais il la voyait toute jeune. Dès son enfance il avait traité sa planète en planète enfant. Il n’était jamais arrivé à prendre au sérieux, peut-être parce qu’il en avait eu le spectacle d’abord en Italie, ses prétendues colères, éruptions du Vésuve, crachats de l’Etna. Toute la tâche de la vie d’ailleurs devient si facile, si douce, si l’on se rend compte qu’on vit sur un astre à peine né, et, en fait, de cette trentaine d’années passées entre un Massif Central adolescent et les rives d’une Loire pucelle, Gilbertain gardait une fraîcheur d’ange. Il souriait donc paternellement devant cette terre que le Créateur dressait ainsi à la longe et effrayait de ses éclairs.
C’est alors que la porte s’ouvrit et que Bellita parut. La ligne téléphonique des mondaines entre Rome et Paris avait battu la ligne Vanelli-Gilbertain, l’association des femmes amoureuses était plus vite renseignée sur le pape que celle des conjurés. Enivrée de cet événement, avec l’élan et la docilité de ceux qui portent un message, fraîchement sortie de l’arche des robes et des voiles, elle se précipita vers nous.
– Le pape est mort, mon petit Gilbertain, le pape est mort !…
Mais je savais quelle autre raison poussait Bellita vers mon ami ; je pris congé.
Bellita était rentrée du Morvan à Paris la veille, dimanche deux octobre, comme pour une rentrée. Une légère lassitude de son destin individuel l’avait poussée à renoncer à son automobile, et à se donner au sort commun des voyageurs de l’express. La chance avait voulu qu’il n’y eût de place qu’en seconde, et elle se sentait vraiment entre deux eaux du monde. De la portière, elle voyait des paysages rendus enfin classiques ou banals par le nombre d’yeux qui les regardaient à la même seconde, avec vallons, forêts, usines et elle était émue par ces tableaux d’école. Autour du Creusot dont les fours étaient éteints, les ouvriers brûlaient les herbes mortes de leur petit jardin. Sur les collines qui dominaient la cité aujourd’hui sans haleine, c’était une multitude de petites fumées et l’agriculture embuait plus le ciel du Morvan en ce matin de fête que ne l’avait fait la guerre dans ses plus mauvais jours. Une grande offensive de calme et de bonheur se préparait chez la peuplade de l’acier et l’on pouvait pour la première fois aspirer la fumée du Creusot, aujourd’hui odorante. Pas d’autres nuages d’ailleurs entre le ciel et la terre. Les nouveaux labours s’ouvraient sur des sillons luisants, et il n’y avait guère pour ne pas refléter le soleil que ces routes auxquelles Bellita venait de renoncer. Prise de jour pour la première fois depuis bien des années entre deux rails, elle jouissait de ce manque de liberté, de cette prison, de cette menace de retard ou de mort commune à tous ces gens qui devaient, sous peine de désastre, être à Paris à cinq heures vingt-trois et non à cinq heures vingt-quatre. Des voisins mangeaient des œufs durs et du saucisson. Elle eut un soupçon de faim démocratique qui crût peu à peu et la poussa à gagner le wagon-restaurant, mais il n’y restait plus de place. Elle fut prise – elle ne se souvenait pas de l’avoir été auparavant – dans le courant de la grande faim humaine. Ses gestes furent dirigés pendant plus d’une heure en ce sens, comme ceux d’un sauvage ou d’un oiseau, elle dut combattre pour obtenir une orange, qu’elle éplucha et dévora car les ongles et les dents lui poussaient. La soif suivit bientôt ; elle accepta à boire d’un officier de tirailleurs, dans un quart de voyage qui avait dû servir pour les puits sahariens. C’était une eau qui sentait le vin à plein nez et aussi un peu le bouc, une eau d’outre, mais encore suffisamment fluide. Glissée dans cette caravane qui avançait à quatre-vingts à l’heure vers Paris, elle eut bientôt toutes les liaisons et les camaraderies des caravanes, consacrées d’ailleurs bientôt par une puce. Elle regrettait seulement d’apercevoir, toutes les fois où la route nationale venait en tangente à la voie, cet âne d’Antoine, son chauffeur, qui s’amusait à lutter de vitesse avec le train, s’efforçant, après l’avoir atteint, de ne pas le dépasser. Que la liberté individuelle paraît stupide, vue d’un express et d’une tribu ! Qu’elle paraît fatale, bornée ! Ces bonds auxquels Antoine se livrait pour son propre compte sur la route défoncée, ce gaspillage d’intelligence, de ruse, d’audace pour parvenir dans la ville du monde dont l’abord est le plus facile, elle en avait pitié… Le vent de l’express faisait tomber les feuilles les plus dorées. Renonçant à ses recettes personnelles pour entrer dans l’automne, Bellita se bornait à éprouver tout ce qu’il y a de plus général en fait de mélancolie, de plus confection en fait de tristesse, et alanguie, ignorant que sa présence signalée aux deux bouts du train par les équipes montantes et descendantes des dîneurs du wagon-restaurant, enlevait pour tous les autres à ce voyage la banalité qui l’enchantait, émue de la vieillesse d’une Beauce desséchée et vide, elle se donnait loyalement à l’extrême vieillesse de sa vingt-cinquième année.