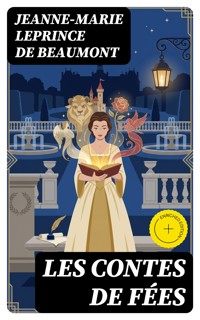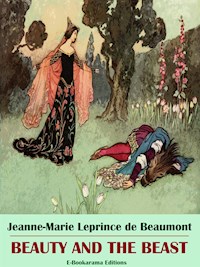Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: La Plume Rêveuse - Les Contes
- Sprache: Französisch
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont rédige, dans un ensemble de recueils, dont le nom complet est « Contes Moraux pour l'instruction de la jeunesse », des histoires qu'elle seule sait raconter. Des récits qui se transmettent de génération en génération, et d'où la voix du conte souffle à notre oreille des malheurs et des rêves qui reflètent aussi bien cet ancien passé que notre présent. Dans ce second tome, découvrez, outre « Les trois souhaits », les contes qui ont su enchanter tant de monde au fil des siècles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table Des Matières
Betsi et Laure
Émilie et la Raison
Marianne, ou en quoi Consiste le Bonheur
La Souris, ou les Sottises des Pères sont Perdues pour leurs Enfants
Rannée et Masca, ou l’Éducation peut Changer la Nature
Henriette, ou que de précautions à prendre, quand il est question de choisir une Gouvernante
Marianne et Robillard, ou l’Amant Anobli par l’Amour
Angélique et Clerville, ou la Paysanne Généreuse et l’Amour Désintéressé
De la Noix et Marianne, ou Recette pour les Dames qui ont des Maris Infidèles
Les trois souhaits
La Femme Curieuse ou La Désobéissance punie
Le Prince Tity
Angélique, ou la Pupille de la Providence
Jeanne Marie Leprince de Beaumont
Betsi et Laure
Il y avait une fois un fermier qui avait été très riche, et qui était devenu bien pauvre. Il avait deux filles, nommées Betsi et Laure. Betsi qui était l’aînée était parfaitement belle ; mais elle était fière de sa beauté : elle n’aimait qu’elle, et par conséquent elle était dure aux pauvres, et n’avait aucune complaisance pour les autres. Elle n’aimait pas non plus à travailler, crainte de gâter ses mains, et elle n’allait jamais dans les champs que quand son père le lui avait commandé vingt fois, parce qu’elle disait que cela lui hâlerait le teint.
Sa cadette, Laure, avait été fort jolie avant la petite vérole ; mais cette maladie l’avait gâtée sans l’affliger, parce qu’elle n’était pas attachée à sa beauté. Elle était aimée de tout le voisinage, parce qu’elle cherchait a obliger tout le monde ; et, bien souvent, elle s’ôtait le pain de la bouche pour le donner aux pauvres. Quoique sa sœur aînée ne l’aimât point, elle cherchait toutes les occasions de lui faire plaisir, et se chargeait volontiers de tout l’ouvrage de la maison, pour lui en épargner la peine.
Un jour que les deux sœurs étaient occupées à traire les vaches, un gentilhomme qui était fort riche, passa par-là, et fut charmé de la beauté de l’aînée. Il lui fit quelques questions ; et, trouvant qu’elle avait de l’esprit, il en devint éperdument amoureux. Betsi fut charmée de cette rencontre, parce qu’en épousant ce gentilhomme, elle pensait qu’elle viendrait demeurer à la ville où elle se divertirait beaucoup. Le gentilhomme lui demanda quelle était cette fille si laide qui s’était retirée aussitôt qu’elle avait paru (car Laure pensait qu’il n’était pas honnête à une fille de s’amuser avec ces beaux messieurs de la ville, qui ne cherchent qu’à tromper les villageoises).
« C’est ma sœur, lui répondit Betsi. C’est une pauvre imbécille qui n’est propre qu’au tracas de la campagne ; pour moi, je m’y ennuie à mourir ; on n’y trouve que des gens grossiers, et je pleure de regret tous les jours de n’être pas née à la cour.
– Vous êtes trop belle pour rester ici, lui dit le gentilhomme ; je vais mettre ordre à quelques affaires ; et, si vous m’aimez, je viendrai vous demander en mariage à votre père. » Betsi pensa mourir de joie à cette proposition, et assura ce gentilhomme qu’elle l’aimait à la folie.
Cependant le fermier s’impatientait de ce que sa fille aînée ne revenait pas, et jurait qu’il voulait la battre quand elle reviendrait. Laure s’échappa de la maison, et vint lui dire que son père était fort en colère. Dans le moment une pauvre femme qui avait trois petits enfants, s’approcha des deux sœurs, et leur dit qu’il y avait vingt-quatre heures que ses trois pauvres enfants n’avaient mangé, et qu’elle les conjurait de lui donner quelque chose.
« Passez votre chemin, lui dit l’aînée ; on ne voit que des gueux qui ne laissent pas un moment de repos aux gens.
– Doucement, ma sœur lui dit Laure ; si vous, ne voulez rien donner à cette femme, ne la maltraitez pas. » En même temps elle tira un schilling de sa poche ( c’était tout ce qu’elle avait dans ce monde), et le donna à cette femme.
Betsi se moqua d’elle, et lui dit : « Vous êtes bien stupide ; il y a trois mois que vous amassez ce schilling pour aller aux marionnettes, et vous le donnez à cette misérable ?
– Je puis me passer des marionnettes, dit Laure, et cette femme ne peut se passer de pain pour ses enfants.
– Vous êtes une sotte de la croire, lui dit Betsi ; peut-être a-t-elle plus d’argent que vous, et qu’elle se divertira avec votre schilling.
– Cela pourrait bien arriver, dit Laure ; mais, comme il se pourrait faire aussi qu’elle eût dit la vérité, j’aime mieux m’exposer à être trompée, que d’être barbare. »
Le gentilhomme écoutait cela avec attention, et il dit aux deux sœurs : « Ne disputez plus, mes belles filles, voilà chacune quatre guinées ; vous pourrez aller aux marionnettes, tant que vous voudrez.
– Je vous suis bien obligée, dit Laure en faisant une grande révérence ; cependant, comme je n’ai pas besoin d’argent, permettez-moi de ne pas prendre le vôtre ; une fille sage ne doit jamais rien recevoir des hommes : si pourtant vous avez tant d’envie de me faire un présent, parce que vous êtes généreux, donnez cet or à cette pauvre femme ; je vous en aurai autant d’obligation que si vous me l’aviez donné à moi-même. » En finissant ces mots, elle s’en alla.
« Gardez-vous-en bien, dit Betsi ; je vous avais bien dit que ma sœur était une sotte. Qui a jamais vu donner quatre guinées à une telle femme, pendant que nous avons mille choses à acheter ? Tenez, monsieur, donnez-moi cet argent que ma sœur refuse, et je donnerai mon schilling à cette femme ».
Le gentilhomme lui dit « Vous aurez les huit guinées ; mais cela ne m’empêchera pas d’en donner quatre ; elles sont à votre sœur, puisque je lui en avais fait présent ; elle a été la maîtresse d’en disposer selon son goût. »
Quand Betsi fut partie, le gentilhomme fit de grandes réflexions : « Mon Dieu ! disait-il, pourquoi la cadette n’a-t-elle pas le visage de l’aînée ? Ou pourquoi l’aînée n’a-t-elle pas le caractère de la cadette ? Après tout, c’est une folie d’épouser un visage ; on doit se marier avec un caractère, cela reste. Si j’épousais Betsi, et qu’elle eût la petite vérole le lendemain de ses noces, il ne me resterait rien du tout. »
Cependant Betsi courut vite dire à son père qu’elle allait devenir une grande dame, puisqu’un lord lui avait promis de l’épouser. D’abord son père se moqua d’elle ; mais ayant vu les guinées, et sachant que ce seigneur devait revenir le lendemain, il ne savait plus que penser. Betsi courut vite acheter des rubans, des dentelles, et employa toutes les ouvrières du village après elle.
Le soir elle se para, et fut aux marionnettes ; car elle n’attendait son amant que le lendemain, et ne voulait pas perdre une occasion de s’amuser. Pendant ce temps, ce gentilhomme ne savait à quoi se déterminer. Les manières de Betsi lui paraissaient hardies ; il voyait qu’elle avait le cœur dur, intéressé ; et pourtant elle était si belle, qu’il ne pouvait s’empêcher de l’excuser. « Elle n’a souhaité avoir de l’argent que pour s’habiller mieux, afin de me plaire, disait-il ; car elle m’aime passionnément ; je l’ai vu dans ses yeux. »
Ce gentilhomme avait un valet, garçon d’esprit, et qui levait les épaules de pitié, d’entendre son maître parler ainsi tout seul. « Qu’as-tu à rire, lui dit le lord ?
– J’ai plus envie de pleurer que de rire, lui dit ce valet ; vous croyez que cette petite pécore vous aime, et moi je vous dis qu’elle n’aime que votre argent. Prêtez-moi votre plus bel habit, je lui dirai que je suis un duc, et, quoique je sois laid comme un monstre, je suis sûr qu’elle aimera mieux m’épouser que vous.
– Je le veux bien, dit le maître ; il n’y a que trois milles d’ici à mon château, prends cet habit brodé d’or, que j’avais le jour de la naissance du roi, et reviens me trouver : je t’attendrai dans cette caverne. »
Pendant que l’on préparait cette mascarade, la pauvre Laure était dans une grande peine. Elle avait trouvé le gentilhomme fort aimable, et elle l’aimait déjà malgré elle, lorsque sa sœur lui apprit, en la grondant bien fort, l’acte de générosité qu’elle avait fait. « Vraiment, lui dit-elle, vous êtes bien plaisante d’être généreuse du bien d’autrui : ces quatre guinées que mon amant a données à cette femme, je ne vous les pardonnerai jamais. »
Cette connaissance de la charité du gentilhomme acheva de gagner le cœur de Laure ; et, comme elle avait peur de faire connaître à cet homme qu’elle avait de l’inclination pour lui, elle résolut de ne pas se trouver à la maison quand il reviendrait. Elle fut bien attrapée quand elle le vit arriver le soir, et voulait se retirer. Le gentilhomme était seul, parce que son valet, ayant appris que Betsi était aux marionnettes, y était allé dans le carrosse de son maître.
Le gentilhomme pria le fermier d’ordonner à Laure de lui tenir compagnie, en attendant que sa sœur fût revenue, et elle fut obligée d’obéir à son père. Il la pria de lui dire les défauts de sa sœur ; et Laure, au lieu de profiter de cette occasion pour le dégoûter de Betsi, lui dit au contraire tout le bien qu’elle pouvait en dire sans mentir, et s’attacha à excuser ses défauts.
Pendant ce temps, le faux duc jurait à l’orgueilleuse paysanne qu’elle était la plus belle personne du monde, et qu’il se croirait trop heureux si elle voulait devenir duchesse en l’épousant.
Betsi, qui n’avait fait semblant d’aimer son premier amant que par ambition et par intérêt, pensa qu’il était plus avantageux d’être duchesse, que simple lady, et dit au duc de nouvelle fabrique qu’il fallait se hâter de la demander à son père, avant qu’un certain gentilhomme de campagne eût fait ses propositions. Le valet la ramena dans le carrosse ; et, quoiqu’il fît très-froid, elle baissa toutes les glaces pour être vue de tous les gens du village.
Elle fut fort surprise de trouver son premier amant chez son père ; et, quand il lui reprocha son inconstance, elle lui dit qu’elle s’était moquée de lui, et qu’elle ne l’avait jamais aimé.
« Je vous laisse ma sœur pour vous consoler, lui dit-elle, en lui riant au nez d’une manière insolente.
– Vous êtes de bon conseil, lui dit le gentilhomme, et, si elle veut y consentir, je me croirai fort heureux de l’obtenir de son père. »
Laure baissa les yeux ; ce qui n’empêcha pas le gentilhomme de connaître qu’elle n’était pas fâchée de l’épouser ; et le fermier, ayant ordonné à cette cadette de regarder ce gentilhomme comme un homme qui serait son époux, elle lui fit connaître modestement, qu’elle estimait plus sa personne que ses richesses.
On signa le contrat de mariage ; et ensuite le valet, reprenant son habit de livrée, apprit à Betsi qu’il s’était moqué d’elle. Elle en conçut un désespoir qui dura autant que sa vie : car aucun homme ne voulut se charger d’une telle femme, et elle devint vieille et laide, sans pouvoir trouver à se marier, au lieu que sa sœur vécut très heureuse avec son mari.
Émilie et la Raison
Il y avait une demoiselle nommée Émilie, qui, à vingt ans, était absolument maîtresse de ses volontés. Elle était de qualité ; elle avait de grands biens, et sa beauté était si grande, qu’on ne pouvait la regarder sans admiration. Outre ces qualités, elle avait le cœur bon, et son esprit était supérieur à celui des personnes de son âge et de son sexe.
Cependant plusieurs personnes croyaient qu’elle était sotte et méchante, parce qu’elle avait des défauts qui gâtaient son esprit et son cœur. Son orgueil était si grand, qu’elle croyait toujours avoir raison ; et, quand on prenait la liberté de la contredire, elle se mettait dans une colère horrible, et accusait ceux qui ne pensaient pas comme elle de stupidité, d’entêtement et d’arrogance, comme si tout l’esprit du monde eût été renfermé dans sa tête.
Je vous ai dit qu’Émilie était riche ; j’ajoute qu’elle était fort généreuse ; elle faisait de grands présents aux personnes qu’elle aimait ; mais elle n’aimait que celles qui étaient de son avis. Elle leur trouvait alors de l’esprit et du mérite. Il est vrai que si, après l’avoir louée et applaudie pendant une année, on hasardait de lui donner un petit conseil, on perdait sur-le-champ ses bonnes grâces. Elle avait une sœur, fille de son père, mais qui était d’une autre mère ; elle se nommait Éliante. C’était une fille de bon sens, qui aimait véritablement Émilie, et qui ne pouvait souffrir que les flatteurs empoisonnassent son heureux naturel.
Éliante n’était pas riche, parce que tout le bien était du côté de la mère d’Émilie ; il est vrai que cette dernière qui, comme je l’ai dit, avait le cœur bon ; ne la laissait manquer de rien ; elle l’avait même priée de venir demeurer avec elle. Les deux sœurs ne s’accommodèrent pas longtemps : cette Éliante était trop sincère pour conserver les bonnes grâces d’une personne à laquelle il ne fallait dire que ce qui lui plaisait.
« Faites comme nous, » disaient à Éliante les parents et les amis d’Émilie, « flattez votre sœur, puisque vous avez besoin d’elle, et que vous êtes sûre d’en tirer par-là tout ce que vous voudrez ; elle est assez sotte pour se croire parfaite, à la bonne heure ; sa folie ne fait mal qu’à elle : ayez la complaisance de vous y conformer.
– J’en serais bien fâchée répondit Éliante. J’aime trop ma sœur pour achever de la gâter. »
Cette bonne fille continuait donc à avertir Émilie de ses défauts ; ce qui impatienta si fort cette dernière, qu’après l’avoir beaucoup maltraitée, elle la chassa de la maison.
Un jour qu’Émilie était à la campagne, elle vit un paysan qui maltraitait une vieille femme, parce qu’en marchant elle avait eu le malheur de casser un pot plein de lait, qu’elle ne voyait pas, et qui appartenait au paysan. Cette femme protestait qu’elle ne l’avait pas fait exprès ; que c’était la faute de sa vue qui était basse ; qu’elle-en était bien fâchée : rien ne pouvait apaiser cet homme brutal qui, loin de recevoir ses excuses, continuait à lui dire les injures les plus grossières, et paraissait disposé à la battre.
Émilie qui était toujours équitable quand il était question de choses qui n’intéressaient pas son orgueil, dit à ce brutal :
« Pourquoi querellez-vous cette pauvre vieille qui vous demande pardon ? Elle est fâchée, d’avoir répandu votre lait ; il faut le lui pardonner. Il n’y a rien de si vilain que de gronder les gens pour une chose qu’ils ont faite sans le vouloir et par accident, surtout si cette chose ne peut se réparer. Tenez, voilà un écu pour payer votre pot et votre lait ; qu’il n’en soit plus parlé, vous me ferez plaisir. »
La bonne vieille remercia Émilie de sa charité, et celle-ci lui fit plusieurs questions sur son âge et sur sa situation ; car elle en avait pitié, parce qu’elle lui paraissait extrêmement pauvre. Pendant que la vieille lui répondit, elle eut le malheur de marcher sur la patte d’un petit chien qu’Émilie aimait beaucoup. Aussitôt l’animal jette de grands cris, et se sauve dans les bras de sa maîtresse qui, touchée jusqu’aux larmes, se mit dans une colère étrange, et maltraita la vieille encore plus que le paysan.
Cette pauvre femme, toute tremblante, lui disait : « Je vous demande pardon, mademoiselle, je ne l’ai pas fait exprès. »
Émilie, au lieu d’être touchée de la douleur qu’elle lui témoignait, leva la main pour la frapper ; mais, dans le même moment, la vieille changea de figure, et parut aux yeux d’Émilie sous la forme d’une dame qui avait l’air très majestueux, et qui la regardant d’un air moqueur, lui répéta les mêmes paroles qu’elle avait dites au paysan.
« Rien n’est si vilain, disiez-vous, il n’y a qu’un moment, que de quereller une personne qui demande excuse d’une faute qu’elle a commise par accident, et sans dessein d’offenser, surtout quand le mal est réparable. Que ceci vous ouvre les yeux, continua la dame. Vos passions auxquelles vous vous êtes abandonnée, troublent votre raison, qui naturellement est droite. Elles vous rendent injuste, capricieuse, méchante et sotte, quoique vous ayez reçu du ciel un excellent caractère, qui paraîtra tel aussitôt que vous travaillerez sérieusement à régler vos passions.
– Ah ! Madame, dit Émilie, êtes-vous un ange ? Êtes-vous un génie bienfaisant envoyé pour m’ouvrir les yeux ?
– Je ne suis ni un ange, ni une fée, répliqua la dame. On m’appelle la Raison. J’étais destinée à régner sur tous les hommes ; et s’ils eussent voulu rester sous mon empire, je les aurais conduits au bonheur ; mais les passions déréglées qui sont mes mortelles ennemies, m’ont disputé mon pouvoir, et elles sont parvenues à me chasser du cœur de la plus grande partie des hommes. Forcée de m’exiler dans mon royaume, je ne règne plus que sur le petit nombre. Voulez-vous augmenter mon empire ; et devenir une de mes sujettes ?
– De tout mon cœur, reprit Émilie ; mais j’ai bien peur que mes passions ne l’emportent. Elles font un si grand bruit, qu’il ne me sera guère possible d’entendre votre voix.
– Je parle bien haut, reprit la Raison ; mais, comme vous le dites fort bien, les passions font un grand vacarme : il faut remédier à cet inconvénient. Vous trouverez dans votre cabinet un miroir qu’on nomme réflexion ; toutes les fois que vous voudrez connaître la situation de votre âme, en découvrir les maladies, et en trouver les remèdes, vous n’aurez qu’à entrer dans ce cabinet. Vous en fermerez soigneusement la porte, et vous vous regarderez attentivement dans ce miroir. Je suis sûre que vous ne le ferez pas longtemps, sans être excitée à faire les plus grands efforts pour vous corriger. »
La Raison disparut en prononçant ces derniers mots ; et Émilie, sans perdre un moment, retourna chez elle, et courut se renfermer dans son cabinet. Elle y trouva le miroir dont la Raison lui avait parlé ; mais la glace en était si trouble qu’elle ne put y rien distinguer. Elle se souvint alors qu’on lui avait recommandé de fermer la porte de son cabinet, elle obéit, et commença à voir quelque chose de confus dans la glace, sans pourtant pouvoir bien connaître ce que c’était.
Elle fut tentée alors de tout abandonner ; toutefois, elle réprima ce mouvement, et résolut de ne point sortir de ce lieu sans découvrir ce que la Raison avait promis de lui faire voir. Elle s’assit donc tranquillement, fit tous ses efforts pour vider son esprit des pensées inutiles, afin de ne s’occuper qu’à regarder dans le miroir. Tout d’un coup elle y découvrit un monstre, dont la vue faillit à la faire mourir de frayeur.
« Voilà votre image, lui dit une voix qu’elle reconnut pour celle de la Raison. » Vous croyez peut-être qu’elle la remercia de l’avertissement, point du tout ; au contraire, elle fut si piquée de la comparaison qu’on faisait d’elle à ce monstre, que, transportée de colère, elle se leva pour casser la glace maudite qui lui offrait un si vilain tableau.
La même voix lui dit en criant bien fort : « Pourquoi vous en prendre à cette glace ? Ce n’est pas elle qui donne à votre âme la figure que vous y voyez ; c’est votre âme qui se peint dans ce miroir. Quand vous le casserez, il n’en sera ni plus ni moins. Si vous avez du bon sens, vous ne travaillerez qu’à effacer ce portrait qui vous choque, vous n’avez qu’à vous corriger.
– Effectivement, dit Émilie, je n’ai d’autre parti à prendre qu’à suivre le conseil de la Raison. Voilà qui est fait, je veux modérer mes passions : j’aurai sans doute beaucoup de peine à y réussir ; mais on peut venir à bout des choses les plus difficiles, avec le secours de la Raison. »
Pendant qu’Émilie était dans son cabinet, un domestique frappa à la porte, et lui annonça la visite d’une de ses tantes. C’était une dame de cinquante ans, assez bonne femme ; mais si capricieuse qu’elle en était insupportable. Elle changeait d’avis à tout moment, et pour vivre en paix avec elle, il eût fallu n’avoir pas une volonté à soi, et se servir de la sienne, aussi tout le monde la fuyait-il : elle lassait la patience de ses domestiques, et était réduite à vivre toute seule.
Émilie quitta son cabinet pour la recevoir ; et sa tante, après l’avoir embrassée, lui dit qu’elle venait lui dire adieu parce qu’elle allait passer quelques mois à la campagne. Dans le moment, Émilie entendit la voix de la Raison, qui lui disait : « Voilà une belle occasion de vous corriger ; si vous aviez le courage de suivre cette femme à la campagne, il faudrait à tout moment renoncer à votre volonté pour suivre la sienne. »
Émilie frémit à cette proposition ; mais comme elle avait un grand courage, elle surmonta sur-le-champ sa répugnance, et dit à sa tante : « J’ai besoin de prendre l’air ; je vous serais bien obligée, si vous vouliez me permettre de vous accompagner. »
La bonne femme fut ravie de cette proposition et demanda à sa niècecomment elle voulait faire ce voyage.
« Comme vous le voudrez, répondit Émilie.
– Oh ! dit la tante, cela m’est absolument indifférent, vous n’avez qu’à choisir, ma chère nièce, demain à huit heures je viendrai vous prendre.
– Puisque vous n’avez rien décidé sur nos voitures, dit Émilie, si vous le voulez, nous irons à cheval.
– Je suis charmée de votre goût, dit la tante, je ne trouve rien de plus ridicule que de s’enfermer dans une chaise de poste, où l’on étouffe, et où l’on est secoué depuis la tête jusqu’aux pieds. Voilà qui est fini ? Nous irons à cheval. »
Quand la bonne femme fut partie, Émilie trembla, en pensant à l’ennui qu’elle allait éprouver avec cette tante. Elle se remit pourtant, et dit en elle-même : « Puisque j’ai dessein de me corriger, il faut le faire de la bonne manière, et une fois pour toutes. Je vais, passer trois mois dans une école de patience, il est vrai ; mais je serai trop récompensée, si j’en puis revenir plus douce, et moins attachée à ma propre volonté. » Elle entra dans son cabinet en finissant ce petit raisonnement. Quelle fut sa surprise et sa joie en jetant les yeux sur son miroir, de voir que son âme était déjà changée. Presque tous les traits du monstre avaient disparu. La Raison lui dit alors : « On est à demi corrigé, quand on a pris une ferme résolution de travailler à ce grand ouvrage. »
Émilie ne pensa plus qu’aux préparatifs de son voyage. Elle n’avait pas d’habit pour monter à cheval ; mais elle savait que son tailleur était accoutumé à ses caprices, et qu’il quitterait tout pour la satisfaire. Elle l’envoya donc chercher, et lui dit :
« Il me faut un habit de cheval pour demain à six heures ; je sais qu’il est huit heures du soir ; ainsi, il faudra y travailler toute la nuit, car je veux l’avoir absolument. Souvenez-vous de plus qu’il me le faut magnifique et galant, n’épargnez pas ma bourse ; je ne dirai rien du prix, pourvu qu’il soit beau.
– Cela suffit, madame, reprit le tailleur, vous serez satisfaite. » Et il était fort content lui-même quand Émilie avait des fantaisies, parce qu’il savait qu’elle ne regrettait pas l’argent dans ces occasions, elle payait le mémoire sans le lire, et il avait coutume alors de lui demander vingt guinées, pour une chose qui n’en valait que dix.
Émilie ne put dormir toute la nuit, le désir de voir son habit, lui avait agité le sang. Le tailleur était à sa porte à cinq heures du matin ; mais, par le plus grand malheur du monde, cet homme qui savait sa taille par cœur, avait pourtant si mal coupé cet habit, qu’il faisait des grimaces de tous les côtés. Le premier mouvement d’Émilie fut de battre l’homme, et de déchirer l’habit.
Dans le moment, elle entendit la Raison qui criait à tue tête : « Si vous vous mettez en colère, vous gâterez votre âme, sans raccommoder votre habit. » Si la Raison n’avait pas crié bien haut, Émilie ne l’eût point entendue ; car la colère et le dépit faisaient chez elle un bruit épouvantable. Elle les fit taire, et Émilie dit en elle-même : « J’allais faire une grande folie qui ne m’aurait servi de rien : il faut l’éviter. »
En même temps, elle s’assit, baissa les yeux, et resta quelque temps comme une statue, parce qu’elle s’occupait à modérer ses mouvements. Lorsqu’elle se sentit plus tranquille, elle dit au tailleur d’une voix douce :
« Mon cher monsieur, il y a encore trois heures jusqu’à huit, où je dois monter à cheval, croyez-vous pouvoir raccommoder cet habit ? »
Le tailleur qui tremblait de crainte, et qui s’attendait à être battu, fut bien surpris de voir Émilie si tranquille. « Mademoiselle, lui dit-il, dans deux heures, je serai de retour, et vous aurez sujet d’être contente. »
Aussitôt que cet homme fut sorti, elle courût à son miroir. Le changement qu’elle remarqua en elle, l’encouragea à continuer ; elle remercia le ciel de la grâce qu’elle en avait reçue pour se vaincre : et, quoiqu’elle se fût fait fête de mettre cet habit, elle prit une ferme résolution de rester tranquille, quand même il serait gâté tout-à-fait.
Le tailleur revint deux heures après, l’habit allait à merveille, et Émilie, en attendant sa tante, se promenait en long et en large dans une chambre remplie de miroirs, pour se voir de tous les côtés. Elle en eut tout le temps, car la tante n’arriva qu’à dix heures, ce qui procura une nouvelle victoire à Émilie, qui mourait d’envie de s’impatienter, et qui n’en fit rien.
La tante avait un habit de cheval qui, étant fait dès l’année précédente, était déjà un peu sale ; il parut horrible à côté de celui d’Émilie ; et la bonne femme en eut tant de dépit, qu’elle était prête à en pleurer ; et, comme elle ne pouvait se résoudre à sortir avec cet habit là, elle dit à Émilie :
« En vérité, ma chère nièce, il fait une chaleur insupportable ; il n’y a pas moyen d’aller à cheval, le soleil me donnerait un grand mal de tête ; ainsi, je vais me déshabiller, et j’irai dans ma chaise de poste. »
Émilie conçut fort bien la véritable raison du changement de sa tante, et la Raison lui dit : « Pourquoi donnerais-tu du chagrin à cette pauvre femme?
Il est vrai qu’elle est une sotte d’être jalouse de ton habit ; mais n’es-tu pas plus sotte qu’elle d’avoir obligé plusieurs hommes à travailler toute la nuit pour satisfaire la fantaisie que tu avais de l’avoir. L’intérêt les a forcés à faire le sacrifice de leur sommeil à ton caprice : la vertu ne pourra-t-elle pas t’obliger a sacrifier ton habit à la jalousie de ta tante ? Tu peux la rendre heureuse, à peu de frais. »
Émilie, docile à la voix de la Raison, dit à sa tante : « Je vais me déshabiller aussi pendant que j’enverrai chercher votre chaise de poste. Aussi bien, depuis un moment, je n’aime plus tant mon habit, qui me paraissait si joli ce matin. La couleur du vôtre irait peut-être mieux à mon visage. Je voudrais que le mien vous convînt, je vous proposerais de faire un troc. Essayez-le, nos tailles sont semblables, et je crois qu’il vous ira à merveille. »
La tante consentit de bon cœur à cette proposition, et, quand elles furent habillées, Émilie lui dit :
« Oh ! pour cela, vous garderez cet habit qui semble fait pour vous.
– Vous perdriez au change, dit la tante ; cependant, je le veux bien, si cela vous fait plaisir.
– Assurément, reprit Émilie, c’est une chose conclue, ne pensons plus qu’à déjeuner. »
La chaise de poste arriva pendant ce temps, et la tante qui brûlait d’envie d’être vue avec ce bel habit, dit à Émilie : « Ma nièce, il me semble que le temps est couvert, et qu’il fait un vent qui a rafraîchi l’air : ce vent nous étouffera de poussière dans la chaise, puisque nos chevaux sont prêts, ne ferions-nous pas mieux de nous en servir ?
– De tout mon cœur, dit Émilie, qui n’en pouvait plus d’impatience, mais qui se contraignit si bien que sa tante n’en vit rien. »
Pendant le voyage, Émilie comparait la paix, la joie, la tranquillité dont elle jouissait, avec la peine qu’elle avait eue à se réprimer, et elle n’y trouvait nulle comparaison. « J’ai été bien dupe jusqu’à présent, disait-elle en elle-même ; je faisais consister mon bonheur à voir tout ce qui m’environnait se plier à mes goûts : je sens qu’il y a beaucoup plus de satisfaction à sacrifier quelque chose pour les autres. On est heureux de leur bonheur, et ce sont deux plaisirs au lieu d’un. »
Émilie, arrivée à la campagne, soutint courageusement la résolution qu’elle avait prise, de ne contrarier jamais sa capricieuse tante. Vous jugez, parce que je vous ai déjà dit, de ce qu’elle eût à souffrir pendant un temps si considérable. Il est pourtant vrai qu’il n’y eut que le premier mois de pénible ; on s’accoutume à tout ; et quand elle revint à la ville, elle fut tentée de croire que sa bonne tante s’était corrigée, tant elle était peu sensible à ses contradictions ; elle ne les apercevait presque plus.
La première chose qu’elle fit en arrivant chez elle, fut de courir à son cabinet pour se voir dans le miroir de la réflexion. Quelle fut sa joie ! Le monstre avait disparu, et son âme était d’une beauté éblouissante. Au même moment, la Raison lui apparut sous la forme où elle s’était offerte à ses yeux, et lui dit :
« Émilie, quand on profite des premières grâces, on mérite d’en recevoir de nouvelles. Je viens pour vous faire présent d’une bague qui doit assurer votre repos. Quand vous l’aurez au doigt, toutes les personnes avec lesquelles vous vous trouverez, seront forcées de vous parler selon leurs pensées, et de vous découvrir le fond de leur cœur. Mais, comme cette bague ne peut servir que deux fois, gardez-la soigneusement pour vous en servir dans les plus importantes affaires de votre vie. »
En finissant ces mots, la Raison disparut ; c’est-à-dire qu’Émilie ne la vit plus sous une forme sensible ; mais elle sentit qu’elle s’était retirée au fond de son cœur, ce qui lui donna beaucoup de joie. Mais la bague ne laissa pas de lui causer une assez grande inquiétude ; elle lui devait servir dans les deux affaires les plus importantes de sa vie ; on ne lui avait pas dit qui elles étaient.
À la fin, elle pensa qu’il n’y avait rien d’aussi grande conséquence pour elle, que de choisir des amis sincères, et un mari honnête homme ; ainsi elle réserva sa bague pour ces deux occasions.
Quelque temps après, elle tomba dangereusement malade ; et, comme elle fut réduite à la dernière extrémité, elle fit son testament. Sa jeunesse et son bon tempérament la sauvèrent ; et, lorsqu’elle fut entièrement rétablie elle assembla toute sa famille et ses amis pour leur donner un grand dîner. Tout le monde lui marquait sa joie de son heureux rétablissement ; et les compliments qu’on lui faisait à cet égard paraissaient si sincères, qu’elle fut tentée de se réjouir d’avoir un si grand nombre de vrais amis.
Tout d’un coup il lui vint en pensée qu’elle ne pouvait trouver une meilleure occasion de faire usage de sa bague, puisqu’elle pouvait lui-faire connaître si la tendresse que ses parents et ses amis lui témoignaient, était réelle. Elle la mit donc à son doigt ; et, dans le même moment, une de ses cousines qui l’accablait de caresses, changeant tout-à-coup de visage, lui dit : « Si tu avais valu quelque chose, tu serais crevée ; je l’espérais bien, et j’attendais le moment de ta mort avec impatience, pour devenir la maîtresse de tes girandoles de diamants que tu me laissais par ton testament.
– Êtes-vous folle, ma fille ? » Dit la mère de celle qui venait de parler. « A-t-on jamais dit de telles sottises aux gens ? J’avais plus d’envie que vous qu’elle fût crevée, puisque sa mort me remettait en possession d’une belle terre que son père a volée au mien, et qu’elle me laissait sans doute à titre de restitution ; mais je me contente de le penser, et, en mille ans, je ne m’aviserais pas de le dire.
– Pour moi, dit un autre, je lui ai souhaité la mort, mais ce n’était pas par intérêt ; elle y avait mis bon ordre : c’était par vengeance. Imaginez-vous que, depuis deux mois, j’encense cette péronnelle ; j’ai eu la complaisance d’applaudir à toutes les impertinences qu’elle disait ; je me suis fait la martyre de ses volontés les plus fantasques, dans l’espérance d’en tirer quelque chose : cependant elle ne me laissait que cent pistoles. Savez-vous bien que, si on comptait exactement, il n’y aurait pas un sou pour chaque mensonge que j’ai fait en la louant. »
Je ne finirais pas si je vous racontais tous les discours de ces faux amis ; qu’il vous suffise de savoir qu’Émilie fut convaincue que tous ces gens à belles démonstrations s’étaient moqués d’elle, ou que, tout au plus, ils ne l’avaient aimée que par intérêt.
Il ne restait plus que la tante avec laquelle Émilie avait été à la campagne, et sa belle-sœur Éliante.
« Pour moi, dit la première, la bague que ma nièce me laissait ne m’eût pas consolée de sa mort ; c’est une bonne enfant, qui a eu mille complaisances pour moi. Elle m’a même fait présent de son habit de cheval, parce qu’elle voyait que j’avais une vraie jalousie de ce qu’elle était mieux mise que moi, et elle eut la générosité de ne pas faire semblant de s’en apercevoir. Ces choses là ne s’oublient point, et gagnent le cœur ; elle s’est tellement emparée du mien par ce bon procédé, que je lui laisse tout mon bien par mon testament, et je souhaite bien sincèrement qu’elle en jouisse longtemps. Il est vrai que je veux tenir la chose secrète. Chacune de mes nièces croit être mon héritière, et, par cet espoir, elles me sont soumises, et ont mille complaisances pour moi, dont je me moque, parce que je connais leur intention. Elles seront bien attrapées à ma mort ; je souhaiterais de ressusciter seulement pour vingt-quatre heures, afin de pouvoir me divertir de la grimace qu’elles feront.
– Hélas ! dit Éliante, je vous sais bon gré, ma chère tante, de vous être attachée à Émilie ; je vous assure qu’elle le mérite dans le fond, quoiqu’elle soit fort impertinente. Ses vices ont été nourris par toutes ces pécores que vous voyez ici ; ce sont elles qui m’ont brouillée avec cette chère sœur que j’aime plus que ma vie. Je l’aurais donnée de bon cœur pour sauver la sienne, quoiqu’elle m’eût donné la moitié de son bien. J’y renonce de bon cœur, et je sacrifierais même le peu que je possède, pour qu’elle pût payer mon attachement de son amitié ; mais j’aurais beau faire, elle ne m’aimera jamais, parce que je ne pourrai jamais me résoudre à la flatter. »
Émilie se leva, et courut embrasser sa sœur et sa tante avec transport. Elle allait leur témoigner combien elle était sensible aux sentiments qu’elles avaient pour elle, lorsqu’une femme-de-chambre, qui avait besoin de quelque chose dans la chambre, y entra ; et, ne pouvant se défendre de la vertu de la bague, elle dit à sa maîtresse :
« Mademoiselle, je vous fais compliment sur votre convalescence : c’est de bon cœur, au moins. Si cela fut arrivé, il y a six mois, c’eût été toute autre chose ; je vous souhaitais alors six pieds sous terre, car vous étiez méchante comme un démon. Aujourd’hui vous êtes devenue si bonne et si douce, que nous avons pleuré votre perte, depuis moi jusqu’au plus petit laquais.
– Il est temps de finir cette scène, » dit Émilie, en remettant sa bague dans sa poche ; « je sais à présent à quoi m’en tenir sur le chapitre de mes amis. »