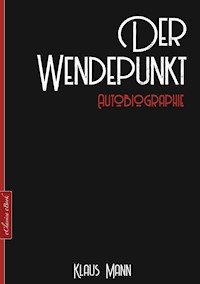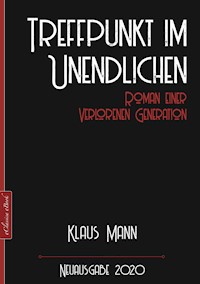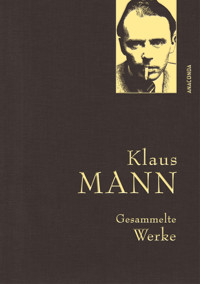Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Contre la barbarie
- Sprache: Französisch
Textes parus entre 1928 et 1938, Articles de journaux, conférences...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Klaus Mann est né le 18 novembre 1906 à Munich. Il entre en littérature au début de la république de Weimar. Adversaire du nazisme, il quitte l'Allemagne en 1933 et est déchu de sa nationalité en 1934. Il se suicide à Cannes, le 21 mai 1949. Son talent s'est aussi bien exprimé dans le roman que l'essai, le théâtre et l'autobiographie, avec des oeuvres comme "Contre la barbarie" (2009), "Point de rencontre à l'infini" (2010), "Speed "(2011) et le recueil "Aujourd'hui et demain" (2011), toutes publiées aux éditions Phébus.. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants auteurs allemands.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KLAUS MANN
CONTRE LA BARBARIE
TOME 1
LE PREMIER JOUR
"8 Uhr-Abendblatt", Berlin,14 avril 1925.
Aujourd’hui comme hier, un premier jour à Paris est pour tout individu sensible une expérience forte, impressionnante - beaucoup en ont déjà témoigné!
Nous sommes arrivés en avion. En deux heures donc, nous étions de Londres à Paris, de la mégalopole européanisée au lumineux foyer de l’Europe. Et il se peut que cette incroyable soudaineté ait encore accru la fascination. Le vol en soi avait été une aventure dont l’intensité s’était très vite épuisée, dégénérant sur la fin en nausée et en léger ennui. Seul le moment du décollage fut réellement formidable, l’instant où l’on se détache de cette bonne vieille terre avec une audace proprement luciférienne, où les champs s’enfoncent à vous donner le vertige, où le paysage se transforme progressivement en carte géographique. La descente, elle, ne se distingue presque en rien d’une épouvantable chute. Dans une oblique expressionniste, le sol se précipite à votre rencontre. Une ville se précipite à votre rencontre - et Paris est là.
Certaines villes mettent des jours, d’autres des semaines à dévoiler leur spécificité et leur charme. Paris convainc et même subjugue en quelques heures. Dès l’instant où l’on traverse en taxi la renversante étendue de la place de la Concorde, on est émerveillé. Quand, depuis l’arc de triomphe, on a vu la descente des Champs-Élysées, on ne peut se soustraire aux sortilèges de la capitale.
Ensuite, on vous accueille à l’hôtel en vous causant de manière charmante. Encore tout étourdi par le voyage en avion, on s’assied au café, le thé est mauvais, mais servi avec classe. Il règne une incroyable confusion babylonienne, autour de soi on entend toutes les langues. Des Espagnols gesticulent avec rudesse à la table voisine. Des Américains, admirés et raillés, sont fiers de ne pas avoir besoin du français même pour parlementer avec le garçon : on veille à leur confort avec le plus grand zèle car ils ont la réputation d’être très riches. Des Russes, des Nègres, des Turcs et des Japonais sont assis là, silencieux ou en proie à une gaieté exotique et débridée. Des Suisses déploient de louables efforts pour se faire comprendre. Et au milieu de tout cela, les Français, malins, amusés et avides de gros pourboires, prêtent l’oreille à ce vacarme. Quant à nous, nous observons. Et soudain, telle une vision d’épouvante, s’abat sur nous la pensée que tous ces peuples se sont fait la guerre. Ils ont tiré... Il ne s’agit pas d’une théorie pacifiste. C’est une peur, une horreur soudaine qui vous étouffe - et qui n’est compréhensible peut-être que pour celui qui n’a pas vécu le jour de la «mobilisation» en août 1914 parce qu’à l’époque il n’était qu’un enfant. Par la suite, ce jour a pu constituer, pour tous ceux qu’il a bouleversés, une sorte de justification des quatre années de guerre. Mais dans ce café, au milieu de ces peuples, dans cet endroit où toutes les langues se fondent en un brouhaha invraisemblable, nous n’avons plus soudain que cette seule pensée : ils ont tiré... Et que d’aucuns veuillent de nouveau en arriver là, voilà une chose que nous n’osons imaginer.
Empli d’une pieuse curiosité, on visite Notre-Dame. La lumière des magnifiques vitraux, rouge, bleu et vert, traverse les perspectives obliques des allées gothiques. On marche, en réfléchissant.
Mais le soir, je suis sur les hauteurs du vieux Montmartre, et derrière moi, le Sacré-Cœur est blanc dans l’obscurité. À mes pieds, dans la brume surmontée du scintillement mat de la lumière électrique, s’étend l’immensité de la ville. Son bruit ne me parvient qu’assourdi. Un aboiement se détache parfois, un klaxon. Et avec un respect qui est comme une stupeur, je comprends soudain ce que c’est - cette ville, cette grande ville, là en bas, dans le scintillement de la brume et de la lumière électrique.
Que l’Allemagne - et non la France - soit le sol où, après bien des peines et des luttes, l’avenir ait enfin le droit de naître, telle est ma conviction sacrée, car l’Allemagne est le pays qui fait le plus d’efforts. Mais c’est dans cette ville que se concentre - aujourd’hui comme depuis des siècles - la splendeur de l’Europe.
RÉPONSE À UNE ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DE JEUNES ÉCRIVAINS SUR LEURS TENDANCES ARTISTIQUES
"Die Kolonne" n°2, février 1930.
De nos jours, tout art sans exception doit être de la propagande politique, dans l’acception la plus large de ce terme. Ce qui signifie se pencher sur notre époque en vue de la rendre meilleure et de rapprocher l’humanité du but auquel elle aspire sans le connaître.
Certes, c’est une méprise très en vogue, surtout à Berlin, que de considérer une œuvre d’art comme légitime, uniquement si elle combat, par exemple, un article de loi dépassé. La valeur militante sert volontiers d’excuse à l’absence la plus flagrante de dimension artistique. Il me semble pourtant que plus une œuvre est passionnée, engagée, «artistique », plus sa faculté d’amender le monde sera grande.
Je souhaiterais n’avoir jamais écrit une ligne qui n’eût pas résulté pour moi - pour moi personnellement - d’une nécessité absolue, qui n’eût pas été une confession mise en forme, organisée, et donc une œuvre d’art. J’aimerais n’avoir jamais publié une ligne qui n’eût, de manière infime, infinitésimale, contribué à éclairer l’énorme confusion que connaît notre époque. Nous ne pouvons faire œuvre utile, faire de la propagande qu’en nous donnant à fond, jamais en bâclant le travail.
L’artiste doit à chaque seconde être conscient de sa mission militante, c’est là son unique vocation. Voudrait-il pour cette raison renoncer à sa qualité d’artiste qu’il se dessaisirait de son outil le plus efficace et le plus important, de son instrument de propagande le plus sacré.
JEUNESSE ET RADICALISME UNE RÉPONSE À STEFAN ZWEIG
Auf der Suche nach einem Weg (En quête d’un chemin), novembre 1930.
Très cher et très honoré Stefan Zweig,
Bien peu d’écrivains de votre rang ont autant d’amis que vous parmi les jeunes. Bien peu s’intéressent d’aussi près à nos aspirations et nous soutiennent aussi judicieusement de leurs conseils et de leur amitié. Si quelqu’un a le droit de s’adresser à «la jeunesse», considérée comme entité, c’est sans conteste vous, cher Stefan Zweig. C’est ce que vous faites dans votre article «Révolte contre la lenteur» que j’ai lu avec le plus grand intérêt. Permettez-moi de vous répondre. Il y a une prétention à tout comprendre, une sorte de complaisance à l’égard de la jeunesse qui va trop loin. Tout ce que fait la jeunesse ne nous montre pas la voie de l’avenir. Moi qui dis cela, je suis jeune moi-même. La plupart des gens de mon âge - ou des gens encore plus jeunes - ont fait, avec l’enthousiasme qui devrait être réservé au progrès, le choix de la régression. C’est une chose que nous ne pouvons sous aucun prétexte approuver. Sous aucun prétexte.
Voilà pourtant ce que vous faites quand vous dites, à propos des effrayants résultats des élections du Reichstag, qu’il s’agit d’une «révolte de la jeunesse, une révolte - peut-être pas très habile mais finalement naturelle et tout à fait à encourager - contre la lenteur et l’indécision de la “haute” politique». Je crains que votre belle sympathie pour la jeunesse en soi ne vous empêche de voir en quoi consiste cette révolte. Que veulent les nationaux-socialistes? (Car c’est d’eux qu’il s’agit à cette heure, et non des communistes.) Dans quelle direction se radicalisent-ils? Voilà en fin de compte la question qu’il faudrait se poser. Le radicalisme ne peut être à lui seul quelque chose de positif, surtout quand il manque d’imagination et prend des allures crapuleuses, comme c’est le cas pour nos chevaliers de la croix gammée. Briser des vitrines et menacer les gens avec de l’huile de ricin, c’est à la portée de n’importe qui.
Vous déplorez la lenteur d’escargot de la politique européenne, et nous la déplorons avec vous. Je veux bien faire partie de «ces honnêtes gens» qui partagent avec vous la déception de voir qu’on nous dupe à chaque session de la Société des Nations en remettant à plus tard ce désarmement que nous réclamons à cor et à cri. La seule question est de savoir si les individus qui dirigent le concert de ce pseudo-nationalisme pseudo-social sont aussi déçus que nous. Qu’est-ce qui pourrait bien les décevoir? Souhaitent-ils une Europe pacifique, unie et régie par l’esprit? C’est plutôt l’exact contraire qu’ils veulent. Leur extrémisme n’est pas l’expression d’un quelconque espoir déçu puisqu’ils n’en avaient aucun; et tout ce qui peut se passer de positif à Genève ou ailleurs, se passe malgré eux et contre leur volonté. Il serait peut-être possible d’aller davantage de l’avant si seulement ils n’étaient pas là ou s’ils étaient différents de ce qu’ils sont malheureusement.
Les choses avancent lentement à Genève, abominablement lentement. Nous serions les premiers à saluer toute tentative plus radicale - radicale dans un sens positif. Mais comment trouver sympathique un radicalisme qui va jusqu’à contrecarrer le peu que l’ancienne génération accomplit? Vous dites, Stefan Zweig : «Le rythme d’une nouvelle génération se révolte contre celui du passé. Si seulement c’était ce qui se produit! Mais il me semble au contraire que les plus jeunes trouvent que le rythme de leurs aînés conduirait encore trop lentement à une catastrophe. Ils veulent qu’elles arrivent plus vite, leur chère catastrophe et la «bataille logistique» dont rêvent leurs philosophes hystériques. Appeler à la guerre revancharde et au bain de sang parce que le désarmement ne va pas assez vite? Mais tout cela n’est que pure perversité! Et je récuse toute forme de perversité en politique. Ce qui nous a rapprochés d’un avenir souhaitable - même si ce n’était peut-être qu’un tout petit pas - ce fut le travail réfléchi de Stresemann, et certainement pas les gesticulations et la brutalité de je ne sais quel petit Hitler lançant ses foudres dans tous les azimuts.
Non, je ne veux rien, absolument rien avoir à faire avec cette forme d’extrémisme. Si l’on ne peut faire en sorte que ce rythme d’escargot soit accéléré, alors je préfère encore que les choses restent en l’état (mais on devrait pouvoir l’accélérer). Il est possible que Genève ne nous apporte pas la paix; mais il est certain que les autres nous mèneront à la catastrophe. Je préfère l’incertitude, c’est plus fort que moi.
Ainsi donc, Stefan Zweig, je répudie devant vous ma propre génération, ou tout au moins cette partie de ma génération que vous, justement, vous excusez. Entre ces gens-là et nous,
aucune alliance n’est envisageable; d’ailleurs, ils seraient les premiers à repousser à coups de matraque tout rapprochement avec nous. La psychologie permet de tout comprendre, même les coups de matraque. Mais cette psychologie-là, je ne veux pas la pratiquer. Je ne veux pas comprendre ces gens-là, je les rejette. Je me force à affirmer - bien que cela aille complètement à l’encontre de mon honneur d’écrivain - que le phénomène du néonationalisme hystérique ne m’intéresse même pas. Je le considère purement et simplement comme
dangereux. Voilà en quoi consiste mon radicalisme.
La génération de 1902 pouvait dire : La guerre - ce sont nos parents. Mais qu’en serait-il si la génération de 1920 devait dire; La guerre - ce sont nos frères? C’est alors que nous devrions avoir honte au plus profond de nous-mêmes d’avoir appartenu à une génération dont le pressant besoin d’action, c’est-à-dire le radicalisme, aurait viré d’aussi effroyable façon, et se serait transformé en quelque chose d’aussi négatif.
EST-CE L’AVÈNEMENT DU «TROISIÈME REICH» ?
Die Literatur, Stuttgart/Berlin, avril 1931.
L’actualité semble être un principe politique de la maison d’édition Rowohlt qui, en matière littéraire, ne nous propose que ce qui a le plus d’originalité et de valeur. Elle pousse parfois ce principe trop loin à mon goût. Quoi qu’il en soit, les deux ouvrages qu’elle publie aujourd’hui sont très méritoires. Je préfère celui de Oehme et Caro à celui de Miltenberg.
Il faut connaître l’ennemi avant de lui régler son compte. L’ennemi, ce sont les nazis, ne nous y trompons surtout pas.
Les auteurs Oehme et Caro, qui connaissent le sujet nébuleux sur lequel ils veulent nous éclairer, nous apportent la preuve de ce que nous avions toujours senti : ces héros de la saison politique n’ont pas la moindre rigueur morale. Ici, tout n’est qu’agitation, démagogie, pêche aux voix; rien qui ressemble à un programme, rien, rien, rien, pas même l’antisémitisme ou la haine des Français, auxquels l’habile Hitler renonce si facilement depuis qu’il veut devenir ministre. La confusion est si effrayante qu’il faut vraiment mobiliser tout son sens psychologique pour comprendre comment ce parti a pu devenir le deuxième parti d’Allemagne, en attendant peut-être d’arriver à la première place. Qu’advient-il de la conscience qu’une nation a de son rang quand un Goebbels peut écrire à son Hitler sans sombrer dans le comble du ridicule : «Ce que vous avez dit là est ce qu’on a entendu de plus extraordinaire en Allemagne depuis Bismarck»? La lecture de ce fascicule extrêmement intéressant n’encourage pas précisément la gaieté et l’espoir. Elle laisse un sentiment de vide, qui suscite le dégoût. Que veulent-ils? Le capitalisme ou le socialisme? Et si c’est le socialisme, pourquoi se font-ils financer par la grande industrie? Quelle sinistre imposture! Comme disent les auteurs : «La jeunesse est tombée aux mains des perdants d’une génération intermédiaire.» Quelle triste jeunesse!
La brochure de Weigand von Miltenberg, Adolf-Hitler, Guillaume III, est moins concrète. La première rassemblait un effrayant matériel de faits; la seconde exprime avant tout la souffrance d’un authentique national-socialiste qui a vu le parti de Hitler devenir un parti parlementaire tout à fait ordinaire et perdre de sa dimension anarchiste. Miltenberg me semble appartenir à la famille intellectuelle d’ErnstJünger, mais en même temps, il a fait son apprentissage auprès de quelques journalistes de la grande ville passablement pervertis. Ce mélange n’est pas toujours réjouissant, le style de Miltenberg aurait besoin d’urgence d’un petit bain d’acier. «Quand Mussolini montre les dents... cela a toujours une allure antique.» Est-on vraiment obligé d’endurer cela? Le lecteur bienveillant en est dédommagé par la formidable exaltation virile avec laquelle ce gaillard, à l’allure tout de même très antique, évoque le 1er août 1914 : «Quand les professeurs étrangers et les unions postales universelles prirent leurs jambes à leur cou (quel triomphe pour l’anarchiste prussien!) et que des millions de gars bombèrent le torse... le “Contrat social” fut déchiré, du papier toilettes.» Qui ne montrerait pas les dents ici? Je terminai pourtant l’ouvrage et ne le regrettai pas, car cette lecture, pas toujours plaisante, me fit comprendre que le parti national-socialiste, qui semble devenir déterminant pour le destin de l’Allemagne, n’a, intellectuellement pariant, rien sur quoi s’appuyer. Pas même la jeunesse en quête d’une véritable révolution nationale, qui recèle incontestablement des énergies fortes, quoique à mon sens mal orientées, et qui est représentée par des individus comme Weigand von Miltenberg.
NE RIEN FAIRE...
8 Uhr-Abendblatt, Berlin, 19 octobre 1931.
La génération des poètes de 1918 déclarait avec enthousiasme que l’être humain était «bon». À l’heure historique où la guerre se terminait, cette affirmation était assurément d’une magnanimité fort téméraire. Elle était évidemment unilatérale et, à l’examiner de près, aussi intenable que la thèse inverse, qui voudrait que l’être humain soit «mauvais», un prédateur avide, muni d’un cerveau par hasard anormalement développé. À l’évidence, l’homme «en soi» n’est ni bon ni mauvais, il porte en lui une égale disposition au bien et au mal et, très souvent, ce sont les circonstances qui l’amènent à développer telle ou telle qualité à un degré effrayant. Ceci dit en préambule pour arriver au constat qu’il est extrêmement difficile d’attribuer à la nature humaine des qualités déterminées. Cela étant, je vois de plus en plus clairement, en cette époque de chômage catastrophique, qu’il y a une chose que l’homme de nos contrées n’est pas : il n’est pas paresseux. Un homme de race blanche paresseux, c’est une anomalie, sans doute une des plus rares.
Oui, l’ennui est un spectre plus malfaisant que le dénuement. Et le terme «ennui» n’est qu’une façon de désigner l’abattement profond et paralysant qui accable celui qui n’a plus le droit de prendre part à la gigantesque activité où notre civilisation trouve chaque jour à se recréer. La mise à l’écart est certainement pire que la faim - et l’on peut imaginer des situations où l’individu, tout en souffrant de la faim, aurait la possibilité d’utiliser toute sa capacité d’action. Ces situations-là auront toujours l’attrait de l’aventure. L’amertume du chômeur ne résulte pas tant du désespoir dû à la baisse de son niveau de vie - même si c’est ce dont il prend le plus tôt conscience - que de la souffrance, bien plus profonde et légitime de ne plus pouvoir participer. Tout se déroule sans lui, au-dessus de sa tête, dans l’indifférence la plus cruelle. Voilà ce qu’il trouve insupportable. Lorsqu’il livrait des paquets ou nettoyait des moteurs, il participait encore. Il collaborait, il contribuait de ses mains à la mystérieuse et perpétuelle métamorphose de la civilisation. Quelle injustice sans égale a désormais décrété qu’il n’avait plus le droit que d’aller se promener? Lui-même trouve cela si indigne qu’il en éprouve du dégoût pour sa personne tandis que ses forces pourrissent.
J’imagine un jeune chômeur, qui dépend d’un de ses proches au point qu’il doit manger sa nourriture, boire sa bière, fumer ses cigarettes. L’opinion courante voudrait qu’il soit on ne peut plus content et satisfait : il mène la belle vie sans rien faire. Mais sur son jeune visage, je vois grandir une morosité, un déplaisir qui finissent par l’assombrir complètement et ternissent ce front clair et intelligent. Il se procure un semblant de travail en faisant du bricolage, des courses pour des gens qu’il connaît. Mais combien de temps s’en satisfera-t-il puisque dès maintenant cela ne lui suffit pas? Tous ces jeunes gens qui traînent aux coins des rues, devant les vitrines, sont, à leur manière moins spectaculaire et plus quotidienne, une accusation tout aussi éloquente contre les insuffisances de notre civilisation que les morts de la guerre mondiale sous leurs croix dérisoires. Ces derniers ont péri par la faute d’un mécanisme qui ne donne même pas aux autres le droit de vivre.
Dans son ouvrage essentiel et méconnu sur la «révolte des masses », le psychologue de la culture hispano-européen Ortega, dépeint avec verve et brio la prétention et l’autoritarisme des masses qu'une civilisation créée par les élites a hissées à un niveau de vie dont l’individu n’avait jamais bénéficié. Mais ce que Ortega oublie de mentionner, c’est que cette même civilisation humilie l’«individu de masse» comme aucune autre ne l’avait fait. De nombreuses époques l’ont laissé mourir de faim, presque toutes l’ont réduit en esclavage, mais toutes le faisaient travailler. Des millions d’hommes purement et simplement exclus de la force de travail avec une évidence d’une incroyable brutalité : ce spectacle était réservé à l’ère de l’émancipation de l’individu de masse. Celui-ci a son eau courante et son droit de vote, mais reste là au milieu de ses conquêtes comme un homme mort, un morceau de viande inutilisable. Et lui qui par nature n’est ni bon ni mauvais pourrait devenir terrible et tout casser si on lui demandait de rester encore longtemps assis là, les bras croisés. Il est très difficile de savoir si, à l’origine, il était plus proche de faire le mal que le bien. Ce qui est sûr, c’est qu’à la longue, il aimera mieux faire le mal que de ne rien faire...
JUMEAUX DE PATHOLOGIE SEXUELLE
Das Tagebuch, Berlin, 31 décembre 1932.
Vous connaissez tous la librairie de sexologie sur la Wittenbergplatz? Dans son numéro sur l’Allemagne, le magazine parisien Vu(1) a consacré une illustration à cette curiosité qui lui paraît typiquement berlinoise. Avec son atmosphère mi-service de consultations médicales, mi-cabinet de luxe, cette librairie est l’endroit un peu douteux et un peu comique où les pères de famille venus de province entrent en cachette, comme dans un bordel, pour y découvrir les dernières nouveautés sur les salons de massage, et devant lequel les dames passent en détournant la tête, non sans jeter un coup d’œil furtif sur la scandaleuse vitrine.
Depuis mon dernier séjour à Berlin - c’était en septembre -, l’aspect de ce local à maints égards remarquable a connu une transformation spectaculaire. Outre la pathologie sexuelle, la librairie cultive désormais une autre spécialité : la politique avec le mouvement de l’Allemagne qui s’ éveille. Le spectacle n’est pas dénué de piquant, tout en restant harmonieux. Horst Wessel(2), apparemment très demandé dans ces cercles, repose parmi des brochures sur le sadisme et sur le fétichisme des bottes. Et le portrait de notre Führer, dont le chien préféré a été empoisonné par de méchantes gens (cf. Dans l’intimité de Hitler), s’étale avec goût entre un ouvrage sur la virginité et un autre sur la bastonnade dans l’éducation. Ce rapprochement inédit et pourtant très éclairant de deux domaines d’ordinaire soigneusement séparés dans la vie publique résulte-t-il de l’inquiétude du libraire sexologue? Voulait-il éviter tout scandale en couvrant ses nudités du voile nationaliste parce que celui de la science lui paraissait trop transparent? Ou bien le propriétaire de la boutique souhaitait-il ainsi rendre visibles des rapports internes qui, à vrai dire, nous ont toujours semblé évidents?
Quoi qu’il en soit, je dénonce cet outrage. C’est un comble : voilà qu’en plus, on nous dégoûte de toute la pathologie sexuelle.
MUNICH, MARS 1933
Le 10 mars 1933.
Nous étions allés faire du ski en Suisse. Ce jour-là, celui-là même, nous rentrons à Munich. Là-haut, nous avions suivi les nouvelles politiques et appris par la radio le résultat des élections allemandes. Mais la pureté et l’indifférence héroïques du grandiose paysage de montagne nous rendaient un peu moins réceptifs à ces informations décisives pour la vie de la nation comme pour la nôtre. Journaux à St Margrethen. Les derniers restes d’atmosphère
héroïco-idyllique se dissipent brutalement. Nous prenons connaissance des changements survenus à Munich : la démission du gouvernement catholique(3), dont nous avions attendu trop de courage et d’intelligence; la nomination du général Epp au poste de commissaire - un général dont nous nous rappelions encore la physionomie martiale et farouchement déterminée à l’époque où, peu après la guerre, il entrait dans le réactionnaire Munich à la tête des «troupes blanches» (4). Le voyage se poursuit dans une ambiance aussi oppressée que tendue, typique des moments de catastrophe, des déclenchements de guerre et des grandes banqueroutes, mêlée d’amertume et, en dépit de tout, d’une curiosité avide de sensationnel.
Munich a l’air calme. Mais lorsqu’on tend l’oreille, on sent la tension, l’inquiétude de tous ces gens qui, déjà sur la place de la gare, se pressent en foule désordonnée - une tension qui pour beaucoup est sûrement joyeuse et confiante en l’avenir, mais pour bien d’autres désespérée. Nous avions connu Munich si différent, et ce précisément au cours des derniers mois : c’était un abri pour ceux qui refusaient le fascisme prussien. Le catholicisme y montrait ce qu’il a en lui d’éléments libéraux. Munich était une oasis. Cela ne pouvait pas durer. Pas seulement parce qu’à Berlin, on ne l’aurait pas toléré; à la longue, Munich lui-même n’aurait pas supporté le rôle qui nous semblait si honorable de refuge de la liberté. Il ya dans sa nature trop de traits qui le contredisent absolument. Une partie du caractère de Munich a toujours été résolument réactionnaire. En Allemagne, on sait l’être sans «esprit prussien», parfois même avec «convivialité».
Nous fûmes donc salués, sur les toits des bâtiments publics, par les drapeaux à croix gammée flottant au vent de leur triomphe, et, sur toutes les colonnes d’affichage, par les appels du général Epp «à son peuple». Le chauffeur qui vint nous chercher à la gare avait l’air bouleversé, il était blême. «Si je puis me permettre un conseil à ces messieurs-dames, dit-il, les lèvres toutes blanches, c’est de rester en retrait les jours qui viennent.» À la maison, quand nous allumâmes la radio, nous nous fîmes agresser par les voix de ceux qui avaient réussi à convaincre un peuple incompréhensible qu’ils étaient des «Führer». Ce n’est pas supportable. On téléphone à des amis. On ne se rencontre plus dans les endroits publics et, quand on est réunis dans les pièces familières, on se sent déjà comme des «conspirateurs ». Les conversations téléphoniques sont surveillées, on parle par allusions et formules obscures. Nous comprenons rapidement que nous pourrions avoir à souffrir non seulement de l’ambiance mais aussi d’atteintes plus tangibles. On commence à apprendre de ces nouvelles qui seront qualifiées plus tard de «propagande mensongère»; mais il n’était pas besoin d’exagérer, comme cela n’a pas manqué de se produire par la suite : la vérité suffit. Nombre de ceux avec qui l’on veut prendre contact ont déjà été arrêtés, ainsi l’avocat qui nous avait conseillés au cours des dernières années. D’autres arrestations sont encore plus surprenantes, par exemple celle du directeur du théâtre de Munich, Otto Falckenberg, un artiste et un esthète totalement apolitique d’une qualité exceptionnelle et d’une excellente réputation, qui avait une prédilection pour la mise en scène du Songe d’une nuit d’été (du reste, Falckenberg a été libéré quelques jours plus tard, mais ce qui l’avait rendu suspect était simplement sa relation aux choses de l’esprit). Ou celle d’un journaliste des Münchener Neuesten Nachrichten, dont les éditoriaux nous paraissaient toujours si nationalistes que nous arrivions à peine à les lire jusqu’au bout. Un de nos amis a même, avec horreur, assisté en pleine rue à une scène lamentable et révoltante : un avocat juif, dont le calvaire a depuis été rapporté par la presse du monde entier, fut promené par des S.A. pieds nus, le pantalon raccourci. Sur la poitrine, il portait un écriteau disant qu’il était juif - ce qui n’est pas sa faute - et que jamais plus il n’irait se plaindre d’un nazi - ce qu’il n’aura plus l’occasion de faire.
Nous sommes restés dans le Munich du général Epp du 11 au 13 mars. C’est le temps qu’il nous a fallu ‘pour comprendre que, dans l’immédiat, nous devions quitter un pays en passe de détruire tout ce qui a fait sa valeur, son attrait et sa dignité parmi les peuples de la terre.
CULTURE ET «BOLCHEVISME CULTUREL»
Paris, avril1933.
L’expression «bolchevisme culturel» est l’arme dont usent les puissances régnant aujourd’hui en Allemagne pour étouffer toute production intellectuelle qui ne serait pas au service de leurs tendances politiques. Il serait malaisé de donner une définition précise du «bolchevisme culturel». Il en va de ce concept comme de tout le pathos de la «nouvelle Allemagne» : il est plus commode de l’expliciter par la négative. (Le nouveau pathos allemand se montre beaucoup plus facilement contre que pour quelque chose : contre le marxisme, contre le traité de Versailles, contre les juifs.) Pour commencer donc, l’esprit du «bolchevisme culturel» n’est pas nationaliste, ce qui suffit déjà à le condamner. Du reste, le bolchevik culturel n’a pas besoin d’avoir le moindre lien avec le bolchevisme, généralement il n’en a aucun. Il faut juste qu’il en ait avec la culture, laquelle est en soi motif à suspicion. Quoi qu’il en soit, il mérite de mourir parce qu’il est «anti-allemand», «réfractaire», «judéo-analytique», dépourvu de respect devant les bonnes vieilles traditions (à savoir les corporations étudiantes et les défilés militaires), pas assez «attaché à la terre», pas assez «dynamique» et de ce fait - de tous les reproches le plus épouvantable : «pacifiste»! Le bolchevik cultùrel s’est ligué avec la France, les Juifs et l’Union soviétique. li est à la fois marxiste et anarchiste (on met tout dans le même sac). Il reçoit tous les jours de l’argent des francs-maçons, des sionistes et de Staline. li faut l’exterminer.
Plutôt que d’essayer de comprendre le concept de «bolchevisme culturel », grotesque par sa totale imprécision, il vaudrait mieux déterminer tout ce qu’il a déjà détruit en Allemagne en fait de valeurs culturelles. Cependant, nous ne parlerons pas des organisations qui, par nature, se situent entre l’intellectuel et le politique, et dont l’ambition souffre peut-être de cette position intermédiaire entre deux éléments si séparés en Allemagne - je pense à la Ligue des droits de l’homme, au Secours rouge, aux diverses associations pacifistes. Dans leur cas, la répression pourrait encore être interprétée comme une opération nécessaire dans l’intérêt des dirigeants et où la dimension intellectuelle ne saurait être prise en considération. Nous nous limiterons donc au domaine purement culturel. En la matière, les nouveaux maîtres semblent se croire très riches, ou alors c’est que leur conscience est sur ce point encore plus insensible que nous ne le pensions.
Un des domaines où l’on «intervient» (pour reprendre une très jolie expression du nouveau jargon) avec une brutalité particulière est évidemment celui de l’éducation de la jeunesse.
Il est capital de ne transmettre aux cerveaux et aux cœurs enfantins que la connaissance de ces idéaux qu’on appelle aujourd’hui «nouveaux» - de manière un peu paradoxale puisque ce sont en réalité les plus anciens. Quelques jours seulement après la «prise de pouvoir» national-socialiste, l’école Karl-Marx, qui jouit d’un niveau pédagogique remarquable, et l’école Heinrich-Zille furent interdites à Berlin.
Tous les autres établissements libéraux de Berlin ou du Reich sont menacés ou déjà fermés. On se montre particulièrement méfiant à l’égard des communautés scolaires libres, qui perpétuent l’esprit initial du mouvement de jeunesse : par exemple Wickersdorf ou l’école d’Odenwald(5), où règnent la tolérance et l’amour de la paix. Ces institutions passent pour des foyers de bolchevisme culturel, d’antigermanisme répugnant - alors que justement, ce sont elles qui sont typiquement allemandes ou du moins perçues comme telles à l’étranger, ainsi que nous l’espérons. Même le très conservateur Kurt Hahn, qui dirige sur le modèle anglais l’école de Salem, au bord du lac de Constance, et ne mérite nullement d’être soupçonné de sympathies révolutionnaires, a dû faire un séjour temporaire en prison.