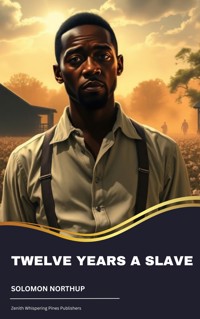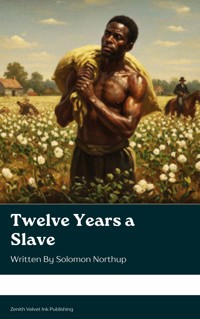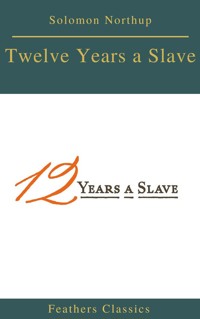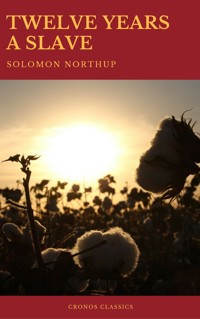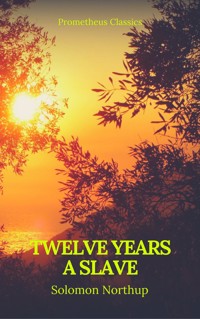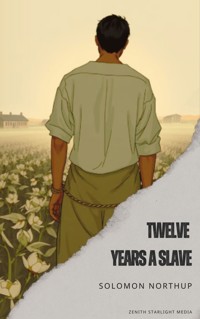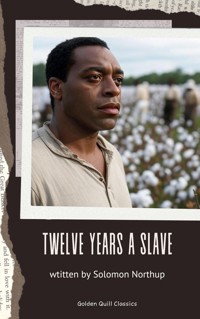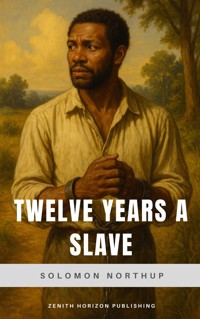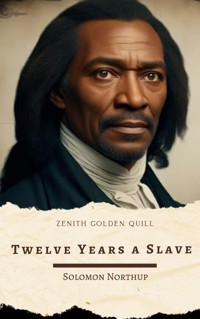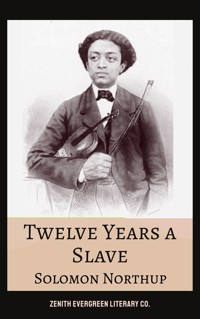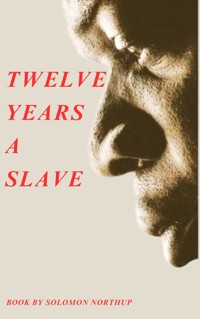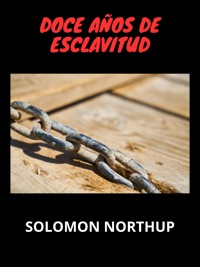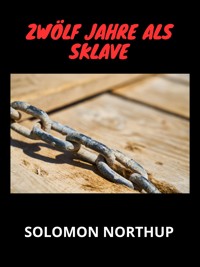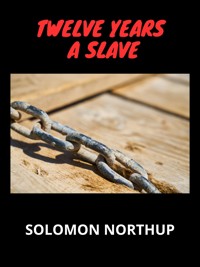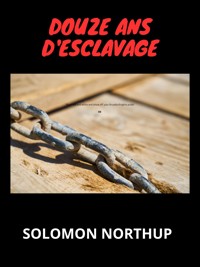
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stargatebook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1853, ce livre a ébranlé la société américaine et annoncé la guerre civile. 160 ans plus tard, il a inspiré Steve McQueen et Brad Pitt pour créer un chef-d'œuvre cinématographique qui a remporté de nombreux prix et récompenses, dont l'Oscar 2014 du meilleur film de l'année.
Quant à Solomon Northup lui-même, le livre a été pour lui une confession sur la période la plus sombre de sa vie. Une période au cours de laquelle le désespoir a presque étouffé l'espoir de se libérer des chaînes de l'esclavage et de retrouver la liberté et la dignité qui lui avaient été retirées.
Le texte de la traduction est tiré de l'édition originale de 1855. Le traducteur a conservé le style de l'auteur, ce qui montre que Solomon Northup était non seulement cultivé mais aussi lettré.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DOUZE ANS D'ESCLAVAGE
SOLOMON NORTHUP
Traduction et édition 2024 par David De Angelis
Tous les droits sont réservés
Table des matières
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
À propos de Northup :
Solomon Northup était un Afro-Américain né libre à New York, fils d'un esclave affranchi. Agriculteur et violoniste, il possédait une propriété à Hebron. En 1841, il a été enlevé par des trafiquants d'esclaves qui lui avaient fait miroiter un emploi de violoniste. Lorsqu'il accompagna ses prétendus employeurs à Washington, ils le droguèrent et le vendirent comme esclave. Il a été expédié à la Nouvelle-Orléans, où il a été vendu à un propriétaire de plantation en Louisiane. Il a été détenu dans la région de la rivière Rouge en Louisiane par plusieurs propriétaires différents pendant 12 ans, période pendant laquelle ses amis et sa famille n'ont eu aucune nouvelle de lui. Il a tenté à plusieurs reprises de s'échapper et de faire passer des messages hors de la plantation. Il finit par donner des nouvelles à sa famille, qui contacta des amis et rallia le gouverneur de New York, Washington Hunt, à sa cause. Il retrouve sa liberté en janvier 1853 et retourne auprès de sa famille à New York.
Chapitre
1
Étant né libre et ayant joui pendant plus de trente ans des bienfaits de la liberté dans un État libre, et ayant à la fin de cette période été enlevé et vendu comme esclave, où je suis resté jusqu'à ce que je sois heureusement libéré au mois de janvier 1853, après douze ans de servitude, on a suggéré qu'un récit de ma vie et de ma fortune ne serait pas inintéressant pour le public.
Depuis mon retour à la liberté, je n'ai pas manqué de constater l'intérêt croissant que suscite le sujet de l'esclavage dans les États du Nord. Des œuvres de fiction, qui prétendent dépeindre ses caractéristiques sous leurs aspects les plus agréables comme les plus répugnants, ont été diffusées dans une mesure sans précédent et, d'après ce que j'ai compris, ont créé un sujet fructueux de commentaires et de discussions.
Je ne peux parler de l'esclavage que dans la mesure où je l'ai observé moi-même, dans la mesure où je l'ai connu et vécu personnellement. Mon but est d'exposer les faits avec franchise et sincérité, de raconter l'histoire de ma vie sans exagération, laissant à d'autres le soin de déterminer si même les pages de fiction présentent une image d'un mal plus cruel ou d'une servitude plus sévère.
Aussi loin que j'ai pu remonter, mes ancêtres paternels étaient esclaves dans le Rhode Island. Ils appartenaient à une famille du nom de Northup, dont l'un des membres, parti dans l'État de New York, s'est installé à Hoosic, dans le comté de Rensselaer. Il emmena avec lui Mintus Northup, mon père. À la mort de cet homme, qui a dû survenir il y a une cinquantaine d'années, mon père est devenu libre, ayant été émancipé par une disposition de son testament.
Henry B. Northup, Esq. de Sandy Hill, un éminent avocat, et l'homme à qui, grâce à la Providence, je suis redevable de ma liberté actuelle et de mon retour dans la société de ma femme et de mes enfants, est un parent de la famille dans laquelle mes ancêtres ont été retenus au service de la justice et de laquelle ils ont tiré le nom que je porte. C'est à ce fait que l'on peut attribuer l'intérêt persévérant qu'il a porté à ma cause.
Quelque temps après la libération de mon père, il s'est installé dans la ville de Minerva, dans le comté d'Essex, dans l'État de New York, où je suis né, au mois de juillet 1808. Je n'ai pas les moyens de déterminer avec certitude combien de temps il est resté dans cette ville. De là, il se rendit à Granville, dans le comté de Washington, près d'un endroit connu sous le nom de Slyborough, où, pendant quelques années, il travailla dans la ferme de Clark Northup, également un parent de son ancien maître ; de là, il se rendit à la ferme Alden, à Moss Street, à une courte distance au nord du village de Sandy Hill ; et de là, à la ferme appartenant aujourd'hui à Russel Pratt, située sur la route menant de Fort Edward à Argyle, où il continua à résider jusqu'à sa mort, survenue le 22e jour de novembre 1829. Il a laissé une veuve et deux enfants - moi-même et Joseph, un frère aîné. Ce dernier vit toujours dans le comté d'Oswego, près de la ville de ce nom ; ma mère est décédée pendant la période de ma captivité.
Bien qu'il soit né esclave et qu'il ait souffert des désavantages auxquels ma malheureuse race est soumise, mon père était un homme respecté pour son industrie et son intégrité, comme de nombreux vivants, qui se souviennent bien de lui, sont prêts à en témoigner. Il a passé toute sa vie dans les paisibles activités de l'agriculture, sans jamais chercher à occuper les postes les plus subalternes, qui semblent être spécialement attribués aux enfants d'Afrique. Outre qu'il nous a donné une éducation supérieure à celle qui est ordinairement accordée aux enfants de notre condition, il a acquis, par son assiduité et son économie, un patrimoine suffisant pour lui permettre d'obtenir le droit de vote. Il avait l'habitude de nous parler de son enfance et, bien qu'il ait toujours éprouvé les sentiments les plus chaleureux de gentillesse et même d'affection envers la famille dont il avait été l'esclave, il comprenait néanmoins le système de l'esclavage et s'attardait avec tristesse sur la dégradation de sa race. Il s'efforça d'imprégner nos esprits de sentiments moraux et de nous apprendre à placer notre confiance en Celui qui s'intéresse aux plus humbles comme aux plus élevées de ses créatures. Combien de fois, depuis cette époque, le souvenir de ses conseils paternels m'est-il venu à l'esprit, alors que j'étais couché dans une hutte d'esclave dans les régions lointaines et malades de la Louisiane, endolori par les blessures imméritées qu'un maître inhumain lui avait infligées, et n'aspirant qu'à ce que la tombe qui l'avait recouvert me protège également du fouet de l'oppresseur. Dans la cour de l'église de Sandy Hill, une humble pierre marque l'endroit où il repose, après avoir dignement rempli les devoirs liés à la modeste sphère dans laquelle Dieu l'avait désigné pour marcher.
Jusqu'à cette époque, j'avais principalement participé avec mon père aux travaux de la ferme. Les heures de loisir qui m'étaient accordées étaient généralement consacrées à mes livres ou à jouer du violon, un amusement qui était la passion dominante de ma jeunesse. Il a également été une source de consolation depuis lors, procurant du plaisir aux êtres simples avec lesquels mon sort a été jeté, et détournant mes propres pensées, pendant de nombreuses heures, de la douloureuse contemplation de mon destin.
Le jour de Noël 1829, j'ai épousé Anne Hampton, une jeune fille de couleur qui vivait alors dans les environs de notre résidence. La cérémonie a été célébrée à Fort Edward par Timothy Eddy, magistrat de cette ville, qui en est toujours un citoyen éminent. Elle avait résidé longtemps à Sandy Hill, chez M. Baird, propriétaire de l'Eagle Tavern, ainsi que dans la famille du révérend Alexander Proudfit, de Salem. Ce dernier a présidé pendant de nombreuses années la société presbytérienne de Salem et s'est distingué par son érudition et sa piété. Anne garde un souvenir reconnaissant de l'extrême gentillesse et des excellents conseils de cet homme de bien. Elle n'est pas en mesure de déterminer la ligne exacte de son ascendance, mais le sang de trois races se mêle dans ses veines. Il est difficile de dire si c'est le rouge, le blanc ou le noir qui prédomine. Cependant, l'union de ces trois races dans son origine lui a donné une expression singulière mais agréable, comme on en voit rarement. Bien que ressemblante, elle ne peut être qualifiée de quadroon, classe à laquelle ma mère appartenait, j'ai omis de le mentionner.
Je venais de passer la période de ma minorité, ayant atteint l'âge de vingt et un ans au mois de juillet précédent. Privé des conseils et de l'assistance de mon père, avec une femme à ma charge, j'ai décidé d'entrer dans une vie d'industrie ; et malgré l'obstacle de la couleur et la conscience de ma condition inférieure, je me suis laissé aller à des rêves agréables d'un bon moment à venir, lorsque la possession d'une humble habitation, avec quelques hectares environnants, récompenserait mes travaux et m'apporterait les moyens du bonheur et de l'aisance.
Depuis mon mariage jusqu'à ce jour, l'amour que j'ai porté à ma femme a été sincère et ininterrompu ; et seuls ceux qui ont ressenti l'ardente tendresse d'un père pour sa progéniture peuvent apprécier l'affection que je porte aux enfants bien-aimés qui nous sont nés depuis. J'estime qu'il est approprié et nécessaire de le dire aujourd'hui, afin que ceux qui liront ces pages puissent comprendre le caractère poignant des souffrances que j'ai été condamné à endurer.
Immédiatement après notre mariage, nous avons commencé à tenir une maison dans le vieux bâtiment jaune qui se trouvait alors à l'extrémité sud du village de Fort Edward et qui a été transformé en un manoir moderne, récemment occupé par le capitaine Lathrop. Il est connu sous le nom de Fort House. C'est dans ce bâtiment que les tribunaux se sont parfois tenus après l'organisation du comté. Il fut également occupé par Burgoyne en 1777, car il était situé près de l'ancien fort, sur la rive gauche de l'Hudson.
Pendant l'hiver, j'ai travaillé avec d'autres personnes à la réparation du canal de Champlain, sur la section dont William Van Nortwick était le surintendant. David McEachron avait la responsabilité immédiate des hommes avec lesquels je travaillais. Au moment de l'ouverture du canal au printemps, j'ai pu, grâce aux économies réalisées sur mon salaire, acheter une paire de chevaux et d'autres choses nécessaires à la navigation.
Ayant engagé plusieurs ouvriers efficaces pour m'aider, j'ai conclu des contrats pour le transport de grands radeaux de bois du lac Champlain à Troy. Dyer Beckwith et un certain M. Bartemy, de Whitehall, m'accompagnèrent lors de plusieurs voyages. Au cours de la saison, je me familiarisai parfaitement avec l'art et les mystères du transport par radeau - une connaissance qui me permit par la suite de rendre un service profitable à un maître digne de ce nom, et d'étonner les bûcherons simples d'esprit sur les rives du Bayou Bœuf.
Au cours d'un de mes voyages sur le lac Champlain, j'ai été incité à visiter le Canada. Me rendant à Montréal, j'ai visité la cathédrale et d'autres lieux d'intérêt de cette ville, d'où j'ai poursuivi mon excursion à Kingston et dans d'autres villes, acquérant ainsi une connaissance des localités qui m'a été utile par la suite, comme on le verra vers la fin de ce récit.
Ayant rempli mes contrats sur le canal de manière satisfaisante pour moi et pour mon employeur, et ne souhaitant pas rester inactif, maintenant que la navigation sur le canal était à nouveau suspendue, j'ai conclu un autre contrat avec Medad Gunn, pour couper une grande quantité de bois. J'ai travaillé dans ce domaine pendant l'hiver 1831-32.
Avec le retour du printemps, Anne et moi avons conçu le projet de prendre une ferme dans le voisinage. J'avais été habitué dès mon plus jeune âge aux travaux agricoles et c'était une occupation qui correspondait à mes goûts. J'ai donc pris des dispositions pour une partie de la vieille ferme Alden, où mon père résidait auparavant. Avec une vache, un porc, une paire de beaux boeufs que j'avais achetés à Lewis Brown, à Hartford, et d'autres biens et effets personnels, nous avons rejoint notre nouvelle maison à Kingsbury. Cette année-là, j'ai planté vingt-cinq acres de maïs, semé de vastes champs d'avoine et commencé à pratiquer l'agriculture à une échelle aussi grande que le permettaient mes moyens les plus modestes. Anne s'occupait avec diligence des affaires de la maison, tandis que je travaillais laborieusement dans les champs.
Nous avons continué à résider à cet endroit jusqu'en 1834. Pendant la saison hivernale, j'étais souvent appelé à jouer du violon. Partout où les jeunes se réunissaient pour danser, j'étais presque invariablement présent. Dans tous les villages environnants, mon violon était bien connu. Anne, elle aussi, durant sa longue résidence à la Taverne de l'Aigle, était devenue quelque peu célèbre en tant que cuisinière. Pendant les semaines de cour, et lors des occasions publiques, elle était employée à la cuisine du Sherrill's Coffee House pour un salaire élevé.
Nous revenions toujours à la maison après avoir rendu ces services avec de l'argent en poche, de sorte qu'avec le violon, la cuisine et l'agriculture, nous nous retrouvâmes bientôt en possession de l'abondance et, en fait, nous menions une vie heureuse et prospère. Nous aurions été bien lotis si nous étions restés à la ferme de Kingsbury, mais le moment est venu de faire le pas suivant vers la cruelle destinée qui m'attendait.
En mars 1834, nous avons déménagé à Saratoga Springs. Nous occupions une maison appartenant à Daniel O'Brien, sur le côté nord de la rue Washington. À cette époque, Isaac Taylor tenait une grande pension de famille, connue sous le nom de Washington Hall, à l'extrémité nord de Broadway. Il m'a embauché pour conduire une voiture de course, fonction que j'ai exercée pendant deux ans. Par la suite, j'ai généralement été employé pendant la saison des visites, tout comme Anne, à l'United States Hotel et dans d'autres établissements publics de la ville. En hiver, je me contentais de mon violon, bien que pendant la construction de la ligne de chemin de fer Troy-Saratoga, j'ai travaillé dur pendant de nombreuses journées.
J'avais l'habitude, à Saratoga, d'acheter les articles nécessaires à ma famille dans les magasins de M. Cephas Parker et de M. William Perry, des hommes envers lesquels j'éprouvais une grande estime pour leurs nombreux actes de gentillesse. C'est pour cette raison que, douze ans plus tard, j'ai fait adresser à ces deux hommes la lettre qui est insérée ci-après et qui a été le moyen, entre les mains de M. Northup, de mon heureuse délivrance.
Lorsque j'habitais à l'hôtel United States, j'ai souvent rencontré des esclaves qui avaient accompagné leurs maîtres depuis le Sud. Ils étaient toujours bien habillés et bien logés, menant apparemment une vie facile, avec peu de problèmes ordinaires pour les rendre perplexes. Ils ont souvent entamé une conversation avec moi sur le sujet de l'esclavage. Presque uniformément, j'ai constaté qu'ils nourrissaient un désir secret de liberté. Certains d'entre eux exprimaient le désir le plus ardent de s'échapper et me consultaient sur la meilleure méthode pour y parvenir. Cependant, la crainte d'une punition, qu'ils savaient devoir accompagner leur capture et leur retour, s'est avérée dans tous les cas suffisante pour les dissuader de tenter l'expérience. Ayant respiré toute ma vie l'air libre du Nord, et conscient de posséder les mêmes sentiments et les mêmes affections qui trouvent place dans la poitrine de l'homme blanc ; conscient, en outre, d'une intelligence égale à celle de certains hommes, du moins, à la peau plus claire. J'étais trop ignorant, peut-être trop indépendant, pour concevoir comment quelqu'un pouvait se contenter de vivre dans la condition abjecte d'un esclave. Je ne pouvais pas comprendre la justice de cette loi ou de cette religion qui soutient ou reconnaît le principe de l'esclavage ; et jamais, je suis fier de le dire, je n'ai manqué de conseiller à quiconque venait me voir de saisir sa chance et de frapper pour la liberté.
J'ai continué à résider à Saratoga jusqu'au printemps 1841. Les attentes flatteuses qui, sept ans auparavant, nous avaient séduits en quittant la paisible ferme située sur la rive est de l'Hudson, ne s'étaient pas concrétisées. Bien que nous ayons toujours été dans une situation confortable, nous n'avions pas prospéré. La société et les associations de ce point d'eau de renommée mondiale n'étaient pas de nature à préserver les habitudes simples d'industrie et d'économie auxquelles j'avais été habitué, mais, au contraire, à les remplacer par d'autres, tendant à l'insouciance et à l'extravagance.
À cette époque, nous étions parents de trois enfants : Elizabeth, Margaret et Alonzo. Elizabeth, l'aînée, était dans sa dixième année ; Margaret avait deux ans de moins, et le petit Alonzo venait de passer son cinquième anniversaire. Ils remplissaient notre maison de joie. Leurs jeunes voix étaient de la musique à nos oreilles. Leur mère et moi-même avons construit de nombreux châteaux aériens pour ces petits innocents. Lorsque je ne travaillais pas, je me promenais toujours avec eux, vêtus de leurs plus beaux atours, dans les rues et les bosquets de Saratoga. Leur présence me ravissait et je les serrais contre mon sein avec un amour aussi chaleureux et tendre que si leurs peaux nuageuses avaient été aussi blanches que la neige.
Jusqu'à présent, l'histoire de ma vie ne présente rien d'extraordinaire, rien d'autre que les espoirs, les amours et les travaux ordinaires d'un obscur homme de couleur qui fait son humble chemin dans le monde. Mais j'étais arrivé à un tournant de mon existence, au seuil d'un mal, d'un chagrin et d'un désespoir indicibles. Je m'étais approché de l'ombre du nuage, de l'épaisse obscurité dans laquelle j'allais bientôt disparaître, pour être désormais caché aux yeux de tous les miens et privé de la douce lumière de la liberté pendant de nombreuses années.
Chapitre
2
UN matin, vers la fin du mois de mars 1841, n'ayant à ce moment-là aucune affaire particulière à régler, je me promenais dans le village de Saratoga Springs, me demandant où je pourrais trouver un emploi jusqu'à l'arrivée de la saison chargée. Anne, comme à son habitude, s'était rendue à Sandy Hill, à une distance d'environ vingt miles, pour prendre en charge le service culinaire du Sherrill's Coffee House, pendant la session de la cour. Elizabeth, je crois, l'avait accompagnée. Margaret et Alonzo étaient avec leur tante à Saratoga.
À l'angle de Congress Street et de Broadway, près de la taverne qui, à l'époque, et pour autant que je sache, est toujours tenue par M. Moon, je fus accueilli par deux messieurs d'apparence respectable, qui m'étaient tous deux totalement inconnus. J'ai l'impression qu'ils m'ont été présentés par une de mes connaissances, dont j'ai vainement cherché à me souvenir, avec la remarque que j'étais un joueur de violon expert. Quoi qu'il en soit, ils engagèrent immédiatement la conversation sur ce sujet, en posant de nombreuses questions sur mes compétences en la matière. Mes réponses étant apparemment satisfaisantes, ils proposèrent d'engager mes services pour une courte période, déclarant en même temps que j'étais exactement la personne dont leur entreprise avait besoin. Leurs noms, tels qu'ils me les donnèrent par la suite, étaient Merrill Brown et Abram Hamilton, bien que j'aie de fortes raisons de douter qu'il s'agisse là de leurs véritables appellations. Le premier était un homme d'une quarantaine d'années, de petite taille et de forte corpulence, dont le visage dénotait de la perspicacité et de l'intelligence. Il portait une redingote noire et un chapeau noir, et disait résider soit à Rochester, soit à Syracuse. Ce dernier était un jeune homme au teint clair et aux yeux clairs, et, à mon avis, il n'avait pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans. Il était grand et mince, vêtu d'un manteau couleur tabac, d'un chapeau brillant et d'un gilet d'un modèle élégant. Tout son habillement était à l'extrême de la mode. Son apparence était quelque peu efféminée, mais séduisante, et il y avait chez lui un air facile qui montrait qu'il s'était mêlé au monde. Ils étaient liés, comme ils me l'ont dit, à une compagnie de cirque qui se trouvait alors dans la ville de Washington ; ils étaient en route pour la rejoindre, après l'avoir quittée pour une courte période afin de faire une excursion vers le nord, dans le but de voir le pays, et ils payaient leurs dépenses par une exhibition occasionnelle. Ils me firent également remarquer qu'ils avaient eu beaucoup de mal à se procurer de la musique pour leurs spectacles et que si je les accompagnais jusqu'à New-York, ils me donneraient un dollar pour chaque jour de service et trois dollars en plus pour chaque soir où je jouerais à leurs spectacles, en plus d'une somme suffisante pour payer les frais de mon retour de New-York à Saratoga.
J'ai immédiatement accepté l'offre alléchante, à la fois pour la récompense qu'elle promettait et par désir de visiter la métropole. Ils étaient impatients de partir immédiatement. Pensant que mon absence serait brève, je ne jugeai pas nécessaire d'écrire à Anne où j'étais parti ; en fait, je supposais que mon retour serait peut-être aussi rapide que le sien. Je pris donc du linge de rechange et mon violon, et je me préparai à partir. On fit venir la voiture - une voiture couverte, tirée par une paire de nobles bays, qui formaient un ensemble élégant. Leurs bagages, composés de trois grandes malles, furent attachés sur le porte-bagages et, montant sur le siège du conducteur, tandis qu'ils prenaient place à l'arrière, je m'éloignai de Saratoga sur la route d'Albany, ravi de ma nouvelle position et heureux comme je ne l'avais jamais été, quel que soit le jour de toute ma vie.
Nous sommes passés par Ballston et avons emprunté la "ridge road", comme on l'appelle, si ma mémoire est bonne, et l'avons suivie directement jusqu'à Albany. Nous atteignîmes cette ville avant la tombée de la nuit et nous nous arrêtâmes dans un hôtel situé au sud du musée. Ce soir-là, j'ai eu l'occasion d'assister à l'un de leurs spectacles - le seul, pendant toute la période où je les ai accompagnés. Hamilton était posté à la porte ; je formais l'orchestre, tandis que Brown assurait le spectacle. Il s'agissait de lancer des balles, de danser sur la corde, de faire frire des crêpes dans un chapeau, de faire couiner des cochons invisibles et d'autres prouesses de ventriloquie et de légendaire. Le public était extraordinairement clairsemé, et pas des plus sélects, et le rapport d'Hamilton sur les recettes n'est qu'un "compte miséreux de boîtes vides".
Tôt le lendemain matin, nous avons repris notre voyage. L'essentiel de leur conversation était désormais l'expression d'un désir d'arriver au cirque sans tarder. Ils se dépêchèrent d'avancer, sans s'arrêter de nouveau pour exposer, et en temps voulu, nous atteignîmes New-York, logeant dans une maison à l'ouest de la ville, dans une rue allant de Broadway à la rivière. Je pensais que mon voyage touchait à sa fin et j'espérais, dans un jour ou deux au moins, retourner auprès de mes amis et de ma famille à Saratoga. Brown et Hamilton, cependant, commencèrent à m'exhorter à continuer avec eux jusqu'à Washington. Ils prétendaient que dès leur arrivée, maintenant que la saison estivale approchait, le cirque partirait pour le nord. Ils me promirent une situation et un salaire élevé si je les accompagnais. Ils m'ont longuement vanté les avantages qui en résulteraient pour moi, et les représentations flatteuses qu'ils m'ont faites étaient telles que j'ai finalement décidé d'accepter l'offre.
Le lendemain matin, ils suggérèrent que, dans la mesure où nous étions sur le point d'entrer dans un État esclavagiste, il serait bon, avant de quitter New-York, de se procurer des papiers libres. L'idée me parut prudente, mais je pense qu'elle ne me serait guère venue à l'esprit s'ils ne l'avaient pas proposée. Nous nous sommes immédiatement rendus à ce que j'ai compris être le bureau des douanes. Ils ont prêté serment sur certains faits montrant que j'étais un homme libre. Un document a été rédigé et nous a été remis, avec la consigne de l'apporter au bureau du greffier. Nous l'avons fait et le greffier y a ajouté quelque chose, pour lequel il a été payé six shillings, puis nous sommes retournés au bureau de douane. Quelques formalités supplémentaires ont été accomplies avant que tout ne soit terminé, et après avoir payé deux dollars à l'officier, j'ai mis les papiers dans ma poche et je suis parti avec mes deux amis vers notre hôtel. Je pensais alors, je dois l'avouer, que ces papiers ne valaient guère la peine d'être obtenus, la crainte d'un danger pour ma sécurité personnelle ne m'ayant jamais effleuré l'esprit. Je me souviens que le greffier auquel nous avons été adressés a rédigé un mémorandum dans un grand livre qui, je suppose, se trouve encore dans le bureau. Une référence aux entrées de la fin mars ou du premier avril 1841 satisfera sans aucun doute les incrédules, du moins en ce qui concerne cette transaction particulière.
Avec la preuve de la liberté en ma possession, le lendemain de notre arrivée à New-York, nous avons traversé le ferry jusqu'à Jersey City et pris la route de Philadelphie. Nous y sommes restés une nuit et avons poursuivi notre voyage vers Baltimore tôt le matin. En temps voulu, nous sommes arrivés dans cette ville et nous nous sommes arrêtés dans un hôtel près de la gare, tenu par un certain M. Rathbone ou connu sous le nom de Rathbone House. Pendant tout le trajet depuis New-York, leur impatience d'arriver au cirque semblait devenir de plus en plus grande. Nous avons quitté la calèche à Baltimore et sommes montés dans les voitures pour nous rendre à Washington, où nous sommes arrivés juste à la tombée de la nuit, la veille des funérailles du général Harrison, et nous nous sommes arrêtés à l'hôtel Gadsby's, sur Pennsylvania Avenue.
Après le dîner, ils m'appelèrent dans leurs appartements et me payèrent quarante-trois dollars, une somme supérieure à mon salaire. Cet acte de générosité était dû, disaient-ils, au fait qu'ils ne s'étaient pas produits aussi souvent qu'ils me l'avaient laissé supposer pendant notre voyage depuis Saratoga. Ils m'informèrent en outre que la compagnie du cirque avait eu l'intention de quitter Washington le lendemain matin, mais qu'en raison des funérailles, elle avait décidé de rester un jour de plus. Ils furent alors, comme ils l'avaient été depuis notre première rencontre, extrêmement aimables. Ils ne manquèrent pas une occasion de m'adresser un langage d'approbation, alors que, d'un autre côté, j'étais certainement très bien disposé à leur égard. Je leur ai donné ma confiance sans réserve, et je leur aurais volontiers fait confiance jusqu'à presque n'importe quel point. Leur conversation constante et leurs manières à mon égard, leur prévoyance en suggérant l'idée des journaux gratuits, et une centaine d'autres petits actes qu'il est inutile de répéter, tout indiquait qu'ils étaient vraiment des amis, sincèrement soucieux de mon bien-être. Je ne sais pas s'ils l'étaient. Je ne sais pas s'ils étaient innocents de la grande méchanceté dont je les crois maintenant coupables. S'ils étaient complices de mes malheurs - des monstres subtils et inhumains sous la forme d'hommes - m'attirant délibérément loin de mon foyer, de ma famille et de ma liberté pour l'amour de l'or - ceux qui liront ces pages auront les mêmes moyens de le déterminer que moi. S'ils étaient innocents, ma disparition soudaine aurait dû être inexplicable ; mais en tournant dans mon esprit toutes les circonstances, je n'ai encore jamais pu me livrer, à leur égard, à une supposition aussi charitable.
Après leur avoir remis l'argent, qu'ils semblaient avoir en abondance, ils m'ont conseillé de ne pas aller dans les rues ce soir-là, car je ne connaissais pas les coutumes de la ville. Promettant de me souvenir de leur conseil, je les quittai ensemble et, peu après, un serviteur de couleur m'indiqua une chambre à coucher dans la partie arrière de l'hôtel, au rez-de-chaussée. Je m'allongeai pour me reposer, pensant à mon foyer, à ma femme, à mes enfants et à la longue distance qui nous séparait, jusqu'à ce que je m'endorme. Mais aucun ange de pitié ne vint à mon chevet pour me dire de m'envoler, aucune voix de miséricorde ne m'avertit dans mes rêves des épreuves qui étaient à portée de main.
Le lendemain, il y eut une grande fête à Washington. Le grondement des canons et le son des cloches emplissaient l'air, tandis que de nombreuses maisons étaient recouvertes d'un linceul et que les rues étaient noires de monde. Au fur et à mesure que la journée avançait, le cortège fit son apparition, s'avançant lentement dans l'avenue, calèche après calèche, dans une longue succession, tandis que des milliers et des milliers de personnes suivaient à pied, le tout au son d'une musique mélancolique. Ils portaient le corps de Harrison vers la tombe.
Dès le matin, j'étais constamment en compagnie de Hamilton et de Brown. Ils étaient les seules personnes que je connaissais à Washington. Nous sommes restés ensemble pendant que la pompe funèbre passait. Je me souviens très bien que les vitres des fenêtres se brisaient et s'effondraient sur le sol après chaque coup de canon tiré dans le cimetière. Nous sommes allés au Capitole et avons marché longtemps dans les environs. Dans l'après-midi, ils se sont dirigés vers la Maison du Président, tout en me gardant près d'eux et en m'indiquant divers endroits intéressants. Je n'avais encore rien vu du cirque. En fait, je n'y avais que très peu pensé, voire pas du tout, au milieu de l'excitation de la journée.
À plusieurs reprises au cours de l'après-midi, mes amis sont entrés dans des débits de boissons et ont demandé de l'alcool. Ils n'avaient cependant pas l'habitude, pour autant que je les connaisse, de se livrer à des excès. À ces occasions, après s'être servis, ils se versaient un verre et me le tendaient. Je n'étais pas en état d'ébriété, comme on peut le déduire de ce qui s'est passé par la suite. Vers le soir, et peu après avoir pris une de ces boissons, j'ai commencé à éprouver des sensations très désagréables. Je me sentais extrêmement mal. J'ai commencé à avoir mal à la tête, une douleur sourde et lourde, inexprimablement désagréable. À table, je n'avais plus d'appétit ; la vue et la saveur des aliments me donnaient la nausée. À la nuit tombée, le même serviteur me conduisit dans la chambre que j'avais occupée la nuit précédente. Brown et Hamilton me conseillèrent de me retirer, me félicitant gentiment et exprimant l'espoir que j'irais mieux demain matin. Me débarrassant simplement de mon manteau et de mes bottes, je me jetai sur le lit. Il me fut impossible de dormir. La douleur à la tête ne cessait d'augmenter, jusqu'à devenir presque insupportable. En peu de temps, j'eus soif. Mes lèvres étaient desséchées. Je ne pouvais penser qu'à l'eau, aux lacs et aux rivières, aux ruisseaux où je m'étais baissé pour boire, et au seau qui s'égouttait, remontant du fond du puits avec son nectar frais et débordant. Vers minuit, autant que je puisse en juger, je me levai, incapable de supporter plus longtemps une telle intensité de soif. J'étais étranger à la maison, et je ne connaissais pas ses appartements. Il n'y avait personne debout, d'après ce que j'ai pu observer. En tâtonnant au hasard, je ne savais pas où, j'ai fini par trouver le chemin d'une cuisine au sous-sol. Deux ou trois domestiques de couleur y circulaient, et l'un d'eux, une femme, me donna deux verres d'eau. Cela me soulagea momentanément, mais lorsque j'eus regagné ma chambre, le même désir brûlant de boire, la même soif torturante, étaient revenus. C'était encore plus torturant qu'avant, tout comme la douleur sauvage dans ma tête, si tant est qu'une telle chose puisse exister. J'étais dans un état de détresse extrême, dans une agonie des plus atroces ! Je semblais au bord de la folie ! Le souvenir de cette nuit d'horribles souffrances me suivra jusque dans la tombe.
Une heure ou plus après mon retour de la cuisine, j'ai eu conscience que quelqu'un entrait dans ma chambre. Il semblait y en avoir plusieurs - un mélange de voix diverses - mais je ne saurais dire combien ils étaient, ni qui ils étaient. Quant à savoir si Brown et Hamilton en faisaient partie, c'est une simple question de conjecture. Je me souviens seulement, avec un certain degré de précision, qu'on m'a dit qu'il était nécessaire d'aller voir un médecin et de me procurer des médicaments, et que, enfilant mes bottes, sans manteau ni chapeau, je les ai suivis à travers un long passage, ou une allée, jusqu'à la rue ouverte. Celle-ci s'étendait à angle droit de Pennsylvania Avenue. De l'autre côté, une lumière brûlait dans une fenêtre. J'ai l'impression qu'il y avait alors trois personnes avec moi, mais c'est tout à fait indéfini et vague, comme le souvenir d'un rêve douloureux. Aller vers la lumière, que j'imaginais provenir du cabinet d'un médecin, et qui semblait s'éloigner au fur et à mesure que j'avançais, est la dernière lueur dont je me souvienne aujourd'hui. À partir de ce moment, je suis resté insensible. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état - que ce soit seulement cette nuit-là ou plusieurs jours et plusieurs nuits - mais lorsque j'ai repris conscience, je me suis retrouvé seul, dans l'obscurité la plus totale et enchaîné.
La douleur à la tête s'était atténuée dans une certaine mesure, mais j'étais très faible. J'étais assis sur un banc bas, fait de planches rugueuses, sans manteau ni chapeau. J'avais les mains menottées. Autour de mes chevilles, il y avait aussi une paire de lourdes entraves. L'une des extrémités d'une chaîne était attachée à un gros anneau dans le sol, l'autre aux entraves de mes chevilles. J'ai essayé en vain de me mettre debout. Sortant d'une transe si douloureuse, il me fallut un certain temps avant de pouvoir rassembler mes pensées. Où étais-je ? Que signifiaient ces chaînes ? Où étaient Brown et Hamilton ? Qu'avais-je fait pour mériter d'être emprisonné dans un tel cachot ? Je n'arrivais pas à comprendre. Il y avait un vide d'une durée indéterminée, précédant mon réveil dans ce lieu solitaire, dont les événements ne pouvaient être rappelés par la mémoire la plus extensible. J'écoutais attentivement pour percevoir un signe ou un son de vie, mais rien ne rompait le silence oppressant, à part le cliquetis de mes chaînes dès que je bougeais. Je parlai à voix haute, mais le son de ma voix me fit sursauter. Je fouillai mes poches, dans la mesure où mes entraves me le permettaient - suffisamment pour m'assurer que non seulement on m'avait volé ma liberté, mais que mon argent et mes papiers libres avaient également disparu ! C'est alors que l'idée commença à s'imposer à mon esprit, d'abord vague et confuse, que j'avais été enlevé. Mais cela me paraissait incroyable.
Il doit y avoir eu un malentendu, une erreur malheureuse. Il n'était pas possible qu'un citoyen libre de New-York, qui n'avait fait de tort à personne et n'avait violé aucune loi, soit traité de façon aussi inhumaine. Cependant, plus je contemplais ma situation, plus mes soupçons se confirmaient. C'était une pensée désolante, en effet. Je sentais que l'homme insensible n'avait ni confiance ni pitié et, me recommandant au Dieu des opprimés, j'inclinai ma tête sur mes mains entravées et pleurai amèrement.
Chapitre
3
Environ trois heures s'écoulèrent, pendant lesquelles je restai assis sur le banc bas, absorbé dans de douloureuses méditations. Enfin, j'entendis le chant d'un coq, et bientôt un grondement lointain, comme celui d'une voiture se déplaçant à toute allure dans les rues, parvint à mes oreilles, et je sus qu'il faisait jour. Cependant, aucun rayon de lumière ne pénétrait dans ma prison. Enfin, j'entendis des pas au-dessus de moi, comme si quelqu'un marchait de long en large. Il me vint alors à l'esprit que je devais me trouver dans un appartement souterrain, et les odeurs d'humidité et de moisissure qui régnaient dans l'endroit confirmèrent cette supposition. Le bruit au-dessus continua pendant au moins une heure, quand enfin j'entendis des pas s'approcher de l'extérieur. Une clé cliqueta dans la serrure, une porte solide bascula sur ses gonds, laissant entrer un flot de lumière, et deux hommes entrèrent et se tinrent devant moi. L'un d'eux était un homme grand et puissant, âgé d'une quarantaine d'années peut-être, aux cheveux bruns, châtains, légèrement parsemés de gris. Son visage était plein, son teint mat, ses traits grossiers, n'exprimant rien d'autre que la cruauté et la ruse. Il mesurait environ cinq pieds et dix pouces, était bien habillé et, sans préjugé, je dois dire que c'était un homme dont l'apparence entière était sinistre et répugnante. Il s'appelait James H. Burch, comme je l'ai appris par la suite, un marchand d'esclaves bien connu à Washington, et qui était alors, ou avait été récemment, associé à Theophilus Freeman, de la Nouvelle-Orléans. La personne qui l'accompagnait était un simple laquais, nommé Ebenezer Radburn, qui n'agissait qu'en qualité de clef de voûte. Ces deux hommes vivent encore à Washington, ou y vivaient au moment de mon retour de l'esclavage par cette ville, en janvier dernier.
La lumière qui pénétrait par la porte ouverte me permit d'observer la pièce dans laquelle j'étais enfermé. Elle mesurait environ douze pieds carrés - les murs étaient en maçonnerie solide. Le sol était fait de lourdes planches. Il y avait une petite fenêtre, barrée de gros barreaux de fer, avec un volet extérieur solidement fixé.
Une porte cerclée de fer donnait accès à une cellule adjacente, ou voûte, totalement dépourvue de fenêtres ou de tout moyen d'apporter de la lumière. Le mobilier de la pièce dans laquelle je me trouvais consistait en un banc de bois sur lequel j'étais assis, un vieux fourneau sale et démodé, et en plus de cela, dans les deux cellules, il n'y avait ni lit, ni couverture, ni quoi que ce soit d'autre. La porte par laquelle Burch et Radburn sont entrés donnait sur un petit passage, une volée de marches et une cour entourée d'un mur de briques de dix ou douze pieds de haut, immédiatement à l'arrière d'un bâtiment de la même largeur que lui. La cour s'étendait à l'arrière de la maison sur une trentaine de pieds. Dans une partie du mur, il y avait une porte solidement ferrée, ouvrant sur un passage étroit et couvert, qui longeait un côté de la maison jusqu'à la rue. Le destin de l'homme de couleur, sur lequel la porte menant à ce passage étroit se refermait, était scellé. Le haut du mur soutenait l'une des extrémités d'un toit qui montait vers l'intérieur, formant une sorte de hangar ouvert. Sous le toit, il y avait un grenier fou tout autour, où les esclaves, s'ils étaient disposés à le faire, pouvaient dormir la nuit ou, par mauvais temps, se mettre à l'abri de la tempête. Ce bâtiment ressemblait à la basse-cour d'un fermier à bien des égards, sauf qu'il était construit de manière à ce que le monde extérieur ne puisse jamais voir le bétail humain qui y était rassemblé.
Le bâtiment auquel la cour était rattachée était haut de deux étages et donnait sur l'une des rues publiques de Washington. Son extérieur ne présentait que l'apparence d'une résidence privée tranquille. Un étranger qui l'aurait regardé n'aurait jamais imaginé les utilisations exécrables qui en étaient faites. Aussi étrange que cela puisse paraître, le Capitole se trouvait à portée de vue de cette même maison, du haut de sa hauteur dominante. Les voix des représentants patriotiques vantant la liberté et l'égalité et le cliquetis des chaînes des pauvres esclaves se mêlaient presque. Un enclos d'esclaves à l'ombre même du Capitole !
Telle est la description exacte, telle qu'elle était en 1841, de l'enclos des esclaves de Williams à Washington, dans l'une des caves où je me suis trouvé si inexplicablement enfermé. "Eh bien, mon garçon, comment te sens-tu maintenant ? dit Burch en entrant par la porte ouverte. Je lui répondis que j'étais malade et lui demandai la cause de mon emprisonnement. Il me répondit que j'étais son esclave, qu'il m'avait acheté et qu'il était sur le point de m'envoyer à la Nouvelle-Orléans. J'affirmai, à haute voix et avec audace, que j'étais un homme libre, un résident de Saratoga, où j'avais une femme et des enfants également libres, et que je m'appelais Northup. Je me plaignis amèrement de l'étrange traitement que j'avais reçu et menaçai, à ma libération, d'obtenir satisfaction pour ce tort. Il nia que j'étais libre et, avec un serment catégorique, déclara que je venais de Géorgie. Je répétai que je n'étais l'esclave de personne et j'insistai pour qu'il me débarrasse immédiatement de mes chaînes. Il s'efforça de me faire taire, comme s'il craignait que ma voix ne soit entendue. Mais je n'ai pas voulu me taire et j'ai dénoncé les auteurs de mon emprisonnement, quels qu'ils soient, comme des scélérats absolus. Constatant qu'il ne pouvait pas me faire taire, il entra dans une violente colère. Avec des serments blasphématoires, il me traita de menteur noir, de fugitif de Géorgie et de toutes les autres épithètes profanes et vulgaires que la fantaisie la plus indécente pouvait concevoir.