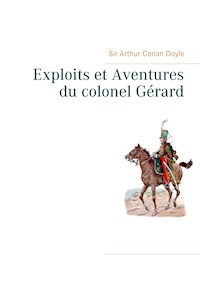
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Conan Doyle nous offre une vision rafraîchissante des aventures d'un officier d'Empire. Humour, aventure...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE
EXPLOITS DU COLONEL GERARD
Comment le colonel gagna la croix
Comment le colonel tint le roi entre ses mains
Comment le roi garda le colonel
Comment le colonel debarrassa l’empereur des frères d’Ajaccio.
Comment le colonel visita le château des horreurs
Comment le colonel fit campagne contre le Maréchal Millefleurs
Comment le colonel fut tente par le diable
AVENTURES DU BRIGADIER GERARD
Avant-propos du traducteur
Comment le brigadier perdit une oreille
Comment le brigadier prit Saragosse
Comment le brigadier tua le renard
Comment le brigadier sauva une armée
Comment le brigadier triompha en angleterre
Comment le brigadier se rendit à minsk
Comment le brigadier se conduisit à waterloo
la dernière aventure du brigadier
LES EXPLOITS DU COLONEL GERARD
Traduction de Geo Adam
I
COMMENT LE COLONEL GAGNA LA CROIX
Le duc de Tarente, ou Macdonald, comme préfèrent l’appeler ses vieux camarades, était ce jour-là d’une humeur exécrable. Sa figure renfrognée d’Ecossais ressemblait à un de ces grotesques marteaux de porte que l’on peut voir dans le faubourg Saint-Germain. J’ai su, depuis, que l’Empereur avait dit un jour, en plaisantant, qu’il l’aurait bien envoyé contre Wellington dans le sud, mais qu’il n’avait pas voulu se hasarder à lui laisser entendre le son des pibrochs. Le major Charpentier et moi nous voyions clairement qu’il était en ce moment dans une grande colère.
— Colonel Gérard, des hussards, cria-t-il, du ton d’un caporal interpellant une recrue.
Je saluai.
— Major Charpentier, des grenadiers à cheval.
Mon camarade répondit de même à l’appel de son nom.
— L’Empereur a une mission à vous confier.
Et sans un mot de plus, il ouvrit la porte et nous annonça.
J’ai vu Napoléon dix fois à cheval pour une fois à pied, et mon avis est qu’il a raison de ne se montrer qu’à cheval à ses troupes, car il a vraiment bonne mine en selle. Tel que nous le vîmes ce jour-là, il était d’une bonne longueur de main le plus petit des six hommes alors réunis dans la pièce, et pourtant, moi-même je ne suis pas très grand, quoique d’une jolie taille cependant pour un hussard. Il est évident qu’il a le buste trop long pour les jambes. Avec sa grosse tête ronde, ses épaules voûtées, sa figure entièrement rasée, il a plutôt l’air d’un professeur de Sorbonne que du premier soldat de France. Chacun son goût, mais il me semble que si je pouvais lui coller en travers de la figure une paire de ces fines moustaches de beau cavalier comme les miennes, cela ne lui nuirait pas. Cependant il a une bouche qui exprime la fermeté et des yeux remarquables. Je ne les ai vus qu’une seule fois dirigés sur moi avec colère, et j’aimerais mieux me jeter sur un carré d’ennemis, au grand galop de mon cheval, que de m’exposer de nouveau à ces yeux-là. Et pourtant je ne suis pas homme à me laisser intimider facilement.
Il se tenait à un bout de la pièce, du côté opposé à la fenêtre ; il examinait une carte pendue au mur. Berthier se tenait près de lui, l’air grave, et au moment où nous entrâmes, Napoléon lui arracha brusquement son sabre et le piqua sur la carte. Il parlait vite et à voix basse, mais je l’entendis qui disait : « La vallée de la Meuse, » et il répéta deux fois « Berlin ». Son aide de camp s’avança vers nous, mais l’Empereur l’arrêta et nous fit signe d’avancer.
— Vous n’avez pas encore la croix d’honneur, colonel Gérard ? me demanda-t-il.
— Non, Sire, répondis-je.
Et j’allais ajouter que ce n’était pas faute de l’avoir méritée, quand il m’arrêta court de son geste péremptoire.
— Et vous, major ?
— Non, Sire !
— Alors voilà une occasion pour vous de la gagner.
Il se retourna vers la carte et plaça la pointe du sabre de Berthier sur Reims.
— Je veux vous parler franchement, Messieurs, dit-il, comme à deux camarades. Et il avait un sourire étrange et charmeur qui éclairait sa figure pâle d’une sorte d’éclat de soleil froid. – Nous voici ici, aujourd’hui 14 mars, à Reims, quartier général actuel. Voilà Paris là, à une distance de vingt-cinq lieues par la route. Blücher est au nord, Schwarzenberg au sud.
Et il piquait la carte avec le sabre en parlant.
— Maintenant, dit-il, plus ces gens-là s’avanceront dans le pays, plus je les écraserai complètement. Très bien, laissons-les faire. Mon frère, le roi d’Espagne, sera là avec cent mille hommes. C’est vers lui que je vous envoie. Vous lui remettrez cette lettre dont je vous confie à chacun une copie. C’est pour lui dire que j’arrive à son secours d’ici deux jours avec toute mon infanterie, ma cavalerie et mon artillerie… Il faut bien leur donner quarante-huit heures pour se remettre… puis, droit sur Paris. Vous me comprenez, Messieurs ?
Ah ! si je pouvais vous dire l’orgueil que je ressentis à me voir ainsi mis dans la confidence du grand homme ! Comme il nous remettait nos lettres, je fis sonner mes éperons, je portai la poitrine en avant, et souris pour lui faire entendre que je comprenais ce qu’il voulait. Il sourit aussi et posa sa main sur la manche de mon dolman. J’aurais donné la moitié de mon arriéré de solde pour que ma mère eût pu me voir à ce moment-là.
— Je vais vous indiquer votre route, dit-il, en se retournant vers la carte. Vous irez de compagnie jusqu’à Bazoches ; là vous vous séparerez, l’un de vous ira sur Paris par Oulchy et Neuilly, l’autre prendra au nord par Braine, Soissons et Senlis. Avez-vous quelque chose à dire, colonel Gérard ?
Je ne suis qu’un soldat, mais j’ai quelquefois des idées, et je sais m’exprimer. J’avais commencé une phrase sur la gloire, le péril de la France, etc., quand il m’arrêta net :
— Et vous, major Charpentier ?
— Si nous trouvons que la route n’est pas sûre, dit celui-ci, pouvons-nous en choisir une autre ?
— Un soldat ne choisit pas, il obéit.
Et d’un signe de tête, il nous fit comprendre que nous pouvions nous retirer. Il se tourna vers Berthier. Je ne sais ce qu’ils se dirent, mais je les entendis rire tous les deux.
Comme bien vous pensez, nous ne perdîmes pas de temps pour nous mettre en route. Une demi-heure plus tard nous descendions au trot la grande rue de Reims, et midi sonnait comme nous passions devant la cathédrale. J’avais ma petite jument grise Violette, celle que Sébastiani voulait m’acheter après Dresde. C’était certainement la bête la plus rapide que l’on pût trouver dans les six brigades de cavalerie légère, et il n’y avait pour la battre que la grande jument anglaise du duc de Rovigo. Quant à Charpentier, il avait un de ces chevaux que l’on a toutes chances de voir entre les jambes d’un grenadier ou d’un cuirassier : un dos comme un lit et des jambes comme des poteaux ; vous voyez d’ici la bête. D’ailleurs il est lui-même assez lourd, de sorte qu’à eux deux ils faisaient une singulière paire. Et cependant, dans sa sotte suffisance, il ne cessait de lancer des œillades aux jeunes filles qui agitaient vers moi leurs mouchoirs et retroussait d’un air vainqueur sa vilaine moustache rouge jusque dans ses yeux, comme si c’eût été à lui que s’adressaient ces marques d’attention.
Une fois hors de la ville, nous traversâmes le camp français et le champ de bataille de la veille, encore couvert des cadavres de nos pauvres soldats et des Russes. Mais c’était le camp qui présentait le spectacle le plus triste. Notre armée se fondait. Les gardes faisaient encore bonne figure, quoique la jeune garde fût pleine de conscrits. L’artillerie et la grosse cavalerie n’étaient pas en trop mauvais état non plus, mais elles étaient bien réduites comme nombre. Quant à l’infanterie, les soldats avec leurs sous-officiers faisaient l’effet d’écoliers avec leurs maîtres. Et nous n’avions pas de réserves. Quand on songeait qu’il y avait quatre-vingt mille Prussiens au nord et cent cinquante mille Russes au sud, il y avait de quoi donner à réfléchir à l’homme le plus brave.
Pour mon propre compte, j’avoue que les larmes me montèrent aux yeux ; mais la pensée me vint que l’Empereur était toujours avec nous, et que le matin même il avait posé sa main sur mon dolman et m’avait promis la croix d’honneur. Cette pensée me rendit la gaîté ; je me mis à fredonner, tout en éperonnant Violette, jusqu’au moment où Charpentier fut obligé de me prier d’avoir pitié de son grand chameau, tout essoufflé et ruisselant de sueur. La route était défoncée par l’artillerie, et il avait raison, somme toute, de dire que ce n’était pas un endroit pour galoper.
Je n’ai jamais beaucoup aimé ce Charpentier, et pendant neuf heures de route je ne pus tirer un mot de lui. Il allait, les sourcils rapprochés et le menton dans la poitrine, comme quelqu’un qui réfléchit profondément. A plusieurs reprises je lui demandai ce qui le préoccupait, pensant que peut-être, avec mon intelligence plus vive, je pourrais lui donner un bon conseil et le tirer d’embarras. Je ne pus obtenir de lui que la même réponse : c’était à sa mission qu’il pensait, et cela me surprenait, car quoique je n’aie jamais eu une bien haute idée de son intelligence, il me semblait impossible qu’une affaire aussi simple pût embarrasser un soldat.
Enfin, nous atteignîmes Bazoches où il devait prendre la route du sud, pendant que moi je me dirigerais au nord. Il se retourna à moitié sur sa selle avant de me quitter, avec une expression singulière d’interrogation peinte sur la figure.
— Qu’est-ce que vous pensez de cela, colonel ? me demanda-t-il.
— De quoi ?
— De notre mission.
— Ma foi, c’est assez clair.
— Vous croyez ? Pourquoi l’Empereur nous mettrait-il dans la confidence de ses plans ?
— Parce qu’il a reconnu notre intelligence.
Mon compagnon partit d’un éclat de rire qui me vexa.
— Puis-je vous demander ce que vous comptez faire si vous trouvez les villages occupés par les Prussiens ?
— J’obéirai à mes ordres.
— Mais vous serez tué.
— C’est fort possible.
Il partit d’un nouvel éclat de rire si offensant que je portai la main à mon sabre ; mais avant que j’eusse pu lui dire ce que je pensais de sa sottise et de sa grossièreté, il avait tourné bride et galopait lourdement sur l’autre route. Je vis son grand bonnet à poil disparaître derrière la crête de la colline, et je continuai ma route, me demandant ce que signifiait sa conduite. De temps en temps je portais la main à ma poitrine, et je sentais le papier craquer sous mes doigts, ce précieux papier qui devait se transformer pour moi en la petite médaille d’argent, après laquelle je soupirais depuis si longtemps. Toute la route de Braine à Sermoise, je ne fis que penser à ce que dirait ma mère quand elle la verrait.
Je fis halte, pour donner à manger à Violette, à une auberge située sur le chemin, au bas d’une côte, non loin de Soissons, dans un endroit entouré de vieux chênes, et peuplé de tant de corbeaux que c’est à peine si l’on pouvait entendre sa propre voix. J’appris de l’aubergiste que Marmont avait battu en retraite deux jours auparavant, et que les Prussiens avaient passé l’Aisne. Une heure plus tard, à la fin du jour, j’aperçus deux de leurs vedettes sur la droite, et lorsque la nuit fut tombée, je vis le ciel éclairé par les feux de leur bivouac.
En apprenant que Blücher était là depuis deux jours, je m’étonnai que l’Empereur n’eût pas su que le pays à travers lequel il m’avait donné l’ordre de passer était déjà occupé par l’ennemi. Mais je me rappelai le ton avec lequel il avait dit à Charpentier qu’un soldat n’a pas à choisir, mais à obéir. J’étais donc bien décidé à suivre la route indiquée aussi longtemps que Violette serait en état de remuer un pied, et moi un doigt sur sa bride. Toute la route de Sermoise à Soissons n’est qu’une suite de montées et de descentes avec des courbes au milieu de bois de sapins ; aussi, je tins mon pistolet prêt et mon sabre tiré, maintenu au poignet par la dragonne, poussant doucement Violette tant que la route était en ligne droite, allant lentement et avec précaution dans les courbes, ainsi que j’avais appris à le faire en Espagne.
Lorsque j’arrivai à hauteur, de la ferme qui se trouve à droite de la route, après avoir passé le pont de bois sur la Crise, près de l’endroit où il y a une statue de la Vierge, une femme me cria d’un champ que les Prussiens étaient à Soissons ; un petit détachement de leurs lanciers était venu dans l’après-midi, et on attendait une division entière dans la nuit. Je ne m’attardai pas à écouter la fin de son histoire. J’éperonnai Violette, et cinq minutes après j’entrais, au galop dans la ville.
Les uhlans étaient à l’entrée de la rue principale ; leurs chevaux étaient à l’attache et ils causaient entre eux, chacun avec une pipe longue comme mon sabre. Moi, je les vis bien à la lueur d’une porte ouverte, mais eux ils ne purent apercevoir de moi que ma pelisse flottant au vent, et la robe grise de Violette passant devant eux comme un éclair. Un instant après, je tombai au milieu d’une autre bande qui sortait de dessous une porte cochère. L’épaule de Violette envoya l’un d’eux rouler sur le sol, et je portai un coup de pointe à un autre, mais je le manquai. Pan ! pan ! deux coups de feu me sont tirés, mais je tournai la rue au même moment, et je n’entendis même pas le sifflement des balles. Ah ! nous étions magnifiques, Violette et moi. Elle allait comme un lièvre poursuivi, faisant voler les étincelles sous ses sabots. Moi, j’étais debout sur mes étriers, brandissant mon sabre. Un uhlan s’élança pour saisir la bride de ma jument ; je lui entamai le bras d’un coup de sabre, et je l’entendis qui hurlait de douleur derrière moi. Deux cavaliers me serraient de près ; j’en abattis un d’un coup de sabre, et distançai l’autre. Une minute plus tard, j’avais traversé la ville et je descendais à un galop infernal une large route toute blanche, bordée de peupliers. Pendant quelque temps encore, j’entendis galoper derrière moi, mais bientôt le bruit diminua peu à peu, si bien que je ne le distinguai plus des battements de mon propre cœur. J’arrêtai bientôt Violette, et je me retournai pour écouter ; mais tout était redevenu silencieux : ils avaient abandonné la poursuite.
La première chose que je fis fut de mettre pied à terre et de conduire ma jument dans un petit bois à travers lequel courait un ruisseau. Je lui baignai les jambes et lui donnai un morceau de sucre trempé d’un peu de cognac de ma gourde. Elle était épuisée par cette course enragée, mais c’est incroyable comme elle se remit vite, après une demi-heure de repos. Quand je remontai en selle, je pus voir que ce ne serait pas sa faute si je n’arrivais pas sain et sauf à Paris.
Je devais être maintenant en plein dans les lignes ennemies, car au moment où j’atteignais une maison sur le bord de la route, j’entendis des voix rauques qui chantaient une de leurs rudes chansons à boire. Je fis un détour par les champs pour éviter la maison, et bientôt j’aperçus deux cavaliers qui – me crièrent quelque chose en allemand. Mais je continuai à galoper sans leur répondre et sans m’occuper d’eux. Ils n’osèrent pas tirer, car leurs propres hussards portent exactement le même uniforme que nous. Dans ces moments-là, voyez-vous, il vaut mieux avoir l’air de ne pas entendre; on met cela sur le compte de la surdité.
Il faisait un clair de lune délicieux, et les arbres coupaient la route de longues barres noires. Je pouvais voir toute la campagne comme si c’eût été en plein jour, et tout paraissait l’image de la paix, à part ceci qu’il y avait un grand incendie quelque part dans la direction du nord. Dans le silence de la nuit, avec la conscience du danger devant et derrière moi, cet incendie dans le lointain avait quelque chose de grandiose et de sinistre. Mais je ne m’attriste pas facilement, car j’ai vu pas mal de spectacles terribles dans ma vie ; aussi je me mis à fredonner en pensant à ma petite Lisette que j’allais pouvoir revoir à Paris. Ma pensée était entièrement absorbée par elle, quand, au tournant de la route, je tombai sur une demi-douzaine de dragons prussiens, assis au bord du fossé autour d’un feu de bruyères.
Je suis un excellent soldat. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais parce que c’est la vérité. Je sais peser les choses en un instant et prendre une décision avec autant de certitude que si je l’avais mûrie pendant toute une semaine. Or je vis tout de suite qu’ils allaient me donner la chasse, et je songeai que j’avais sous moi une bête qui venait de faire douze lieues dans les conditions les plus pénibles. Mais poursuite pour poursuite, il valait mieux aller de l’avant que de revenir en arrière. Par cette nuit claire, avec des chevaux frais derrière moi, il fallait courir le risque d’une façon ou de l’autre, et si je devais réussir à me débarrasser d’eux, il était préférable que ce fût près de Senlis plutôt que de Soissons. Tout cela me passa dans l’esprit comme un trait, par une sorte d’instinct, vous comprenez.
Aussi à peine eus-je aperçu leurs faces barbues que j’enfonçai mes éperons dans les flancs de Violette, et nous voilà partis au galop de charge. Ah ! si vous aviez entendu ces cris et ce remue-ménage ! Trois d’entre eux firent feu et les trois autres sautèrent sur leurs chevaux. Une balle vint frapper le pommeau de ma selle avec un bruit sec, comme un coup de bâton sur une porte. Violette fit un bond en avant, et je crus qu’elle était blessée ; mais l’épaule seulement avait été légèrement effleurée. Ah ! ma chère petite jument, comme je l’aimais quand je la vis prendre ce galop long et soutenu qui lui est particulier, ses sabots claquant sur la route comme les castagnettes d’une Espagnole ! Je ne pus pas me retenir ; je me retournai sur ma selle et je criai à pleins poumons : « Vive l’Empereur ! » Je ne pus m’empêcher de rire à la bordée de jurons qui m’arriva par derrière.
Mais ce n’était pas fini. Si Violette n’avait pas été fatiguée, elle leur aurait rendu facilement un kilomètre sur quatre. Mais elle soutenait tout juste le train, avec un peu d’avance, toutefois. Il y en avait un, un jeune officier, presque un enfant, qui était mieux monté que les autres. Il gagnait sur moi à chaque pas. À deux cents mètres derrière lui galopaient deux dragons, et chaque fois que je me retournais je voyais la distance augmenter entre eux. Les trois autres, qui avaient pris le temps de tirer, étaient loin derrière. J’attendis que l’officier eût une grande avance sur ses hommes ; alors je ralentis un peu l’allure de ma jument, très peu, très peu, pour lui donner à croire qu’il me rattrapait. Quand je le sentis à bonne portée, je tournai la tête, le menton sur l’épaule pour voir ce qu’il allait faire. Il ne se disposait pas à tirer, et je sus bientôt pourquoi : l’imprudent jeune homme avait retiré ses pistolets des fontes, lorsqu’il avait mis pied à terre pour la nuit. Il brandissait son sabre en hurlant son baragouin. Il ne semblait pas comprendre qu’il était à ma merci. Je ralentis encore un peu jusqu’à ce qu’il n’y eût plus qu’une longueur de lance entre nos deux chevaux.
— Rendez-vous ! me cria-t-il en français !
— Permettez-moi de vous complimenter sur votre français, lui répondis-je en posant le canon de mon pistolet sur mon bras gauche (c’est à mon avis la meilleure façon de tirer à cheval).
Je le visai à la tête et, à la clarté de la lune, je pus le voir pâlir, quand il comprit que c’en était fait de lui. Je pensai à sa mère et j’envoyai ma balle dans l’épaule de son cheval. Je crois qu’il dut se faire mal en tombant, car le cheval s’abattit lourdement ; mais j’avais à m’occuper de ma dépêche, aussi je remis ma jument au galop.
Mais je n’en avais pas encore fini avec ces gaillards-là. Les deux dragons ne firent pas plus attention à leur officier que si c’eût été une recrue désarçonnée dans le manège. Ils laissèrent aux autres le soin de s’occuper de lui et continuèrent à galoper après moi. J’avais ralenti le pas en montant la côte, croyant l’affaire terminée, mais, ma parole, je ne tardai pas à voir que je n’avais pas le temps de flâner, et nous voilà repartis, ma jument levant la tête, et moi agitant mon shako, pour leur montrer ce que nous pensions de deux dragons essayant d’atteindre un hussard.
Mais à ce moment, pendant que je riais en moi-même de l’idée, mon cœur s’arrêta de battre : je venais d’apercevoir au bout de la longue route blanche, en face de moi, une masse noire de cavaliers qui semblaient attendre pour me recevoir. Un conscrit aurait pu prendre cela pour l’ombre des arbres, mais moi, je ne m’y trompai pas : c’était une troupe de hussards, et de quelque côté que je me retournasse, la mort semblait me guetter.
J’avais donc les dragons derrière moi et les hussards devant. Jamais, depuis Moscou, je ne m’étais vu dans un pareil danger. Mais pour l’honneur de la cavalerie, je préférais être pris par la cavalerie légère, plutôt que par la grosse. Je laissai donc Violette faire à sa tête. Je me souviens que j’essayai de prier, mais je suis un peu brouillé avec les oraisons et tout ce que je pus me rappeler, ce fut celle que nous avions l’habitude de dire quand j’allais à l’école, la veille des congés, pour avoir du beau temps le lendemain. Cela me semblait mieux que rien, et comme je la marmottais inconsciemment, j’entendis des voix françaises devant moi. La joie me traversa le cœur comme une balle de fusil, et du coup j’oubliai la suite de ma prière. C’étaient les nôtres, ces enragés coquins du corps de Marmont. Mes deux dragons tournèrent bride et repartirent au grand galop, la lune faisant briller leurs casques de cuivre, pendant que je m’avançais vers mes amis au petit trot et sans me presser, car je tenais à leur faire voir que, bien qu’un hussard puisse fuir, il n’est pas dans sa nature de fuir très vite. Cependant je crains bien que les flancs et la bouche de Violette tout couverts d’écume n’aient donné un démenti à mon air dégagé.
Vous ne devineriez pas qui je trouvai à la tête de la troupe : mon vieux Bouvet, à qui j’avais sauvé la vie à Leipzig ! Quand il m’aperçut, ses petits yeux gris se remplirent de larmes, et ma foi, je l’avoue, je me mis à pleurer aussi en voyant sa joie. Je lui dis la mission dont j’étais chargé. Mais il se mit à rire quand je lui annonçai que je devais passer par Senlis.
— L’ennemi est là, dit-il, vous ne pourrez pas passer.
— Je préfère aller là où est l’ennemi, répondis-je. Je passerais par Berlin, si tel était l’ordre de l’Empereur.
— Mais pourquoi ne pas aller droit à Paris avec votre dépêche ? Pourquoi vouloir passer par la seule place où vous êtes à peu près sûr d’être pris et tué ?
— Un soldat ne choisit pas ; il obéit, lui répondis-je, tout comme j’avais entendu dire à l’Empereur.
Le vieux Bouvet se mit à rire de son rire d’asthmatique, jusqu’au moment où je fus obligé de retrousser ma moustache et de le toiser des pieds à la tête d’une façon qui le calma. D’ailleurs j’étais plus ancien de grade que lui.
— C’est bon, dit-il. Ce que vous avez de mieux à faire, c’est de venir avec nous. Nous allons sur Senlis. Il y a devant nous un escadron de lanciers de Poniatowski. S’il faut que vous traversiez la place, nous tâcherons de vous aider.
Nous voilà donc partis avec un cliquetis de ferraille, au milieu de la nuit calme. Nous rejoignîmes bientôt les Polonais, de beaux soldats, ma foi, un peu lourds peut-être pour leurs chevaux ; mais c’est égal, ils n’auraient pas fait trop mauvaise figure s’ils avaient appartenu à ma brigade. Nous continuâmes à marcher ensemble, et au point du jour nous aperçûmes les lumières de Senlis. Un paysan que nous rencontrâmes, conduisant une charrette, nous donna quelques détails sur ce qui se passait.
Ses renseignements étaient sûrs, car son frère était cocher chez le maire, et il lui avait parlé la veille au soir. Il y avait un seul escadron de Cosaques, un « polk » comme ils disent dans leur affreuse langue, cantonné dans la maison du maire, la plus grande de la ville et qui fait le coin de la place du Marché. Une division entière de Prussiens était campée dans les bois au nord, mais les Cosaques seuls étaient dans la ville. Quelle bonne occasion de nous venger de ces barbares dont la cruauté envers nos pauvres paysans était le sujet de toutes les conversations autour des feux de bivouac.
Nous entrâmes dans la ville comme une trombe ; les sentinelles, surprises, furent égorgées, et nous étions en train de démolir les portes de la maison du maire, qu’ils croyaient encore qu’il n’y avait pas un Français à plus de vingt kilomètres de là. D’horribles têtes se montrèrent aux fenêtres, des têtes avec de la barbe jusque dans les yeux, des cheveux embroussaillés et des bonnets en peau de mouton. Ils se mirent à crier : « Hourrah ! hourrah ! » et déchargèrent leurs armes ; mais nos hommes étaient dans la maison et sur leurs dos qu’ils se frottaient encore les yeux. C’était terrible de voir les Polonais se précipiter sur eux comme une bande de loups sur un troupeau de daims, car les Polonais, comme vous savez, ont une dent contre les Cosaques. La plupart furent tués à l’étage supérieur où ils s’étaient réfugiés, et le sang coulait dans l’escalier comme la pluie sur un toit. Ce sont de terribles soldats, ces Polonais, quoique je les trouve un peu lourds pour leurs chevaux. Ils sont aussi grands que les cuirassiers de Kellermann ; leur équipement est plus léger naturellement, puisqu’ils n’ont ni casque ni cuirasse.
C’est ici que je commis une faute, une très grosse faute, il faut l’avouer. Jusqu’alors je m’étais acquitté de ma mission d’une façon que ma modestie seule m’empêche de qualifier de remarquable. Mais à ce moment je fis une faute qu’un civil pourrait condamner, mais que certainement un soldat excusera. Ma jument était épuisée, c’était évident ; cependant j’aurais pu traverser avec elle Senlis et atteindre la campagne, où je n’aurais plus eu d’ennemis entre moi et Paris. Mais quel est le hussard capable de passer à côté d’une bataille sans s’arrêter ? C’est trop lui demander. Et ajoutez à cela la vue de ces vilaines têtes aux fenêtres avec leurs grands bonnets de peau de mouton. Je sautai à terre, je jetai la bride de Violette autour d’un poteau et je me précipitai dans la maison avec les autres. Il est vrai que j’arrivai trop tard pour être utile, et je faillis recevoir un coup de lance d’un de ces sauvages étendu à moitié mort sur le plancher. Cependant c’est dommage de manquer même la plus petite affaire ; on ne sait jamais quelle occasion on peut avoir d’obtenir de l’avancement. J’ai vu des escarmouches d’avant-postes et autres petites affaires de ce genre dans lesquelles un soldat avait plus d’occasions de se distinguer que dans beaucoup des grandes batailles livrées par l’Empereur.
Quand la maison fut nettoyée de toute cette vermine, je m’occupai de Violette : je lui donnai un seau d’eau, et le paysan qui nous avait guidés me montra où M. le maire ramassait son foin. Ma foi, ma petite Violette ne demanda pas mieux que d’y faire honneur. Puis je lui lavai les jambes et, la laissant attachée là, je rentrai dans la maison pour tâcher d’y trouver quelque chose à me mettre sous la dent, afin de n’avoir plus à m’arrêter jusqu’à Paris.
J’arrive ici à un point de mon récit qui pourra vous paraître singulier, et cependant je pourrais vous raconter au moins une douzaine de choses aussi singulières et qui me sont arrivées dans le cours de ma carrière, car vous pensez bien qu’un homme qui, comme moi, a passé sa vie à faire un service d’éclaireur, et d’exploration sur le terrain souvent couvert de sang qui sépare deux grandes armées n’est pas sans avoir vu parfois d’étranges choses. Quoi qu’il en soit, je vais vous raconter exactement ce qui se passa.
Le vieux Bouvet m’attendait dans le corridor quand j’entrai, et me demanda si nous ne pourrions pas vider une-bouteille de vin ensemble.
— Il ne faut pas que nous nous attardions ici, ajouta-t-il. Il y a dix mille Prussiens avec Theilman dans les bois là-bas.
— Où est le vin ? demandai-je.
— Oh ! vous pouvez vous fier à deux hussards pour découvrir où est le vin.
Et prenant une chandelle, il me précéda dans l’escalier qui conduisait à la cuisine.
Arrivés là, nous trouvâmes une autre porte ouvrant sur un escalier tournant qui descendait à la cave. Les Cosaques nous y avaient précédés, comme nous pûmes le constater aux débris de bouteilles qui couvraient le sol. Cependant le maire était un bon vivant, et je ne demande pas à posséder une meilleure cave : chambertin, graves, alicante, vins rouges et blancs, mousseux et non mousseux, étaient là couchés sur de la sciure de bois. Le vieux Bouvet était debout devant toutes ces bouteilles, et ronronnait comme un chat devant une jatte de lait. Il avait enfin fixé son choix sur une bouteille de vieux bourgogne, et étendait la main pour la prendre, quand tout à coup voilà que nous entendons au-dessus, de nous un vacarme de coups de feu, de piétinements et de cris comme je n’en ai jamais entendu de pareil : les Prussiens étaient sur nous. Bouvet était un brave ; je tiens à le déclarer. Il tira aussitôt son sabre, et le voilà grimpant quatre à quatre l’escalier de pierre, ses éperons sonnant sur chaque marche. Je m’élançai à la suite ; mais juste comme nous arrivions au couloir de la cuisine, un immense cri nous apprit que la maison était reprise.
— C’est fini, lui dis-je en le saisissant par sa pelisse.
— Cela fera un de plus à mourir, cria-t-il.
Et le voilà parti, montant comme un fou le second escalier. Et de fait, moi aussi, à sa place je serais allé à la mort, car il avait commis une faute grave en ne plaçant pas de vedettes, pour l’avertir dans le cas où l’ennemi s’avancerait vers lui. Un instant je fus sur le point de me précipiter après lui mais je réfléchis qu’après tout j’avais ma dépêche à remettre et, si j’étais fait prisonnier ou tué, c’en était fait de ma mission. Je laissai Bouvet mourir seul, et je redescendis dans la cave en fermant la porte derrière moi.
À la vérité, la perspective d’un séjour dans cette cave n’avait rien non plus de bien attrayant. Bouvet avait lâché la chandelle à la première alarme, et j’étais dans l’obscurité, tâtant avec mes mains de tous côtés pour la retrouver et ne rencontrant que des tessons de bouteille. Enfin je finis par mettre la main dessus : elle avait roulé sous une barrique, mais je ne pus pas réussir à l’allumer, car la mèche avait trempé dans le vin ; j’en coupai un bout avec mon sabre et je pus l’allumer. Mais que faire ? Les brigands au-dessus de moi – ils étaient bien cinq ou six cents à en juger par le bruit qu’ils faisaient — hurlaient à s’enrouer, et il était évident qu’ils n’allaient pas tarder les uns ou les autres à éprouver le besoin de s’humecter le gosier. Alors, adieu le beau soldat, la mission et la croix d’honneur ! Je pensai à ma mère et je pensai à l’Empereur. J’eus une larme à l’idée que l’une allait perdre un si bon fils et l’autre le meilleur officier de cavalerie légère qu’il eût eu depuis Lasalle. Mais cela ne dura qu’un instant ; je m’essuyai les yeux.
— Allons ! du courage ! me dis-je en me frappant la poitrine, du courage, mon garçon, toi qui t’es tiré de Moscou sain et sauf, sans une engelure, tu mourrais dans une cave, comme un rat ! Allons donc ! ce n’est pas possible !
Je me redressai et je portai la main à ma poitrine pour tâter ma dépêche, et cela me redonna du courage.
La première idée qui me vint à l’esprit fut de mettre le feu à la maison et de m’échapper à la faveur de la confusion. Ma seconde idée fut de me cacher dans un tonneau vide. Je regardai autour de moi pour en trouver un, quand tout à coup j’aperçus dans un coin une petite porte basse peinte de la même couleur grise que le mur, de sorte que seul quelqu’un ayant une bonne vue pouvait la distinguer. Je poussai cette porte, et je crus d’abord qu’elle était fermée à clef, mais tout de suite elle céda un peu, et je compris qu’il y avait derrière quelque obstacle qui l’empêchait de s’ouvrir. Je m’arc-boutai contre un tonneau, et je fis un tel effort de mes deux épaules que la porte sauta de ses gonds et je roulai par terre ; la chandelle m’avait sauté de la main et je me trouvais de nouveau dans l’obscurité. Je me relevai et je tâchai de distinguer quelque chose dans le trou noir.
Il y avait un petit rayon de lumière qui filtrait par un soupirail à la hauteur du plafond. Le jour était venu, et je pus distinguer vaguement une rangée de tonneaux, ce qui me donna à penser que c’était là que le maire gardait ses réserves de vin. Dans tous les cas, l’endroit était plus sûr. Je ramassai ma chandelle et je relevais la porte pour la remettre en place quand j’aperçus quelque chose qui me remplit d’étonnement et, je dois l’avouer, d’une toute petite pointe de peur.
Je vous ai dit qu’à l’extrémité de la cave passait un rayon de lumière venant de quelque part à la hauteur du plafond. Au moment où je me baissai pour relever la porte, je vis un homme de grande taille passer dans ce rayon de lumière, puis rentrer dans l’obscurité de l’autre côté. Ma parole, j’eus un tel sursaut que je faillis en casser la jugulaire de mon shako. Cela n’avait duré qu’une seconde, mais j’avais eu le temps de voir que l’homme avait un bonnet de Cosaque sur la tête et un sabre au côté. Ma foi, Etienne Gérard fut un peu déconcerté sur le moment, en se voyant seul dans l’obscurité avec ce brigand aux longues jambes et aux larges épaules.
Mais cela ne dura qu’un instant.
— Du courage ! me dis-je. N’es-tu pas hussard, colonel encore, à vingt-huit ans, et le messager de l’Empereur ? Après tout, ce gaillard-là a plus de raisons d’avoir peur de toi, que toi de lui !
Et alors l’idée me vint qu’il devait avoir peur, horriblement peur ; c’était visible à ses mouvements rapides, à son dos courbé lorsqu’il courait tout à l’heure au milieu des tonneaux comme un rat cherchant son trou. Naturellement ce devait être lui qui retenait la porte lorsque j’avais essayé de la pousser la première fois, et non quelque tonneau comme j’avais cru. C’était lui qui était le poursuivi et moi le poursuivant. Ah ! ah ! je sentis ma moustache se redresser, comme je m’avançai vers lui dans l’obscurité. Ah ! il allait voir, ce sauvage du Nord, qu’il n’avait pas affaire à une poule mouillée. A ce moment, j’étais magnifique.
Je n’avais pas osé d’abord rallumer ma chandelle, de crainte que la lumière ne me fît découvrir. Mais je venais de m’écorcher la jambe contre un débris de boîte, et j’avais embarrassé mes éperons dans une toile d’emballage qui se trouvait là ; aussi je jugeai plus prudent d’allumer.
Puis je m’avançai à grandes enjambées, mon sabre à la main.
— Sors de là, brigand ! criai-je. Rien ne peut te sauver. Tu vas recevoir la récompense que tu mérites.
Je tenais ma chandelle levée et j’aperçus la tête de l’homme qui dépassait un tonneau ; ses yeux pleins de terreur me regardaient fixement. Il avait un galon d’or sur son bonnet noir, et je reconnus que c’était un officier.
— Monsieur, me cria-t-il en excellent français, je me rends sur votre promesse que j’aurai la vie sauve. Si vous ne me donnez pas votre parole, je veux essayer de vendre ma vie aussi chèrement que possible.
— Monsieur, lui dis-je, un Français sait les égards dus à un ennemi malheureux. Vous avez la vie sauve.
Sur ce, il me tendit son sabre par-dessus le tonneau ; je le pris en m’inclinant et en ramenant la chandelle vers ma poitrine.
— Qui ai-je l’honneur de faire prisonnier ? lui demandai-je.
— Je suis le comte Boutkine, des Cosaques du Don de l’Empereur de Russie. Nous étions sortis pour faire une reconnaissance dans Senlis et, comme nous n’apercevions aucun de vos gens, nous avions résolu de passer la nuit ici.
— Et, serait-il indiscret de vous demander comment il se fait que vous vous trouviez dans cette cave ?
— Rien de plus simple. Nous comptions partir au petit jour. Après m’être habillé, comme je sentais le froid, je pensai qu’un verre de vin ne me ferait pas de mal, et je suis descendu à la cave pour voir ce que je pourrais trouver. Pendant que j’étais ici, la maison a été prise d’assaut si rapidement que, avant que je pusse remonter, tout était fini. Il ne me restait plus qu’à me sauver. Je suis donc revenu ici, et je me suis caché dans la seconde cave où vous m’avez trouvé.
Je pensai à la conduite du vieux Bouvet dans les mêmes circonstances, et les larmes me vinrent aux yeux en songeant à notre supériorité en bravoure, à nous Français, sur tous ces étrangers. Je réfléchis à ce que je devais faire. Il était clair que le comte Boutkine, étant dans la seconde cave pendant que nous étions dans la première, n’avait rien entendu du bruit qui nous avait appris que la maison était de nouveau entre les mains de l’ennemi. S’il venait à soupçonner l’état réel des choses, tout changeait de face, et c’était moi le prisonnier. Que faire ? J’étais très embarrassé, quand il me vint une idée lumineuse, tellement lumineuse que je ne pus m’empêcher de me demander comment elle avait bien pu me venir.
— Comte Boutkine, dis-je, je me trouve moi-même dans une situation bien difficile.
— Pourquoi ? de manda-t-il.
— Parce que je vous ai promis la vie sauve.
Il fit la grimace.
— Vous ne voudriez pourtant pas revenir sur votre parole ?
— Je mourrais plutôt pour vous défendre, répondis-je, mais cela me met dans une grande difficulté.
— Qu’y a-t-il donc ?
— Je veux être franc avec vous. Vous devez savoir que nos amis, et surtout les Polonais sont des ennemis féroces des Cosaques. La vue seule de votre uniforme les met en fureur ; ils se précipitent immédiatement sur quiconque porte cet uniforme ; leurs officiers eux-mêmes ne peuvent pas les retenir.
Le Cosaque pâlit en entendant cela, et le ton avec lequel je le dis.
— Mais c’est horrible ! dit-il.
— Horrible, répétai-je. Si nous nous montrions ensemble en ce moment, je ne sais pas jusqu’à quel point je pourrais vous protéger.
— Je suis entre vos mains. Dites-moi ce qu’il faut faire. Ne vaudrait-il pas mieux que je reste ici ?
— C’est encore pis.
— Pourquoi ?
— Parce que nos hommes vont piller la maison, et alors vous êtes sûr de ne pas sortir vivant d’ici. Non, je vais monter et leur parler. Mais, malgré tout, je ne suis pas encore tranquille. S’ils voient votre uniforme maudit, je ne sais pas ce qui peut arriver.
— Si je l’ôtais ?
— Excellente idée, m’écriai-je. C’est cela ! Vous allez ôter votre uniforme et prendre le mien. Vous serez sacré alors pour un soldat français.
— Ce ne sont pas les Français, mais les Polonais que je crains.
— Mon uniforme sera pour vous une sauvegarde contre les uns et les autres.
— Comment vous remercier ? dit-il. Mais vous, qu’allez-vous mettre ?
— Je vais mettre le vôtre.
— Et être victime de votre générosité, peut-être ?
— C’est mon devoir de courir le risque, répondis-je ; moi, je ne crains rien. Je monterai avec votre uniforme. Cent sabres seront dirigés sur moi. Je crierai : « Halte ! Je suis le colonel Gérard. » Ils me reconnaîtront. Je leur raconterai l’affaire, et je reviendrai vous chercher. Sous le couvert de l’uniforme français vous serez sacré pour eux.
Ses doigts tremblaient comme il ôtait sa tunique. Ses bottes et sa culotte étaient les mêmes que les miennes ; il était inutile de les échanger. Je lui donnai mon dolman et mon shako, et je pris son grand bonnet de peau de mouton avec le galon d’or, sa capote bordée de fourrure et son sabre recourbé. Vous pensez bien qu’en changeant de vêtements je n’eus garde d’oublier la précieuse lettre.
L’échange fait, je lui dis :
— Maintenant, si vous le permettez, je vais vous attacher à ce tonneau.
Il fit beaucoup de difficultés, mais j’ai appris dans ma carrière de soldat à ne jamais laisser aucune chance contre moi ; or, il pouvait se faire qu’une fois que j’aurais le dos tourné, il s’aperçût de l’état réel des choses, ce qui n’aurait pas manqué de contrecarrer mes plans. Malgré ses protestations, je pris une forte corde qui se trouvait là, et je le ficelai au tonneau par cinq ou six tours de la corde que je nouai solidement. Maintenant, s’il lui prenait fantaisie de vouloir monter l’escalier, il aurait à traîner après lui mille litres de bon vin de France en guise de havresac. Je fermai ensuite la porte derrière moi afin qu’il ne pût entendre ce qui allait se passer et, jetant la chandelle, je montai l’escalier de la cave.
Il n’y avait guère qu’une trentaine de marches, et cependant, tout en les montant, j’eus le temps de repasser dans mon esprit toute ma vie entière et tous mes projets d’avenir. J’éprouvai la même sensation qu’à Eylau, lorsque, étendu sur le champ de bataille, la jambe brisée, je vis toute l’artillerie arriver sur moi au galop. Mais là, du moins, c’était une mort glorieuse, au service direct de l’Empereur, et je me disais que j’aurais au moins cinq lignes dans le Moniteur, peut-être sept. Palaret en a bien eu huit, lui, et je suis sûr qu’il n’avait pas mes états de service.
Quand j’arrivai dans le corridor, l’air aussi calme que je pouvais prendre, la première chose que j’aperçus ce fut le corps de Bouvet, les bras étendus en croix sur le parquet, et tenant à la main son sabre brisé. A une tache noire sur son dolman, je pus voir qu’il avait été tué d’un coup de feu tiré à bout portant. J’aurais bien voulu saluer en passant, mais je craignis d’être vu, et je continuai mon chemin.
Le corridor était plein de soldats prussiens occupés à percer des meurtrières dans le mur, comme s’ils s’étaient attendus à une nouvelle attaque. L’officier, un petit homme à figure chafouine, courait de tous côtés en donnant des ordres. Ils étaient trop occupés pour prendre garde à moi. Mais un autre officier, qui se tenait appuyé contre la porte, avec une longue pipe à la bouche, me frappa sur l’épaule en me montrant les corps de nos pauvres hussards ; il me dit en allemand quelque chose qui devait être fort spirituel à son sens, car sa longue barbe s’entrouvrit et il exhiba une rangée d’énormes crocs jaunes. Je me mis à rire aussi et je lui servis les seuls mots russes que j’aie jamais sus. Je les avais appris à Vilna avec la petite Sophie. Cela veut dire : « S’il fait beau, venez me trouver sous le chêne ; s’il pleut, venez dans l’écurie. » Mais pour cet Allemand c’était tout de même du russe, et je ne doute pas qu’il n’ait cru que je lui disais quelque chose de très drôle, car il se tordit de rire et me frappa de nouveau sur l’épaule. Je lui fis un signe de tête et je sortis de la maison d’un pas aussi délibéré que si j’eusse été le commandant de la garnison.
Il y avait une centaine de chevaux attachés dehors, la plupart appartenant aux hussards polonais. Ma bonne petite Violette était là aussi et elle se mit à hennir quand elle m’aperçut. Mais je me gardai bien de la monter. Oh ! non, j’étais trop malin pour faire cela. Au contraire, je choisis un petit cheval cosaque, le plus hérissé que je pus trouver, et je l’enfourchai avec autant d’assurance que s’il eût appartenu à mon grand-père. Il avait un grand sac à butin jeté en travers sur la selle. Je le mis sur le dos de Violette, et j’emmenai celle-ci par la bride avec moi. Je voudrais que vous eussiez pu me voir. J’avais l’air d’un vrai Cosaque revenant du butin. La ville était pleine de Prussiens ; ils me regardaient passer et devaient se dire : « Voilà un de ces démons de Cosaques ; en voilà qui se chargent de piller ! »
Un ou deux officiers m’adressèrent la parole avec un air d’autorité, mais je me contentai de secouer la tête en souriant, et je leur servis, de nouveau ma phrase russe : « S’il fait beau, venez me trouver sous le chêne ; s’il pleut, venez dans l’écurie. » Ils haussèrent les épaules, et ne pouvant tirer autre chose de moi, ils me laissèrent passer. J’arrivai aux portes de la ville. Là je vis deux lanciers placés en vedette sous la porte, avec leurs flammes noires et blanches, et je savais que ceux-là une fois franchis, je serais de nouveau en sûreté. Je mis mon petit cheval cosaque au trot, pendant que Violette frottait son nez contre mon genou, se demandant probablement quelle faute elle avait bien pu commettre pour se voir préférer cet amas de poils qui avait plutôt l’air d’un paillasson retourné que d’un honnête cheval d’officier. Je n’étais pas arrivé à plus de deux cents pas des deux uhlans, quand tout à coup j’aperçus un Cosaque, un vrai celui-là, qui galopait sur la route à ma rencontre.
Ah ! mes amis, qui lisez ceci, si vous avez un peu de cœur, vous ne pourrez pas vous empêcher d’éprouver pour moi un sentiment de sympathie. Avoir traversé tant d’épreuves et me voir exposé à un nouveau danger qui pouvait tout perdre ! J’avoue qu’un instant je fus découragé. Mais je me ressaisis : je n’étais pas encore battu. Je déboutonnai ma capote afin de pouvoir saisir la lettre, car j’étais résolu, quand tout serait perdu, à l’avaler et à mourir l’épée à la main. Je m’assurai que mon sabre jouait bien dans le fourreau, et je continuai à me diriger au trot vers les vedettes. Elles firent semblant de vouloir m’arrêter, mais je leur montrai du doigt l’autre Cosaque qui était à deux cents mètres, et comprenant que je voulais aller seulement à sa rencontre, les deux uhlans me saluèrent et me laissèrent passer.
J’enfonçai mes éperons dans les flancs de ma monture, car je pensais pouvoir me défaire du Cosaque sans trop de difficultés, pourvu que je fusse assez loin des uhlans. C’était un officier, avec un galon d’or à son bonnet, tout comme moi. Quand il m’aperçut, il mit son cheval au trot, ce qui me permit de mettre une bonne distance entre les vedettes et moi. J’arrivai sur lui, et je pus voir son étonnement se changer en soupçon lorsqu’il vit mon équipement. Je ne sais ce qu’il y trouva d’anormal, mais évidemment il remarqua quelque chose qui n’était pas régulier. Il me cria quelques mots, et comme je ne répondais pas, il tira son sabre. Je fus content au fond, car j’ai toujours mieux aimé me battre loyalement que de tuer un ennemi sans méfiance. Je me jetai sur lui, le sabre haut, et parant le coup qu’il me portait, j’enfonçai mon arme juste sous le troisième bouton de sa capote. Il tomba aussitôt et faillit m’entraîner avec lui avant que j’eusse pu me dégager. Je ne m’attardai pas à voir s’il était mort ; je plantai là mon cheval cosaque, je sautai sur Violette et je partis au galop, après avoir envoyé du bout des doigts un salut aux deux uhlans, qui arrivaient après moi en criant. Mais Violette, reposée, était aussi alerte qu’à notre départ de Reims. Je pris la première route de traverse à l’ouest, puis la première au sud pour quitter plus vite le pays occupé par l’ennemi. Je continuai à galoper, chaque pas m’éloignant de l’ennemi et me rapprochant de nos amis. Enfin, je regardai derrière moi, et ne voyant personne à ma poursuite, je compris que j’étais au bout de mes épreuves.
Et je me sentis heureux et fier, en pensant que j’avais accompli à la lettre la mission de l’Empereur. Que pourrait-il bien me dire pour rendre justice à la façon incroyable dont j’avais surmonté tous les dangers. Il m’avait donné l’ordre de passer par Sermoise, Soissons et Senlis, ne se doutant guère, je suis sûr, que ces trois places étaient occupées par l’ennemi, et j’avais réussi à passer avec ma dépêche. Hussards, dragons, uhlans, Cosaques, fantassins, j’avais eu affaire à tous et je m’en étais tiré sans une égratignure.
J’atteignis Dammartin, où j’aperçus nos premiers postes avancés. Il y avait dans un champ une petite troupe de dragons que je reconnus facilement pour des Français. Je me dirigeai de leur côté pour leur demander si la route était libre jusqu’à Paris, et tout en trottant, je me sentis si heureux de revoir des amis, que je ne pus m’empêcher d’agiter mon sabre en l’air. Un jeune officier se détacha du groupe en brandissant aussi son sabre, et cela me réchauffa le cœur de le voir galoper à ma rencontre avec cette ardeur et cet enthousiasme. Je fis caracoler Violette, et comme nous arrivions à la hauteur l’un de l’autre, je me mis à agiter mon sabre plus joyeusement que jamais, mais vous aurez peine à vous imaginer ce que je ressentis quand tout d’un coup, il me porta un coup de sabre qui certainement m’aurait coupé la tête si je n’avais baissé le nez vivement jusque sur la crinière de Violette. J’entendis la lame siffler au-dessus de ma tête comme un vent d’est. C’était la faute de mon maudit uniforme, que j’avais oublié, dans ma joie, et ce jeune dragon s’était imaginé que j’étais quelque champion russe venant défier la cavalerie française. Ma parole, il resta tout penaud, quand il vit qu’il avait failli tuer le célèbre colonel Gérard.
La route était libre, et vers trois heures j’étais à Saint-Denis. De là à Paris, je mis deux longues heures, car la route était encombrée par les fourgons de l’intendance et l’artillerie du corps de réserve qui allaient rejoindre Marmont et Mortier au nord.
Vous ne pouvez vous faire une idée de la sensation que causa mon entrée à Paris, dans mon costume de Cosaque. Je crois que la foule qui courait et se bousculait s’étendait bien à un kilomètre devant et derrière moi. L’histoire avait été répandue par les dragons (j’en avais pris deux avec moi comme escorte), et tout le monde connaissait mes aventures et la façon dont je m’étais procuré mon uniforme. Ce fut un vrai triomphe. Les hommes m’acclamaient, les femmes agitaient leurs mouchoirs et m’envoyaient des baisers.
Je suis loin d’être un homme présomptueux, mais en cette occasion, j’avoue que je ne pus m’empêcher de montrer combien j’étais touché de cette réception. L’habit du Cosaque était un peu vaste pour moi, mais je bombais la poitrine et je l’emplissais entièrement. Et ma petite Violette allait, la tête haute, piaffant et remuant la queue comme pour dire : « C’est nous qui avons fait tout cela ; on peut nous confier des missions à nous ! » Quand je mis pied à terre devant les Tuileries et que je l’embrassai sur les naseaux, un immense cri d’applaudissement s’éleva, comme à la lecture d’un bulletin de victoire de la Grande-Armée.
Ma tenue n’était guère convenable pour rendre visite à un roi ; mais après tout, quand on a une belle tournure martiale comme moi, on peut passer là-dessus. Je fus introduit sur-le-champ près de Joseph que j’avais déjà vu en Espagne. C’était toujours le même garçon aussi gros, aussi calme, aussi aimable que jamais. Talleyrand était avec lui ; peut-être devrais-je lui donner son titre de prince de Bénévent, mais j’avoue que je préfère les anciens noms. Il lut ma dépêche, que Joseph Bonaparte lui tendit, puis il se mit à me regarder de ses petits yeux clignotants :
— Vous étiez seul chargé de cette mission ? me demanda-t-il.
— Nous étions deux, Monsieur, le major Charpentier, des grenadiers à cheval, et moi.
— Il n’est pas encore arrivé, dit le roi d’Espagne.
— Si vous aviez vu les jambes de son cheval, Sire, répondis-je, vous n’en seriez pas surpris.
— Il peut y avoir d’autres raisons, dit Talleyrand, avec ce singulier sourire qui lui est particulier.
Bref, ils me dirent un ou deux mots de compliment, mais je trouvai qu’ils auraient pu en ajouter plus long, sans en avoir dit encore assez. Je saluai et me retirai, enchanté de sortir de là, car autant j’aime les camps, autant je déteste les cours. Je m’en fus trouver mon vieil ami Chaubert, dans la rue Miromesnil, et j’endossai son uniforme de hussards qui m’allait très bien. Nous soupâmes ensemble à son logement, en compagnie de Lisette, et j’oubliai avec eux tous les dangers que j’avais courus. Le matin, je retrouvai Violette prête à faire encore ses vingt lieues. C’était mon intention de retourner immédiatement au quartier général de l’Empereur, car vous pensez bien que j’étais impatient d’entendre ses éloges et de recevoir ma récompense.
Je n’ai pas besoin de vous dire que j’effectuai mon retour par une route sûre, car j’en avais assez des uhlans et des Cosaques. Je passai par Meaux et Château-Thierry, et le soir, j’arrivai à Reims, où était encore Napoléon. Les corps de nos soldats et ceux des Russes de Saint-Prest avaient été enterrés, et je pus voir aussi le changement qui s’était opéré dans le camp. Les soldats paraissaient mieux soignés ; la cavalerie avait reçu des chevaux frais ; tout était dans un ordre parfait. C’est étonnant ce que peut faire un bon général en deux jours !
Quand j’arrivai au quartier général, je fus conduit tout de suite à l’appartement de l’Empereur. Il était en train de prendre son café sur le coin d’une table sur laquelle était déployée une grande carte qu’il annotait. Berthier et Macdonald étaient penchés chacun par-dessus une de ses épaules, et il parlait si vite que je suis sûr qu’ils ne devaient pas comprendre la moitié de ce qu’il disait. Mais quand il me vit debout près de la porte, il laissa tomber sa plume sur la carte, et se leva d’un bond avec un regard qui me glaça.
— Du diable ! qu’est-ce que vous faites ici ? cria-t-il d’une voix aigre.
Quand il était en colère, il avait une voix comme un paon.
— J’ai l’honneur d’informer Votre Majesté que j’ai remis sa dépêche au roi d’Espagne, dis-je.
— Quoi ? hurla-t-il.
Et ses deux yeux me transpercèrent comme des baïonnettes. Oh ! ces yeux terribles, passant du gris au bleu, comme de l’acier au soleil ; je les revois encore dans mes mauvais rêves.
— Qu’est devenu Charpentier ? demanda-t-il en se tournant vers les deux généraux.
— Il a été pris, dit Macdonald.
— Par qui ?
— Par les Russes.
— Par les Cosaques.
— Il s’est fait prendre par un Cosaque.
— Il s’est rendu ?
— Sans résistance.
— C’est un officier intelligent. Vous lui ferez donner la croix d’honneur.
Quand j’entendis cela, je fus obligé de me frotter les yeux, pour bien m’assurer que j’étais éveillé.
— Quant à vous, cria l’Empereur en faisant un pas vers-moi comme s’il eût voulu me frapper, cervelle de lièvre que vous êtes, pourquoi croyez-vous donc que je vous ai confié cette mission ? Est-ce que vous vous imaginez que j’irais confier un message important à un idiot comme vous ? et à travers un pays dont tous les villages sont occupés par l’ennemi ? Comment vous avez réussi à passer, je me le demande. Mais si votre camarade avait eu aussi peu d’intelligence que vous, mon plan de campagne était perdu. Vous n’avez pas vu, coglione, que cette dépêche contenait des nouvelles fausses, et n’avait pour but que de tromper l’ennemi, pendant que je mettrais à exécution un plan entièrement différent ?
En entendant ces paroles cruelles, et lorsque je vis cette figure pâle et furieuse fixée sur moi, je fus obligé d’empoigner le dossier d’une chaise, car je sentais le cœur me manquer et mes jambes flageoler sous moi. Mais je repris courage, en me disant que j’étais un soldat plein d’honneur et que j’avais passé ma vie à me battre pour cet homme et pour mon cher pays.
— Sire, dis-je — et les larmes me roulaient sur les joues comme je parlais — avec un homme comme moi il vaut mieux parler franchement. Si j’avais su que vous vouliez que votre lettre tombât entre les mains de l’ennemi, je m’y serais pris en conséquence. Mais je croyais le contraire, et j’étais préparé à sacrifier ma vie pour cela. Je ne crois pas, Sire, qu’aucun homme au monde ait surmonté autant de dangers et d’épreuves que je l’ai fait pour exécuter fidèlement ce que je croyais être vos ordres.
En disant ces derniers mots, j’essuyai les larmes de mes yeux et je lui fis le récit de tout ce qui m’était arrivé ; je lui racontai mon passage à travers Soissons, ma rencontre avec les dragons, mon aventure à Senlis, avec le comte Boutkine, mon déguisement, mon combat avec l’officier de Cosaques, ma fuite et comment au dernier moment j’avais failli être tué par un dragon français. L’Empereur, Berthier et Macdonald écoutaient avec le plus grand étonnement peint sur leur figure.
Quand j’eus fini, l’Empereur s’avança vers moi et me pinça l’oreille.
— Là ! là ! dit-il, oubliez ce que je vous ai dit. J’aurais dû avoir plus de confiance en vous. Vous pouvez partir.
Je me dirigeai vers la porte et j’allai sortir quand, d’un geste, l’Empereur m’arrêta.
— Vous ferez donner la croix d’honneur au colonel Gérard, dit-il en se tournant vers le duc de Tarente ; s’il a la cervelle la plus épaisse, il a aussi le cœur le plus solide de toute mon armée.
II
COMMENT LE COLONEL TINT LE ROI ENTRE SES MAINS
Je crois, mes amis, que, la dernière fois, je vous ai raconté comment je reçus, sur l’ordre de l’Empereur, la croix de la Légion d’honneur, que j’avais, si je puis le dire, depuis si longtemps méritée. Vous pouvez voir le ruban ici, à la boutonnière de ma redingote, mais la croix elle-même, je la garde chez moi dans un écrin en cuir, et je ne la sors jamais, à moins qu’un de nos généraux de ce temps, ou quelque étranger de distinction, se trouvant à passer dans notre petite ville, ne profite de l’occasion pour présenter ses respects au célèbre colonel Gérard. Alors je la mets sur ma poitrine, et je donne à ma moustache ce vieux tour de Marengo qui me met une pointe grise dans chacun des yeux.





























