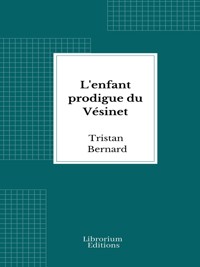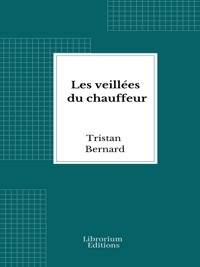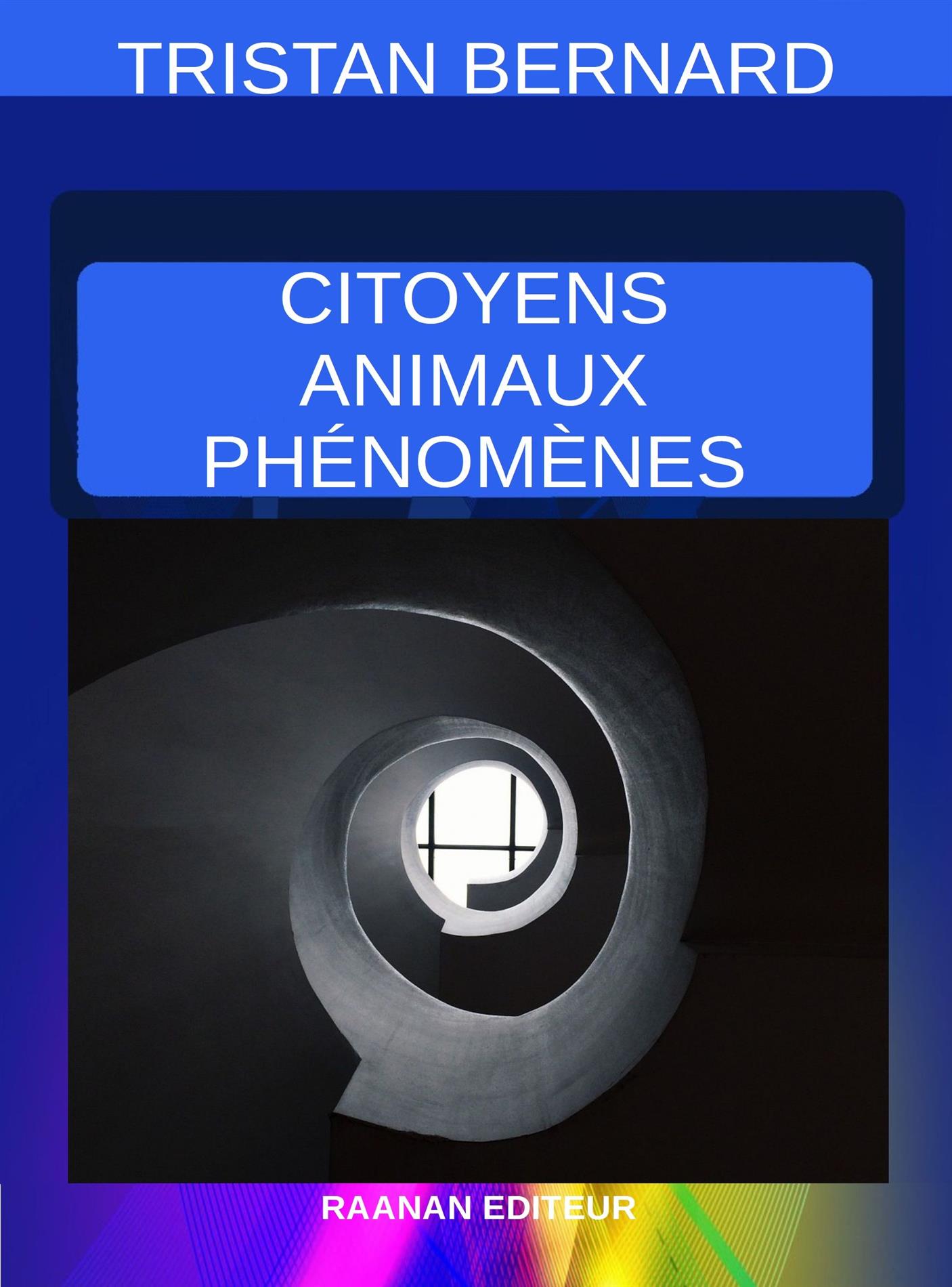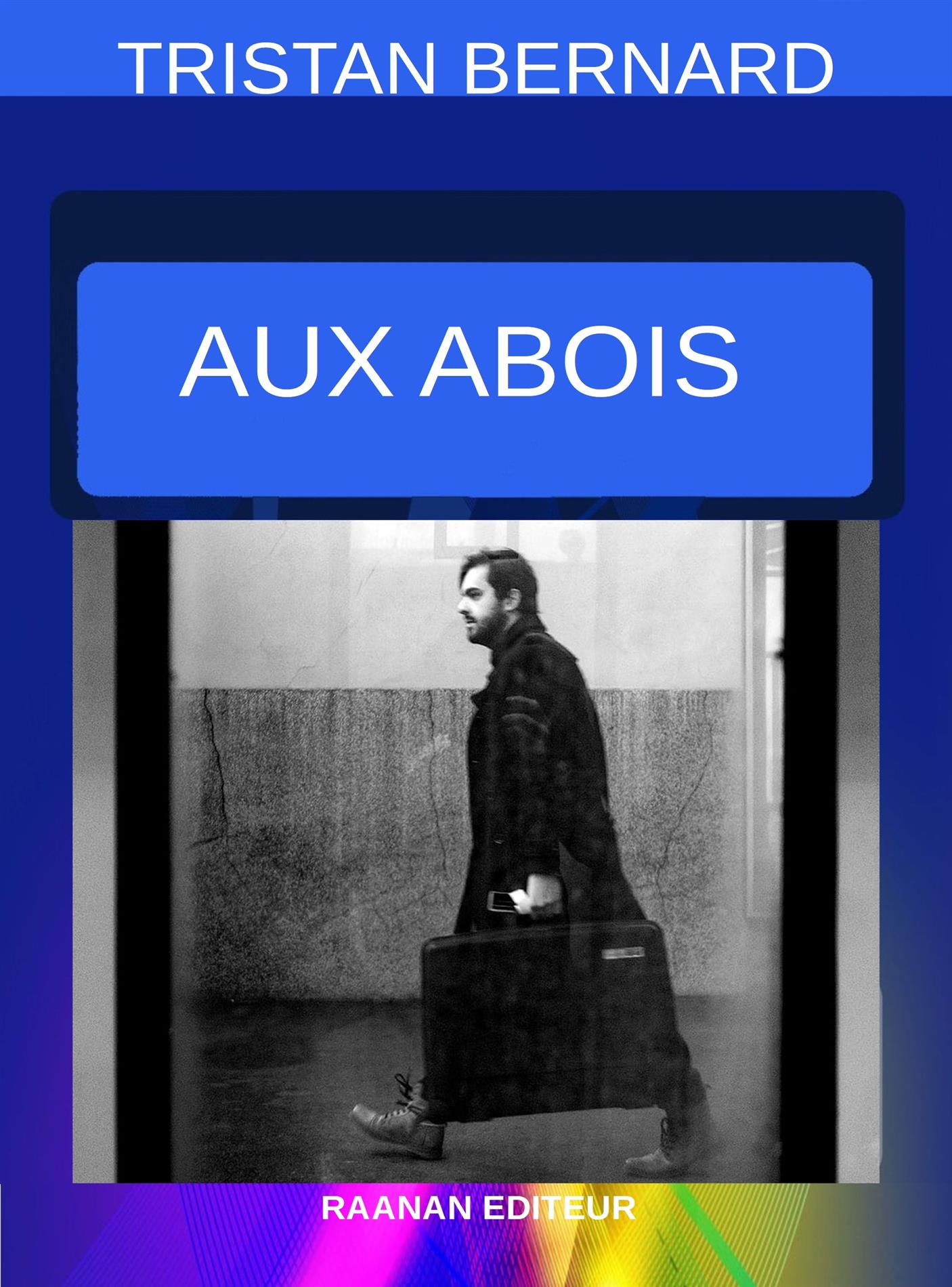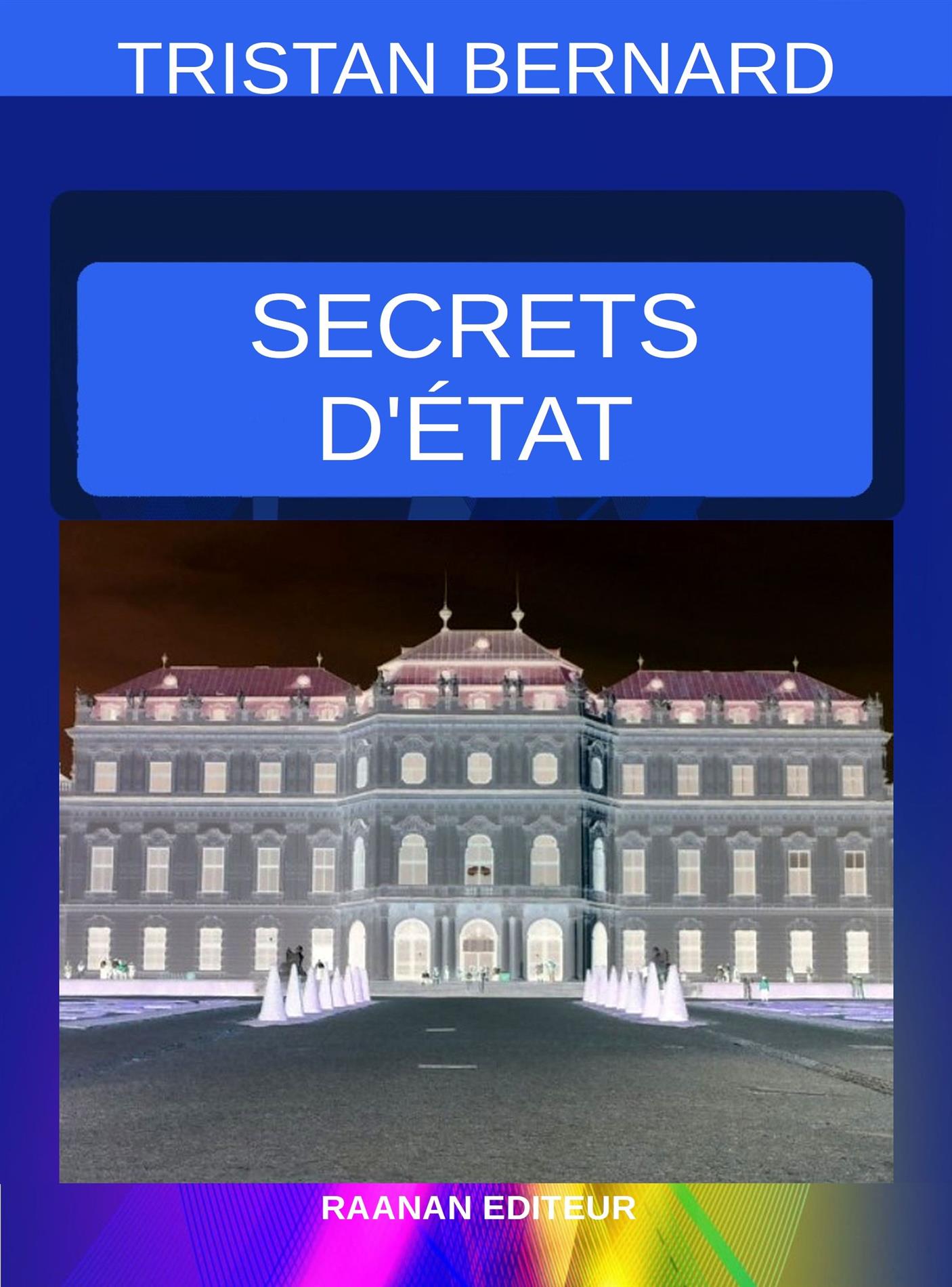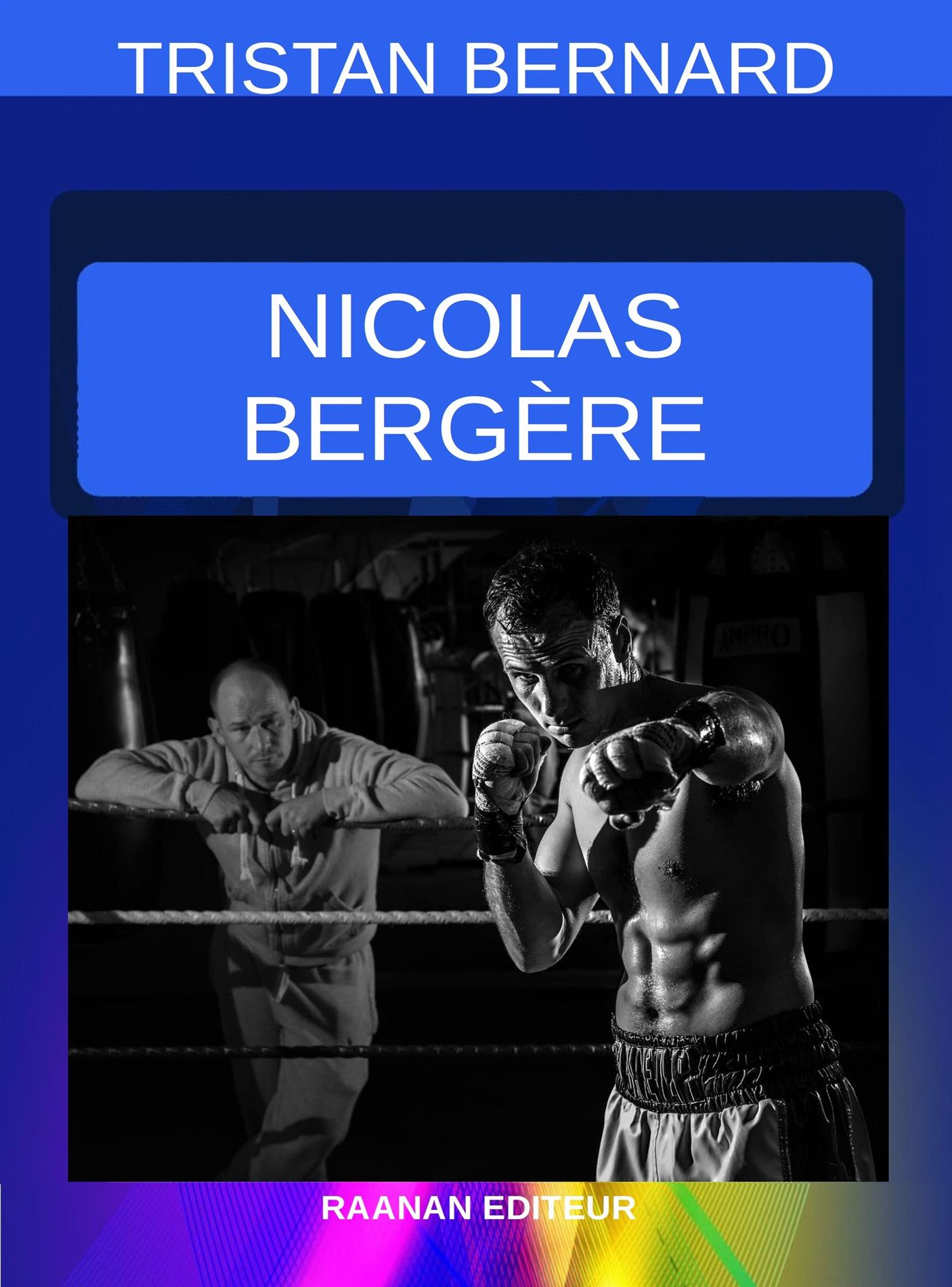1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Féerie bourgeoise est un roman de Tristan Bernard publié en 1924.
Extrait
| I
Ce jour-là, chez M. Bernard Lunéville, on attend Mme Levreau, la sœur de Bernard. Elle habite Dijon, avec son mari et ses enfants, et n’est pas venue depuis trois ans à Paris.
L’appartement et le bureau de Bernard se trouvent au premier étage d’une maison de la rue Réaumur. Depuis 1888, M. Lunéville y vend des diamants et des perles. Il en a été exilé pendant dix mois, au moment où l’on a démoli et rebâti l’immeuble pour le mettre à l’alignement. Durant ce laps de temps, il a émigré à côté, pour ne pas trop changer l’adresse de la maison, et ce petit déménagement provisoire n’a pas nui à ses affaires.
Bernard est veuf depuis dix ans. Mme Lunéville a succombé à toutes sortes de maladies, après avoir gémi pendant des années et annoncé constamment son décès pour la semaine suivante. On avait fini par croire que cette santé si chancelante chancellerait éternellement, et l’événement fatal a frappé encore plus douloureusement la famille que ne l’eût fait un dénouement moins escompté.
Bernard a un enfant unique, une jeune fille de dix-huit ans, au visage songeur et tendre.
Claire aime beaucoup sa tante Levreau et se réjouit vraiment de la revoir, peut-être aussi parce qu’elle a l’espoir de l’étonner un peu. Tante Sarah ne manquera pas de la trouver très changée, tout à fait jeune fille maintenant. Mais c’est surtout tante Louise, la sœur de feu Mme Lunéville, une maigre et taquine vieille demoiselle, qui s’apprête à éblouir la tante de province. Tante Sarah, de son côté, s’attend à cela, et, dans le train qui l’amène à Paris, se prépare une âme rebelle à tout éblouissement.
À six heures du soir, la famille : Bernard, Louise qui habite chez Bernard, et la jeune Claire s’enfonce dans le métro pour gagner la gare de Lyon...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
X
XI
XII
XIII
XIV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
TRISTAN BERNARD
FÉERIE BOURGEOISE
ROMAN
Paris, 1924
Raanan Editeur
Livre 747| édition 1
I
Ce jour-là, chez M. Bernard Lunéville, on attend Mme Levreau, la sœur de Bernard. Elle habite Dijon, avec son mari et ses enfants, et n’est pas venue depuis trois ans à Paris.
L’appartement et le bureau de Bernard se trouvent au premier étage d’une maison de la rue Réaumur. Depuis 1888, M. Lunéville y vend des diamants et des perles. Il en a été exilé pendant dix mois, au moment où l’on a démoli et rebâti l’immeuble pour le mettre à l’alignement. Durant ce laps de temps, il a émigré à côté, pour ne pas trop changer l’adresse de la maison, et ce petit déménagement provisoire n’a pas nui à ses affaires.
Bernard est veuf depuis dix ans. Mme Lunéville a succombé à toutes sortes de maladies, après avoir gémi pendant des années et annoncé constamment son décès pour la semaine suivante. On avait fini par croire que cette santé si chancelante chancellerait éternellement, et l’événement fatal a frappé encore plus douloureusement la famille que ne l’eût fait un dénouement moins escompté.
Bernard a un enfant unique, une jeune fille de dix-huit ans, au visage songeur et tendre.
Claire aime beaucoup sa tante Levreau et se réjouit vraiment de la revoir, peut-être aussi parce qu’elle a l’espoir de l’étonner un peu. Tante Sarah ne manquera pas de la trouver très changée, tout à fait jeune fille maintenant. Mais c’est surtout tante Louise, la sœur de feu Mme Lunéville, une maigre et taquine vieille demoiselle, qui s’apprête à éblouir la tante de province. Tante Sarah, de son côté, s’attend à cela, et, dans le train qui l’amène à Paris, se prépare une âme rebelle à tout éblouissement.
À six heures du soir, la famille : Bernard, Louise qui habite chez Bernard, et la jeune Claire s’enfonce dans le métro pour gagner la gare de Lyon.
Bernard, qui pendant toute sa jeunesse a voyagé sur tous les réseaux, est un grand expert en organisations de départ et d’arrivée. Aussitôt à la gare, il s’informe du retard des trains et voit qu’il n’y a rien de signalé pour l’express de Dijon. Dix minutes donc avant l’heure d’arrivée, il va retenir un taxi-auto. On a amené une des bonnes, à qui on remettra le bulletin de bagages et qui se débrouillera avec un autre taxi. On ne peut attendre la malle de la tante : il faut se mettre à table à sept heures et demie exactement. Le principe de la régularité dans les heures des repas domine toute la vie de la famille Lunéville.
Bernard est un homme corpulent ; il n’est pas gras de nature, mais l’âge et son autorité en affaires l’ont fortement épaissi. Il n’a rien de la jovialité des hommes gros. Certes, il ne dédaigne pas de rire aux plaisanteries qui en valent la peine, mais il est rare qu’il en profère lui-même, en dehors cependant de trois ou quatre anecdotes, que son entourage écoute avec une joie rituelle.
Bernard est bon pour ses parents peu fortunés, mais faut-il dire bon ? Il leur vient en aide par devoir, sans le moindre plaisir.
Dans son commerce, il se montre assez strict et oblige ses débiteurs à s’acquitter aux échéances. Il ne renonce aux moyens de défense dont la loi l’a armé que lorsqu’il se trouve en présence d’une insolvabilité certaine. Toutefois, fût-ce à l’égard de ceux qui peuvent payer, il ne se montre pas d’une sévérité arabe. On cite même de lui quelques traits de générosité.
Le dîner préparé en l’honneur de la tante Sarah est confortable. La famille Lunéville, originaire du Haut-Rhin et des Vosges, a gardé une tradition exacte de certains plats alsaciens et lorrains. On y mange d’excellents choux rouges et des saucisses courtes. Une purée de pois recouvre, comme une surprise, de fermes morceaux de bœuf fumé.
Tante Louise avait attendu le dîner pour commencer la grande séance d’éblouissement.
Elle raconte qu’ils sont allés sept fois au théâtre depuis le début de la saison, et les sept fois avec des billets de faveur, mais pas des billets de faveur ordinaires : tantôt la loge du préfet, tantôt celles des beaux-arts. Elle ajoute :
— C’est un monsieur qui vient souvent ici, une relation de Bernard, un écrivain. Il nous donne des places sans que nous lui en demandions.
Elle passe en revue les pièces qu’ils ont vues. Elle préfère l’Opéra et Bernard, le Français.
La tante de Dijon pénètre timidement dans la lice en faisant le récit d’une représentation de bienfaisance organisée au théâtre municipal et qui a éclipsé toutes les manifestations de ce genre.
Sans parler du préfet, on avait noté dans la salle la présence du général commandant la subdivision, de l’évêque, du premier président et du recteur. La représentation était donnée avec le concours des meilleurs artistes de l’Opéra et de la Comédie-Française.
— Lesquels ? demande agressivement tante Louise.
Tante Sarah nomme deux ou trois sociétaires de second ordre.
— …C’était bien, dit tante Louise, mais ce n’est pas ces artistes-là que vous appelez les meilleurs du Français, je pense ?
Tante Sarah, pour s’épauler, cite alors l’opinion du recteur qui se trouvait dans la loge à côté, et qui n’a pas tari d’éloges sur l’ensemble du programme.
— Enfin, dit Bernard, nous aurons probablement une loge dans le courant de la semaine et l’on emmènera Sarah.
Au gré de Louise, M. Lunéville a masqué un peu trop indulgemment la défaite de Mme Levreau. Aussi, sans laisser souffler l’adversaire, reprend-elle un nouvel assaut. Elle ne parle plus de l’écrivain, leur ami, mais d’un ami de cet écrivain, un jeune homme de vingt-huit ans, le vicomte de Berrin.
— Je me suis informé, dit Bernard ; c’est une très grande noblesse. Ils n’ont que des ducs et des marquis dans leur parenté.
— Je connais d’ailleurs ce nom, dit Sarah, beaucoup plus disposée à faire des concessions à son frère qu’à Louise.
Le vicomte de Berrin appartenait, en effet, à une des premières familles de France. Il avait été mis en rapport avec Lunéville par Renaud de Sérizier, l’écrivain qui fournissait la famille de places de théâtre.
Jean Sérier, plus connu sous son pseudonyme de Renaud de Sérizier, avait fait lui-même la connaissance de Lunéville à la suite de l’affaire suivante.
Il avait acheté au magasin pour trois mille francs de bijoux, des boucles et un pendentif, qu’il avait payés avec des billets à six mois. Bernard Lunéville, qui n’ignorait pas ses besoins d’argent, l’avait mis en contact le même jour avec un petit marchand de bijoux, qui s’offrait à reprendre, pour deux mille deux cents francs payés comptant, le pendentif et les boucles. Ces différentes transactions avaient enrichi de quatre louis une personne âgée, une dame Moringhe, vêtue avec un luxe un peu fatigué, et qui elle-même avait mis en rapport Renaud de Sérizier et Lunéville.
Les billets n’avaient d’ailleurs pas été payés à l’échéance et, depuis un an, tous les trimestres, on les prorogeait, en en accroissant un peu le montant… Il avait fallu à Mme Moringhe beaucoup d’activité et d’autres affaires, pour ne pas gâter ses relations avec M. Lunéville.
D’autre part, deux ou trois fois par mois, des billets de théâtre assourdissaient les murmures de Bernard.
Le jeune vicomte de Berrin avait été amené par Renaud de Sérizier chez M. Lunéville, un matin de printemps. Il fallait à ce nouvel amateur, passionné de bijoux, des bracelets, des bagues, des broches de la plus belle qualité, mais la joie de la possession serait vite émoussée chez lui, car il demandait en même temps un autre amateur de bijoux, qui lui reprendrait, dans le plus bref délai possible, ces précieux joyaux.
Le jeune homme avait signé trente mille francs de billets. Les renseignements sur sa famille étaient excellents. Son père, le comte, de Berrin, ne possédait pas une fortune colossale, mais il était loin d’être gêné, sinon par une sérieuse parcimonie.
D’autre part, on signalait dans la famille un grand-père breton et une tante angevine, tout près de franchir la lisière fatale, en laissant, bien entendu, dans ce bas monde un certain nombre de titres au porteur.
M. Lunéville fit l’affaire, mais le premier billet de sept mille cinq cents francs ne fut pas payé à la date de l’échéance. Le soir même de ce jour, toute la famille Lunéville applaudissait Thaïs à l’Opéra.
Bernard était beaucoup plus riche que son train de maison ne pouvait le faire supposer. Une affaire de trente mille francs qui lui donnait du tracas ne représentait pas pour lui une catastrophe. Il était vexé seulement comme un joueur qui a raté son coup.
D’ailleurs, on ne pouvait pas dire que M. Lunéville aimât l’argent. Il aimait en gagner, voilà tout, et s’il dépensait peu, c’était pour ne pas diminuer son gain. Il éprouvait une grande satisfaction morale à enregistrer un bel inventaire.
Il n’était pas homme à faire une affaire d’usure caractérisée, car la loi lui disait alors trop expressément que ce n’était pas bien ; mais il trouvait naturel, quand le cas se présentait, de vendre des bijoux à un fils de famille, le plus cher possible, et de les lui faire racheter au rabais par un ami à lui. Il avait toute sa vie pratiqué ce métier, chaque fois qu’il en avait eu l’occasion, et sa conscience faisait aussi bien de rester tranquille, car il n’aurait pas compris ses reproches. Loin de là, il lui semblait que lorsqu’une affaire de ce genre se présentait, c’eût été un péché de la laisser échapper.
Bien sûr, il savait que lorsqu’il recevait des places de théâtre, c’était parce qu’on voulait l’amadouer ; il les acceptait avec une rancune qui s’astreignait à rester muette, car les billets faisaient tant plaisir à Claire et à Louise ! Il ne manifestait donc devant elles aucun mécontentement, flatté peut-être tout de même et content de s’être procuré, même à un prix aussi cher, de belles relations dans le monde des arts.
Mais, par-dessus tout, il était heureux du plaisir que sa fille goûtait au théâtre, car il aimait Claire profondément, exclusivement. Quand on disait devant lui qu’elle était jolie, il bougonnait : « Vous la trouvez si belle que ça ? Moi, je ne sais pas. Est-ce parce que je suis habitué à elle ? Je ne peux pas m’imaginer que c’est une beauté. » Au fond, ses protestations et ses dénégations ne servaient qu’à exciter l’interlocuteur pour l’amener à insister et à enchérir.
La jeune fille adorait son père. Bernard jouissait, dans sa famille, d’une grande réputation d’intelligence et d’initiative. Claire avait reçu une instruction plus raffinée, mais elle sentait très bien que si son père avait appris tout ce qu’on lui avait enseigné à elle, il l’aurait su beaucoup mieux qu’elle. Elle était ravie de voir que tous les cousins, quand ils avaient un différend, venaient trouver Bernard, comme une espèce de cadi familial. Personne, dans la famille, n’entreprenait une affaire importante sans lui demander conseil.
Elle avait aussi remarqué que l’esprit de son père s’adaptait à tout. Quand on allait au Théâtre-Français, son jugement sur les pièces paraissait plein de sens et même de sensibilité.
Bernard n’avait pas d’employé, en dehors d’un vieux comptable dont l’incapacité était, pour la famille, un infatigable sujet de railleries. Charmelin n’avait jamais été capable de recevoir un acheteur… Il avait fait, dans toute sa vie, une affaire de quarante-cinq francs !
Quand il était seul au magasin, il suffisait qu’il indiquât le prix d’une marchandise, pour que le client prît la porte à l’instant même, complètement dégoûté.
Bernard, sans s’en rendre compte, tenait à ce vieux serviteur, qui était, pour le chef de la maison, le plus éloquent des repoussoirs.
La plupart du temps, quand Bernard n’était pas chez lui, c’était sa fille qui recevait le monde, et quand il arrivait à Claire de vendre toute seule un bracelet ou une broche, son père en souriait d’un air supérieur et ravi.
II
Claire avait reçu plusieurs fois le vicomte de Berrin.
Le jeune homme avait trouvé la jeune fille fort agréable à regarder. D’autre part, il entrait dans ses plans de faire la cour à tout ce qui approchait de Bernard Lunéville. Il ne soupçonnait pas du tout que le marchand de diamants pût être flatté d’être en relations avec lui. Il se faisait à lui-même, quand il était devant le redoutable prêteur, l’effet d’être un fils de famille sans aucun sérieux, d’un galopin. On l’aurait bien étonné si on lui avait dit que, devant des tiers, Bernard Lunéville citait parmi ses relations, avec gravité, le nom du vicomte de Berrin.
Le jeune vicomte avait fait un semblant de cour à Claire. Il se figurait que c’était par calcul, pour se gagner un allié dans la maison. Mais la grâce de Claire lui facilitait singulièrement cette comédie. Elle, très innocente, avait bien l’impression qu’elle plaisait au jeune homme, et cela la troublait un peu.
Cependant, Bernard Lunéville faisait ses comptes. Si Georges de Berrin tardait trop à le rembourser, l’affaire devenait beaucoup moins avantageuse, étant donné que la commission portait sur un laps de temps beaucoup plus long. Pour les délais supplémentaires, il ne pouvait exiger un gros intérêt, car l’affaire eût cessé d’être correcte au point de vue strictement légal. Le mieux était de vendre encore au vicomte quelques autres bijoux, avec un bénéfice qui compenserait la perte du retard. Mais il fallait attendre la proposition du jeune Berrin. Lunéville ne pouvait en prendre l’initiative.
M. Lunéville était un travailleur sérieux. Il ne s’éternisait pas sur une mauvaise affaire, qu’il passait à « profits et pertes », en faisant une croix. Quand Georges de Berrin vint le voir, Bernard lui dit qu’il avait éprouvé une grande désillusion.
— Que voulez-vous ? Je me verrai obligé de poursuivre le recouvrement de mon argent, quitte à faire des frais, qui resteront à ma charge tant que vos affaires ne se seront pas améliorées. Je vous avoue, ajouta-t-il, que je ferai cela à contre-cœur, car j’ai de la sympathie pour vous, et je ne suis pas du tout satisfait de vous occasionner des ennuis.
Il parlait ainsi par une vieille habitude de commerçant et ne se doutait pas qu’il était sincère quand il parlait de ses sentiments de sympathie. Le jeune homme, lui, ne croyait pas à ces belles protestations et n’y voyait qu’un boniment d’usurier, désireux d’embarquer un fils de famille dans une nouvelle affaire. Docilement, et d’ailleurs parce qu’il le désirait, il demanda à acheter de nouveaux bijoux. Il ne s’agissait pas seulement pour lui de retirer les billets impayés, il avait besoin en outre d’une quinzaine de mille francs liquides pour se remettre un peu à flot. Il allait donner tant bien que mal toutes ces précisions quand la conversation fut interrompue par le départ de Lunéville, que tante Sarah attendait pour sortir.
— Revenez un de ces jours, dit Bernard. D’ici là, je réfléchirai.
Georges écrivit, le soir même, une lettre de quatre pages, où il parla de quinze mille francs supplémentaires, auxquels il n’avait fait, dans leur entretien, qu’une vague allusion. Puis il revint timidement le jour suivant. Bien que ses besoins fussent urgents, il se sentit presque soulagé en apprenant que Bernard n’était pas chez lui et que la conversation, forcément, devait se remettre au lendemain.
Claire était toute seule quand le jeune homme arriva. Papa, avec tante Sarah et tante Louise, était parti pour rendre visite à un vieil oncle qui habitait Vaugirard, à vingt minutes de métro seulement, mais qu’on ne songeait à aller voir que tous les trois ans, quand l’arrivée d’un parent de province en donnait l’occasion.
— Papa, dit Claire au jeune vicomte, n’est pas content de vous. Je sais que vous lui avez envoyé une lettre où vous lui demandez je ne sais au juste quoi…
— De traiter avec moi une nouvelle affaire… Et il n’a rien dit, mademoiselle ?
— Rien de précis. Quand votre lettre est arrivée, il l’a lue des yeux, il a hoché la tête et il a fait : « Et quoi encore ? »
— Oh ! oh ! fit le jeune homme. Ça ne me paraît pas aller très bien.
Claire fut ennuyée de le voir déconfit.
— On ne sait jamais, avec papa ; d’abord, il fait celui qui ne veut rien entendre, et puis, brusquement, il vous accorde ce que vous lui demandez.
— Il me fait peur, votre père, dit le jeune homme.
Claire se mit à rire.