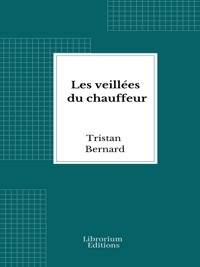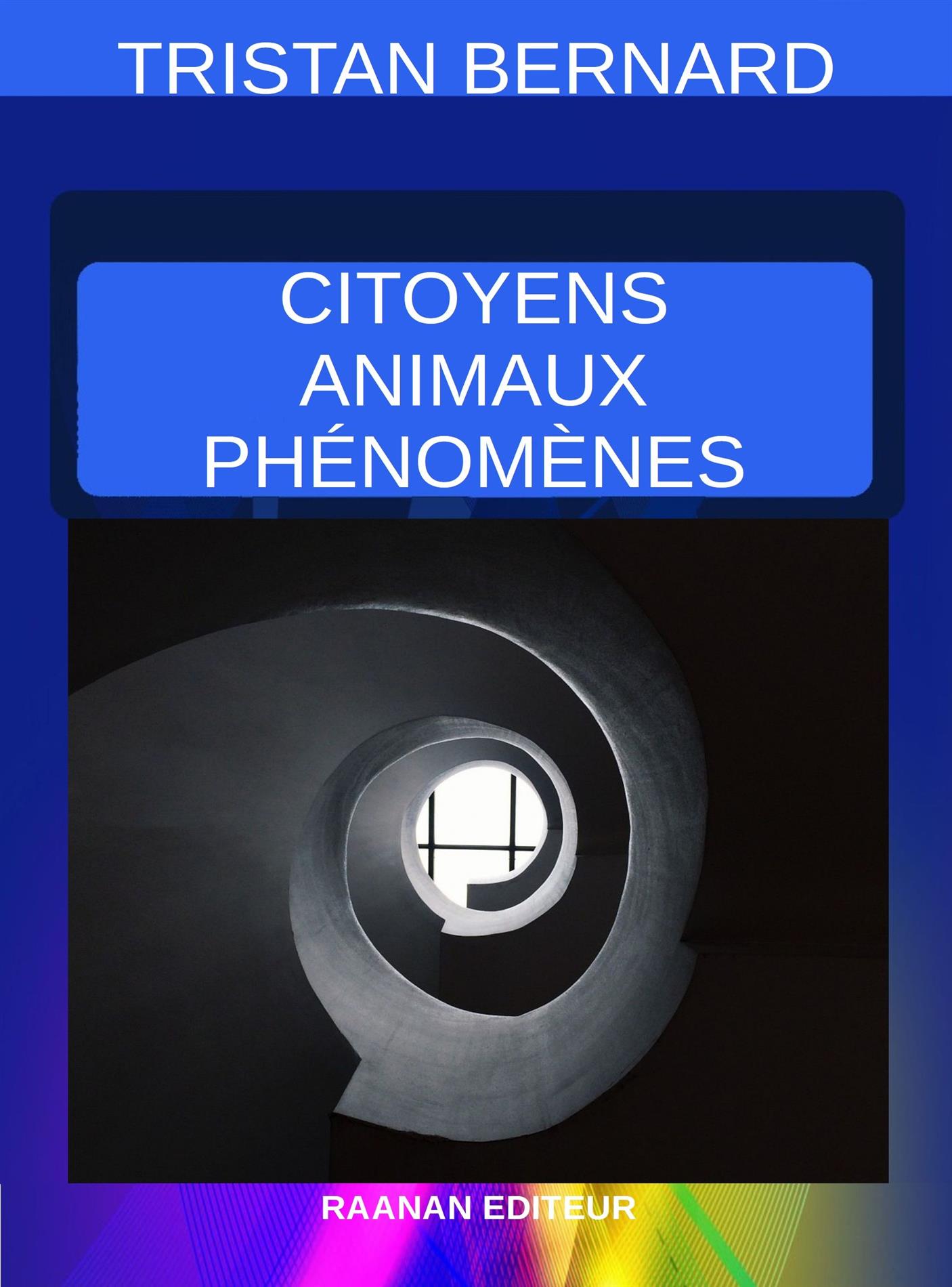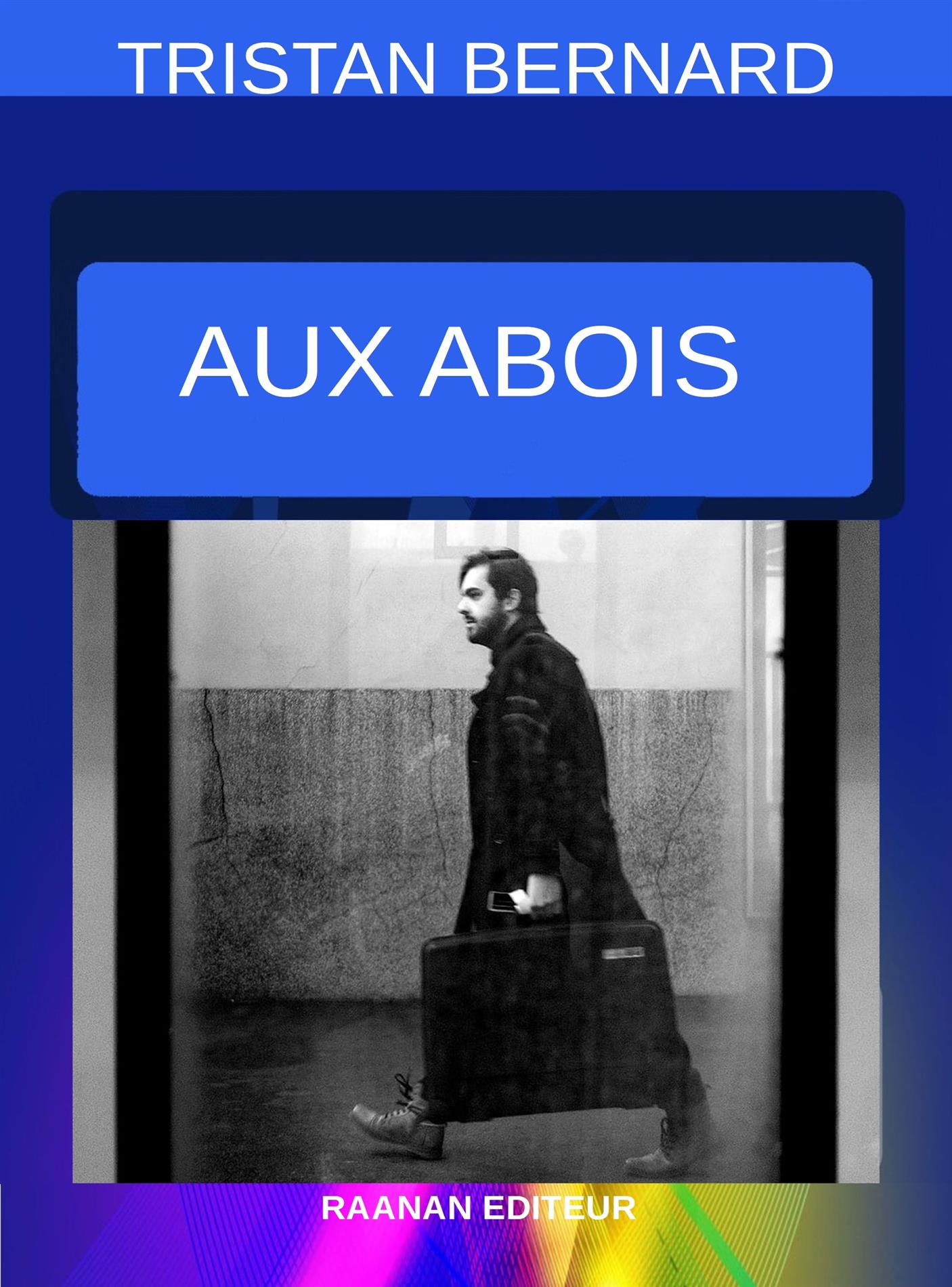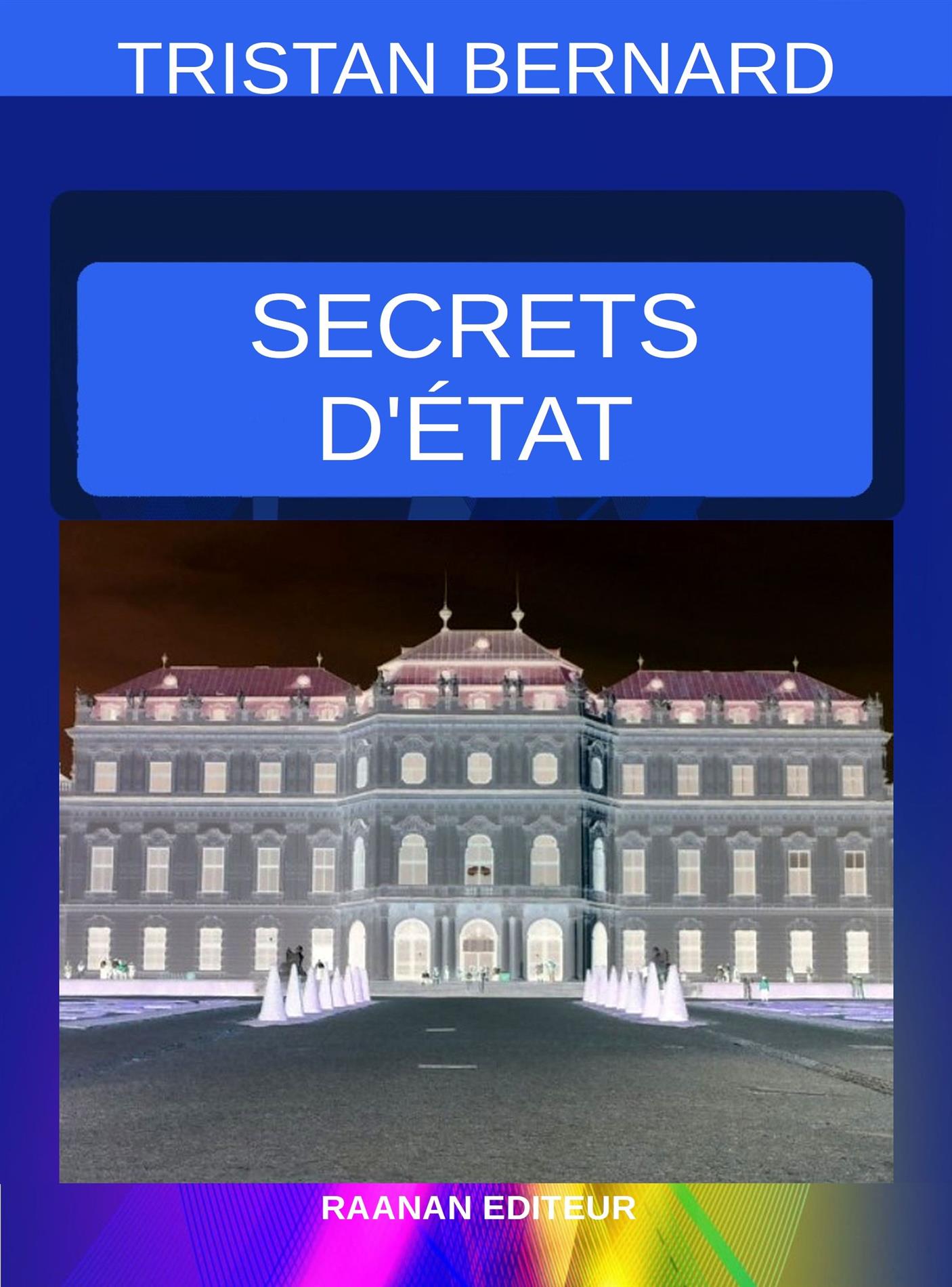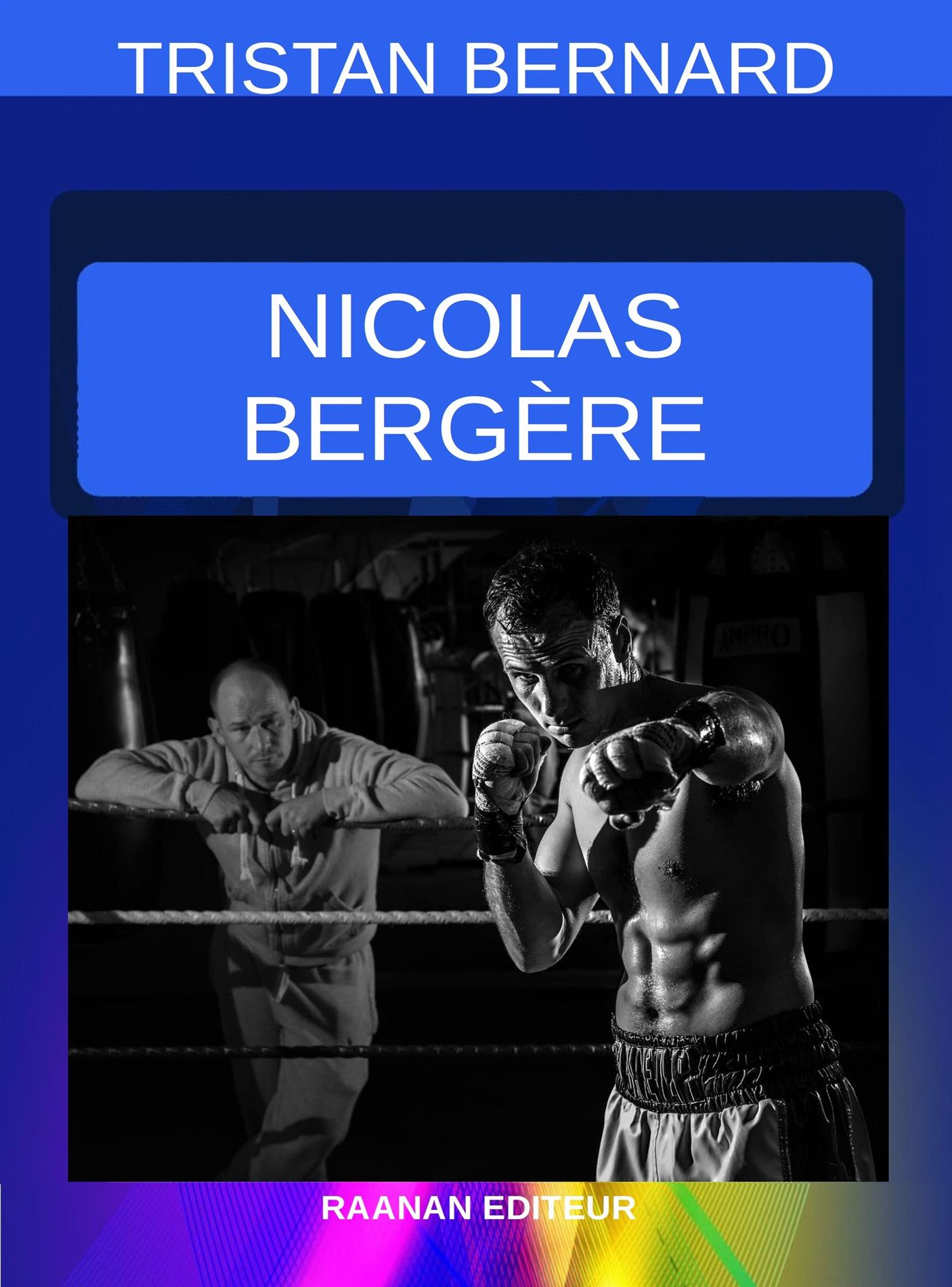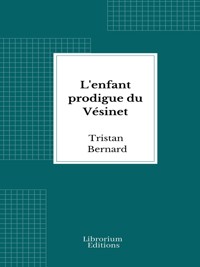
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le train de 5 h. 35, qui partait de la gare Saint-Lazare pour Saint-Germain, emmenait chaque jour un grand nombre de commerçants en villégiature au Vésinet. Arthur Brunal, l’assureur maritime, qui habitait rue du Havre, et se trouvait le premier sur le quai, avait la mission quotidienne de retenir un compartiment pour huit personnes, toujours les mêmes.
C’étaient Georges Blaque, le marchand de tissus, et son associé Louis Félix, Jules Zèbre, le remisier, les frères Rourème, cols et cravates, et enfin M. Aristide Nordement, fabricant de bouchons, et son fils Robert, qui arrivaient d’assez loin, de leur maison de la rue des Vinaigriers, près du canal Saint-Martin.
Aristide Nordement était un petit vieillard à tête de géant. Son visage osseux était assez grossièrement taillé. Le poil de sa barbe grise était mal réparti ; celui des sourcils était abondant et dur, comme le poil des terriers écossais.
Qu’il fût question de politique étrangère, des cours de la Bourse, ou du théâtre, il ne prenait part à la conversation que par des : hon, hon… un peu sourds, et dont personne ne sut jamais s’ils marquaient une protestation ou un acquiescement.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TRISTAN BERNARD
L’enfant prodigue du Vésinet
ROMAN
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385744700
L’enfant prodigue du Vésinet
I
Le train de 5 h. 35, qui partait de la gare Saint-Lazare pour Saint-Germain, emmenait chaque jour un grand nombre de commerçants en villégiature au Vésinet. Arthur Brunal, l’assureur maritime, qui habitait rue du Havre, et se trouvait le premier sur le quai, avait la mission quotidienne de retenir un compartiment pour huit personnes, toujours les mêmes.
C’étaient Georges Blaque, le marchand de tissus, et son associé Louis Félix, Jules Zèbre, le remisier, les frères Rourème, cols et cravates, et enfin M. Aristide Nordement, fabricant de bouchons, et son fils Robert, qui arrivaient d’assez loin, de leur maison de la rue des Vinaigriers, près du canal Saint-Martin.
Aristide Nordement était un petit vieillard à tête de géant. Son visage osseux était assez grossièrement taillé. Le poil de sa barbe grise était mal réparti ; celui des sourcils était abondant et dur, comme le poil des terriers écossais.
Qu’il fût question de politique étrangère, des cours de la Bourse, ou du théâtre, il ne prenait part à la conversation que par des : hon, hon… un peu sourds, et dont personne ne sut jamais s’ils marquaient une protestation ou un acquiescement.
Robert Nordement ne ressemblait pas à son père. C’était un jeune garçon imberbe, aux traits réguliers, au teint un peu gris perle, au visage éclairé par deux grands yeux noirs ardents, dont il tempérait la plupart du temps l’éclat intempestif sous les stores à demi abaissés de ses paupières.
Pas plus que son père il n’ouvrait la bouche à ces réunions quotidiennes. Mais c’était sans doute parce qu’il était là comme un intrus, comme un jeune homme de vingt-deux ans encore indigne, et en tout cas sans autorité. Il méprisait ses compagnons de voyage, et souffrait aussi de se voir dédaigné par eux.
Il enviait, en s’en moquant, la facilité avec laquelle Georges Blaque, spécialiste improvisé des questions de politique extérieure, jouait avec les nations d’Europe, comme avec un jouet d’enfant à six quatre-vingt-quinze. Ce petit quinquagénaire obèse semblait connaître à fond les desseins, cachés ou avoués, de tous les hommes d’État d’Europe et d’Amérique. Il ne trouvait de contradicteur que dans le cadet des Rourème, une sorte de grand corbeau, encore plus noir et plus triste que son frère, et qui répondait aux conceptions arbitraires de M. Blaque par des faits précis, d’ailleurs imparfaitement contrôlés : il prétendait puiser dans les lettres de ses voyageurs des renseignements sur l’état d’esprit des différentes populations.
On questionnait sur les tendances de la Bourse le mystérieux Jules Zèbre, remisier vénérable, très entouré de barbe et de cheveux blancs. Parfois, Arthur Brunal, célibataire myope et d’un blond attardé, racontait des histoires sur les gens de théâtre.
Louis Félix, l’associé de Georges Blaque, dissimulait derrière un fin sourire un manque d’opinions congénital.
A l’arrivée au Vésinet, la plupart des dames de ces messieurs, environnées de grappes d’enfants, venaient prendre livraison de leurs époux.
On s’embrassait rituellement, et l’on se dirigeait vers les villas, où ces messieurs se débarrassaient de leurs faux cols et mettaient des chemises molles, pour bien marquer qu’ils étaient à la campagne.
Aristide Nordement était attendu par sa femme, une petite dame sèche, article distingué, aux cheveux d’argent frisottants. Elle avait d’ordinaire avec elle sa fille cadette, Mme Turnèbe, dont le mari, pour le moment, était au Maroc. L’autre fille, Mme Glass, la femme de l’antiquaire, habitait Montmorency.
Après avoir frôlé d’un baiser le front maternel, Robert, toujours taciturne, accompagnait la petite troupe en flanc-garde, à cinq pas à l’écart. Depuis longtemps, il n’y avait plus de conversation très suivie entre sa famille et lui. Leur mariage l’avait séparé de ses deux sœurs, qui étaient ses aînées. Son père et sa mère oubliaient de lui parler pendant des heures, souvent aux instants où il eût souhaité un peu d’expansion et de tendresse. Puis, quand on s’occupait de lui, quand sa mère lui posait des questions, d’ailleurs oiseuses, il se trouvait justement qu’il n’était pas disposé à causer.
Il n’avait eu dans la vie qu’un véritable ami, Francis Picard, de deux ans plus âgé que lui, et qui avait été tué à la guerre, très peu de temps avant la fin.
Lui était parti au début de 1918. Il était resté six mois dans un dépôt de cavalerie. Au moment de l’armistice, il était depuis peu dans la zone des armées.
Sa famille avait eu à son sujet des alarmes, qu’elle n’avait d’ailleurs cachées à personne.
Le régiment de Robert, en décembre, était allé à Mayence. Puis le jeune homme avait été réformé ; il était au moment de la visite, très mince de thorax. Un bon repos, après la réforme, l’avait développé d’une façon extraordinaire.
Ses parents lui avaient fait suivre ses classes de lettres. Au retour du régiment, il prit ses inscriptions pour la licence d’histoire. Il la préparait à la Sorbonne et au magasin de son père, pour ne pas trop s’éloigner des affaires… Il faut dire qu’au lycée, il avait déçu l’orgueil de sa famille, en n’étant pas dans les tout premiers. Sa préparation de licence donnait, même à des profanes, l’impression d’être un peu molle. Mais il suffisait qu’un ouvrage ne fût pas sur les programmes pour qu’il l’étudiât avec ardeur ; de sorte que son instruction, plutôt marginale, était assez étendue.
Son ami Francis Picard et lui s’étaient considérés comme des êtres très supérieurs au reste de l’humanité. Et, grâce à cette admiration mutuelle, ils avaient beaucoup grandi l’un et l’autre. C’est un excellent entraînement intellectuel que d’avoir en soi-même une confiance exagérée.
La vie sentimentale de ces deux jeunes hommes avait été plutôt restreinte. Ils avaient eu chacun deux ou trois petites amies, qu’ils s’étaient aidés réciproquement à mépriser. Et ils s’étaient préservés ainsi d’influences spirituelles qui risquent d’être un peu affadissantes, si le hasard nous a fait rencontrer une âme-sœur de second choix.
Depuis la mort de Francis, Robert était bien isolé. Il sentait autour de lui un vide désespérant dont il rendait tout le monde responsable et surtout sa famille, car Francis Picard, en véritable ami, avait exercé un pouvoir de destruction instinctivement systématique sur tout ce qui n’était pas leur amitié.
Robert avait l’impression d’être détaché des siens. Il ne sentait de lien vivant, entre son père et lui, que lorsque M. Nordement était pris d’une crise cardiaque. Alors il le voyait mort, tout de suite, et c’était une angoisse intolérable. Une fois que sa mère, sortie en auto, se fit attendre pendant deux heures, il souffrit d’inquiétudes atroces, et promit aux pauvres des sommes assez considérables, qu’il fut ensuite très pénible de payer.
Dans ces cas-là, il constatait qu’il tenait tout de même à son père et à sa mère, mais il était navré de voir qu’en analysant ses sentiments, il ne découvrait pas les traces d’un véritable amour filial.
Ses parents n’avaient jamais aimé son ami Francis ; il ne leur pardonnait pas.
La guerre avait aussi contribué à affaiblir cette habitude religieuse et timide qui le liait encore à sa famille. Cependant, il n’aurait jamais eu la force de se séparer des siens, sans une exigence absurde de son père que soutenait de sa volonté froide Mme Nordement, dont le petit jugement était orgueilleux, inconscient de ses limites, et, par conséquent, sûr de son infaillibilité.
II
Léopold Ourson avait acheté la villa des Clématites, d’une certaine importance, puisqu’elle avait été jadis louée douze mille francs, garage compris et frais de jardinage en sus.
La situation de M. Ourson s’était fortement modifiée pendant la guerre.
On l’avait connu courtier de publicité, puis attaché sans titre bien établi à une maison de robinets en cuivre, puis « démarcheur », c’est-à-dire placeur de titres, au service de banques incertaines. Plusieurs personnes se rappelaient lui avoir prêté des sommes modiques. Mais, depuis 1914, il s’était formidablement débrouillé. Maintenant, le nombre de ses millions variait de dix à quarante, selon l’appétit et le besoin de romanesque de ceux qui évaluaient sa fortune.
Quelles affaires avait-il faites au juste ? On en citait quelques-unes, notamment celle de Salonique.
Lors de la première entrée de nos troupes dans cette ville, l’enthousiasme de la population fut, on peut le dire aujourd’hui, moins unanime que les rapports de presse s’étaient plu à le constater.
Les habitants de Salonique sont, pour la plupart, des commerçants actifs et avisés. Ils s’étaient procuré, à l’intention de nos braves biffins, un stock de pantalons rouges, qu’ils comptaient nous céder à des conditions avantageuses… Ils éprouvèrent un léger dépit quand ils virent arriver tout un corps expéditionnaire en bleu horizon.
Un cousin d’Ourson était sergent-fourrier dans un régiment de zouaves. Il eut, à l’instigation d’un teinturier chimiste qui servait à sa compagnie, une idée fort ingénieuse. On télégraphia à Léopold, qui était mobilisé à Paris comme auxiliaire, de se procurer des fonds. Et l’on acheta à bas prix à un nommé Zafiriotis une bonne partie du stock de pantalons rouges invendables. Le chimiste, fort débrouillard, organisa, dans le pays même, une teinturerie. Une plante indigène, séchée à la vapeur, permit de donner aux pantalons rouges, non pas exactement un bleu horizon parfait, mais une sorte de bleu gris fort acceptable, et que l’intendance finit par accepter, la nécessité aidant.
On racontait encore toutes sortes de légendes, des transformations de couvertures de lit en couvertures de chevaux, de couvertures de chevaux en couvertures de lit, du pinard obtenu en traitant du cidre, de la gnole en maltraitant du houblon. On racontait du vrai et du faux, mais la villa des Clématites était là, en bonne pierre et en brique fine. Et l’on avait été forcé d’agrandir le garage pour y mettre deux luxueuses autos.
Mme Alvar, qui s’occupait de vente de bijoux et de mariages riches, connaissait les Ourson et les Nordement. Elle eut l’idée charmante et généreuse d’unir le fils Nordement à la demoiselle Ourson.
Les Ourson étaient beaucoup plus riches que les Nordement. Mais Léopold Ourson avait eu des hauts et des bas, ou plutôt une série de bas assez continue, suivie d’un haut un peu brusque. La famille Nordement, au moins depuis deux générations, jouissait de l’estime publique.
Aristide Nordement, qui avait succédé à son père dans le commerce des bouchons, était devenu un monsieur important, d’ailleurs sans s’en apercevoir, et sans que personne autour de lui se fût demandé pourquoi ni comment.
Il n’avait rien de brillant : c’est ce qui fit la solidité de sa situation, car il ne fut jamais excité, pour justifier une réputation d’homme d’affaires exceptionnel, à se départir de cette bonne prudence instinctive, qui l’avait toujours empêché de tenter de dangereux coups d’audace. Il n’eut, en somme, dans sa vie, qu’une seule idée prétentieuse : à un moment donné, il s’intitula fabricant de bouchons au lieu de marchand de bouchons, bien qu’en réalité, il achetât ses bouchons à diverses fabriques.
Sa femme, une Gormas, de Bayonne, fille d’un courtier d’assurances, avait plus d’ambition. Elle pensait qu’Aristide serait un jour conseiller du commerce extérieur, et peut-être décoré, grâce à l’appui d’un député, du parlementaire que l’on cultive dans chaque famille bourgeoise.
Ce fut surtout Mme Nordement qui accueillit avec faveur les ouvertures de Mme Alvar.
Irma, fille unique des Ourson, n’était pas très séduisante. Son visage avait à peu près l’expression d’une larve. Quelques cils rares et très peu de sourcils avaient poussé dans les environs de ses mornes yeux.
Depuis deux ans, des professeurs inlassables, Danaïdes à vingt francs l’heure, versaient leur littérature, leurs sciences physiques et leur histoire, dans ce petit tonneau sans fond.
Un thé chez Mme Alvar réunit les Ourson et les Nordement.
M. Nordement était un gros homme rasé, dont la lèvre forte découvrait des dents trop neuves.
Mme Ourson était aussi amorphe que sa fille, avec un peu plus de chair.
Une conversation lente et lourde s’engagea entre les ascendants. On avait essayé d’isoler les jeunes gens, qui s’en allèrent ensemble dans le jardin. Mais, de la terrasse, on eut beau arroser le banc où ils avaient pris place de regards fécondants, il sembla bien que le jeune Nordement n’avait pas trouvé là sa compagne d’élection, et que, cette fragile créature une fois mise entre ses mains, il n’avait eu d’autre idée que de la reposer sur le sol avec d’infinies précautions, pour ne pas avoir l’air de la laisser tomber.
On procéda à une contre-épreuve, plus soigneusement organisée. Une seconde entrevue eut lieu un soir dans la villa somptueuse des Ourson. Peut-être avait-on espéré qu’Irma donnerait mieux aux lumières. En tout cas, c’était à essayer.
Dans l’après-midi, Mme Alvar l’avait emmenée dans un Institut de Beauté.
Jamais l’impuissance de l’artifice ne se manifesta d’une façon aussi indiscutable. L’éclat des fards ne fit qu’accuser sans recours l’indigence de ce visage ingrat.
Mais, à mesure que s’avérait l’impossibilité d’une telle union, le désir cupide de la voir se réaliser grandissait chez Mme Nordement. On s’était renseigné à fond, et ces messieurs avaient même eu, sans avoir l’air d’y toucher, des conversations officieuses très complètes : Léopold Ourson donnait, en titres de premier ordre, quatre millions à la jeune Irma.
Mme Nordement pensait que c’était une folie, un péché même, de manquer une occasion comme celle-là.
Une jeune fille est une jeune fille. Elle se fait toujours. Elle devient ce que son mari veut qu’elle soit. On oubliait volontairement Mme Ourson, dont le simple aspect rabattait sérieusement l’optimisme de ceux qui escomptaient pour son rejeton une mise en valeur possible.
Robert ne disait rien, et feignait obstinément d’ignorer tous les conciliabules où se tramait son bonheur futur. Il savait qu’il n’avait pas beaucoup de volonté, et que la tactique la meilleure pour lui était de ne pas engager le fer. Mais, le lendemain de la soirée chez les Ourson, après le déjeuner, sa mère lui dit, de son petit air de commandement :
— Reste un peu, Robert. Papa et moi nous avons à te parler.
Robert savait que son père ne dirait rien. Sur les questions de ce genre, il laissait la parole à son major-général. Mais la formule : « Papa et moi, nous avons à te parler », indiquait au jeune homme que les hautes autorités dont il dépendait étaient complètement d’accord.
D’autre part, le fait que papa fût rentré déjeuner au Vésinet annonçait que la question était grave.
— Tu sais quels sont nos projets ? dit Mme Nordement.
Il inclina le tête sans rien dire.
— Je pense, ajouta-t-elle, que tu es assez raisonnable pour être d’accord avec tes parents.
Un instinct secret l’avertissait que, s’il sortait de son silence, il était perdu. Il laissa donc aller sa mère, qui parla un peu trop, et ne fut pas très adroite.
Elle concéda que la jeune fille — pour le moment — n’était pas une beauté.
Mais elle alla jusqu’à dire, en termes plus ou moins voilés, que la fidélité des hommes n’était pas obligatoire, et que, chez un mari encore jeune, on excusait certaines peccadilles.
Robert, par malheur, savait très bien que ce n’était pas là les idées de cette dame très collet-monté, très sévère pour les ménages un peu libres. Il lui sembla qu’elle sacrifiait un peu cyniquement, pour les besoins de la cause présente, son rigorisme habituel. Il gardait le silence. Elle y sentit une marque de désapprobation, perdit un peu la tête, et se lança dans des arguments encore plus contestables…
— Je sais, dit-elle, que tu es un garçon désintéressé. Cela tient à ton bon cœur, mais aussi à ton inexpérience de la vie. Tu n’as jamais manqué de rien. Alors tu ne sais pas ce que représente l’argent. Tu t’en rendras compte plus tard. Dieu merci, ton père est à son aise. Mais il n’a pas une fortune colossale. Les affaires peuvent devenir difficiles d’un moment à l’autre. Et si un jour papa a besoin d’un coup de main, il sera très utile pour lui d’être allié avec un homme comme M. Ourson, dont les ressources sont inépuisables.
Robert ne vacilla qu’un instant. Il se voyait déjà sauvant son père au bord de la ruine. Mme Nordement n’avait pas eu une mauvaise idée en faisant appel à son noble esprit de sacrifice. Mais elle gâta son avantage en insistant.
Le jeune homme eut alors l’impression que tout cela était faux, que jamais le prudent M. Nordement ne serait gêné dans ses affaires, et qu’il y avait là un petit chantage, dont il fut un peu écœuré.
Comme il ne se décidait pas à parler, sa maman continua :
— Enfin, on ne te presse pas. On a confiance en toi. Embrasse ta mère.
— Nous en reparlerons demain, dit papa.