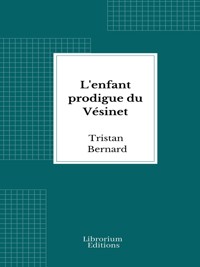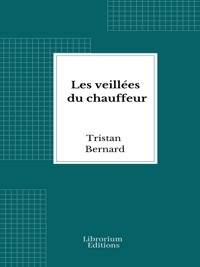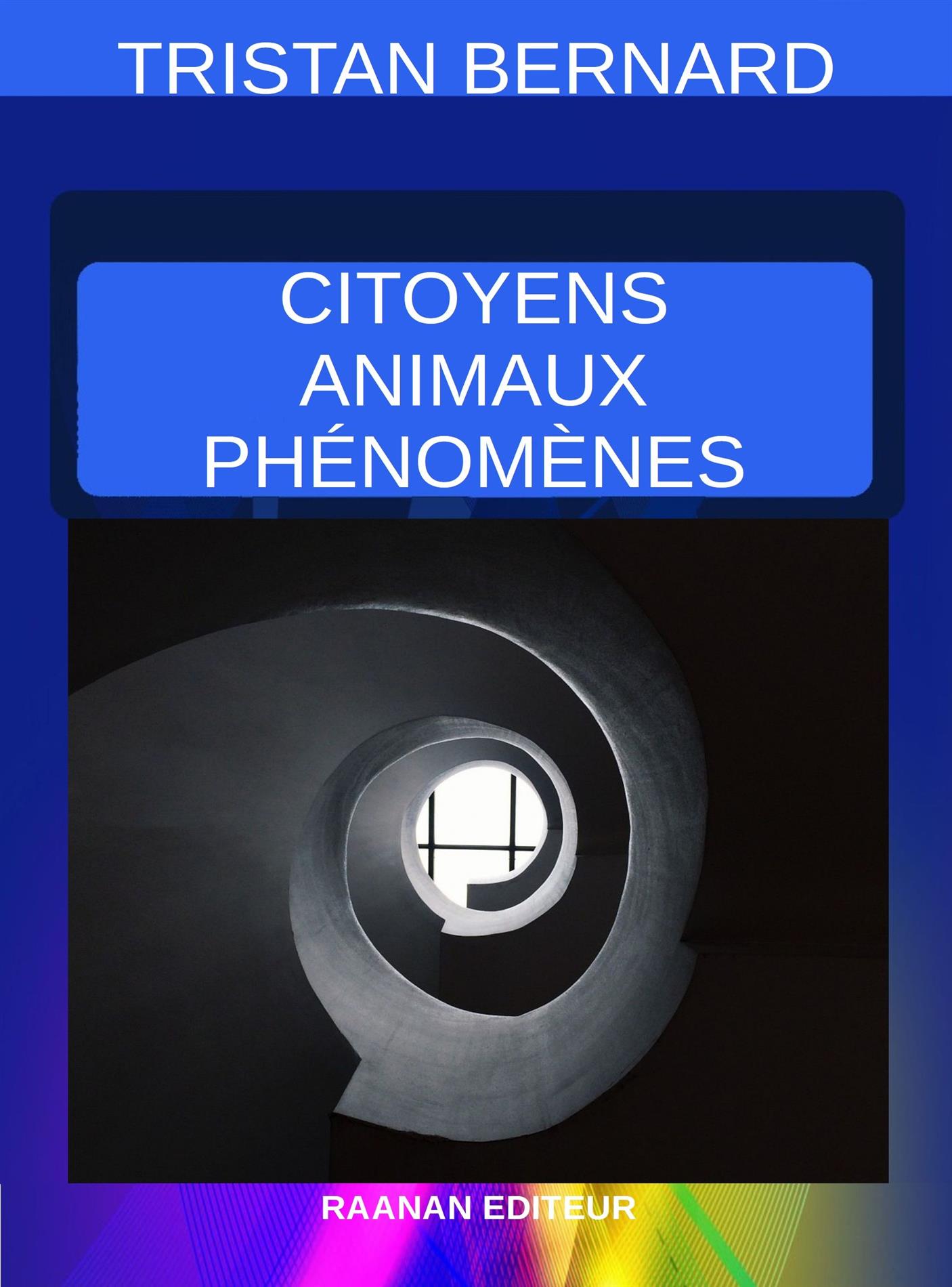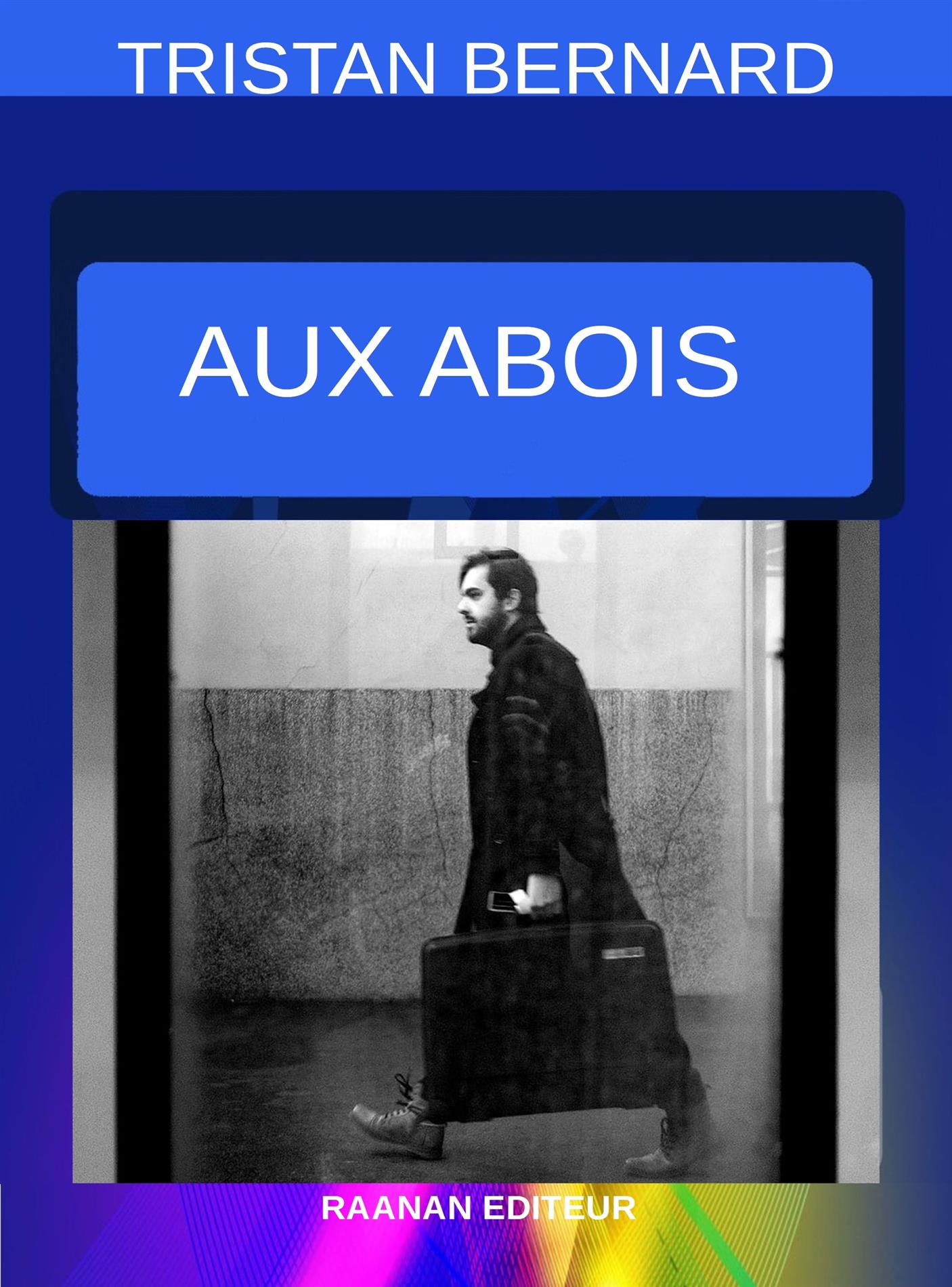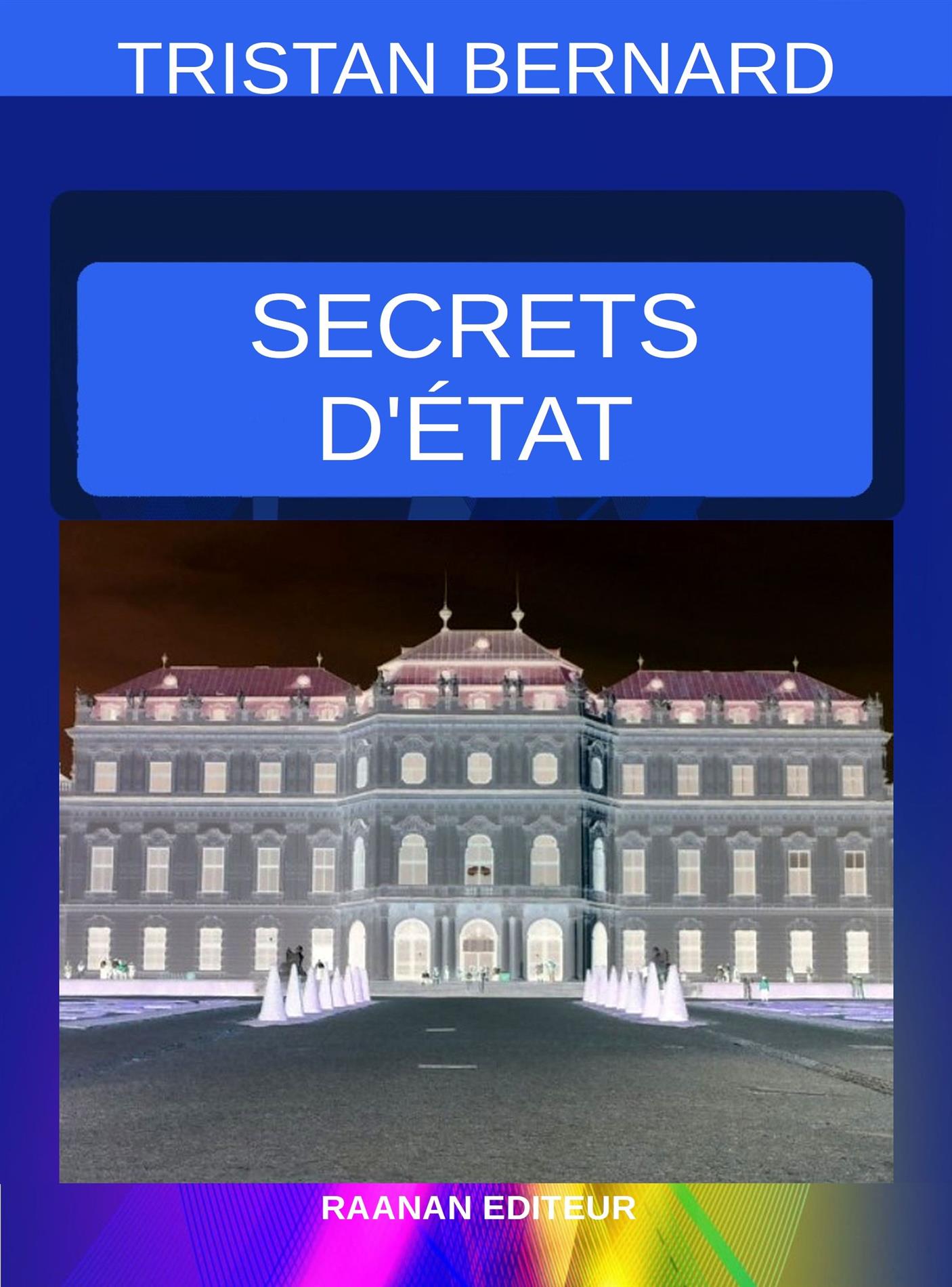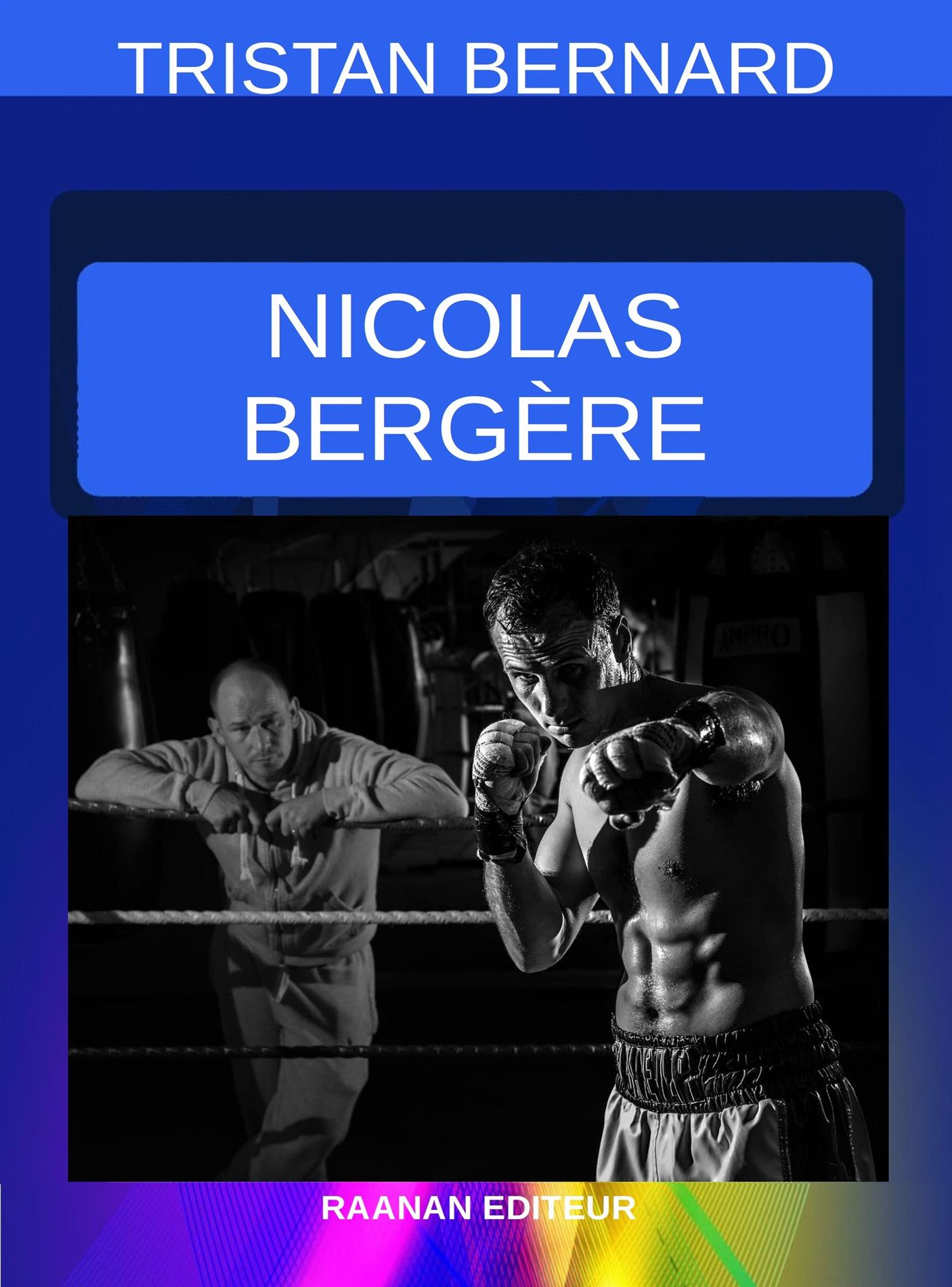0,69 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nous étions, Larcier et moi, sous-officiers aux dragons à Nancy. Je terminais mon service, et Larcier, qui voulait faire sa carrière militaire, était sur le point de rengager. Nous avions passé maréchaux des logis de très bonne heure, et pourtant, dans notre régiment, ce n’était pas facile, car il y avait beaucoup de rengagés; mais il en était parti plusieurs d’un seul coup et nous en avions profité.
Nous n’étions pas très liés avec les autres sous-officiers, qui étaient d’une tout autre génération, je veux dire qu’ils avaient deux ou trois ans de plus que nous, mais ces trois ans étaient trois années de service. C’était considérable.
Quelques-uns d’entre eux ne nous aimaient pas, et avaient fini par nous rendre antipathiques à tous les autres. Cette hostilité qui nous entourait était d’autant plus dangereuse qu’elle ne nous préoccupait pas et que nous ne faisions rien pour l’atténuer. Larcier et moi, nous nous suffisions l’un à l’autre, et nous leur montrions trop clairement que nous n’avions besoin de personne. Comme tous ces sous-officiers n’avaient pas grand chose à faire, quand les classes étaient terminées, et comme peu d’entre eux se préparaient à Saumur, la haine véritable qu’ils nous vouaient était devenue pour eux une espèce de passe-temps, auquel ils eussent difficilement renoncé.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TRISTAN BERNARD
ROMAN © 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385742782
L’affaire Larcier
I
Nous étions, Larcier et moi, sous-officiers aux dragons à Nancy. Je terminais mon service, et Larcier, qui voulait faire sa carrière militaire, était sur le point de rengager. Nous avions passé maréchaux des logis de très bonne heure, et pourtant, dans notre régiment, ce n’était pas facile, car il y avait beaucoup de rengagés; mais il en était parti plusieurs d’un seul coup et nous en avions profité.
Nous n’étions pas très liés avec les autres sous-officiers, qui étaient d’une tout autre génération, je veux dire qu’ils avaient deux ou trois ans de plus que nous, mais ces trois ans étaient trois années de service. C’était considérable.
Quelques-uns d’entre eux ne nous aimaient pas, et avaient fini par nous rendre antipathiques à tous les autres. Cette hostilité qui nous entourait était d’autant plus dangereuse qu’elle ne nous préoccupait pas et que nous ne faisions rien pour l’atténuer. Larcier et moi, nous nous suffisions l’un à l’autre, et nous leur montrions trop clairement que nous n’avions besoin de personne. Comme tous ces sous-officiers n’avaient pas grand chose à faire, quand les classes étaient terminées, et comme peu d’entre eux se préparaient à Saumur, la haine véritable qu’ils nous vouaient était devenue pour eux une espèce de passe-temps, auquel ils eussent difficilement renoncé.
Larcier était du pays, c’est-à-dire que sa famille habitait à dix lieues de là. Il m’emmena un jour chez lui, et je fis la connaissance de sa mère et de ses deux jeunes frères. Son père avait été professeur au lycée de Nancy; il était mort d’une fièvre cérébrale, en leur laissant une petite fortune que gérait un de leurs cousins, un vieux monsieur qui avait été notaire dans les Vosges, et qui habitait maintenant à Toul, dans un faubourg.
A sa majorité, Robert Larcier n’avait pas réclamé son compte de tutelle; il lui semblait préférable d’ajourner ces formalités jusqu’à l’époque de son réengagement. Il continuait à recevoir du vieux monsieur les sommes nécessaires à sa modeste vie de sous-officier.
Une rencontre que nous fîmes dans notre garnison changea assez subitement les conditions de notre existence.
Parmi les réservistes, arrivèrent quelques sous-officiers, dont un de mes camarades de lycée. C’était le fils d’un gros marchand de chevaux de Paris, un garçon très bon vivant et qui ne demandait qu’à «tirer» joyeusement sa période d’exercice. Il avait pris une chambre dans le meilleur hôtel, et tous les soirs il nous réunissait à cinq ou six. On buvait, on jouait au baccara. Il y avait là d’autres jeunes gens de Paris: le fils d’un agent de change, un journaliste, un marchand de bronze... Tous ces jeunes gens avaient de l’argent sur eux et étaient passablement joueurs.
Moi, que le jeu a toujours effrayé, je restais un peu à l’écart. De temps en temps, je hasardais une pièce de cent sous, que je perdais, et j’en avais des remords cuisants.
Le malheureux Larcier, par contre, avait un vrai tempérament de joueur. Il perdit un soir plus de cinq cents francs. Comme il était un peu en avance avec son parent, il n’osa pas les lui demander; il n’osa pas non plus les demander à sa mère. Heureusement que je pus les lui prêter. Mes parents, qui habitaient Chalon-sur-Saône, m’envoyèrent cette somme par mandat.
L’histoire fut propagée avec une certaine perfidie par un sous-officier de l’active, à qui un réserviste l’avait racontée. Le capitaine de Halban, qui commandait notre escadron, fit venir Larcier au bureau et l’attrapa dans les grands prix, à la satisfaction sournoise du chef Audibert, qui détestait particulièrement Larcier. Celui-ci fut très affecté de ces remontrances, qui firent naître en lui un sentiment de révolte. D’ordinaire, c’était un garçon soumis. Mais il faut croire que sa perte au jeu l’avait aigri. Il parla du capitaine avec une vive irritation, et, pour la première fois, s’exaspéra de l’attitude des sous-officiers, qui, jusque-là, l’avait laissé si indifférent.
A la fin, il se dit: «J’aurai payé cette leçon cinq cents francs et je ne jouerai plus. Voilà tout! Je m’arrêterai là et ce ne sera pas cher.»
Le soir, nous traînions dans les rues de la ville. Comme je ne lui proposais pas de retourner à l’hôtel où était installé mon ami de Paris, il se décida à me dire hypocritement:
—Ce n’est peut-être pas gentil de ne pas aller les revoir, sous prétexte que j’ai perdu.
Je cédai, par faiblesse. Nous arrivâmes dans la chambre des réservistes. Le baccara était déjà commencé. Il les regarda d’un air dégagé.
On lui demanda pourquoi il ne jouait pas. Il répondit avec une franchise un peu forcée qu’il avait déjà beaucoup trop perdu, qu’il n’avait pas les moyens de jouer ce jeu-là.
—D’ailleurs, ajouta-t-il, je n’ai pas sur moi de quoi payer. Même si je fais une différence peu importante, de mille ou deux mille francs, je ne pourrai pas la régler dans les vingt-quatre heures, car il me faudra plus d’un jour pour les obtenir de mon vieux parent... J’aime mieux, dit-il encore, mais sans grande conviction, ne pas me mettre tous ces soucis en tête.
On insista:
—Vous n’aurez pas besoin de nous payer tout de suite, nous sommes ici pour une période de vingt-huit jours, encore trois semaines à tirer... Vous voyez que nous sommes de revue!
Il me prit à part, et me dit:
—Ecoute, Ferrat. Je vais jouer simplement pour rattraper les cinq cents francs que tu m’as prêtés...
—Mon vieux, je t’en supplie! Ces cinq cents francs, je n’en ai pas besoin. Tu me les rendras dans un an ou deux ans... Je ne veux pas que tu te remettes à jouer à cause de moi. Tu vas t’enfoncer davantage!...
—Mais non, vieux, j’ai eu une déveine inouïe hier soir, je ne l’aurai pas ce soir... Ce n’est pas possible... Je suis en veine, je sens que je suis en veine... J’ai l’impression que je vais gagner tout ce que je voudrai...
Il n’y avait qu’à le laisser faire... C’était fini... Cette passion l’avait repris. Il n’écouterait plus aucune remontrance.
Il s’assit à la table de jeu, et, quand nous rentrâmes au quartier, à trois heures du matin, il avait perdu près de cinq mille francs...
Nous marchions en silence dans la cour du quartier. Il ne pouvait se décider à monter dans sa chambre.
—Tu penses bien, me dit-il, que je ne veux pas profiter du délai que ces gens-là m’ont accordé; d’autant que, lorsque nous avons eu fini de jouer, ils ne m’ont pas répété ce qu’ils m’avaient dit avant le jeu: que j’avais le temps de les payer, que nous étions entre camarades... Ce ne sont pas de mauvais garçons, ajouta-t-il, mais je sens bien qu’ils n’ont pas voulu, en me disant de ne pas me presser, risquer de retarder la rentrée de leur argent... Oh! j’ai senti cela!...
C’était aussi mon avis. J’aurais voulu qu’au moment où l’on s’était quitté, l’un des gagnants dît à ce malheureux Larcier quelques paroles bienveillantes, mais tous semblaient avoir les lèvres vissées.
Pour ne pas l’affoler, je lui cachai mon impression, je lui dis au contraire qu’ils m’avaient paru, à moi, bien désireux de ne lui causer aucun désagrément...
—Non, non, répéta-t-il, je ne peux pas les faire attendre. Il est quatre heures; je vais tâcher de dormir quelques heures, puis j’irai trouver le vieux, aujourd’hui même, à Toul. Il faudra bien qu’il me donne de l’argent. L’important pour moi, c’est que maman ne soit au courant de rien. Ça lui ferait trop de peine...
—Alors, tu vas demander une permission pour aller à Toul?
—Non, je ne demanderai pas de permission. Il faudrait donner des explications au capiston, lui dire pourquoi je vais là-bas, lui faire ma confession. Après l’algarade de l’autre jour, je ne veux pas... Et je n’ai pas la tête à trouver une blague...
Je ne le reconnaissais plus. Il parlait comme un homme désorbité. Le jeu l’avait complètement changé. C’était auparavant un garçon si régulier, si ordonné et si strict sur les questions de discipline! Un être ardent qui vivait en lui, sans qu’il s’en doutât, était sorti soudain... Jusqu’à sa manière de parler s’était modifiée. Il était plus décidé qu’avant, plus obstiné...
Quelle impression douloureuse de voir se transformer ainsi, d’une façon imprévue, un homme que l’on aime d’amitié, que l’on croit si bien connaître! Nos idées, nos sentiments en sont brusqués...
J’allai le conduire à la gare vers trois heures; le matin il y avait eu une revue, et il n’avait pas pu quitter le quartier. Il arriverait à Toul pour dîner. En somme, avec la complaisance de l’adjudant de semaine, il pouvait très bien ne rentrer que le lendemain matin, vers onze heures, pour le dressage des chevaux. D’ici là, certainement personne ne demanderait après lui. Si l’officier de semaine le cherchait pour le pansage du soir ou pour celui du lendemain matin, on en serait quitte pour inventer quelque histoire; qu’il avait été souffrant et qu’il était monté dans sa chambre... Quand un sous-officier invoque une excuse de ce genre, on ne lui fait pas l’injure de ne pas le croire et l’on n’exige pas qu’il aille à la visite du médecin.
II
Il était donc facile de cacher jusqu’au lendemain l’absence de Larcier. Pourtant je n’étais pas tranquille en le conduisant à la gare... Lui ne pensait qu’à l’explication fâcheuse qu’il aurait avec son parent.
—L’oncle Bonnel—je l’appelle oncle bien qu’il ne soit que mon cousin—l’oncle Bonnel est un vieil original, très ferme et très autoritaire. Jamais je n’oserai lui dire tout de suite que j’ai perdu de l’argent au jeu. Soi-disant, je viendrai lui réclamer mon compte de tutelle, qui devrait être réglé depuis plusieurs mois... J’ai près de vingt-deux ans, tu sais, je suis entré au service à dix-neuf ans.
—Mais comment se fait-il qu’il n’ait pas encore réglé les comptes en question?