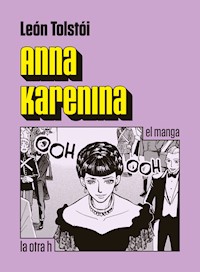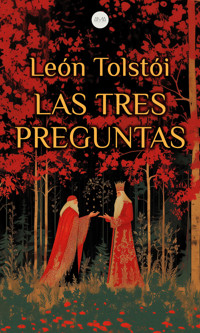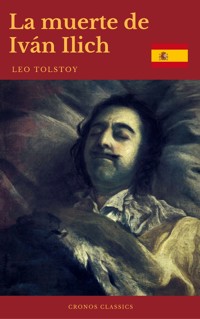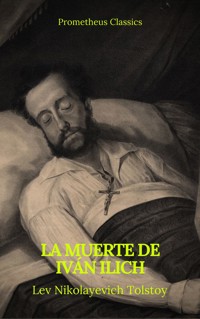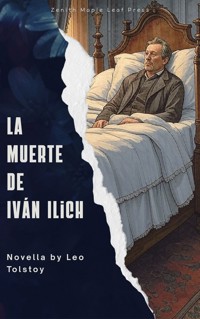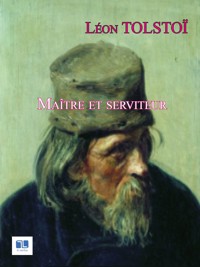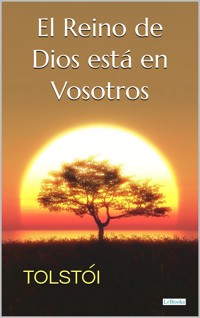Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pretorian Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Plongez dans un monde épique où les destins personnels et l'histoire s'entrechoquent. "Guerre et Paix" est un chef-d'œuvre à l'équilibre complexe entre les champs de tension de la guerre et de l'amour. Avec la Russie napoléonienne en toile de fond, cette œuvre monumentale relie les destins de personnages inoubliables, tous confrontés à leurs propres désirs, rêves et destins. Suivez l'énigmatique Pierre Bezoukhov, l'envoûtante Natacha Rostova et le stoïque prince André Bolkonski, alors qu'ils sont poussés par l'amour et l'ambition au milieu du chaos de la guerre. Le brillant récit de Tolstoï dresse un portrait vivant de la Russie du XIXe siècle, vous invitant à découvrir la splendeur des bals mondains, la brutalité des champs de bataille et les abîmes de l'âme humaine. Avec sa prose luxuriante et ses profondes intuitions, Guerre et Paix est plus qu'un simple roman ; c'est une exploration de la condition humaine elle-même. Que vous soyez un amateur de littérature chevronné ou que vous commenciez tout juste votre voyage littéraire, "Guerre et Paix" est un classique intemporel qui a sa place dans toute bibliothèque. Plongez dans ses pages et vivez les hauts et les bas de la vie dans toute sa splendeur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2866
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
DEUXIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
TROISIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
QUATRIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
CINQUIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
SIXIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
SEPTIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
HUITIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
NEUVIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
DIXIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVIII
Chapitre XXXIX
ONZIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
DOUZIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
TREIZIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
QUATORZIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
QUINZIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
ÉPILOGUE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
ÉPILOGUE DEUXIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
APPENDICE
Chapitre I
Chapitre II
Mention légale
Titre : Guerre et Paix
Auteur : Léon Tolstoï
Éditeur : Pretorian Media GmbH, Ul. Yanaki Bogdanov 11, BG-9010 Varna
Date : 2023
PREMIÈRE PARTIE[footnote 1]
Chapitre I
— Eh bien ! Maintenant, Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des domaines de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antéchrist, (ma parole, j’y crois), je ne vous connais plus, vous n’êtes plus mon ami, vous n’êtes plus mon fidèle esclave, comme vous dites. Eh bien ! Bonjour, bonjour ! Je vois que je vous fais peur, asseyez-vous et causons.
Ainsi parlait, en juillet 1805, Anna Pavlovna Schérer, demoiselle d’honneur et personne très proche de l’Impératrice Maria Fedorovna, en allant à la rencontre d’un personnage très grave, écrasé de titres, du prince Vassili, arrivé le premier à sa soirée. Anna Pavlovna toussait depuis quelques jours, c’était une grippe, comme elle disait (grippe était alors un mot nouveau très rarement employé). Les billets doux, qu’elle avait envoyés le matin par un laquais en livrée rouge, portaient tous sans distinction :
« Si vous n’avez rien de mieux à faire, monsieur le Comte (ou mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre sept et dix heures.
» Annette Schérer. »
— Dieu, quelle virulente sortie ! — répondit, nullement gêné par cet accueil, le prince qui entrait en uniforme de Cour brodé, en bas de soie et en souliers à boucle, plein de décorations, et avec une expression souriante sur son visage plat.
Il s’exprimait en un français précieux, que non seulement nos aïeux parlaient mais dans lequel ils pensaient, et avec ces intonations douces, protectrices, qui sont propres à un homme important vieilli dans le monde et à la Cour. Il s’approcha d’Anna Pavlovna, baisa sa main en lui tendant son crâne parfumé et luisant, et, tranquillement, s’assit sur le divan :
— Avant tout, dites-moi comment vous allez, chère amie ? Rassurez l’ami — dit-il sans changer de voix et d’un ton dans lequel, derrière les convenances et la sympathie, perçait l’indifférence et même la moquerie.
— Comment peut-on se bien porter quand le moral souffre ?… Peut-on rester calme, en notre temps, quand on a du cœur ? — répondit Anna Pavlovna. — J’espère que vous êtes chez moi pour toute la soirée ?
— Et la fête de l’Ambassadeur d’Angleterre ? C’est aujourd’hui mercredi. Je dois y paraître — dit le prince, — ma fille passera me prendre ici.
— Je pensais que la fête d’aujourd’hui était ajournée. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d’artifice commencent à devenir insipides.
— Si l’on avait su que vous le désiriez, on eût ajourné cette fête — fit le prince, qui par habitude, comme une montre remontée, disait des choses auxquelles il ne voulait même pas qu’on crût.
— Ne me tourmentez pas. Eh bien ! Qu’a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff ? Vous savez tout.
— Comment vous dire ? — répondit le prince d’un ton froid, ennuyé. — Qu’a-t-on décidé ? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres.
Le prince Vassili parlait toujours paresseusement, comme un acteur qui récite le rôle d’une vieille pièce. Anna Pavlovna Schérer, au contraire, malgré ses quarante ans, était pleine d’animation et d’enthousiasme.
Être enthousiaste était devenu sa position sociale, et parfois, même quand elle ne le voulait pas, pour ne pas tromper l’attente de ceux qui la connaissaient, elle devenait enthousiaste. Le sourire contenu qui était toujours sur le visage d’Anna Pavlovna, bien que ne s’harmonisant pas avec ses traits fanés, exprimait, comme chez les enfants gâtés, la conscience absolue de son charmant défaut, dont elle ne voulait pas, ne pouvait pas, et ne trouvait pas nécessaire de se corriger.
Au milieu d’une conversation sur la politique, Anna Pavlovna s’échauffait.
— Ah ! ne me parlez pas de l’Autriche ! Je ne comprends peut-être rien, mais l’Autriche ne voulut jamais la guerre, et ne la veut pas. Elle nous trahit. La Russie seule doit sauver l’Europe. Notre bienfaiteur connaît sa haute destinée et il lui sera fidèle. Voilà, c’est la seule chose en quoi j’ai foi. À notre bon et admirable empereur, revient le plus grand rôle au monde, et il est si vertueux et si bon que Dieu ne l’abandonnera pas et qu’il remplira sa destinée : il écrasera l’hydre de la révolte, qui maintenant est encore terrible dans la personne de cet assassin, de ce malfaiteur. Nous seuls devons racheter le sang du juste… Sur qui pouvons-nous compter, je vous le demande ? L’Angleterre avec son esprit commercial ne comprendra pas et ne pourra pas comprendre toute l’élévation d’âme d’Alexandre. Elle a refusé d’évacuer Malte. Elle veut voir, elle cherche partout l’arrière-pensée de nos actes. Qu’ont-ils dit à Novosilzoff ? Rien. Ils n’ont pas compris, ils ne peuvent comprendre le sacrifice de notre empereur qui ne veut rien pour lui et veut tout pour le bien du monde. Et qu’ont-ils promis ? Rien. Et même ils ne tiendront pas ce qu’ils ont promis ! La Prusse a déjà déclaré que Bonaparte est invincible et que toute l’Europe ne peut rien faire contre lui… Et je ne crois pas une seule parole ni d’Hardenberg, ni de Haugwitz. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n’est qu’un piège. Je ne crois qu’en Dieu seul et en la haute destinée de notre charmant Empereur. Il sauvera l’Europe !… — Elle s’arrêta d’un coup avec un sourire moqueur pour sa propre ardeur.
— Je pense — dit le prince en souriant — que si l’on vous avait envoyé au lieu de notre aimable Wintzingerode, vous eussiez emporté d’assaut le consentement du roi de Prusse. Vous êtes si éloquente. Mais, me donnerez-vous du thé ?
— Tout de suite. À propos, — ajouta-t-elle en se calmant de nouveau — j’ai chez moi aujourd’hui deux hommes très intéressants : le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans, c’est une des meilleures familles de France. C’est un des bons émigrants, des vrais. Et puis l’abbé Morio : vous connaissez cet esprit profond ? Il a été reçu par l’Empereur. Vous le savez ?
— Ah ! je serai très heureux — dit le prince. — Dites-moi, je vous prie — ajouta-t-il très négligemment, comme s’il venait de se rappeler quelque chose, tandis que ce qu’il demandait était le but principal de sa visite, — est-ce vrai que l’Impératrice mère désire la nomination du baron Funke comme premier secrétaire à Vienne ? C’est un pauvre sire, ce baron, à ce qu’il paraît.
Le prince Vassili voulait faire obtenir à son fils ce poste qu’on s’efforçait de donner au baron par l’intermédiaire de l’impératrice Maria Feodorovna.
Anna Pavlovna ferma presque les yeux en signe que ni elle, ni personne ne pouvait critiquer ce qui plaisait ou déplaisait à l’impératrice.
— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l’impératrice mère par sa sœur — se borna-t-elle à dire d’un ton triste et sec. Quand Anna Pavlovna nomma l’impératrice, son visage prit tout à coup l’expression profonde et sincère du dévouement et de l’estime, mélangée de douleur, ce qui lui arrivait chaque fois qu’en causant elle mentionnait sa haute protectrice. Elle dit que sa majesté avait voulu montrer au baron de Funke beaucoup d’estime, et de nouveau son regard s’assombrit de tristesse.
Le prince se tut, indifférent. Anna Pavlovna, avec son habileté de femme et de femme de la cour, et avec la rapidité du tact, voulut en même temps et punir le prince de ce qu’il avait osé parler sur ce ton de la personne recommandée à l’impératrice, et le consoler.
— Mais à propos de votre famille, — dit-elle, — savez-vous que votre fille, depuis son entrée dans la société, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle comme le jour.
Le prince s’inclina en signe de respect et de reconnaissance.
— Je pense, — continua Anna Pavlovna, après un silence d’un moment, en s’approchant du prince et en lui souriant tendrement, et en montrant par là que la conversation politique était terminée et que maintenant commençait la conversation intime, — je pense souvent avec quelle injustice se partage le bonheur de la vie. Pourquoi la fortune vous a-t-elle donné deux si beaux enfants (sauf votre Anatole, votre cadet, je ne l’aime pas, — ajouta-t-elle d’un ton décisif, et en soulevant les sourcils), de si charmants enfants ! Et vraiment, vous les appréciez moins que nous tous, et parce que vous ne les valez pas.
Et elle sourit de son sourire enthousiaste.
— Que voulez-vous ? Lavater aurait dit que je n’ai pas la bosse de la paternité, — dit le prince.
— Cessez de plaisanter. Je voudrais causer sérieusement avec vous. Savez-vous que je suis mécontente de votre fils cadet ? Entre nous soit dit (sa physionomie reprit une expression triste) on a parlé de lui chez Sa Majesté et on vous a plaint…
Le prince ne répondit pas, mais elle, en silence, le regardait avec importance, attendant la réponse. Le prince Vassili fronça un peu les sourcils.
— Que voulez-vous que j’y fasse ? — dit-il enfin. — Vous savez que j’ai fait pour leur éducation tout ce que peut faire un père, et tous deux sont des imbéciles. Hippolyte au moins est un sot tranquille, et Anatole un sot turbulent. Voilà, c’est la seule différence entre eux deux, — fit-il avec un sourire encore plus imprévu et une animation encore plus étrange, tandis qu’en même temps, dans les plis entourant sa bouche, se montrait très nettement quelque chose de grossier et de désagréable.
— Et pourquoi des hommes comme vous, ont-ils des enfants ? Si vous n’étiez pas père, je ne pourrais rien vous reprocher, — dit Anna Pavlovna, en levant pensivement les yeux.
— Je suis votre fidèle esclave, et à vous seule, je puis l’avouer. Mes enfants, ce sont les entraves de mon existence. C’est ma croix. Je m’explique cela ainsi. Que voulez-vous ?… — Il se tut, en exprimant d’un geste sa soumission à la cruelle fortune. Anna Pavlovna devint pensive.
— Vous n’avez jamais pensé à marier votre fils prodigue, votre Anatole ? On dit — ajouta-t-elle, — que les vieilles filles ont la manie des mariages. Je ne sens pas encore en moi cette faiblesse, mais j’ai en vue une petite personne qui est très malheureuse avec son père, une parente à nous, une princesse Bolkonskaia. — Le prince Vassili ne répondit pas, bien qu’avec la rapidité de calcul et de mémoire particulière aux hommes du monde il montrât par un mouvement de tête qu’il avait pris en considération ce renseignement.
— Non, vous savez que cet Anatole me coûte quarante mille roubles par an, — dit-il, n’ayant plus évidemment la force de retenir le cours de ses pensées tristes. — Il se tut.
— Que sera-ce dans cinq ans, si cela marche ainsi ? Voilà l’avantage d’être père. Elle est riche, votre princesse ?
— Le père est très riche et très avare. Il vit à la campagne. Vous savez, c’est le fameux prince Bolkonskï, révoqué du temps de l’empereur défunt, et surnommé le roi de Prusse. C’est un homme très intelligent, mais avec des bizarreries, et d’un commerce difficile. La pauvre petite est malheureuse comme les pierres. Elle a un frère, celui qui s’est marié récemment avec Lise Meïnen. Il est aide de camp de Koutouzov. Il sera chez moi aujourd’hui.
— Écoutez, chère Annette, — dit le prince en prenant tout à coup la main de son interlocutrice et la baisant. — Arrangez-moi cette affaire et je suis votre plus fidèle esclave à tout jamais. Elle est d’une bonne famille et riche. C’est tout ce qu’il me faut.
Et, avec les mouvements aisés, familiers, gracieux, qui le distinguaient, il prit la main de la demoiselle d’honneur, la baisa en l’agitant, puis s’enfonça dans son fauteuil et regarda de côté.
— Attendez, — dit Anna Pavlovna, en réfléchissant. — Aujourd’hui-même je parlerai à Lise (la femme du jeune Bolkonskï). Et peut-être tout cela s’arrangera-t-il. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille.
Chapitre II
Le salon d’Anna Pavlovna commençait peu à peu à s’emplir. La haute société de Pétersbourg arrivait, c’est-à-dire des personnes les plus diverses par l’âge et le caractère, mais tout à fait du même milieu. C’étaient : la fille du prince Vassili, la belle Hélène, qui venait chercher son père pour aller avec lui à la fête de l’ambassadeur ; — elle était en robe de bal avec le chiffre des demoiselles d’honneur ; — puis la jeune petite princesse Bolkonskaia, connue comme la femme la plus séduisante de Pétersbourg, mariée l’hiver dernier ; — maintenant, à cause de sa grossesse, elle ne pouvait sortir dans les grandes réceptions et ne fréquentait que les petites soirées ; et aussi le prince Hippolyte, fils du prince Vassili, avec Mortemart qu’il présentait, et encore l’abbé Morio et beaucoup d’autres.
— Vous n’avez pas encore vu, ou vous ne connaissez pas encore ma tante ? — disait Anna Pavlovna aux invités qui arrivaient, et, très gravement, elle les menait devant une petite vieille en toilette chargée de rubans qui émergea de l’autre chambre dès que les invités commencèrent à se réunir.
Anna Pavlovna les présentait en les nommant et en levant lentement ses yeux de l’invité à ma tante. Ensuite elle s’éloigna. Tous les invités firent les saluts d’usage à la tante inconnue de tous, à qui personne ne s’intéressait et dont personne n’avait besoin. Anna Pavlovna, d’un air solennel et triste, suivait leurs salamalecs en les approuvant silencieusement. Ma tante, dans les mêmes termes, parlait à chacun de sa santé, de sa santé à elle et de la santé de Sa Majesté qui, aujourd’hui, grâce à Dieu, allait mieux. Tous ceux qui s’approchaient de la vieille, par convenance, s’éloignaient d’elle sans se hâter, avec le sentiment d’avoir accompli un pénible devoir, et ensuite pour ne pas revenir près d’elle de toute la soirée.
La jeune princesse Bolkonskaia avait apporté son ouvrage dans un petit sac de velours brodé d’or. Sa lèvre supérieure, très jolie, avec un léger duvet à peine brun, était courte en comparaison des dents, mais elle s’ouvrait d’autant plus charmante, et plus charmante elle s’allongeait sur la lèvre inférieure. Comme il arrive toujours chez les femmes tout à fait attrayantes, son défaut — sa lèvre trop courte et sa bouche demi ouverte — semblait être sa beauté particulière, spéciale à elle.
C’était un plaisir pour tous de regarder cette belle future maman, pleine de santé et de vivacité et qui supportait si facilement son état. Les vieillards et les jeunes gens ennuyés qui la regardaient semblaient devenir comme elle quand ils étaient dans sa compagnie et lui parlaient quelque temps ; qui causait avec elle et voyait à chacune de ses paroles le sourire clair et les dents blanches et brillantes qu’on apercevait sans cesse, se croyait aujourd’hui particulièrement aimable. Et chacun pensait cela.
La petite princesse, en se dandinant, à petits pas rapides, fit le tour de la table avec son sac à ouvrage à la main et, en rajustant sa robe, elle s’assit sur le divan, près du samovar d’argent, comme si tout ce qu’elle faisait était une partie de plaisir pour elle et pour tous ceux qui l’entouraient :
— J’ai apporté mon ouvrage, — dit-elle en ouvrant son sac et en s’adressant à tous à la fois. — Prenez garde, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour, — dit-elle, s’adressant à la maîtresse de la maison. — Vous m’avez écrit que c’était une toute petite soirée ; voyez comme je suis attifée !
Et elle étendit les bras pour montrer sa robe grise, élégante, garnie de dentelles, ceinte au-dessous de la poitrine par un large ruban.
— Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie, — répondit Anna Pavlovna
— Vous savez, mon mari m’abandonne, — reprit-elle du même ton, en s’adressant au général, — il va se faire tuer. Dites-moi pourquoi cette vilaine guerre ? — continua-t-elle en s’adressant au prince Vassili ; et, sans attendre sa réponse, elle parla à la fille du prince Vassili, à la belle Hélène.
— Quelle délicieuse personne que cette petite princesse ! — fit doucement le prince Vassili à Anna Pavlovna.
Peu après la petite princesse, entrait un gros jeune homme, massif, la tête rasée, en lunettes, avec des pantalons clairs à la mode de cette époque, un haut jabot et un frac marron. Ce gros jeune homme était le fils naturel d’un seigneur célèbre du temps de Catherine II, le comte Bezoukhov, qui, en ce moment, se mourait à Moscou. Il n’avait encore servi nulle part, il venait d’arriver de l’étranger, où il avait été élevé, et pour la première fois il venait en soirée. Anna Pavlovna l’accueillit d’un salut qui était réservé aux hommes du dernier rang hiérarchique de son salon. Mais, malgré ce salut s’adressant à un inférieur, en voyant entrer Pierre, la physionomie d’Anna Pavlovna exprima l’inquiétude et la crainte qu’on ressent en voyant une chose par trop énorme et qui n’est pas à sa place. Pierre était en effet un peu plus grand que les autres messieurs qui se trouvaient là : mais cette peur ne se rapportait qu’au regard intelligent et en même temps timide, observateur et franc, qui le distinguait de tous les autres invités.
— C’est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d’être venu voir une pauvre malade, — lui dit Anna Pavlovna, en jetant un regard effaré sur sa tante, près de qui elle l’emmenait. Pierre murmura quelque chose d’incompréhensible et continua à chercher quelqu’un des yeux. Il sourit joyeusement en saluant la petite princesse comme une proche connaissance, et s’approcha de la tante. La crainte d’Anna Pavlovna n’était pas vaine, parce que Pierre n’écouta pas jusqu’au bout la phrase de la tante sur la santé de Sa Majesté et s’éloigna d’elle. Anna Pavlovna, effrayée, l’arrêta par ces paroles :
— Vous ne connaissez pas l’abbé Morio ? C’est un homme très intéressant…
— Oui, j’ai entendu parler de ses projets de paix éternelle ; c’est très intéressant, mais est-ce possible…
— Vous croyez ?… — fit Anna Pavlovna, pour dire quelque chose et retourner ensuite à ses devoirs de maîtresse de maison ; mais Pierre fit une impolitesse à l’envers. Avant, sans écouter jusqu’à la fin les paroles de son interlocutrice, il s’en était allé, et maintenant, il arrêtait par sa conversation l’interlocutrice qui devait s’éloigner de lui. La tête baissée, écartant ses longues jambes, il commençait à prouver à Anna Pavlovna pourquoi il tenait les plans de l’abbé pour une chimère.
— Nous parlerons après, — dit Anna Pavlovna en souriant ; et, se débarrassant du jeune homme qui n’avait aucun usage du monde, elle revint à ses occupations de maîtresse de maison et continua à écouter et à regarder, prête à venir à la rescousse au moment où la conversation tomberait. Comme un maître d’atelier de fuseaux qui, ayant installé les ouvriers à leurs places, se promène par l’atelier et remarquant l’immobilité ou le bruit inaccoutumé, trop fort, des fuseaux, court en tête, arrête et réinstalle la vraie marche, de même Anna Pavlovna, en marchant dans son salon, s’approchait tantôt d’un groupe silencieux, tantôt d’un groupe qui parlait trop, et par un mot, par un déplacement de personnes, remontait la machine à conversation qui continuait à tourner d’un mouvement régulier et convenable. Mais, dans ces soins, on voyait qu’elle redoutait surtout quelque chose de la part de Pierre. Elle le regardait attentivement lorsqu’il s’approchait, écoutait ce qu’on disait autour de Mortemart, et se dirigeait vers l’autre groupe où était l’abbé. Pour Pierre, élevé à l’étranger, cette soirée d’Anna Pavlovna était la première qu’il vit en Russie. Il savait que là était réunie l’élite de Saint-Pétersbourg, et ses yeux, comme ceux d’un enfant dans une boutique de jouets, allaient de tous côtés. Il avait peur de perdre la conversation intelligente qu’il pourrait entendre. En observant les expressions sûres et élégantes des visages de ceux qui étaient réunis ici, il attendait constamment quelque chose d’extraordinairement spirituel. Enfin il s’approcha de Morio. La conversation lui sembla intéressante ; il s’arrêta, attendant l’occasion d’exprimer ses pensées, comme aiment à le faire les jeunes gens.
Chapitre III
III
La soirée d’Anna Pavlovna était lancée. Les fuseaux travaillaient régulièrement de divers côtés et faisaient un bruit ininterrompu. Outre ma tante, près de qui était une dame âgée, au visage fané et maigre, un peu déplacée dans ce cercle brillant, les invités formaient trois groupes. Dans l’un, où il y avait plus d’hommes, l’abbé était le centre. Dans l’autre, jeune, c’étaient la belle princesse Hélène, fille du prince Vassili, et la jolie et fraîche, un peu trop replète pour son âge, petite princesse Bolkonskaia. Dans le troisième, Mortemart et Anna Pavlovna.
Le vicomte était un homme jeune, gracieux, aux traits et aux manières agréables, qui, visiblement, se considérait comme une célébrité, mais, par bonne éducation, permettait modestement à la société dans laquelle il se trouvait de profiter de lui. Apparemment, Anna Pavlovna régalait ses hôtes par lui. Comme un bon maître d’hôtel qui sert comme quelque chose de fin, d’extraordinaire, ce même morceau de viande qu’on ne voudrait pas manger si on le voyait dans la cuisine sale, de même, à cette soirée, Anna Pavlovna servait à ses hôtes, d’abord le vicomte, puis l’abbé, comme quelque chose de fin, d’extraordinaire. Dans le groupe de Mortemart, on parlait de l’assassinat du duc d’Enghien. Le vicomte disait que le duc d’Enghien avait péri à cause de sa magnanimité et qu’il y avait une cause spéciale à la colère de Bonaparte.
— Ah ! voyons. Contez-nous cela, vicomte, — dit Anna Pavlovna avec joie, et trouvant que dans cette phrase résonnait quelque chose à la Louis XV. — Contez-nous cela, vicomte.
Le vicomte s’inclina en signe d’obéissance et sourit poliment. Anna Pavlovna fit faire cercle autour du vicomte et invita tout le monde à écouter son récit.
— Le vicomte a été personnellement connu de Monseigneur, — chuchota à l’un Anna Pavlovna. — Le vicomte est un parfait conteur, — dit-elle à un autre. — Comme on voit l’homme de la bonne compagnie, — fit-elle à un troisième ; et le vicomte était servi à la société, sous l’aspect le plus élégant et le plus avantageux pour lui, comme un rosbif sur un plat chaud orné de verdure.
Le vicomte s’apprêtait à commencer son récit et souriait finement.
— Venez ici, chère Hélène, — dit Anna Pavlovna à la belle princesse, qui, assise plus loin, faisait le centre de l’autre groupe.
La princesse Hélène souriait ; elle se leva avec le même sourire invariable d’une femme tout à fait belle, qu’elle avait en entrant au salon. Avec le léger bruit de sa robe de bal, blanche ornée de peluche, et éblouissante par la blancheur de ses épaules, la splendeur de ses cheveux et de ses diamants, elle passa, parmi les hommes qui lui cédèrent la place, droite, ne regardant personne, mais souriant à tous, et comme en donnant aimablement à chacun le droit d’admirer la beauté de sa stature, de ses épaules rondes, de son dos, de sa poitrine très décolletée, selon la mode de cette époque, et portant en elle l’éclat des bals, elle s’approcha d’Anna Pavlovna. Hélène était si belle, que non seulement il n’y avait pas en elle l’ombre de coquetterie, mais qu’au contraire, elle semblait avoir honte de sa beauté indiscutable qui agissait trop fort et trop victorieusement ; elle semblait désirer, sans pouvoir y arriver, diminuer l’effet de sa beauté !
— Quelle belle personne ! — disaient tous ceux qui la voyaient. Comme frappé de quelque chose d’extraordinaire, le vicomte secoua les épaules et baissa les yeux pendant qu’elle s’asseyait devant lui et l’éclairait de son même sourire invariable.
— Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire, — dit-il avec un sourire et en inclinant la tête.
La princesse appuya son bras nu, gras, et ne trouva pas nécessaire de dire un mot. Elle attendait en souriant. Pendant tout le récit, elle resta assise droite, regardant rarement, tantôt son beau bras rond, qui se déformait par la pression sur la table, tantôt sa poitrine encore plus belle et sur laquelle elle arrangeait son collier de diamants ; parfois elle rajustait les plis de sa robe, et quand le récit produisait un effet, elle regardait Anna Pavlovna, et aussitôt prenait la même expression que celle du visage de la demoiselle d’honneur, et ensuite de nouveau reprenait son calme et son sourire clair. Après Hélène, la petite princesse quitta aussi la table à thé.
— Attendez-moi, je vais prendre mon ouvrage, prononça-t-elle. Voyons, à quoi pensez-vous ? fit-elle s’adressant au prince Hippolyte : Apportez-moi mon ridicule.
La princesse, en souriant et en parlant à tous, s’installa et, en s’asseyant, se rajusta gaîment.
— Maintenant c’est bien, prononça-t-elle, et en demandant de commencer, elle se mit au travail. Le prince Hippolyte lui apporta son ridicule, resta dans le groupe et, s’approchant très près du fauteuil, s’assit près d’elle.
Le charmant Hippolyte frappait par sa ressemblance extraordinaire avec sa sœur, et surtout parce que, malgré cette ressemblance, il était horriblement laid. Les traits étaient les mêmes que chez sa sœur, mais chez celle-ci tout était éclairé par un sourire joyeux, satisfait, jeune, immuable, vivant, et par la beauté remarquable, antique, du corps. Chez le frère, au contraire, le même visage était obscurci par l’idiotie, exprimait toujours l’humeur grondeuse, et le corps était maigre et chétif. Les yeux, le nez, la bouche, tout semblait contracté par une grimace vague et ennuyeuse, et les bras et les jambes n’étaient jamais dans leur position naturelle. — Ce n’est pas une histoire de revenants ? dit-il en s’asseyant près de la princesse et portant vivement à ses yeux son face-à-main, comme s’il ne pouvait commencer à parler sans cet instrument.
— Mais non, mon cher, — fit le narrateur étonné, en haussant les épaules.
— C’est que je déteste les histoires de revenants, — dit-il sur un tel ton qu’on voyait qu’il prononçait des mots et n’en comprenait le sens qu’ensuite.
À cause de la hardiesse avec laquelle il parlait, personne ne pouvait comprendre si ce qu’il disait était très spirituel ou très bête. Il était en habit vert foncé, en pantalon couleur cuisse de nymphe effrayée, comme il disait lui-même, en bas de soie et en souliers à boucles. Le Vicomte raconta très joliment l’anecdote qui courait alors : le duc d’Enghien venant à Paris, en cachette, pour des rendez-vous avec mademoiselle George, s’était rencontré chez elle avec Bonaparte, qui jouissait aussi des faveurs de la célèbre actrice ; et, dans cette rencontre, Napoléon avait été pris par hasard d’une de ces crises auxquelles il était sujet et ainsi, s’était trouvé à la merci du duc ; le duc n’avait pas profité de cet avantage, et, dans la suite, Bonaparte, précisément pour cette magnanimité, s’était vengé du duc en le faisant tuer.
Le récit était très joli et intéressant surtout à cet endroit où les deux rivaux se rencontrent tout à coup ; les dames semblèrent émues. Charmant ! dit Anna Pavlovna, en regardant interrogativement la petite princesse. Charmant ! chuchota la petite princesse en piquant l’aiguille dans son ouvrage, montrant ainsi que l’intérêt et le charme du récit, l’empêchaient de continuer de travailler. Le vicomte apprécia cette louange silencieuse et en souriant avec reconnaissance, il continua. Mais à ce moment, Anna Pavlovna, qui regardait toujours le jeune homme terrible, remarquant qu’il parlait trop haut et avec trop de feu à l’abbé, se hâta d’aller porter secours à l’endroit dangereux. En effet, Pierre avait réussi à nouer conversation avec l’abbé sur l’équilibre politique, et l’abbé, visiblement intéressé par l’ardeur sincère du jeune homme, développait devant lui son idée favorite. Tous deux écoutaient et parlaient avec trop d’animation et de naturel, et cela ne plaisait pas à Anna Pavlovna.
— Les moyens sont l’équilibre européen et le droit des gens, — disait l’abbé. — Il faut qu’un état puissant comme la Russie, réputée barbare, se mette avec désintéressement à la tête d’une union dont le but est l’équilibre de l’Europe, et elle sauvera le monde !
— Comment trouverez-vous un pareil équilibre ? commençait Pierre ; mais à ce moment s’approcha Anna Pavlovna, et, regardant sévèrement Pierre, elle demanda à l’Italien comment il supportait le climat de Pétersbourg. La physionomie de l’Italien se transforma d’un coup et prit l’expression doucereuse, affable et offensée, qui lui était évidemment habituelle en causant avec des femmes : « Je suis tellement accablé par le charme de l’esprit et de l’intelligence de cette société, et surtout de la société féminine dans laquelle j’ai eu l’honneur d’être reçu, que je n’ai pas encore réussi à penser au climat, dit-il. »
Ne lâchant plus l’abbé et Pierre, Anna Pavlovna, pour la commodité de l’observation, les joignit au groupe commun.
À ce moment, un nouvel arrivant entra au salon. C’était le jeune prince André Bolkonskï, le mari de la petite princesse. Le prince Bolkonskï était un jeune homme de petite taille, très joli, avec des traits secs et accentués. Toute sa personne, à commencer par le regard fatigué et ennuyé, jusqu’au pas lent et égal, présentait le contraste le plus frappant avec sa petite femme si animée. Évidemment il connaissait tous ceux qui étaient au salon et déjà ils l’ennuyaient tant qu’il lui était très désagréable de les regarder et de les écouter. Et de toutes les physionomies, celle qui semblait l’ennuyer le plus était celle de sa jolie femme. Avec une grimace qui gâtait son joli visage, il se détourna d’elle. Il baisa la main d’Anna Pavlovna, et, en clignant des yeux, il regarda toute la société.
— Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince ? lui demanda Anna Pavlovna.
— Le général Koutouzoff, — dit Bolkonskï, en accentuant la dernière syllabe zoff comme un Français, — a bien voulu de moi pour aide de camp…
— Et Lise, votre femme ?
— Elle ira à la campagne.
— C’est un grand péché de nous priver de votre charmante femme !
— André, — dit celle-ci, en s’adressant à son mari du même ton coquet qu’elle prenait pour s’adresser aux étrangers, — quelle histoire nous a racontée le vicomte sur mademoiselle George et Bonaparte !
Le prince André ferma les yeux et se détourna. Pierre, qui depuis l’entrée du prince André au salon, n’avait pas détaché de lui son regard joyeux et amical, s’approcha et lui prit la main. Le prince André, sans se retourner, fronça le visage dans une grimace qui exprimait du dépit contre celui qui lui touchait la main ; mais en apercevant le visage souriant de Pierre, lui-même sourit d’un sourire inattendu, bon et agréable.
— Eh quoi !… Toi aussi dans le grand monde ! — dit-il à Pierre.
— Je savais que vous y seriez, — répondit Pierre. — J’irai souper chez vous, — ajouta-t-il à voix basse, pour ne pas déranger le vicomte qui continuait son récit. — Est-ce possible ?
— Non, impossible, — fit le prince André en riant, et en serrant la main de Pierre de façon à lui faire comprendre qu’il ne fallait pas demander cela. Il voulait dire encore quelque chose, mais à ce moment le prince Vassili se leva avec sa fille et les deux jeunes gens se dérangèrent pour les laisser passer.
— Vous m’excuserez, mon cher vicomte, — dit en français le prince Vassili, en appuyant doucement sur son bras pour qu’il ne se levât pas de sa chaise. — Cette malheureuse fête chez l’ambassadeur me prive d’un plaisir et me fait vous interrompre. C’est très triste pour moi de quitter votre charmante soirée, — dit-il à Anna Pavlovna. Sa fille, la princesse Hélène, soutenant à peine les plis de sa robe, passa entre les chaises, et son sourire éclairait encore davantage son beau visage.
Quand elle passa devant Pierre, il la regarda avec des yeux presque effrayés et enthousiastes.
— Elle est très belle — fit le prince André.
— Très belle — dit Pierre.
En passant devant eux, le prince Vassili prit la main de Pierre et s’adressant à Anna Pavlovna :
— Domptez-moi cet ours. Voilà un mois entier qu’il vit chez moi et c’est la première fois que je le vois dans le monde ; rien n’est si indispensable pour un jeune homme que la société des femmes intelligentes.
Chapitre IV
IV
Anna Pavlovna promit en souriant de s’occuper de Pierre, qui, ainsi qu’elle le savait, était, par son père, parent du prince Vassili.
La dame âgée qui était assise près de ma tante se leva vivement et rejoignit le prince Vassili dans l’antichambre. Son visage n’avait plus son expression d’intérêt simulé. Sa physionomie bonne et geignarde n’exprimait plus que l’inquiétude et la peur.
— Eh bien ! mon prince, que me direz-vous de mon Boris ? — dit-elle en le rejoignant dans l’antichambre. (Elle prononçait Boris, avec un accent particulier sur o.) — Je ne puis rester plus longtemps à Pétersbourg. Dites-moi quelle nouvelle je puis rapporter à mon pauvre enfant ?
Bien que le prince Vassili écoutât par force, presque impoliment et même en montrant quelque impatience, la dame âgée lui souriait tendrement et d’une façon touchante ; pour qu’il ne s’éloignât pas, elle lui prit la main.
— Que vous fassiez dire un mot à l’empereur, et tout de suite il passera dans la garde, — fit-elle.
— Croyez que je ferai tout mon possible, princesse, — répondit le prince Vassili ; — mais il m’est difficile de faire une demande à l’empereur ; je vous conseillerais de vous adresser à Roumiantzev par l’intermédiaire du prince Golitzine : ce serait plus adroit.
La dame âgée s’appelait la princesse Droubetzkaia, d’une des meilleures familles de la Russie, mais elle était pauvre, avait quitté le monde depuis longtemps et avait perdu ses anciennes relations. Elle était venue, maintenant, afin d’obtenir, pour son fils unique, une nomination dans la garde.
C’était seulement pour rencontrer le prince Vassili qu’elle s’était imposée et était venue à la soirée d’Anna Pavlovna, c’était pour cela seul qu’elle avait écouté l’histoire du vicomte. Elle s’effraya des paroles du prince Vassili. Son visage, jadis beau, exprima la colère, mais cela ne dura qu’un moment. Elle sourit de nouveau, et étreignit plus fortement la main du prince.
— Écoutez, prince, — dit-elle, — je ne vous ai jamais rien demandé, je ne vous demanderai jamais rien ; je ne vous ai jamais rappelé l’amitié de mon père pour vous. Mais maintenant, au nom de Dieu, je vous en conjure, faites cela pour mon fils, et je vous regarderai comme mon bienfaiteur — ajouta-t-elle hâtivement. — Non, ne vous fâchez pas, mais promettez-moi… Je me suis adressée à Golitzine, il a refusé. Soyez le bon enfant que vous avez été, — ajouta-t-elle en s’efforçant de sourire, tandis que ses yeux s’emplissaient de larmes.
— Papa, nous serons en retard, — dit la princesse Hélène, qui attendait à la porte et tournait sa belle tête sur ses épaules dignes de l’antique.
L’influence dans le monde, c’est un capital qu’il faut garder pour qu’il ne disparaisse pas. Le prince Vassili savait cela et comprenait que s’il intervenait pour tous ceux qui le sollicitaient, alors bientôt, il ne pourrait rien demander pour lui-même, et il usait très rarement de son influence. Dans le cas de la princesse Droubetzkaia, il sentit à son appel comme un remords de conscience. Elle lui rappelait la vérité : ses premiers pas dans le service il les devait à son père. En outre, il vit à sa façon d’agir que c’était une de ces femmes, surtout de ces mères, qui une fois qu’elles ont mis quelque chose dans leur tête, ne s’en iront pas avant qu’on ait satisfait à leurs désirs, et dans le cas contraire, sont prêtes à revenir à la charge chaque jour, à chaque moment et même à faire des scènes. Cette dernière considération le fit hésiter.
— Chère Anna Mikhaïlovna — fit-il avec sa familiarité accoutumée et avec de l’ennui dans la voix, — il m’est presque impossible de faire ce que vous voulez, mais pour vous prouver comme je vous aime et comme je respecte le souvenir de feu votre père, je ferai l’impossible. Votre fils passera dans la garde ; voici ma main. Êtes-vous contente ?
— Mon ami, mon bienfaiteur ! Je n’attendais rien d’autre de vous, je savais comme vous êtes bon. Il voulait s’en aller. — Attendez, deux mots… Une fois passé aux gardes… — elle s’arrêta, — vous êtes en bonnes relations avec Mikhaïl Illarionovitch Koutouzov, recommandez-lui Boris comme aide de camp. Alors je serai déjà tranquille et alors…
Le prince Vassili sourit.
— Cela je ne le promets pas. Vous ne savez pas comment on assiège Koutouzov depuis qu’il est nommé commandant en chef de l’armée. Il m’a dit lui-même que toutes les dames de Moscou se sont concertées pour lui donner leurs fils comme aides de camp.
— Non, promettez-le-moi, je ne vous laisserai pas, cher, mon bienfaiteur.
— Papa, — répéta du même ton la belle, — nous serons en retard.
— Eh bien, au revoir, vous voyez ?
— Alors demain vous ferez un rapport à l’empereur ?
— Absolument, mais pour Koutouzov, je ne promets pas.
— Non, promettez, promettez, Basile, — dit derrière lui Anna Mikhaïlovna avec un sourire de jeune coquette qui autrefois, probablement lui était habituel, et qui maintenant allait si mal à son visage fané. Elle oubliait évidemment son âge et mettait en jeu, selon l’habitude, tous ses anciens moyens de femme. Mais aussitôt qu’il sortit, son visage reprit la même expression froide, feinte, qu’elle avait auparavant. Elle retourna dans le groupe où le vicomte continuait à raconter, et de nouveau feignit d’écouter, en attendant le moment de partir au plus vite, puisque maintenant son affaire était faite.
— Eh bien ! Mais comment trouvez-vous toute cette dernière comédie du sacre de Milan ? — dit Anna Pavlovna. — Et la nouvelle comédie des peuples de Gênes et de Lucques, qui viennent présenter leurs vœux à M. Buonaparte assis sur un trône et exauçant les vœux des nations ! Adorable ! Non, mais c’est à en devenir folle ! on dirait que le monde entier a perdu la tête.
Le Prince André sourit en regardant en face le visage d’Anna Pavlovna.
— « Dieu me la donne, gare à qui la touche, » — dit-il (paroles de Bonaparte lors du couronnement). — On dit qu’il a été très beau en prononçant ces paroles, — ajouta-t-il, et il les répéta en italien : « Dio mi la dona, gai a qui la tocca. »
— J’espère enfin, — continua Anna Pavlovna, — que ç’a été la goutte d’eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout.
— Les souverains ? Je ne parle pas de la Russie, — dit poliment et désespérément le vicomte. — Les souverains, madame ! qu’ont-ils fait pour Louis XVI, pour la reine, pour madame Élisabeth ? Rien, — continua-t-il en s’animant. — Et croyez-moi, ils subissent la punition de leur trahison à la cause des Bourbons. Les souverains ? Ils envoient des ambassadeurs complimenter l’usurpateur.
Et avec un soupir de mépris, il prit une nouvelle pose. Le prince Hippolyte, qui depuis longtemps regardait le vicomte derrière son face-à-main, à ces paroles, se tourna de tout le corps vers la petite princesse et lui demandant une aiguille, il lui montra, en le dessinant sur la table avec l’aiguille, le blason des Condé. Il lui expliqua ce blason avec un air important, comme si la princesse le lui eût demandé.
— Bâton de gueules, engrêlé de gueules d’azur — maison Condé, — dit-il. La princesse écoutait en souriant.
— Si Bonaparte reste encore une année au trône de France, — dit le vicomte, continuant la conversation commencée, de l’air d’un homme qui n’écoute pas les autres, mais qui, dans une affaire qui lui est connue, suit exclusivement le cours de ses idées, — alors les choses iront très loin. Par l’intrigue, par la violence, par l’exil, par les supplices, la société, je parle de la bonne société française, sera détruite pour toujours, et alors…
Il leva les épaules et écarta les bras. Pierre voulut dire quelque chose, car la conversation l’intéressait, mais Anna Pavlovna, qui le surveillait, l’en empêcha.
— L’empereur Alexandre — dit-elle avec la tristesse qui accompagnait toujours sa conversation, quand elle parlait de la famille impériale, — a déclaré qu’il laissera aux Français eux-mêmes le choix de leur mode de gouvernement. Et je pense qu’il n’y a pas de doute, que toute la nation, affranchie de l’usurpateur, ne se jette entre les mains d’un roi légitime, — dit Anna Pavlovna, en s’efforçant d’être aimable pour l’émigrant royaliste.
— C’est douteux, dit le prince André. Monsieur le vicomte croit avec raison que les choses sont allées déjà trop loin. Je pense que le retour au passé sera difficile.
— D’après ce que j’ai entendu — dit Pierre qui se mêla à la conversation en rougissant — presque toute la noblesse est allée déjà du côté de Bonaparte.
— Ce sont les bonapartistes qui le disent, répondit le vicomte sans regarder Pierre. Il est difficile maintenant de connaître l’opinion publique en France.
— Bonaparte l’a dit, objecta le prince André, avec un sourire.
(Il était évident que le vicomte lui déplaisait, et que tout en ne le concernant pas, ces paroles étaient dirigées contre lui.)
— « Je leur ai montré le chemin de la gloire, — dit-il après un court silence, en répétant de nouveau les paroles de Napoléon ; — ils n’en ont pas voulu ; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont précipités en foule »… Je ne sais pas jusqu’à quel point il a eu le droit de le dire ?
— Aucun — répondit le vicomte. — Après l’assassinat du duc, même les hommes les plus partiaux, cessèrent de voir en lui un héros. Si même ç’a été un héros pour certaines gens, — poursuivit le vicomte en s’adressant à Anna Pavlovna, — depuis l’assassinat du duc, il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre.
Anna Pavlovna et les autres n’avaient pas encore réussi à apprécier, par un sourire, les paroles du vicomte, que Pierre se jetait de nouveau dans la conversation, et qu’Anna Pavlovna, bien qu’elle pressentît qu’il allait dire quelque chose de déplacé, ne pouvait déjà plus l’arrêter.
— Le supplice du duc d’Enghien — dit M. Pierre — était une telle nécessité d’État, que je vois précisément de la grandeur d’âme en ce que Napoléon n’ait pas craint de prendre sur lui seul la responsabilité de cet acte.
— Dieu ! mon Dieu ! — murmura terrifiée, Anna Pavlovna.
— Comment, M. Pierre, vous trouvez que l’assassinat est grandeur d’âme, — fit la petite princesse en souriant et en approchant d’elle son ouvrage.
— Ah ! Oh ! — exclamaient diverses voix.
— Capital — dit en anglais le prince Hippolyte, en commençant à frapper sur ses genoux. Le vicomte se contenta de hausser les épaules. Pierre, par dessus ses lunettes, regardait triomphalement les auditeurs. — Je parle ainsi, continua-t-il, parce que les Bourbons ont fui la Révolution et laissé le peuple à l’anarchie ; seul Napoléon sut comprendre la révolution, la vaincre et c’est pourquoi, pour le bien commun, il ne pouvait s’arrêter devant la vie d’un seul homme.
— Ne voulez-vous pas passer à cette table ? — dit Anna Pavlovna.
Mais sans répondre, Pierre continua son discours.
— Non, — dit-il en s’animant de plus en plus, — Napoléon est grand parce qu’il s’est mis au-dessus de la Révolution, dont il a réprimé les abus et retenu tout le bon : l’égalité des citoyens, la liberté de la parole et de la presse ; et c’est seulement par cela qu’il a conquis le pouvoir.
— Oui, si en prenant le pouvoir pour lui sans en profiter par l’assassinat, il l’avait rendu au roi légitime, alors, je l’appellerais un grand homme, — dit le vicomte.
— Il ne pouvait faire cela. Le peuple lui a donné le pouvoir pour qu’il le débarrassât des Bourbons, et parce qu’il voyait en lui un grand homme. La révolution a été une grande œuvre, — continua Pierre en montrant par cette proposition audacieuse et provocante son extrême jeunesse et le désir d’exprimer tout le plus complètement possible.
— La révolution et l’assassinat des rois, une grande œuvre !… Après cela… mais ne voulez-vous pas venir à cette table ? — répéta Anna Pavlovna.
— Contrat social — fit, avec un sourire doux, le vicomte.
— Je ne parle pas de l’exécution du roi. Je parle des idées.
— Oui, des idées du pillage, du meurtre, et de l’assassinat du roi, — interrompit de nouveau la voix ironique.
— Sans doute ce furent des excès, mais en eux n’est pas tout ; l’important est dans les droits de l’homme, la disparition des préjugés, l’égalité des citoyens. Et Napoléon a retenu ces idées dans toute leur intégralité.
— Liberté et égalité, — fit avec mépris le vicomte comme s’il se décidait enfin à prouver sérieusement à ce jeune homme la sottise de ses paroles, — ce sont de grands mots compromis depuis longtemps. Qui n’aime pas la liberté et l’égalité ? Notre saint Sauveur propageait déjà la liberté et l’égalité. Est-ce qu’après la Révolution les hommes sont devenus plus heureux ? Au contraire. Nous avons voulu la liberté et Bonaparte l’a détruite.
Le prince André regardait avec un sourire, tantôt Pierre, tantôt le vicomte, tantôt la maîtresse de la maison. Dès les premiers assauts de Pierre, Anna Pavlovna, malgré son habitude du monde, était terrifiée, mais quand elle vit qu’en dépit des paroles sacrilèges prononcées par Pierre, le vicomte ne se mettait pas hors de lui, quand elle fut convaincue qu’il n’était pas possible d’étouffer ses paroles, elle reprit des forces et, s’unissant au vicomte, s’attaqua à l’orateur.
— Mais mon cher monsieur Pierre, — dit Anna Pavlovna, — comment expliquez-vous ceci : un grand homme qui a pu faire exécuter le duc, enfin, tout simplement un homme, sans jugement et sans crime ?…
— Je demanderais — fit le vicomte — comment monsieur explique le 18 Brumaire. N’est-ce pas une tromperie ? C’est un escamotage qui ne ressemble nullement à la manière d’agir d’un grand homme.
— Et les prisonniers d’Afrique qu’il a tués — dit la petite princesse, — c’est horrible ! — Et elle leva les épaules.
— C’est un roturier, vous aurez beau dire, — déclara le prince Hippolyte,
M. Pierre ne savait à qui répondre ; il les regardait tous et souriait. Son sourire n’était pas comme celui des autres hommes. Chez lui, au contraire, quand il souriait, le visage sérieux et un peu sombre disparaissait tout à coup, et, à sa place, se montrait un visage enfantin, bon, même un peu bébête, et qui semblait demander grâce.
Pour le vicomte qui le voyait pour la première fois, il était clair que ce Jacobin n’était pas du tout si terrible que ses paroles.
Tous se turent.
— Comment voulez-vous qu’il réponde à tout le monde à la fois ? — dit le prince André. — En outre, dans les actes d’un homme d’État il faut distinguer les actes de l’homme privé, du chef de l’armée ou de l’Empereur. Cela me semble ainsi.
— Oui, oui, sans doute, — fit Pierre, réjoui de l’aide qui venait à lui.
— On ne peut pas ne pas avouer — continua le prince André — que Napoléon, comme homme, fut très grand, sur le pont d’Arcole, à l’hôpital de Jaffa, où il donna la main aux pestiférés, mais… mais il y a d’autres actes qu’il est difficile de justifier.
Le prince André, qui avait voulu évidemment adoucir l’inconvenance des paroles de Pierre, se leva pour partir, et donna le signal à sa femme.
Tout à coup le prince Hippolyte se leva et d’un geste de main, les arrêtant tous, il leur demanda de s’asseoir et prononça :
— Ah ! aujourd’hui on m’a raconté une anecdote moscovite charmante ; il faut que je vous en régale. Vous m’excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l’histoire. Et le prince Hippolyte se mit à parler en russe avec la prononciation des Français qui ont passé une année en Russie. Tous s’arrêtèrent, telles étaient l’animation et l’insistance avec lesquelles le prince Hippolyte demandait l’attention pour son récit.
— À Moscou, il y a une dame. Et elle est très avare. Il lui fallait avoir deux valets de pied derrière la voiture. Et il les lui fallait de très haute taille. C’était son goût. Et elle avait une femme de chambre de très haute taille. Elle dit…
Ici le prince Hippolyte se mit à réfléchir et, visiblement, avec beaucoup de difficulté :
— Elle dit… oui, elle dit : « Fille (À la femme de chambre), prends la livrée et viens avec moi derrière la voiture faire des visites.
Ici, le prince Hippolyte pouffa et éclata de rire bien avant ses auditeurs, ce qui produisit une impression désavantageuse pour le narrateur. Cependant plusieurs personnes, et de ce nombre les dames âgées et Anna Pavlovna, sourirent.
— Elle partit. Tout à coup s’éleva un grand vent, la fille perdit son chapeau, et ses longs cheveux se déroulèrent…
Il ne pouvait déjà plus se contenir, et tout en éclatant d’un rire saccadé, il prononça :
— Et tout le monde le sut…
Ce fut la fin de l’anecdote. Bien qu’on ne comprît pas pourquoi il la racontait, et pourquoi il fallait absolument la raconter en russe, cependant Anna Pavlovna et les autres apprécièrent la galanterie mondaine du prince Hippolyte qui terminait si agréablement l’assaut désagréable de M. Pierre. Après ce récit, la conversation se dispersa en petits papotages sur les bals passés et futurs, sur le spectacle, et sur le lieu et le jour d’une prochaine rencontre.
Chapitre V
V
En remerciant Anna Pavlovna pour sa charmante soirée, les hôtes commencèrent à se retirer.
Pierre était maladroit, lourd, de haute taille, large, avec d’énormes mains rouges ; il ne pouvait, comme on dit, entrer dans un salon et encore moins en sortir, c’est-à-dire qu’il ne savait pas dire avant de se retirer quelques paroles agréables. En outre il était distrait. En se levant, au lieu de son chapeau, il attrapa le tricorne à plumes du général, et le tint en en secouant le panache, jusqu’à ce que le général l’eût prié de le lui remettre. Mais cette distraction et le défaut de ne savoir entrer au salon ni causer, se rachetaient par une expression de bonhomie, de simplicité et de modestie. Anna Pavlovna se tourna vers lui, et lui exprimant, avec une douceur chrétienne, le pardon pour son assaut, elle le salua en disant :
— J’espère vous revoir, mais j’espère aussi que vous modifierez vos opinions, mon cher monsieur Pierre.
Il ne répondit rien à ces paroles, s’inclina seulement, et, de nouveau, montra à tous son sourire qui n’exprimait rien, ou peut-être ceci : « Les opinions sont les opinions, et vous voyez que je suis un bon et charmant garçon. » Et tous, y compris Anna Pavlovna, involontairement sentaient cela.
Le prince André sortit dans l’antichambre ; en tendant ses épaules au valet qui lui mettait son manteau, il écoutait avec indifférence le bavardage de sa femme et du prince Hippolyte qui sortait aussi dans l’antichambre. Le prince Hippolyte était près de la jolie princesse enceinte, et avec persistance, la fixait derrière son face-à-main.
— Allez, Annette, vous vous enrhumerez, — dit la petite princesse en faisant ses adieux à Anna Pavlovna. — C’est arrêté, — ajouta-t-elle plus bas.
Anna Pavlovna avait déjà réussi à parler à Lise du mariage qu’elle projetait entre Anatole et la belle-sœur de la petite princesse.
— Je compte sur vous, chère amie, — dit Anna Pavlovna aussi doucement — vous lui écrirez et vous me direz comment le père envisagera la chose. Au revoir. — Et elle s’éloigna de l’antichambre.
Le prince Hippolyte s’approcha de la petite princesse, et, penchant son visage très près d’elle, se mit à lui chuchoter quelque chose.
Deux valets, le sien et celui de la princesse, attendant qu’ils eussent fini de parler, étaient debout avec un manteau et un châle et écoutaient la langue française, incompréhensible pour eux, d’un air de comprendre mais de ne vouloir pas le montrer. La princesse, comme toujours, parlait et écoutait en souriant.
— Je suis très heureux de ne pas être allé chez l’ambassadeur, disait le prince Hippolyte, c’est ennuyeux là-bas… Une charmante soirée, charmante, n’est-ce pas ?
— On dit que le bal sera très beau, — répondit la princesse en remuant ses lèvres duvetées, — toutes les jolies femmes de la société y seront.
— Pas toutes, puisque vous n’y serez pas, — repartit le prince Hippolyte en riant joyeusement ; et prenant le châle des mains du valet, lui-même le mettait sur la princesse. Par maladresse ou volontairement (on ne pouvait le savoir), de longtemps il ne retira pas ses mains, quand le châle était déjà mis ; on eût dit qu’il étreignait la jeune femme.
Elle, gracieuse, toujours souriante, s’éloigna, se tourna et regarda son mari. Le prince André avait les yeux fermés, il paraissait fatigué et endormi.
— Vous êtes prête ? — demanda-t-il à sa femme en la parcourant du regard.
Le prince Hippolyte mit rapidement son pardessus qui, à la mode d’alors, tombait au-dessous des talons, et en s’embarrassant, il courut au perron derrière la princesse que le valet aidait à monter en voiture.
— Princesse, au revoir, — cria-t-il en s’embarrassant de la langue comme des pieds.
La princesse, soulevant sa robe, montait dans la voiture ; son mari arrangeait son sabre. Le prince Hippolyte, sous prétexte de servir, les gênait tous.
— Permettez, monsieur ? — fit sèchement et désagréablement le prince André en s’adressant en russe au prince Hippolyte qui l’empêchait de passer.
— Je t’attends, Pierre, — ajouta-t-il, mais d’une voix douce et tendre.
Le cocher tira les guides et la voiture s’ébranla. Le prince Hippolyte, riant d’un rire saccadé, était debout sur le perron et attendait le vicomte qui lui avait promis de le reconduire à la maison.