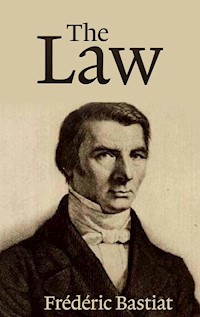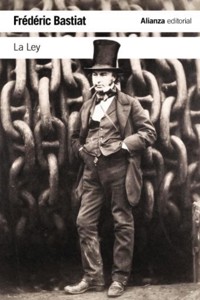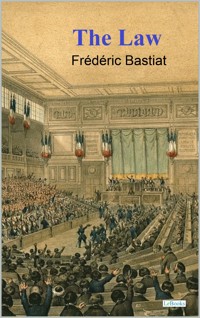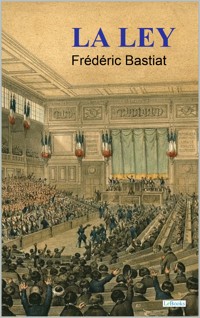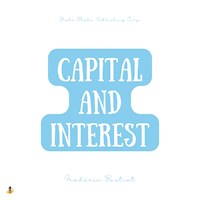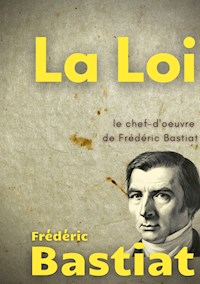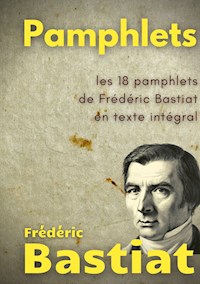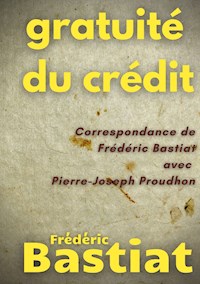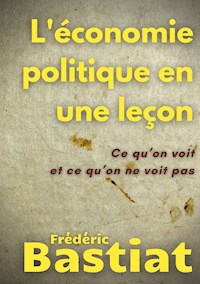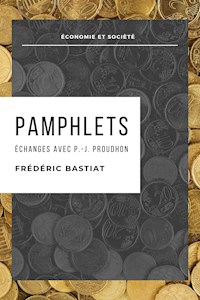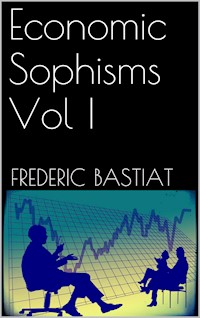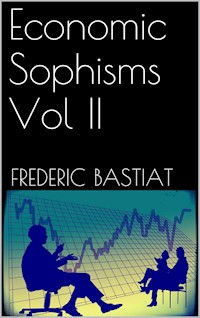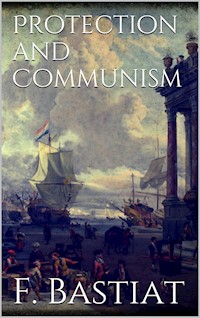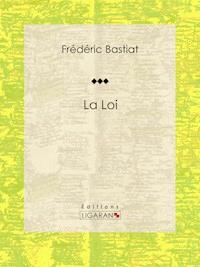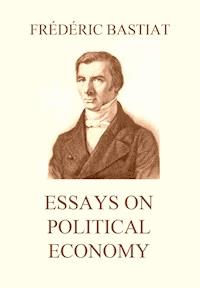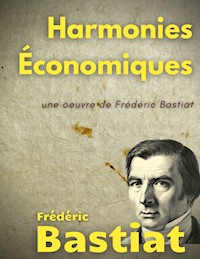
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Harmonies Économiques" de Frédéric Bastiat est une oeuvre phare qui explore les principes fondamentaux de l'économie à travers une approche harmonieuse et optimiste. Bastiat y développe l'idée que les lois économiques naturelles, lorsqu'elles ne sont pas entravées par des interventions artificielles, tendent vers l'harmonie et le bien-être général. L'ouvrage aborde des concepts tels que la propriété, la liberté des échanges, et le rôle de l'État, tout en soulignant les bénéfices du libre marché. Bastiat utilise un style clair et didactique pour démontrer comment les intérêts individuels peuvent converger vers le bien commun. Il s'attaque également aux idées protectionnistes et aux préjugés économiques de son temps, en utilisant des analogies et des exemples concrets pour illustrer ses arguments. "Harmonies Économiques" se distingue par sa capacité à rendre accessibles des concepts économiques complexes, tout en plaidant pour une société où la coopération et la liberté économique sont les moteurs de la prospérité. Ce livre est non seulement une défense éloquente du libéralisme économique, mais également un appel à la raison et à la compréhension des mécanismes économiques qui régissent nos sociétés. L'AUTEUR : Frédéric Bastiat, né le 30 juin 1801 à Bayonne, est un économiste et homme politique français du XIXe siècle. Issu d'une famille de négociants, il s'intéresse très tôt aux questions économiques et politiques. Bastiat est surtout connu pour sa défense ardente du libéralisme économique et son opposition aux politiques protectionnistes. Il commence sa carrière en tant que négociant, mais se tourne rapidement vers l'écriture et la politique. En 1848, il est élu député des Landes, où il milite pour le libre-échange et la réduction des impôts. Bastiat est également un membre actif de la Société d'économie politique de Paris. Ses écrits, tels que "La Loi" et "Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas", sont des oeuvres majeures qui continuent d'influencer la pensée économique contemporaine. Son style est caractérisé par l'usage de la satire et de la logique rigoureuse pour démonter les sophismes économiques. Bien que sa carrière soit écourtée par une maladie, Bastiat laisse derrière lui un héritage intellectuel important, marqué par sa foi inébranlable en la capacité de l'économie de marché à améliorer le sort de l'humanité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 979
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
À LA JEUNESSE FRANÇAISE
I. ORGANISATION NATURELLE
II. BESOINS, EFFORTS, SATISFACTIONS
III. DES BESOINS DE L'HOMME
IV. ÉCHANGE
V. DE LA VALEUR
VI. RICHESSE
VII. CAPITAL
VIII. PROPRIÉTÉ, COMMUNAUTÉ
IX. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
X. CONCURRENCE
XI. PRODUCTEUR. — CONSOMMATEUR
XII. LES DEUX DEVISES
XIII. DE LA RENTE
XIV. DES SALAIRES
XV. DE L'ÉPARGNE
XVI. DE LA POPULATION
XVII. SERVICES PRIVÉS, SERVICE PUBLIC
XVIII. CAUSES PERTURBATRICES
XIX. GUERRE
XX. RESPONSABILITÉ
XXI. SOLIDARITÉ
XXII. MOTEUR SOCIAL
XXIII. LE MAL
XXIV. PERFECTIBILITÉ
XXV. RAPPORTS DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE
À LA JEUNESSE FRANÇAISE
Amour de l’étude, besoin de croyances, esprit dégagé de préventions invétérées, cœur libre de haine, zèle de propagande, ardentes sympathies, désintéressement, dévouement, bonne foi, enthousiasme de tout ce qui est bon, beau, simple, grand, honnête, religieux, tels sont les précieux attributs de la jeunesse. C’est pourquoi je lui dédie ce livre. C’est une semence qui n’a pas en elle le principe de vie, si elle ne germe pas sur le sol généreux auquel je la confie.
J’aurais voulu vous offrir un tableau, je ne vous livre qu’une ébauche ; pardonnez-moi : qui peut achever une œuvre de quelque importance en ce temps-ci ? Voici l’esquisse. En la voyant, puisse l’un d’entre vous s’écrier comme le grand artiste : Anch’io son pittore ! et, saisissant le pinceau, jeter sur cette toile informe la couleur et la chair, l’ombre et la lumière, le sentiment et la vie.
Jeunes gens, vous trouverez le titre de ce livre bien ambitieux. HARMONIES ÉCONOMIQUES ! Aurais-je eu la prétention de révéler le plan de la Providence dans l’ordre social, et le mécanisme de toutes les forces dont elle a pourvu l’humanité pour la réalisation du progrès ?
Non, certes ; mais je voudrais vous mettre sur la voie de cette vérité : Tous les intérêts légitimes sont harmoniques. C’est l’idée dominante de cet écrit, et il est impossible d’en méconnaitre l’importance.
Il a pu être de mode, pendant un temps, de rire de ce qu’on appelle le problème social ; et, il faut le dire, quelques-unes des solutions proposées ne justifiaient que trop cette hilarité railleuse. Mais, quant au problème lui-même, il n’a certes rien de risible ; c’est l’ombre de Banquo au banquet de Macbeth, seulement ce n’est pas une ombre muette, et, d’une voix formidable, elle crie à la société épouvantée : Une solution ou la mort !
Or cette solution, vous le comprendrez aisément, doit être toute différente selon que les intérêts sont naturellement harmoniques ou antagoniques.
Dans le premier cas, il faut la demander à la Liberté ; dans le second, à la Contrainte. Dans l’un, il suffit de ne pas contrarier ; dans l’autre, il faut nécessairement contrarier.
Mais la Liberté n’a qu’une forme. Quand on est bien convaincu que chacune des molécules qui composent un liquide porte en elle-même la force d’où résulte le niveau général, on en conclut qu’il n’y a pas de moyen plus simple et plus sûr pour obtenir ce niveau que de ne pas s’en mêler. Tous ceux donc qui adopteront ce point de départ : Les intérêts sont harmoniques, seront aussi d’accord sur la solution pratique du problème social : s’abstenir de contrarier et de déplacer les intérêts.
La Contrainte peut se manifester, au contraire, par des formes et selon des vues en nombre infini. Les écoles qui partent de cette donnée : Les intérêts sont antagoniques, n’ont donc encore rien fait pour la solution du problème, si ce n’est qu’elles ont exclu la Liberté. Il leur reste encore à c hercher, parmi les formes infinies de la Contrainte, quelle est la bonne, si tant est qu’une le soit. Et puis, pour dernière difficulté, il leur restera à faire accepter universellement par des hommes, par des agents libres, cette forme préférée de la Contrainte.
Mais, dans cette hypothèse, si les intérêts humains sont poussés par leur nature vers un choc fatal, si ce choc ne peut être évité que par l’invention contingente d’un ordre social artificiel, le sort de l’Humanité est bien chanceux, et l’on se demande avec effroi :
1° Se rencontrera-t-il un homme qui trouve une forme satisfaisante de la Contrainte ?
2° Cet homme ramènera-t-il à son idée les écoles innombrables qui auront conçu des formes différentes ?
3° L’Humanité se laissera-t-elle plier à cette forme, laquelle, selon l’hypothèse, contrariera tous les intérêts individuels ?
4° En admettant que l’Humanité se laisse affubler de ce vêtement, qu’arrivera-t-il, si un nouvel inventeur se présente avec un vêtement plus perfectionné ? Devra-t-elle persévérer dans une mauvaise organisation, la sachant mauvaise ; ou se résoudre à changer tous les matins d’organisation, selon les caprices de la mode et la fécondité des inventeurs ?
5° Tous les inventeurs, dont le plan aura été rejeté, ne s’uniront-ils pas contre le plan préféré, avec d’autant plus de chances de troubler la société que ce plan, par sa nature et son but, froisse tous les intérêts ?
6° Et, en définitive, y a-t-il une force humaine capable de vaincre un antagonisme qu’on suppose être l’essence même des forces humaines ?
Je pourrais multiplier indéfiniment ces questions et proposer, par exemple, cette difficulté :
Si l’intérêt individuel est opposé à l’intérêt général, où placerez-vous le principe d’action de la Contrainte ? Où sera le point d’appui ? Sera-ce en dehors de l’humanité ? Il le faudrait pour échapper aux conséquences de votre loi. Car, si vous confiez l’arbitraire à des hommes, prouvez donc que ces hommes sont pétris d’un autre limon que nous ; qu’ils ne seront pas mus aussi par le fatal principe de l’intérêt, et que, placés dans une situation qui exclut l’idée de tout frein, de toute résistance efficace, leur esprit sera exempt d’erreurs, leurs mains de rapacité et leur cœur de convoitise.
Ce qui sépare radicalement les diverses écoles socialistes (j’entends ici celles qui cherchent dans une organisation artificielle la solution du problème social) de l’École économiste, ce n’est pas telle ou telle vue de détail, telle ou telle combinaison gouvernementale ; c’est le point de départ, c’est cette question préliminaire et dominante : Les intérêts humains, laissés à eux-mêmes, sont-ils harmoniques ou antagoniques ?
Il est clair que les socialistes n’ont pu se mettre en quête d’une organisation artificielle que parce qu’ils ont jugé l’organisation naturelle mauvaise ou insuffisante ; et ils n’ont jugé celle-ci insuffisante et mauvaise que parce qu’ils ont cru voir dans les intérêts un antagonisme radical, car sans cela ils n’auraient pas eu recours à la Contrainte. Il n’est pas nécessaire de contraindre à l’harmonie ce qui est harmonique de soi.
Aussi ils ont vu l’antagonisme partout :
Entre le propriétaire et le prolétaire,
Entre le capital et le travail,
Entre le peuple et la bourgeoisie,
Entre l’agriculture et la fabrique,
Entre le campagnard et le citadin,
Entre le regnicole et l’étranger,
Entre le producteur et le consommateur,
Entre la civilisation et l’organisation,
Et, pour tout dire en un mot :
Entre la Liberté et l’Harmonie.
Et ceci explique comment il se fait qu’encore qu’une sorte de philanthropie sentimentaliste habite leur cœur, la haine découle de leurs lèvres. Chacun d’eux réserve tout son amour pour la société qu’il a rêvée ; mais, quant à celle où il nous a été donné de vivre, elle ne saurait s’écrouler trop tôt à leur gré, afin que sur ses débris s’élève la Jérusalem nouvelle.
J’ai dit que l'École économiste, partant de la naturelle harmonie des intérêts, concluait à la Liberté.
Cependant, je dois en convenir, si les économistes, en général, concluent à la Liberté, il n’est malheureusement pas aussi vrai que leurs principes établissent solidement le point de départ : l’harmonie des intérêts.
Avant d’aller plus loin et afin de vous prémunir contre les inductions qu’on ne manquera pas de tirer de cet aveu, je dois dire un mot de la situation respective du Socialisme et de l’Économie politique.
Il serait insensé à moi de dire que le Socialisme n’a jamais rencontré une vérité, que l’Économie politique n’est jamais tombée dans une erreur.
Ce qui sépare profondément les deux écoles, c’est la différence des méthodes. L’une, comme l’astrologie et l’alchimie, procède par l’Imagination ; l’autre, comme l’astronomie et la chimie, procède par l’observation.
Deux astronomes, observant le même fait peuvent ne pas arriver au même résultat.
Malgré cette dissidence passagère, ils se sentent liés par le procédé commun qui tôt ou tard la fera cesser. Ils se reconnaissent de la même communion. Mais, entre l’astronome qui observe et l’astrologue qui imagine, l’abîme est infranchissable, encore que, par hasard, ils se puissent quelquefois rencontrer.
Il en est ainsi de l’Économie politique et du Socialisme.
Les Économistes observent l’homme, les lois de son organisation et les rapports sociaux qui résultent de ces lois. Les Socialistes imaginent une société de fantaisie et ensuite un cœur humain assorti à cette société.
Or, si la science ne se trompe pas, les savants se trompent. Je ne nie donc pas que les Économistes ne puissent faire de fausses observations, et j’ajoute même qu’ils ont nécessairement dû commencer par là.
Mais voici ce qui arrive. Si les intérêts sont harmoniques, il s’ensuit que toute observation mal faite conduit logiquement à l’antagonisme. Quelle est donc la tactique des Socialistes ? C’est de ramasser dans les écrits des Économistes quelques observations mal faites, d’en exprimer toutes les conséquences et de montrer qu’elles sont désastreuses. Jusque-là ils sont dans leur droit. Ensuite ils s’élèvent contre l’observateur qui s’appellera, je suppose, Malthus ou Ricardo. Ils sont dans leur droit encore. Mais ils ne s’en tiennent pas là. Ils se tournent contre la science, l’accusant d’être impitoyable et de vouloir le mal. En ceci ils heurtent la raison et la justice ; car la science n’est pas responsable d’une observation mal faite. Enfin, ils vont bien plus loin encore. Ils s’en prennent à la société elle-même, ils menacent de la détruire pour la refaire, — et pourquoi ? Parce que, disent-ils, il est prouvé par la science que la société actuelle est poussée vers un abîme. En cela ils choquent le bon sens : car, ou la science ne se trompe pas ; et alors pourquoi l’attaquent-ils ? ou elle se trompe ; et, en ce cas, qu’ils laissent la société en repos, puisqu’elle n’est pas menacée.
Mais cette tactique, tout illogique qu’elle est, n’en est pas moins funeste à la science économique, surtout si ceux qui la cultivent avaient la malheureuse pensée, par une bienveillance très-naturelle, de se rendre solidaires les uns des autres et de leurs devanciers. La science est une reine dont les allures doivent être franches et libres. L’atmosphère de la coterie la tue.
Je l’ai déjà dit : il n’est pas possible, en économie politique, que l’antagonisme ne soit au bout de toute proposition erronée. D’un autre côté, il n’est pas possible que les nombreux écrits des économistes, même les plus éminents, ne renferment quelque proposition fausse. — C’est à nous à les signaler et à les rectifier dans l’intérêt de la science et de la société. Nous obstiner à les soutenir, pour l’honneur du corps, ce serait non-seulement nous exposer, ce qui est peu de chose, mais exposer la vérité même, ce qui est plus grave, aux coups du socialisme.
Je reprends donc et je dis : La conclusion des économistes est la liberté. Mais, pour que cette conclusion obtienne l’assentiment des intelligences et attire à elle les cœurs, il faut qu’elle soit solidement fondée sur cette prémisse : Les intérêts, abandonnés à eux-mêmes, tendent à des combinaisons harmoniques, à la prépondérance progressive du bien général.
Or plusieurs d’entre eux, parmi ceux qui font autorité, ont émis des propositions qui, de conséquence en conséquence, conduisent logiquement au mal absolu, à l’injustice nécessaire, — à l’inégalité fatale et progressive, — au paupérisme inévitable, etc.
Ainsi il en est bien peu, à ma connaissance, qui n’aient attribué de la valeur aux agents naturels, aux dons que Dieu avait prodigués gratuitement à sa créature. Le mot valeur implique que ce qui en est pourvu, nous ne le cédons que moyennant rémunération. Voilà donc des hommes, et en particulier les propriétaires du sol, vendant contre du travail effectif les bienfaits de Dieu, et recevant une récompense pour des utilités auxquelles leur travail est resté étranger. — Injustice évidente, mais nécessaire, disent ces écrivains.
Vient ensuite la célèbre théorie de Ricardo. Elle se résume ainsi : Le prix des subsistances s’établit sur le travail que demande pour les produire le plus pauvre des sols cultivés. Or l’accroissement de la population oblige de recourir à des sols de plus en plus ingrats. Donc l’humanité tout entière (moins les propriétaires) est forcée de donner une somme de travail toujours croissante contre une égale quantité de subsistances ; ou, ce qui revient au même, de recevoir une quantité toujours décroissante de subsistances contre une somme égale de travail ; tandis que les possesseurs du sol voient grossir leurs rentes chaque fois qu’on attaque une terre de qualité inférieure. Conclusion : — Opulence progressive des hommes de loisir ; misère progressive des hommes de travail, — soit : Inégalité fatale.
Apparaît enfin la théorie plus célèbre encore de Malthus. La population tend à s’accroître plus rapidement que les subsistances, et cela, à chaque moment donné de la vie de l’humanité. Or, les hommes ne peuvent être heureux et vivre en paix s’ils n’ont pas de quoi se nourrir. Il n’y a que deux obstacles à cet excédant toujours menaçant de population : la diminution des naissances, ou l’accroissement de la mortalité, dans toutes les horribles formes qui l’accompagnent et la réalisent. La contrainte morale, pour être efficace, devrait être universelle, et nul n’y compte. Il ne reste donc que l’obstacle répressif, le vice, la misère, la guerre, la peste, la famine et la mortalité, soit : Paupérisme inévitable.
Je ne mentionnerai pas d’autres systèmes d’une portée moins générale et qui aboutissent aussi à une désespérante impasse. Par exemple, M. de Tocqueville et beaucoup d’autres comme lui disent : Si l’on admet le droit de primogéniture, on arrive à l’aristocratie la plus concentrée ; si on ne l’admet pas, on arrive à la pulvérisation et à l’improductivité du territoire.
Et ce qu’il y a de remarquable, c’est que ces quatre désolants systèmes ne se heurtent nullement. S’ils se heurtaient, nous pourrions nous consoler en pensant qu’ils sont tous faux, puisqu’ils se détruisent l’un par l’autre. Mais non, ils concordent, ils font partie d’une même théorie générale, laquelle, appuyée de faits nombreux et spécieux, paraissant expliquer l’état convulsif de la société moderne et forte de l’assentiment de plusieurs maîtres de la science, se présente à l’esprit découragé et confondu, avec une autorité effrayante.
Il reste à comprendre comment les révélateurs de cette triste théorie ont pu poser comme principe l'harmonie des intérêts, et comme conclusion la Liberté.
Car, certes, si l’humanité est fatalement poussée par les lois de la Valeur vers l’Injustice, — par les lois de la Rente vers l’Inégalité, — par les lois de la Population vers la Misère, — et par les lois de l’Hérédité vers la Stérilisation, — il ne faut pas dire que Dieu a fait du monde social, comme du monde matériel, une œuvre harmonique ; il faut avouer, en courbant la tête, qu’il s’est plu à le fonder sur une dissonance révoltante et irrémédiable.
Il ne faut pas croire, jeunes gens, que les socialistes aient réfuté et rejeté ce que j’appellerai, pour ne blesser personne, la théorie des dissonances. Non, quoi qu’ils en disent, ils l’ont tenue pour vraie ; et c’est justement parce qu’ils la tiennent pour vraie qu’ils proposent de substituer la Contrainte à la Liberté, l’organisation artificielle à l’organisation naturelle, l’œuvre de leur invention à l’œuvre de Dieu. Ils disent à leurs adversaires (et en cela je ne sais s’ils ne sont pas plus conséquents qu’eux) : Si, comme vous l’aviez annoncé, les intérêts humains laissés à eux-mêmes tendaient à se combiner harmonieusement, nous n’aurions rien de mieux à faire qu’à accueillir et glorifier, comme vous, la Liberté. Mais vous avez démontré d’une manière invincible que les intérêts, si on les laisse se développer librement, poussent l’humanité vers l’injustice, l’inégalité, le paupérisme et la stérilité. Eh bien ! nous réagissons contre votre théorie précisément parce qu’elle est vraie ; nous voulons briser la société actuelle précisément parce qu’elle obéit aux lois fatales que vous avez décrites ; nous voulons essayer de notre puissance, puisque la puissance de Dieu a échoué.
Ainsi, on s’accorde sur le point de départ, on ne se sépare que sur la conclusion.
Les Économistes auxquels j’ai fait allusion disent : Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal ; mais il faut se garder de troubler leur action, parce qu’elle est heureusement contrariée par d’autres lois secondaires qui retardent la catastrophe finale, et toute intervention arbitraire ne ferait qu’affaiblir la digue sans arrêter l’élévation fatale du flot.
Les Socialistes disent : Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal ; il faut les abolir et en choisir d’autres dans notre inépuisable arsenal.
Les catholiques disent : Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal ; il faut leur échapper en renonçant aux intérêts humains, en se réfugiant dans l’abnégation, le sacrifice, l’ascétisme et la résignation.
Et, au milieu de ce tumulte, de ces cris d’angoisse et de détresse, de ces appels à la subversion ou au désespoir résigné, j’essaye de faire entendre cette parole devant laquelle, si elle est justifiée, toute dissidence doit s’effacer : Il n’est pas vrai que les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal.
Ainsi toutes les écoles se divisent et combattent à propos des conclusions qu’il faut tirer de leur commune prémisse. Je nie la prémisse. N’est-ce pas le moyen de faire cesser la division et le combat ?
L’idée dominante de cet écrit, l’harmonie des intérêts, est simple. La simplicité n’est-elle pas la pierre de touche de la vérité ? Les lois de la lumière, du son, du mouvement, nous semblent d’autant plus vraies qu’elles sont plus simples ; pourquoi n’en serait-il pas de même de la loi des intérêts ?
Elle est conciliante. Quoi de plus conciliant que ce qui montre l’accord des industries, des classes, des nations et même des doctrines ?
Elle est consolante, puisqu’elle signale ce qu’il y a de faux dans les systèmes qui ont pour conclusion le mal progressif.
Elle est religieuse, car elle nous dit que ce n’est pas seulement la mécanique céleste, mais aussi la mécanique sociale qui révèle la sagesse de Dieu et raconte sa gloire.
Elle est pratique, et l’on ne peut certes rien concevoir de plus aisément pratique que ceci : Laissons les hommes travailler, échanger, apprendre, s’associer, agir et réagir les uns sur les autres, puisque aussi bien, d’après les décrets providentiels, il ne peut jaillir de leur spontanéité intelligente qu’ordre, harmonie, progrès, le bien, le mieux, le mieux encore, le mieux à l’infini.
— Voilà bien, direz-vous, l’optimisme des économistes ! Ils sont tellement esclaves de leurs propres systèmes, qu’ils ferment les yeux aux faits de peur de les voir. En face de toutes les misères, de toutes les injustices, de toutes les oppressions qui désolent l’humanité, ils nient imperturbablement le mal. L’odeur de la poudre des insurrections n’atteint pas leurs sens blasés ; les pavés des barricades n’ont pas pour eux de langage ; et la société s’écroulera qu’ils répéteront encore : « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. »
Non certes, nous ne pensons pas que tout soit pour le mieux.
J’ai une foi entière dans la sagesse des lois providentielles, et, par ce motif, j’ai foi dans la Liberté.
La question est de savoir si nous avons la Liberté.
La question est de savoir si ces lois agissent dans leur plénitude, si leur action n’est pas profondément troublée par l’action opposée des institutions humaines.
Nier le Mal ! nier la douleur ! qui le pourrait ? Il faudrait oublier qu’on parle de l’homme. Il faudrait oublier qu’on est homme soi-même. Pour que les lois providentielles soient tenues pour harmoniques, il n’est pas nécessaire qu’elles excluent le mal. Il suffit qu’il ait son explication et sa mission, qu’il se serve de limite à lui-même, qu’il se détruise par sa propre action, et que chaque douleur prévienne une douleur plus grande en réprimant sa propre cause.
La société a pour élément l’homme qui est une force libre. Puisque l’homme est libre, il peut choisir ; puisqu’il peut choisir, il peut se tromper ; puisqu’il peut se tromper, il peut souffrir.
Je dis plus : il doit se tromper et souffrir ; car son point de départ est l’ignorance, et devant l’ignorance s’ouvrent des routes infinies et inconnues qui toutes, hors une, mènent à l’erreur.
Or, toute Erreur engendre souffrance. Ou la souffrance retombe sur celui qui s’est égaré, et alors elle met en œuvre la Responsabilité. Ou elle va frapper des êtres innocents de la faute, et, en ce cas, elle fait vibrer le merveilleux appareil réactif de la Solidarité.
L’action de ces lois, combinée avec le don qui nous a été fait de lier les effets aux causes, doit nous ramener, par la douleur même, dans la voie du bien et de la vérité.
Ainsi non-seulement nous ne nions pas le Mal, mais nous lui reconnaissons une mission, dans l’ordre social comme dans l’ordre matériel.
Mais, pour qu’il la remplisse cette mission, il ne faut pas étendre artificiellement la Solidarité de manière à détruire la Responsabilité ; en d’autres termes, il faut respecter la Liberté.
Que si les institutions humaines viennent contrarier en cela les lois divines, le Mal n’en suit pas moins l’erreur, seulement il se déplace. Il frappe qui il ne devait pas frapper ; il n’avertit plus ; il n’est plus un enseignement ; il ne tend plus à se limiter et à se détruire par sa propre action ; il persiste, il s’aggrave, comme il arriverait dans l’ordre physiologique, si les imprudences et les excès commis par les hommes d’un hémisphère ne faisaient ressentir leurs tristes effets que sur les hommes de l’hémisphère opposé.
Or c’est précisément là la tendance non-seulement de la plupart de nos institutions gouvernementales, mais encore et surtout de celles qu’on cherche à faire prévaloir comme remèdes aux maux qui nous affligent. Sous le philanthropique prétexte de développer entre les hommes une Solidarité factice, on rend la Responsabilité de plus en plus inerte et inefficace. On altère, par une intervention abusive de la force publique, le rapport du travail à sa récompense, on trouble les lois de l’industrie et de l’échange, on violente le développement naturel de l’instruction, on dévoie les capitaux et les bras, on fausse les idées, on enflamme les prétentions absurdes, on fait briller aux yeux des espérances chimériques, on occasionne une déperdition inouïe de forces humaines, on déplace les centres de population, on frappe d’inefficacité l’expérience même, bref on donne à tous les intérêts des bases factices, on les met aux prises, et puis on s’écrie : Voyez, les intérêts sont antagoniques. C’est la Liberté qui fait tout le mal. Maudissons et étouffons la Liberté.
Et cependant, comme ce mot sacré a encore la puissance de faire palpiter les cœurs, on dépouille la Liberté de son prestige en lui arrachant son nom ; et c’est sous le nom de concurrence que la triste victime est conduite à l’autel, aux applaudissements de la foule tendant ses bras aux liens de la servitude.
Il ne suffisait donc pas d’exposer, dans leur majestueuse harmonie, les lois naturelles de l’ordre social, il fallait encore montrer les causes perturbatrices qui en paralysent l’action. C’est ce que j’ai essayé de faire dans la seconde partie de ce livre.
Je me suis efforcé d’éviter la controverse. C’était perdre, sans doute, l’occasion de donner aux principes que je voulais faire prévaloir cette stabilité qui résulte d’une discussion approfondie. Mais l’attention, attirée sur les digressions, n’aurait-elle pas été détournée de l’ensemble ? Si je montre l’édifice tel qu’il est, qu’importe comment d’autres l’ont vu, alors même qu’ils m’auraient appris à le voir ?
Et maintenant je fais appel, avec confiance, aux hommes de toutes les écoles qui mettent la justice, le bien général et la vérité au-dessus de leurs systèmes.
Économistes, comme vous, je conclus à la LIBERTÉ ; et si j’ébranle quelques-unes de ces prémisses qui attristent vos cœurs généreux, peut-être y verrez-vous un motif de plus pour aimer et servir notre sainte cause.
Socialistes, vous avez foi dans l’Association. Je vous adjure de dire, après avoir lu cet écrit, si la société actuelle, moins ses abus et ses entraves, c’est-à-dire sous la condition de la Liberté, n’est pas la plus belle, la plus complète, la plus durable, la plus universelle, la plus équitable de toutes les Associations.
Égalitaires, vous n’admettez qu’un principe, la MUTUALITÉ DES SERVICES. Que les transactions humaines soient libres, et je dis qu’elles ne sont et ne peuvent être autre chose qu’un échange réciproque de services toujours décroissants en valeur, toujours croissants en utilité.
Communistes, vous voulez que les hommes, devenus frères, jouissent en commun des biens que la Providence leur a prodigués. Je prétends démontrer que la société actuelle n’a qu’à conquérir la Liberté pour réaliser et dépasser vos vœux et vos espérances : car tout y est commun à tous, à la seule condition que chacun se donne la peine de recueillir les dons de Dieu, ce qui est bien naturel ; ou restitue librement cette peine à ceux qui la prennent pour lui, ce qui est bien juste.
Chrétiens de toutes les communions, à moins que vous ne soyez les seuls qui mettiez en doute la sagesse divine, manifestée dans la plus magnifique de celle de ses œuvres qu’il nous soit donné de connaître, vous ne trouverez pas une expression dans cet écrit qui heurte votre morale la plus sévère ou vos dogmes les plus mystérieux.
Propriétaires, quelle que soit l’étendue de vos possessions, si je prouve que le droit qui vous est aujourd’hui contesté se borne, comme celui du plus simple manœuvre, à recevoir des services contre des services réels par vous ou vos pères positivement rendus, ce droit reposera désormais sur une base inébranlable.
Prolétaires, je me fais fort de démontrer que vous obtenez les fruits du champ que vous ne possédez pas, avec moins d’efforts et de peine que si vous étiez obligés de les faire croître par votre travail direct ; que si on vous donnait ce champ à son état primitif et tel qu’il était avant d’avoir été préparé, par le travail, à la production.
Capitalistes et ouvriers, je me crois en mesure d’établir cette loi : « À mesure que les capitaux s’accumulent, le prélèvement absolu du capital dans le résultat total de la production augmente, et son prélèvement proportionneldiminue ; le travail voit augmenter sa part relative et à plus forte raison sa part absolue. L’effet inverse se produit quand les capitaux se dissipent[1] » — Si cette loi est établie, il en résulte clairement l’harmonie des intérêts entre les travailleurs et ceux qui les emploient.
Disciples de Malthus, philanthropes sincères et calomniés, dont le seul tort est de prémunir l’humanité contre une loi fatale, la croyant fatale, j’aurai à vous soumettre une autre loi plus consolante : « Toutes choses égales d’ailleurs, la densité croissante de population équivaut à une facilité croissante de production. » — Et s’il en est ainsi, certes, ce ne sera pas vous qui vous affligerez de voir tomber du front de notre science chérie sa couronne d’épines.
Hommes de spoliation, vous qui, de force ou de ruse, au mépris des lois ou par l’intermédiaire des lois, vous engraissez de la substance des peuples ; vous qui vivez des erreurs que vous répandez, de l’ignorance que vous entretenez, des guerres que vous allumez, des entraves que vous imposez aux transactions ; vous qui taxez le travail après l’avoir stérilisé, et lui faites perdre plus de gerbes que vous ne lui arrachez d’épis ; vous qui vous faites payer pour créer des obstacles, afin d’avoir ensuite l’occasion de vous faire payer pour en lever une partie ; manifestations vivantes de l’égoïsme dans son mauvais sens, excroissances parasites de la fausse politique, préparez l’encre corrosive de votre critique : à vous seuls je ne puis faire appel, car ce livre a pour but de vous sacrifier, ou plutôt de sacrifier vos prétentions injustes. On a beau aimer la conciliation, il est deux principes qu’on ne saurait concilier : la Liberté et la Contrainte.
Si les lois providentielles sont harmoniques, c’est quand elles agissent librement, sans quoi elles ne seraient pas harmoniques par elles-mêmes. Lors donc que nous remarquons un défaut d’harmonie dans le monde, il ne peut correspondre qu’à un défaut de liberté, à une justice absente. Oppresseurs, spoliateurs, contempteurs de la justice, vous ne pouvez donc entrer dans l’harmonie universelle, puisque c’est vous qui la troublez.
Est-ce à dire que ce livre pourra avoir pour effet d’affaiblir le pouvoir, d’ébranler sa stabilité, de diminuer son autorité ? J’ai en vue le but directement contraire. Mais entendons-nous.
La science politique consiste à discerner ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être dans les attributions de l’État ; et, pour faire ce grand départ, il ne faut pas perdre de vue que l’État agit toujours par l’intermédiaire de la Force. Il impose tout à la fois et les services qu’il rend et les services qu’il se fait payer en retour sous le nom de contributions.
La question revient donc à ceci : Quelles sont les choses que les hommes ont le droit de s’imposer les uns aux autres par la force ? Or je n’en sais qu’une dans ce cas, c’est la justice. Je n’ai pas le droit de forcer qui que ce soit à être religieux, charitable, instruit, laborieux ; mais j’ai le droit de le forcer à être juste ; c’est le cas de légitime défense.
Or il ne peut exister, dans la collection des individus, aucun droit qui ne préexiste dans les individus eux-mêmes. Si donc l’emploi de la force individuelle n’est justifié que par la légitime défense, il suffit de reconnaître que l’action gouvernementale se manifeste toujours par la Force pour en conclure qu’elle est essentiellement bornée à faire régner l’ordre, la sécurité, la justice.
Toute action gouvernementale en dehors de cette limite est une usurpation de la conscience, de l’intelligence, du travail, en un mot de la Liberté humaine.
Cela posé, nous devons nous appliquer sans relâche et sans pitié à dégager des empiétements du pouvoir le domaine entier de l’activité privée ; c’est à cette condition seulement que nous aurons conquis la liberté ou le libre jeu des lois harmoniques, que Dieu a préparées pour le développement et le progrès de l’humanité.
Le Pouvoir sera-t-il pour cela affaibli ? Perdra-t-il de sa stabilité parce qu’il aura perdu de son étendue ? Aura-t-il moins d’autorité, parce qu’il aura moins d’attributions ? S’attirera-t-il moins de respect, parce qu’il s’attirera moins de plaintes ? Sera-t-il davantage le jouet des factions, quand on aura diminué ces budgets énormes et cette influence si convoitée, qui sont l’appât des factions ? Courra-t-il plus de dangers, quand il aura moins de responsabilité ?
Il me semble évident, au contraire, que renfermer la force publique dans sa mission unique, mais essentielle, incontestée, bienfaisante, désirée, acceptée de tous, c’est lui concilier le respect et le concours universel. Je ne vois plus alors d’où pourraient venir les oppositions systématiques, les luttes parlementaires, les insurrections des rues, les révolutions, les péripéties, les factions, les illusions, les prétentions de tous à gouverner sous toutes les formes, les systèmes aussi dangereux qu’absurdes qui enseignent au peuple à tout attendre du gouvernement, cette diplomatie compromettante, ces guerres toujours en perspective, ou ces paix armées presque aussi funestes, ces taxes écrasantes et impossibles à répartir équitablement, cette immixtion absorbante et si peu naturelle de la politique en toutes choses, ces grands déplacements factices de capital et de travail, source de frottements inutiles, de fluctuations, de crises et de dommages. Toutes ces causes et mille autres de troubles, d’irritation, de désaffection, de convoitise et de désordre n’auraient plus de raison d’être ; et les dépositaires du pouvoir, au lieu de la troubler, concourraient à l’universelle harmonie. Harmonie qui n’exclut pas le mal, mais ne lui laisse que la place de plus en plus restreinte que lui font l’ignorance et la perversité de notre faible nature, que sa mission est de prévenir ou de châtier.
Jeunes gens, dans ce temps où un douloureux Scepticisme semble être l’effet et le châtiment de l’anarchie des idées, je m’estimerais heureux si la lecture de ce livre faisait arriver sur vos lèvres, dans l’ordre des idées qu’il agite, ce mot si consolant, ce mot d’une saveur si parfumée, ce mot qui n’est pas seulement un refuge, mais une force, puisqu’on a pu dire de lui qu’il remue les montagnes, ce mot qui ouvre le symbole des chrétiens : JE CROIS. — « Je crois, non d’une foi soumise et aveugle, car il ne s’agit pas du mystérieux domaine de la révélation ; mais d’une foi scientifique et raisonnée, comme il convient à propos des choses laissées aux investigations de l’homme. — Je crois que celui qui a arrangé le monde matériel n’a pas voulu rester étranger aux arrangements du monde social. — Je crois qu’il a su combiner et faire mouvoir harmonieusement des agents libres aussi bien que des molécules inertes. — Je crois que sa providence éclate au moins autant, si ce n’est plus, dans les lois auxquelles il a soumis les intérêts et les volontés que dans celles qu’il a imposées aux pesanteurs et aux vitesses. — Je crois que tout dans la société est cause de perfectionnement et de progrès, même ce qui la blesse. — Je crois que le Mal aboutit au Bien et le provoque, tandis que le Bien ne peut aboutir au Mal, d’où il suit que le Bien doit finir par dominer. — Je crois que l’invincible tendance sociale est une approximation constante des hommes vers un commun niveau physique, intellectuel et moral, en même temps qu’une élévation progressive et indéfinie de ce niveau. — Je crois qu’il suffit au développement graduel et paisible de l’humanité que ses tendances ne soient pas troublées et qu’elles reconquièrent la liberté de leurs mouvements. — Je crois ces choses, non parce que je les désire et qu’elles satisfont mon cœur, mais parce que mon intelligence leur donne un assentiment réfléchi. »
Ah ! si jamais vous prononcez cette parole : JE CROIS, vous serez ardents à la propager, et le problème social sera bientôt résolu, car il est, quoi qu’on en dise, facile à résoudre. — Les intérêts sont harmoniques, — donc la solution est tout entière dans ce mot : LIBERTÉ.
1. ↑ Je rendrai cette loi sensible par des chiffres. Soient trois époques pendant lesquelles le capital s’est accru, le travail restant le même. Soit la production totale aux trois époques, comme : 80 — 100 — 120. Le partage se fera ainsi :
Part du capital. Part du travail.
Total.
Première époque :
45
35
80
Deuxième époque :
50
50
100
Troisième époque :
55
65
120
Bien entendu, ces proportions n’ont d’autre but que d’élucider la pensée.
I
ORGANISATION NATURELLE
ORGANISATION ARTIFICIELLE [2].
Est-il bien certain que le mécanisme social, comme le mécanisme céleste, comme le mécanisme du corps humain, obéisse à des lois générales ? Est-il bien certain que ce soit un ensemble harmonieusement organisé ? Ce qui s’y fait remarquer surtout, n’est-ce pas l’absence de toute organisation ? N’est-ce pas précisément une organisation que recherchent aujourd’hui tous les hommes de cœur et d’avenir, tous les publicistes avancés, tous les pionniers de la pensée ? Ne sommes-nous pas une pure juxtaposition d’individus agissant en dehors de tout concert, livrés aux mouvements d’une liberté anarchique ? Nos masses innombrables, après avoir recouvré péniblement et l’une après l’autre toutes les libertés, n’attendent-elles pas qu’un grand génie les coordonne dans un ensemble harmonieux ? Après avoir détruit, ne faut-il pas fonder ?
Si ces questions n’avaient d’autre portée que celle-ci : La société peut-elle se passer de lois écrites, de règles, de mesures répressives ? chaque homme peut-il faire un usage illimité de ses facultés, alors même qu’il porterait atteinte aux libertés d’autrui, ou qu’il infligerait un dommage à la communauté tout entière ? en un mot, faut-il voir dans cette maxime : Laissez faire, laissez passer, la formule absolue de l’économie politique ? si, dis-je, c’était là la question, la solution ne pourrait être douteuse pour personne. Les économistes ne disent pas qu’un homme peut tuer, saccager, incendier, que la société n’a qu’à le laisser faire ; ils disent que la résistance sociale à de tels actes se manifesterait de fait, même en l’absence de tout code ; que, par conséquent, cette résistance est une loi générale de l’humanité ; ils disent que les lois civiles ou pénales doivent régulariser et non contrarier l’action de ces lois générales qu'elles supposent. Il y a loin d’une organisation sociale fondée sur les lois générales de l’humanité à une organisation artificielle, imaginée, inventée, qui ne tient aucun compte de ces lois, les nie ou les dédaigne, telle enfin que semblent vouloir l’imposer plusieurs écoles modernes.
Car, s’il y a des lois générales qui agissent indépendamment des lois écrites et dont celles-ci ne doivent que régulariser l’action, il faut étudier ces lois générales ; elles peuvent être l’objet d’une science, et l’économie politique existe. Si, au contraire, la société est une invention humaine, si les hommes ne sont que de la matière inerte, auxquels un grand génie, comme dit Rousseau, doit donner le sentiment et la volonté, le mouvement et la vie, alors il n’y a pas d’économie politique ; il n’y a qu’un nombre indéfini d’arrangements possibles et contingents, et le sort des nations dépend du fondateur auquel le hasard aura confié leurs destinées.
Pour prouver que la société est soumise à des lois générales, je ne me livrerai pas à de longues dissertations. Je me bornerai à signaler quelques faits qui, pour être un peu vulgaires, n’en sont pas moins importants.
Rousseau a dit : « Il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous. »
Tels sont les phénomènes sociaux au milieu desquels nous vivons et nous nous mouvons. L’habitude nous a tellement familiarisés avec ces phénomènes, que nous n’y faisons plus attention, pour ainsi dire, à moins qu’ils n’aient quelque chose de brusque et d’anormal qui les impose à notre observation.
Prenons un homme appartenant à une classe modeste de la société, un menuisier de village, par exemple, et observons tous les services qu’il rend à la société et tous ceux qu’il en reçoit ; nous ne tarderons pas à être frappés de l’énorme disproportion apparente.
Cet homme passe sa journée à raboter des planches, à fabriquer des tables et des armoires, il se plaint de sa condition, et cependant que reçoit-il en réalité de cette société en échange de son travail ?
D’abord, tous les jours, en se levant il s’habille, et il n’a personnellement fait aucune des nombreuses pièces de son vêtement. Or, pour que ces vêtements, tout simples qu’ils sont, soient à sa disposition, il faut qu’une énorme quantité de travail, d’industrie, de transports, d’inventions ingénieuses, ait été accomplie. Il faut que des Américains aient produit du coton, des Indiens de l’indigo, des Français de la laine et du lin, des Brésiliens du cuir ; que tous ces matériaux aient été transportés en des villes diverses, qu’ils y aient été ouvrés, filés, tissés, teints, etc.
Ensuite il déjeune. Pour que le pain qu’il mange lui arrive tous les matins, il faut que des terres aient été défrichées, closes, labourées, fumées, ensemencées ; il faut que les récoltes aient été préservées avec soin du pillage ; il faut qu’une certaine sécurité ait régné au milieu d’une innombrable multitude ; il faut que le froment ait été récolté, broyé, pétri et préparé ; il faut que le fer, l’acier, le bois, la pierre aient été convertis par le travail en instruments de travail ; que certains hommes se soient emparés de la force des animaux, d’autres du poids d’une chute d’eau, etc. ; toutes choses dont chacune, prise isolément, suppose une masse incalculable de travail mise en jeu, non-seulement dans l’espace, mais dans le temps.
Cet homme ne passera pas sa journée sans employer un peu de sucre, un peu d’huile, sans se servir de quelques ustensiles.
Il enverra son fils à l’école, pour y recevoir une instruction qui, quoique bornée, n’en suppose pas moins des recherches, des études antérieures, des connaissances dont l’imagination est effrayée.
Il sort : il trouve une rue pavée et éclairée.
On lui conteste une propriété : il trouvera des avocats pour défendre ses droits, des juges pour l’y maintenir, des officiers de justice pour faire exécuter la sentence ; toutes choses qui supposent encore des connaissances acquises, par conséquent des lumières et des moyens d’existence.
Il va à l’église : elle est un monument prodigieux, et le livre qu’il y porte est un monument peut-être plus prodigieux encore de l’intelligence humaine. On lui enseigne la morale, on éclaire son esprit, on élève son âme ; et, pour que tout cela se fasse, il faut qu’un autre homme ait pu fréquenter les bibliothèques, les séminaires, puiser à toutes les sources de la tradition humaine, qu’il ait pu vivre sans s’occuper directement des besoins de son corps.
Si notre artisan entreprend un voyage, il trouve que, pour lui épargner du temps et diminuer sa peine, d’autres hommes ont aplani, nivelé le sol, comblé des vallées, abaissé des montagnes, joint les rives des fleuves, amoindri tous les frottements, placé des véhicules à roues sur des blocs de grès ou des bandes de fer, dompté les chevaux ou la vapeur, etc.
Il est impossible de ne pas être frappé de la disproportion, véritablement incommensurable, qui existe entre les satisfactions que cet homme puise dans la société et celles qu’il pourrait se donner, s’il était réduit à ses propres forces. J’ose dire que, dans une seule journée, il consomme des choses qu’il ne pourrait produire lui-même en dix siècles.
Ce qui rend le phénomène plus étrange encore, c’est que tous les autres hommes sont dans le même cas que lui. Chacun de ceux qui composent la société a absorbé des millions de fois plus qu’il n’aurait pu produire ; et cependant ils ne se sont rien dérobé mutuellement. Et si l’on regarde les choses de près, on s’aperçoit que ce menuisier a payé en services tous les services qui lui ont été rendus. S’il tenait ses comptes avec une rigoureuse exactitude, on se convaincrait qu’il n’a rien reçu sans le payer au moyen de sa modeste industrie ; que quiconque a été employé à son service, dans le temps ou dans l’espace, a reçu ou recevra sa rémunération.
Il faut donc que le mécanisme social soit bien ingénieux, bien puissant, puisqu’il conduit à ce singulier résultat, que chaque homme, même celui que le sort a placé dans la condition la plus humble, a plus de satisfactions en un jour qu’il n’en pourrait produire en plusieurs siècles.
Ce n’est pas tout, et ce mécanisme social paraîtra bien plus ingénieux encore, si le lecteur veut bien tourner ses regards sur lui-même.
Je le suppose simple étudiant. Que fait-il à Paris ? Comment y vit-il ? On ne peut nier que la société ne mette à sa disposition des aliments, des vêtements, un logement, des diversions, des livres, des moyens d’instruction, une multitude de choses enfin, dont la production, seulement pour être expliquée, exigerait un temps considérable, à plus forte raison pour être exécutée. Et, en retour de toutes ces choses, qui ont demandé tant de travail, de sueurs, de fatigues, d’efforts physiques ou intellectuels, de transports, d’inventions, de transactions, quels services cet étudiant rend-il à la société ? Aucun ; seulement il se prépare à lui en rendre. Comment donc ces millions d’hommes qui se sont livrés à un travail positif, effectif et productif, lui en ont-ils abandonné les fruits ? Voici l’explication : c’est que le père de cet étudiant, qui était avocat, médecin ou négociant, avait rendu autrefois des services, — peut-être à la société chinoise, — et en avait retiré, non des services immédiats, mais des droits à des services qu’il pourrait réclamer dans le temps, dans le lieu et sous la forme qu’il lui conviendrait. C’est de ces services lointains et passés que la société s’acquitte aujourd’hui ; et, chose étonnante ! si l’on suivait par la pensée la marche des transactions infinies qui ont dû avoir lieu pour atteindre le résultat, on verrait que chacun a été payé de sa peine ; que ces droits ont passé de main en main, tantôt se fractionnant, tantôt se groupant jusqu’à ce que, par la consommation de cet étudiant, tout ait été balancé. N’est-ce pas là un phénomène bien étrange ?
On fermerait les yeux à la lumière, si l’on refusait de reconnaître que la société ne peut présenter des combinaisons si compliquées, dans lesquelles les lois civiles et pénales prennent si peu de part, sans obéir à un mécanisme prodigieusement ingénieux. Ce mécanisme est l’objet qu’étudie l’Économie politique.
Une chose encore digne de remarque, c’est que dans ce nombre, vraiment incalculable, de transactions qui ont abouti à faire vivre pendant un jour un étudiant, il n’y en a peut-être pas la millionième partie qui se soit faite directement. Les choses dont il a joui aujourd’hui, et qui sont innombrables, sont l’œuvre d’hommes dont un grand nombre ont disparu depuis longtemps de la surface de la terre. Et pourtant ils ont été rémunérés comme ils l’entendaient, bien que celui qui profite aujourd’hui du produit de leur travail n’ait rien fait pour eux. Il ne les a pas connus, il ne les connaîtra jamais. Celui qui lit cette page, au moment même où il la lit, a la puissance, quoiqu’il n’en ait peut-être pas conscience, de mettre en mouvement des hommes de tous les pays, de toutes les races, et je dirai presque de tous les temps, des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes ; il fait concourir à ses satisfactions actuelles des générations éteintes, des générations qui ne sont pas nées ; et cette puissance extraordinaire, il la doit à ce que son père a rendu autrefois des services à d’autres hommes qui, en apparence, n’ont rien de commun avec ceux dont le travail est mis en œuvre aujourd’hui. Cependant il s’est opéré une telle balance, dans le temps et dans l’espace, que chacun a été rétribué et a reçu ce qu’il avait calculé devoir recevoir.
En vérité, tout cela a-t-il pu se faire, des phénomènes aussi extraordinaires ont-ils pu s’accomplir sans qu’il y eût, dans la société, une naturelle et savante organisation qui agit pour ainsi dire à notre insu ?
On parle beaucoup de nos jours d’inventer une nouvelle organisation. Est-il bien certain qu’aucun penseur, quelque génie qu’on lui suppose, quelque autorité qu’on lui donne, puisse imaginer et faire prévaloir une organisation supérieure à celle dont je viens d’esquisser quelques résultats ?
Que serait-ce, si j’en décrivais aussi les rouages, les ressorts et les mobiles ?
Ces rouages sont des hommes, c’est-à-dire des êtres capables d’apprendre, de réfléchir, de raisonner, de se tromper, de se rectifier, et par conséquent d’agir sur l’amélioration ou sur la détérioration du mécanisme lui-même. Ils sont capables de satisfaction et de douleur, et c’est en cela qu’ils sont non-seulement les rouages, mais les ressorts du mécanisme. Ils en sont aussi les mobiles, car le principe d’activité est en eux. Ils sont plus que cela encore, ils en sont l’objet même et le but, puisque c’est en satisfactions et en douleurs individuelles que tout se résout en définitive.
Or on a remarqué, et malheureusement il n’a pas été difficile de remarquer, que, dans l’action, le développement et même le progrès (par ceux qui l’admettent) de ce puissant mécanisme, bien des rouages étaient inévitablement, fatalement écrasés ; que, pour un grand nombre d’êtres humains, la somme des douleurs imméritées surpassait de beaucoup la somme des jouissances.
À cet aspect, beaucoup d’esprits sincères, beaucoup de cœurs généreux ont douté du mécanisme lui-même. Ils l’ont nié, ils ont refusé de l’étudier, ils ont attaqué, souvent avec violence, ceux qui en avaient recherché et exposé les lois ; ils se sont levés contre la nature des choses, et enfin ils ont proposé d’organiser la société sur un plan nouveau, où l’injustice, la souffrance et l’erreur ne sauraient trouver place.
À Dieu ne plaise que je m’élève contre des intentions manifestement philanthropiques et pures ! Mais je déserterais mes convictions, je reculerais devant les injonctions de ma propre conscience, si je ne disais que, selon moi, ces hommes sont dans une fausse voie.
En premier lieu ils sont réduits, par la nature même de leur propagande, à la triste nécessité de méconnaître le bien que la société développe, de nier ses progrès, de lui imputer tous les maux, de les rechercher avec un soin presque avide et de les exagérer outre mesure.
Quand on croit avoir découvert une organisation sociale différente de celle qui est résultée des naturelles tendances de l’humanité, il faut bien, pour faire accepter son invention, décrire sous les couleurs les plus sombres les résultats de l’organisation qu’on veut abolir. Aussi les publicistes auxquels je fais allusion, après avoir proclamé avec enthousiasme et peut-être exagéré la perfectibilité humaine, tombent dans l’étrange contradiction de dire que la société se détériore de plus en plus. À les entendre, les hommes sont mille fois plus malheureux qu’ils ne l’étaient dans les temps anciens, sous le régime féodal et sous le joug de l’esclavage ; le monde est devenu un enfer. S’il était possible d’évoquer le Paris du dixième siècle, j’ose croire qu’une telle thèse serait insoutenable.
Ensuite ils sont conduits à condamner le principe même d’action des hommes, je veux dire l'intérêt personnel, puisqu’il a amené un tel état de choses. Remarquons que l’homme est organisé de telle façon, qu’il recherche la satisfaction et évite la peine ; c’est de là, j’en conviens, que naissent tous les maux sociaux, la guerre, l’esclavage, le monopole, le privilège ; mais c’est de là aussi que viennent tous les biens, puisque la satisfaction des besoins et la répugnance pour la douleur sont les mobiles de l’homme. La question est donc de savoir si ce mobile qui, par son universalité, d’individuel devient social, n’est pas en lui-même un principe de progrès.
En tout cas, les inventeurs d’organisations nouvelles ne s’aperçoivent-ils pas que ce principe, inhérent à la nature même de l’homme, les suivra dans leurs organisations, et que là il fera bien d’autres ravages que dans notre organisation naturelle, où les prétentions injustes et l’intérêt de l’un sont au moins contenus par la résistance de tous ? Ces publicistes supposent toujours deux choses inadmissibles : la première, que la société telle qu’ils la conçoivent sera dirigée par des hommes infaillibles et dénués de ce mobile, — l’intérêt ; la seconde, que la masse se laissera diriger par ces hommes.
Enfin les Organisateurs ne paraissent pas se préoccuper le moins du monde des moyens d’exécution. Comment feront-ils prévaloir leurs systèmes ? Comment décideront-ils tous les hommes à la fois à renoncer à ce mobile qui les fait mouvoir : l’attrait pour les satisfactions, la répugnance pour les douleurs ? Il faudrait donc, comme disait Rousseau, changer la constitution morale et physique de l’homme ?
Pour déterminer tous les hommes à la fois à rejeter comme un vêtement incommode l’ordre social actuel, dans lequel l’humanité a vécu et s’est développée depuis son origine jusqu’à nos jours, à adopter une organisation d’invention humaine et à devenir les pièces dociles d’un autre mécanisme, il n’y a, ce me semble, que deux moyens : la Force, ou l’Assentiment universel.
Il faut, ou bien que l’organisateur dispose d’une force capable de vaincre toutes les résistances, de manière à ce que l’humanité ne soit entre ses mains qu’une cire molle qui se laisse pétrir et façonner à sa fantaisie ; ou obtenir, par la persuasion, un assentiment, si complet, si exclusif, si aveugle même, qu’il rende inutile l’emploi de la force.
Je défie qu’on me cite un troisième moyen de faire triompher, de faire entrer dans la pratique humaine un phalanstère ou toute autre organisation sociale artificielle.
Or, s’il n’y a que ces deux moyens et si l’on démontre que l’un est aussi impraticable que l’autre, on prouve par cela même que les organisateurs perdent leur temps et leur peine.
Quant à disposer d’une force matérielle qui leur soumette tous les rois et tous les peuples de la terre, c’est à quoi les rêveurs, tout rêveurs qu’ils sont, n’ont jamais songé. Le roi Alphonse avait bien l’orgueil de dire : « Si j’étais entré dans les conseils de Dieu, le monde planétaire serait mieux arrangé. » Mais s’il mettait sa propre sagesse au-dessus de celle du Créateur, il n’avait pas au moins la folie de vouloir lutter de puissance avec Dieu ; et l’histoire ne rapporte pas qu’il ait essayé de faire tourner les étoiles selon les lois de son invention. Descartes aussi se contenta de composer un petit monde de dés et de ficelles, sachant bien qu’il n’était pas assez fort pour remuer l’univers. Nous ne connaissons que Xerxès qui, dans l’enivrement de sa puissance, ait osé dire aux flots : « Vous n’irez pas plus loin. » Les flots cependant ne reculèrent pas devant Xerxès ; mais Xerxès recula devant les flots, et, sans cette humiliante mais sage précaution, il aurait été englouti.
La Force manque donc aux Organisateurs pour soumettre l’humanité à leurs expérimentations. Quand ils gagneraient à leur cause l’autocrate russe, le schah de Perse, le kan des Tartares et tous les chefs des nations qui exercent sur leurs sujets un empire absolu, ils ne parviendraient pas encore à disposer d’une force suffisante pour distribuer les hommes en groupes et séries, et anéantir les lois générales de la propriété, de l’échange, de l’hérédité et de la famille ; car, même en Russie, même en Perse et en Tartarie, il faut compter plus ou moins avec les hommes. Si l’empereur de Russie s’avisait de vouloir altérer la constitution morale et physique de ses sujets, il est probable qu’il aurait bientôt un successeur, et que ce successeur ne serait pas tenté de poursuivre l’expérience.
Puisque la force est un moyen tout à fait hors de la portée de nos nombreux Organisateurs, il ne leur reste d’autre ressource que d’obtenir l’assentiment universel.
Il y a pour cela deux moyens : la persuasion et l’imposture.
La persuasion ! mais on n’a jamais vu deux intelligences s’accorder parfaitement sur tous les points d’une seule science. Comment donc tous les hommes, de langues, de races, de mœurs diverses, répandus sur la surface du globe, la plupart ne sachant pas lire, destinés à mourir sans entendre parler du réformateur, accepteront-ils unanimement la science universelle ? De quoi s’agit-il ? De changer le mode de travail, d’échanges, de relations domestiques, civiles, religieuses, en un mot, d’altérer la constitution physique et morale de l’homme ; — et l’on espérerait rallier l’humanité tout entière par la conviction !
Vraiment la tâche paraît bien ardue.
Quand on vient dire à ses semblables :
« Depuis cinq mille ans, il y a eu un malentendu entre Dieu et l’humanité ;
Depuis Adam jusqu’à nous, le genre humain fait fausse route, et pour peu qu’il me croie, je le vais mettre en bon chemin ;
Dieu voulait que l’humanité marchât différemment, elle ne l’a pas voulu, et voilà pourquoi le mal s’est introduit dans le monde. Qu’elle se retourne tout entière à ma voix pour prendre une direction inverse, et le bonheur universel va luire sur elle. »
Quand, dis-je, on débute ainsi, c’est beaucoup si l’on est cru de cinq ou six adeptes ; de là à être cru d’un milliard d’hommes, il y a loin, bien loin ! si loin, que la distance est incalculable.
Et puis songez que le nombre des inventions sociales est aussi illimité que le domaine de l’imagination ; qu’il n’y a pas un publiciste, qui, se renfermant pendant quelques heures dans son cabinet, n’en puisse sortir avec un plan d’organisation artificielle à la main ; que les inventions de Fourier, Saint-Simon, Owen, Cabet, Blanc, etc., ne se ressemblent nullement entre elles ; qu’il n’y a pas de jour qui n’en voie éclore d’autres encore ; que, véritablement, l’humanité a quelque peu raison de se recueillir et d’hésiter avant de rejeter l’organisation sociale que Dieu lui a donnée, pour faire, entre tant d’inventions sociales, un choix définitif et irrévocable. Car, qu’arriverait-il, si, lorsqu’elle aurait choisi un de ces plans, il s’en présentait un meilleur ? Peut-elle chaque jour constituer la propriété, la famille, le travail, l’échange sur des bases différentes ? Doit-elle s’exposer à changer d’organisation tous les matins ?
« Ainsi donc, comme dit Rousseau, le législateur ne pouvant employer ni la force, ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. »
Quelle est cette autorité ? L’imposture. Rousseau n’ose pas articuler le mot ; mais, selon son usage invariable en pareil cas, il le place derrière le voile transparent d’une tirade d’éloquence :
« Voilà, dit-il, ce qui força de tous les temps les Pères des nations de recourir à l’intervention du ciel, et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples soumis aux lois de l’État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui l’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, etc. »
Et pour qu’on ne s’y trompe pas, il laisse à Machiavel, en le citant, le soin d’achever sa pensée : Mai non fu alcuno ordinatore di leggi STRAORDINARIE in un popolo che non ricorresse a Dio.
Pourquoi Machiavel conseille-t-il de recourir à Dieu,et Rousseauaux dieux, aux immortels ? Je laisse au lecteur à résoudre la question.
Certes je n’accuse pas les modernes Pères des nations d’en venir à ces indignes supercheries. Cependant il ne faut pas se dissimuler que, lorsqu’on se place à leur point de vue, on comprend qu’ils se laissent facilement entraîner par le désir de réussir. Quand un homme sincère et philanthrope est bien convaincu qu’il possède un secret social, au moyen duquel tous ses semblables jouiraient dans ce monde d’une félicité sans bornes ; quand il voit clairement qu’il ne peut faire prévaloir son idée ni par la force ni par le raisonnement, et que la supercherie est sa seule ressource, il doit éprouver une bien forte tentation. On sait que les ministres mêmes de la religion qui professe au plus haut degré l’horreur du mensonge, n’ont pas reculé devant les fraudes pieuses ; et l’on voit, par l’exemple de Rousseau, cet austère écrivain qui a inscrit en tête de tous ses ouvrages cette devise : Vitam impendere vero, que l’orgueilleuse philosophie elle-même peut se laisser séduire à l’attrait de cette maxime bien différente : La fin justifie les moyens. Qu’y aurait-il de surprenant à ce que les Organisateurs modernes songeassent aussi à honorer les dieux de leur propre sagesse, à mettre leurs décisions dans la bouche des immortels, à entraîner sans violence et à persuader sans convaincre ?
On sait qu’à l’exemple de Moïse, Fourier a fait précéder son Deutéronome d’une Genèse. Saint-Simon et ses disciples avaient été plus loin dans leurs velléités apostoliques. D’autres, plus avisés, se rattachent à la religion la plus étendue, en la modifiant selon leurs vues, sous le nom de néo-christianisme ; et il n’y a personne qui ne soit frappé du ton d’afféterie mystique que presque tous les Réformateurs modernes introduisent dans leur prédication.
Mais les efforts qui ont été essayés dans ce sens n’ont servi qu’à prouver une chose qui a, il est vrai, son importance : c’est que, de nos jours, n’est pas prophète qui veut. On a beau se proclamer Dieu, on n’est cru de personne, ni du public, ni de ses compères, ni de soi-même.
Puisque j’ai parlé de Rousseau, je me permettrai de faire ici quelques réflexions sur cet organisateur, d’autant qu’elles serviront à faire comprendre en quoi les organisations artificielles diffèrent de l’organisation naturelle. Cette digression n’est pas d’ailleurs tout à fait intempestive, puisque, depuis quelque temps, on signale le Contrat social comme l’oracle de l’avenir.
Rousseau était convaincu que l’isolement était l'état de nature de l’homme, et que, par conséquent, la société était d’invention humaine. « L’ordre social, dit-il en débutant, ne vient pas de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. »
En outre, ce philosophe, quoique aimant avec passion la liberté, avait une triste opinion des hommes. Il les croyait tout à fait incapables de se donner une bonne institution. L’intervention d’un fondateur, d’un législateur, d’un père des nations, était donc indispensable.