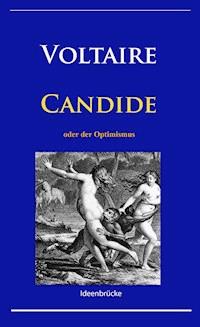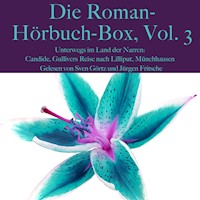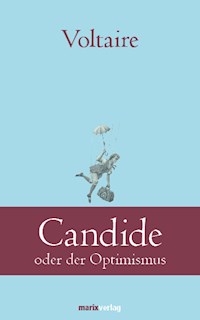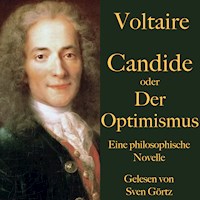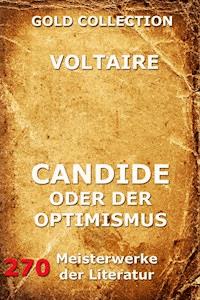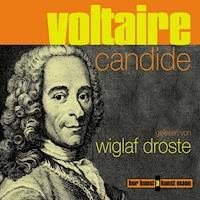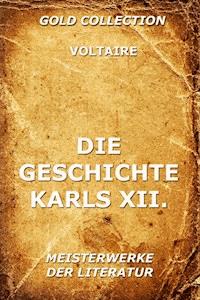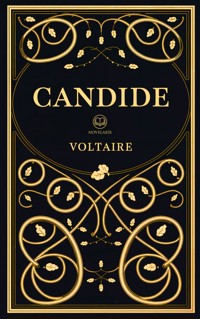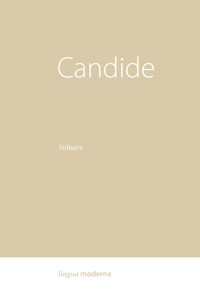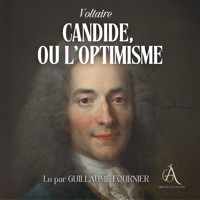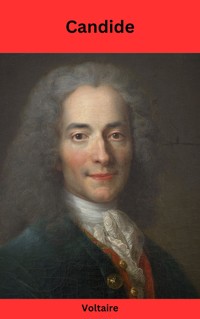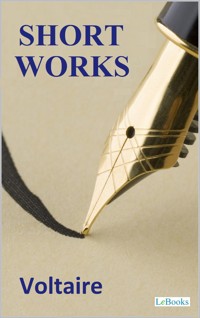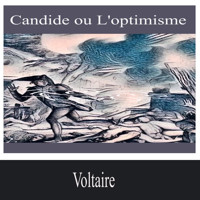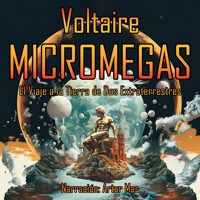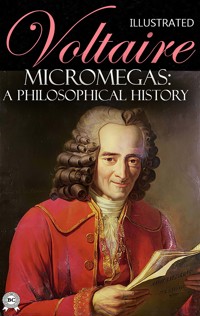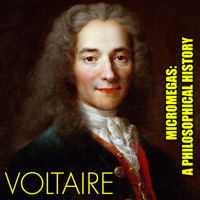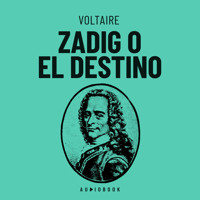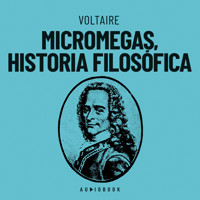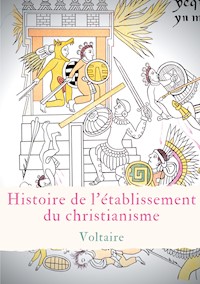
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ce texte méconnu de Voltaire, mais primordial pour comprendre l'étendue de sa réflexion concernant la liberté de pensée et la tolérance, est d'une vibrante actualité. Voltaire y traite de ses sujets les plus chers : l'hypocrisie des religions monothéistes et de leur clergé, le fanatisme et le radicalisme qu'elles engendrent. L'Histoire de l'établissement du christianisme a été publié sous un pseudonyme anglais en 1777 et s'inscrit dans la lignée de livres déjà parus sur ce sujet comme la Collection d'anciens Evangiles dans lequel Voltaire traduit lui-même plusieurs Evangiles de l'hébreu. Dans l'Histoire de l'établissement du christianisme, Voltaire propose une critique acerbe mais éclairée du christianisme en se présentant comme un déiste s'opposant aux pratiques superstitieuses. Tout en reconnaissant la présence d'un dieu, il refuse les dérives fanatiques et les violences commises en son nom. Extrait : "C'est ce mépris des honnêtes gens, c'est cette voix de la raison entendue d'un bout de l'Europe à l'autre, qui triomphe aujourd'hui du fanatisme sans autre effort que la force de la vérité. Les sages éclairés ont persuadé les ignorants qui n'étaient pas sages. Peu à peu les nations ont été étonnées d'avoir cru si longtemps des absurdités (horribles) qui devaient épouvanter le bon sens et la nature."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I. Que les Juifs et leurs livres furent très longtemps ignorés des autres peuples.
Chapitre II. Que les Juifs ignorèrent longtemps le dogme de l’immortalité de l’âme.
Chapitre III. Comment le platonisme
Chapitre IV. Sectes des Juifs.
Chapitre V. Superstitions juives.
Chapitre VI. De la personne de Jésu.
Chapitre VII. Des disciples de Jésu.
Chapitre VIII. De Saul, dont le nom fut
Chapitre IX. Des Juifs d’Alexandrie, et du Verbe.
Chapitre X. Du dogme de la fin du monde, joint au platonisme.
Chapitre XI. De l’abus étonnant des mystères chrétiens.
Chapitre XII. Que les quatre évangiles furent connus les derniers. Livres, miracles, martyrs supposés.
Chapitre XIII. Des progrès de l’association chrétienne. Raisons de ces progrès.
Chapitre XIV. Affermissement de l’association chrétienne sous plusieurs empereurs, et surtout sous Dioclétien.
Chapitre XV. De Constance Chlore, ou le pâle, et de l’abdication de Dioclétien.
Chapitre XVI. De constantin.
Chapitre XVII. Du « labarum »
Chapitre XVIII. Du concile de Nicée.
Chapitre XIX. De la donation de Constantin, et du pape de Rome Silvestre. Court examen si Pierre a été pape a Rome.
Chapitre XX. De la famille de Constantin, et de l’empereur Julien le philosophe[53].
Chapitre XXI. Questions sur l’empereur Julien.
Chapitre XXII. En quoi le christianisme pouvait être utile.
Chapitre XXIII. Que la tolérance est le principal remède contre le fanatisme.
Chapitre XXIV. Excès du fanatisme.
Chapitre XXV. Contradictions funestes.
Chapitre XXVI. Du théisme.
Chapitre I. Que les Juifs et leurs livres furent très longtemps ignorés des autres peuples.
D’épaisses ténèbres envelopperont toujours le berceau du christianisme. On en peut juger par les huit opinions principales qui partagèrent les savants sur l’époque de la naissance de Jésu ou Josuah ou Jeschu, fils de Maria ou Mirja, reconnu pour le fondateur ou la cause occasionnelle de cette religion, quoiqu’il n’ait jamais pensé à faire une religion nouvelle. Les chrétiens passèrent environ six cent cinquante années avant d’imaginer de dater les événements de la naissance de Jésu. Ce fut un moine scythe, nommé Dionysios (Denys le petit), transplanté à Rome, qui proposa cette ère sous le règne de l’empereur Justinien ; mais elle ne fut adoptée que cent ans après lui. Son système sur la date de la naissance de Jésu était encore plus erroné que les huit opinions des autres chrétiens. Mais enfin ce système, tout faux qu’il est, prévalut. Une erreur est le fondement de tous nos almanachs.
L’embryon de la religion chrétienne, formé chez les Juifs sous l’empire de Tibère, fut ignoré des Romains pendant plus de deux siècles. Ils surent confusément qu’il y avait une secte juive appelée galiléenne, ou pauvre, ou chrétienne ; mais c’est tout ce qu’ils en savaient : et on voit que Tacite et Suétone n’en étaient pas véritablement instruits. Tacite parle des Juifs au hasard, et Suétone se contente de dire que l’empereur Claude réprima les Juifs qui excitaient des troubles à Rome, à l’instigation d’un nommé Christ ou Chrest : Judeos impulsore Chresto assidue tumultuantes repressit[2]. Cela n’est pas étonnant. Il y avait huit mille Juifs à Rome qui avaient droit de synagogue, et qui recevaient des empereurs les libéralités congiaires de blé, sans que personne daignât s’informer des dogmes de ce peuple. Les noms de Jacob, d’Abraham, de Noé, d’Adam, et d’Ève, étaient aussi inconnus du sénat que le nom de Manco-Capac l’était de Charles-Quint avant la conquête du Pérou.
Aucun nom de ceux qu’on appelle patriarches n’était jamais parvenu à aucun auteur grec. Cet Adam, qui est aujourd’hui regardé en Europe comme le père du genre humain par les chrétiens et par les musulmans, fut toujours ignoré du genre humain jusqu’au temps de Dioclétien et de Constantin.
C’est douze cent dix ans avant notre ère vulgaire qu’on place la ruine de Troie, en suivant la chronologie des fameux marbres de Paros. Nous plaçons d’ordinaire l’aventure du Juif Jephté en ce temps-là même. Le petit peuple hébreu ne possédait pas encore la ville capitale. Il n’eut la ville de Shéba que quarante ans après, et c’est cette Shéba, voisine du grand désert de l’Arabie Pétrée, qu’on nomma Hershalaïm, et ensuite Jérusalem, pour adoucir la dureté de la prononciation.
Avant que les Juifs eussent cette forteresse, il y avait déjà une multitude de siècles que les grands empires d’Égypte, de Syrie, de Chaldée, de Perse, de Scythie, des Indes, de la Chine, du Japon, étaient établis. Le peuple judaïque ne les connaissait pas, n’avait que des notions très imparfaites de l’Égypte et de la Chaldée. Séparé de l’Égypte, de la Chaldée, et de la Syrie, par un désert inhabitable ; sans aucun commerce réglé avec Tyr ; isolé dans le petit pays de la Palestine, large de quinze lieues et long de quarante-cinq, comme l’affirme saint Hiéronyme ou Jérôme, il ne s’adonnait à aucune science, il ne cultivait presque aucun art. Il fut plus de six cents ans sans aucun commerce avec les autres peuples, et même avec ses voisins d’Égypte et de Phénicie. Cela est si vrai que Flavius Josèphe, leur historien, en convient formellement, dans sa réponse à Apion d’Alexandrie, réponse faite sous Titus à cet Apion, qui était mort du temps de Néron.
Voici les paroles de Flavius Josèphe au chapitre IV : « Le pays que nous habitons étant éloigné de la mer, nous ne nous appliquons point au commerce, et n’avons point de communication avec les autres peuples ; nous nous contentons de fertiliser nos terres, et de donner une bonne éducation à nos enfants. Ces raisons, ajoutées à ce que j’ai déjà dit, font voir que nous n’avons point eu de communication avec les Grecs, comme les Égyptiens et les Phéniciens, etc. »
Nous n’examinerons point ici dans quel temps les Juifs commencèrent à exercer le commerce, le courtage, et l’usure, et quelle restriction il faut mettre aux paroles de Flavius Josèphe. Bornons-nous à faire voir que les Juifs, tout plongés qu’ils étaient dans une superstition atroce, ignorèrent toujours le dogme de l’immortalité de l’âme, embrassé depuis si longtemps par toutes les nations dont ils étaient environnés. Nous ne cherchons point à faire leur histoire : il n’est question que de montrer ici leur ignorance.
Chapitre II. Que les Juifs ignorèrent longtemps le dogme de l’immortalité de l’âme.
C’est beaucoup que les hommes aient pu imaginer par le seul secours du raisonnement qu’ils avaient une âme : car les enfants n’y pensent jamais d’eux-mêmes ; ils ne sont jamais occupés que de leurs sens, et les hommes ont dû être enfants pendant bien des siècles. Aucune nation sauvage ne connut l’existence de l’âme. Le premier pas dans la philosophie des peuples un peu policés fut de reconnaître un je ne sais quoi qui dirigeait les hommes, les animaux, les végétaux, et qui présidait à leur vie : ce je ne sais quoi, ils l’appelèrent d’un nom vague et indéterminé qui répond à notre mot d’âme. Ce mot ne donna chez aucun peuple une idée distincte. Ce fut, et c’est encore, et ce sera toujours, une faculté, une puissance secrète, un ressort, un germe inconnu par lequel nous vivons, nous pensons, nous sentons ; par lequel les animaux se conduisent, et qui fait croître les fleurs et les fruits : de là les âmes végétatives, sensitives, intellectuelles, dont on nous a tant étourdis. Le dernier pas fut de conclure que notre âme subsistait après notre mort, et qu’elle recevait dans une autre vie la récompense de ses bonnes actions ou le châtiment de ses crimes. Ce sentiment était établi dans l’Inde avec la métempsycose, il y a plus de cinq mille années. L’immortalité de cette faculté qu’on appelle âme était reçue chez les anciens Perses, chez les anciens Chaldéens : c’était le fondement de la religion égyptienne, et les Grecs adoptèrent bientôt cette théologie. Ces âmes étaient supposées être de petites figures légères et aériennes, ressemblantes parfaitement à nos corps. On les appelait dans toutes les langues connues de noms qui signifiaient ombres, mânes, génies, démons, spectres, lares, larves, farfadets, esprits, etc.
Les brachmanes furent les premiers qui imaginèrent un monde, une planète, où Dieu emprisonna les anges rebelles, avant la formation de l’homme. C’est de toutes les théologies la plus ancienne.
Les Perses avaient un enfer : on le voit par cette fable si connue qui est rapportée dans le livre de la Religion des anciens Perses de notre savant Hyde[3] . Dieu apparaît à un des premiers rois de Perse, il le mène en enfer ; il lui fait voir les corps de tous les princes qui ont mal gouverné : il s’en trouve un auquel il manquait un pied[4] . « Qu’avez-vous fait de son pied ? dit le Persan à Dieu. — Ce coquin-là, répond Dieu, n’a fait qu’une action honnête en sa vie il rencontra un âne lié à une auge, mais si éloignée de lui qu’il ne pouvait manger. Le roi eut pitié de l’âne, il donna un coup de pied à l’auge, l’approcha, et l’âne mangea. J’ai mis ce pied dans le ciel, et le reste de son corps en enfer. »
On connaît le Tartare des Égyptiens, imité par les Grecs et adopté par les Romains. Qui ne sait combien de dieux et de fils de dieux ces Grecs et ces Romains forgèrent depuis Bacchus, Persée, et Hercule, et comme ils remplirent l’enfer d’Ixions et de Tantales ?
Les Juifs ne surent jamais rien de cette théologie. Ils eurent la leur, qui se borna à promettre du blé, du vin et de l’huile, à ceux qui obéiront au Seigneur en égorgeant tous les ennemis d’Israël, et à menacer de la rogne et d’ulcères dans le gras des jambes, et dans le fondement, tous ceux qui désobéiront[5] ; mais d’âmes, de punitions dans les enfers, de récompenses dans le ciel, d’immortalité, de résurrection, il n’en est dit un seul mot ni dans leurs lois, ni chez leurs prophètes.
Quelques écrivains, plus zélés qu’instruits, ont prétendu que si le Lévitique et le Deutéronome ne parlent jamais en effet de l’immortalité de l’âme, et de récompenses ou de châtiments après la mort, il y a pourtant des passages, dans d’autres livres du canon juif, qui pourraient faire soupçonner que quelques Juifs connaissaient l’immortalité de l’âme. Ils allèguent et ils corrompent ce verset de Job : « Je crois que mon protecteur vit, et que dans quelques jours je me relèverai de terre : ma peau, tombée en lambeaux, se consolidera. Tremblez alors, craignez la vengeance de mon épée. »
Ils se sont imaginé que ces mots : « Je ne relèverai, » signifiaient « je ressusciterai après ma mort. » Mais alors comment ceux auxquels Job répond auraient-ils à craindre son épée ? Quel rapport entre la gale de Job et l’immortalité de l’âme ?
Une des plus lourdes bévues des commentateurs est de n’avoir pas songé que ce Job n’était point Juif, qu’il était Arabe ; et qu’il n’y a pas un mot dans ce drame antique de Job qui ait la moindre connexité avec les lois de la nation judaïque.
D’autres, abusant des fautes innombrables de la traduction latine appelée Vulgate, trouvent l’immortalité de l’âme et l’enfer des Grecs dans ces paroles que Jacob prononce[6] en déplorant la perte de son fils Joseph, que les patriarches ses frères avaient vendu comme esclave à des marchands arabes, et qu’ils faisaient passer pour mort : Je mourrai de douleur, je descendrai avec mon fils dans la fosse. La Vulgate a traduit sheol, la fosse, par le mot enfer, parce que la fosse signifie souterrain. Mais quelle sottise de supposer que Jacob ait dit : « Je descendrai en enfer, je serai damné, parce que mes enfants m’ont dit que mon fils Joseph a été mangé par des bêtes sauvages ! » C’est ainsi qu’on a corrompu presque tous les anciens livres par des équivoques absurdes. C’est ainsi qu’on s’est servi de ces équivoques pour tromper les hommes.
Certainement le crime des enfants de Jacob et la douleur du père n’ont rien de commun avec l’immortalité de l’âme. Tous les théologiens sensés, tous les bons critiques en conviennent ; tous avouent que l’autre vie et l’enfer furent inconnus aux Juifs jusqu’au temps d’Hérode. Le docteur Arnauld, fameux théologien de Paris, dit en propres mots, dans son Apologie de Port-Royal : « C’est le comble de l’ignorance de mettre en doute cette vérité, qui est des plus communes, et qui est attestée par tous les pères, que les promesses de l’Ancien Testament n’étaient que temporelles et terrestres, et que les Juifs n’adoraient Dieu que pour des biens charnels. » Notre sage Middleton[7] a rendu cette vérité sensible.
Notre évêque Warburton, déjà connu par son Commentaire de Shakespeare, a démontré en dernier lieu que la loi mosaïque ne dit pas un seul mot de l’immortalité de l’âme, dogme enseigné par tous les législateurs précédents. Il est vrai qu’il en tire une conclusion qui l’a fait siffler dans nos trois royaumes. La loi mosaïque, dit-il, ne connaît point l’autre vie donc cette loi est divine. Il a même soutenu cette assertion avec l’insolence la plus grossière. On sent bien qu’il a voulu prévenir le reproche d’incrédulité, et qu’il s’est réduit lui-même à soutenir la vérité par une sottise ; mais enfin cette sottise ne détruit pas cette vérité, si claire et si démontrée.
L’on peut encore ajouter que la religion des Juifs ne fut fixe et constante qu’après Esdras. Ils n’avaient adoré que des dieux étrangers et des étoiles, lorsqu’ils erraient dans les déserts, si l’on en croit Ézéchiel, Amos, et saint Étienne[8]. La tribu de Dan adora longtemps les idoles de Michas[9] ; et un petit-fils de Moïse, nommé Éléazar, était le prêtre de ces idoles, gagé par toute la tribu.
Salomon fut publiquement idolâtre. Les melchim ou rois d’Israël adorèrent presque tous le dieu syriaque Baal. Les nouveaux Samaritains, du temps du roi de Babylone, prirent pour leurs dieux Sochothbénoth, Nergel, Adramélech, etc.
Sous les malheureux régules de la tribu de Juda, Ézéchias, Manassé, Sosias, il est dit que les Juifs adoraient Baal et Moloch, qu’ils sacrifiaient leurs enfants dans la vallée de Topheth. On trouva enfin le Pentateuque du temps du melk ou roitelet Josias ; mais bientôt après Jérusalem fut détruite, et les tribus de Juda et de Benjamin furent menées en esclavage dans les provinces babyloniennes.
Ce fut là, très vraisemblablement, que plusieurs Juifs se firent courtiers et fripiers : la nécessité fit leur industrie. Quelques-uns acquirent assez de richesses pour acheter du roi que nous nommons Cyrus la permission de rebâtir à Jérusalem un petit temple de bois sur des assises de pierres brutes, et de relever quelques pans de murailles. Il est dit, dans le livre d’Esdras, qu’il revint dans Jérusalem quarante-deux mille trois cent soixante personnes, toutes fort pauvres. Il les compte famille par famille, et il se trompe dans son calcul, au point qu’en additionnant le tout on ne trouve que vingt-neuf mille neuf cent dix-huit personnes. Une autre erreur de calcul subsiste dans le dénombrement de Néhémie ; et une bévue encore plus grande est dans l’édit de Cyrus, qu’Esdras rapporte. Il fait parler ainsi le conquérant Cyrus : « Adonaï le Dieu du ciel m’a donné tous les royaumes de la terre, et m’a commandé de lui bâtir un temple dans Jérusalem, qui est en Judée. » On a très bien remarqué que c’est précisément comme si un prêtre grec faisait dire au Grand Turc : Saint Pierre et saint Paul m’ont donné tous les royaumes du monde, et m’ont commandé de leur bâtir une maison dans Athènes, qui est en Grèce.
Si l’on en croit Esdras, Cyrus, par le même édit, ordonna que les pauvres qui étaient venus à Jérusalem fussent secourus par les riches qui n’avaient pas voulu quitter la Chaldée, où ils se trouvaient très bien, pour un territoire de cailloux, où l’on manquait de tout, et où même on n’avait pas d’eau à boire pendant six mois de l’année. Mais, soit riches, soit pauvres, il est constant qu’aucun Juif de ces temps-là ne nous a laissé la plus légère notion de l’immortalité de l’âme.
Chapitre III. Comment le platonisme pénétra chez les Juifs.
Cependant Socrate et Platon enseignèrent dans Athènes ce dogme qu’ils tenaient de la philosophie égyptienne et de celle de Pythagore. Socrate, martyr de la Divinité et de la raison, fut condamné à mort, environ trois cents ans avant notre ère, par le peuple léger, inconstant, impétueux, d’Athènes, qui se repentit bientôt de ce crime. Platon était jeune encore. Ce fut lui qui, le premier chez les Grecs, essaya de prouver, par des raisonnements métaphysiques, l’existence de l’âme et sa spiritualité, c’est-à-dire sa nature légère et aérienne, exempte de tout mélange de matière grossière ; sa permanence après la mort du corps, ses récompenses et ses châtiments après cette mort ; et même sa résurrection avec un corps tombé en pourriture. Il réduisit cette philosophie en système dans son Phédon, dans son Timée, et dans sa République imaginaire ; il orna ses arguments d’une éloquence harmonieuse et d’images séduisantes.
Il est vrai que ses arguments ne sont pas la chose du monde la plus claire et la plus convaincante. Il prouve d’une étrange manière, dans son Phédon, l’immortalité de l’âme, dont il suppose l’existence sans avoir jamais examiné si ce que nous nommons âme est une faculté donnée de Dieu à l’espèce animale, ou si c’est un être distinct de l’animal même. Voici ses paroles : « Ne dites-vous pas que la mort est le contraire de la vie ? — Oui. — Et qu’elles naissent l’une de l’autre ? — Oui. — Qu’estce donc qui naît du vivant ? — Le mort. — Et qu’est-ce qui naît du mort ?... Il faut avouer que c’est le vivant : c’est donc des morts que naissent toutes les choses vivantes ? — Il me le semble. — Et, par conséquent, les âmes vont dans les enfers après notre mort ? — La conséquence est sûre. »