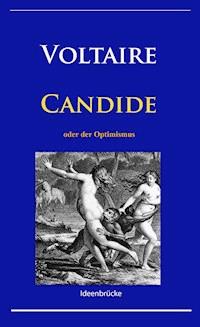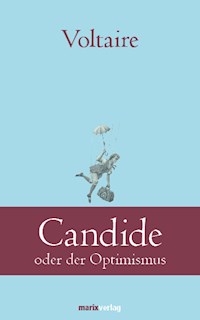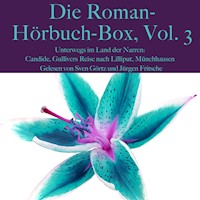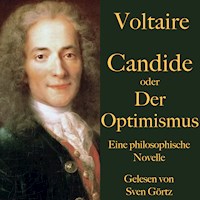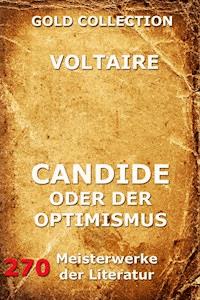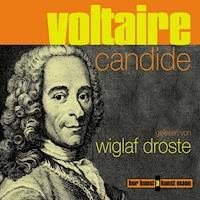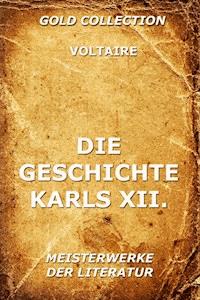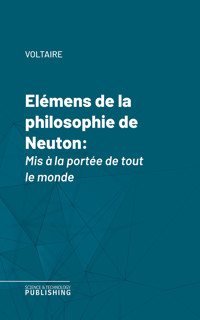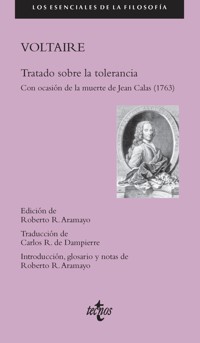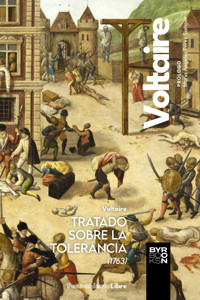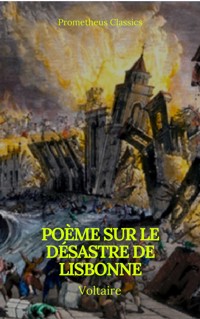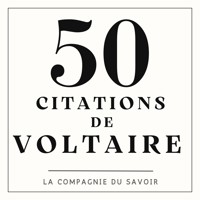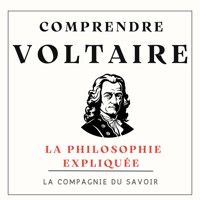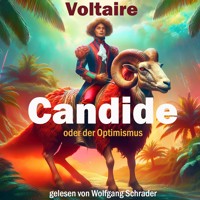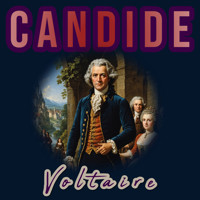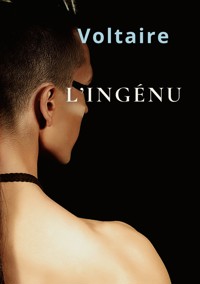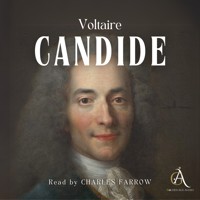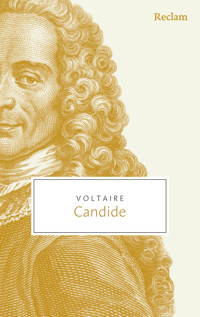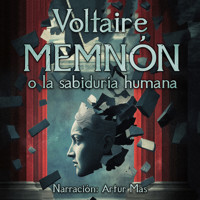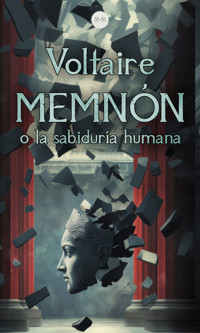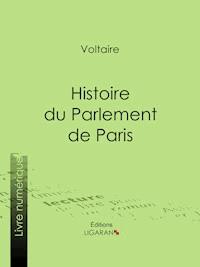
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Presque toutes les nations ont eu des assemblées générales. Les Grecs avaient leur église, dont la société chrétienne prit le nom ; le peuple romain eut ses comices ; les Tartares ont eu leur cour-illé, et ce fut dans une de ces cours-illés que Gengis-kan prépara la conquête de l'Asie. Les peuples du Nord avaient leur vittenagemoth ; et lorsque les Francs, ou Sicambres, se furent rendus maîtres des Gaules,..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091304
©Ligaran 2015
Les désaveux de Voltaire lorsque parut L’Histoire du Parlement de Paris ne convainquirent personne. Ils ne donnèrent que plus de prix à l’ouvrage, en excitant la curiosité. On paya jusqu’à six louis l’exemplaire. Les colporteurs pris en flagrant délit furent châtiés avec une sévérité extrême. D’autant plus chèrement on paya le livre. Ce succès même inquiéta Voltaire, au point qu’il jugea à propos de consulter le jurisconsulte Christin sur les poursuites auxquelles il pouvait être exposé.
Voltaire invoquait principalement pour sa justification l’impossibilité où il était de faire les recherches qu’avait nécessitées une telle œuvre. Il disait au censeur Marin (5 juillet 1769) : « Il y aurait de la folie à prétendre que j’ai pu m’instruire des formes judiciaires de France et rassembler un fatras énorme de dates, moi qui suis absent de France depuis plus de vingt années. » De même, à d’Argental (7 juillet) : « Quant à l’Histoire dont vous me parlez, il est impossible que j’en sois l’auteur ; elle ne peut être que d’un homme qui a fouillé deux ans de suite des archives poudreuses. » À d’Alembert (9 juillet) : « Il me paraît absurde de m’attribuer un ouvrage dans lequel il y a deux ou trois morceaux qui ne peuvent être tirés que d’un greffe poudreux où je n’ai assurément pas mis le pied ; mais la calomnie n’y regarde pas de si près. » À Thieriot (12 juillet) : « Il y a quelques anecdotes assez curieuses qui ne peuvent être tirées que du greffe du parlement même : il n’y a certainement qu’un homme du métier qui puisse être auteur de cet ouvrage. Il faut être enragé pour le mettre sur mon compte. » À l’abbé Morellet (14 juillet) : « Il y a dans cette Histoire des anecdotes dont, Dieu merci, je n’ai jamais entendu parler. »
Comme on le voit, c’était un mot d’ordre qu’il donnait.
Voltaire signalait ainsi deux anecdotes importantes qu’il a rapportées dans l’Histoire du Parlement (p 541-542) et dans l’Essai sur les Mœurs (voyez t. XII, p 537). Il s’agit d’un fait considérable, quoique bien rare : l’intervention du souverain statuant seul et prononçant la peine capitale. Ainsi Henri IV ordonnant que le frère Jehan Leroy fut jeté à l’eau dans un sac, pour crime d’assassinat sur la personne du capitaine Héricourt ; et que le cadavre de Jacques Clément fût tiré à quatre chevaux, brûlé, et ses cendres jetées à la rivière. Il paraît que Voltaire n’avait pu découvrir ces faits que dans le Recueil d’ordonnances des rois de France Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, depuis le 24 décembre 1567 jusqu’au 9 août 1647, manuscrit petit in-folio longtemps enfoui au greffe de Versailles, et maintenant rendu aux Archives nationales, sa place véritable.
M. G. Desnoiresterres fait remarquer que si Voltaire, du fond de son château de Ferney, n’était pas à même de secouer la poussière séculaire d’archives qu’on ne communiquait d’ailleurs qu’à bon escient, il avait des aides et des collaborateurs occultes, autant et plus intéressés que lui à la chute de ce corps redoutable du parlement de Paris ; et que, s’il est vrai que l’ouvrage fût écrit à l’instigation du ministre, comme le déclare Wagnière, il est à croire que ce dernier se prêta à la recherche de pièces probantes.
Il faut toutefois rappeler, comme nous venons de le dire, que les mêmes anecdotes se trouvent déjà consignées dans les mêmes termes au chapitre CLXIII de l’Essai sur les Mœurs.
Lorsque l’ancien parlement fut brisé par le chancelier Maupeou, en janvier 1771, le chancelier, sentant le besoin d’avoir dans son parti des plumes incisives et éloquentes pour répondre aux innombrables pamphlets dont il était assailli, sollicita de loin l’auteur de l’Histoire du Parlement. Voltaire se mit à son service. Il composa brochures contre brochures : Lettres d’un jeune abbé sur les vénalités des charges ; Réponse aux remontrances de la cour des aides ; Avis important d’un gentilhomme à toute la noblesse du royaume ; Sentiment des six consuls établis par le roi et de tous les bons citoyens ; Très humbles et très respectueuses Remontrances du grenier à sel ; les Peuples aux Parlements. Et on lui en attribua plus encore qu’il n’en fit.
Voltaire justifie ainsi son attitude, dans une lettre à la duchesse de Choiseul (13 mai 1771): « Je mourrai aussi fidèle à la foi que je vous ai jurée qu’à ma juste haine contre des hommes qui m’ont persécuté tant qu’ils ont pu, et qui me persécuteraient encore s’ils étaient les maîtres. Je ne dois pas assurément aimer ceux qui devaient me jouer un mauvais tour au mois de janvier, ceux qui versaient le sang de l’innocence, ceux qui portaient la barbarie dans le centre de la politesse ; ceux qui, uniquement occupés de leur sotte vanité, laissaient agir leur cruauté sans scrupule, tantôt en immolant Calas sur la roue, tantôt en faisant expirer dans les supplices, après la torture, un jeune gentilhomme qui méritait six mois de Saint-Lazare, et qui aurait mieux valu qu’eux tous. Ils ont bravé l’Europe entière, indignée de cette inhumanité ; ils ont traîné dans un tombereau, avec un bâillon dans la bouche, un lieutenant général justement haï à la vérité, mais dont l’innocence m’est démontrée par les pièces mêmes du procès. Je pourrais produira vingt barbaries pareilles, et les rendre exécrables à la postérité. J’aurais mieux aimé mourir dans le canton de Zug, ou chez les Samoyèdes, que de dépendre de tels compatriotes. »
L’Histoire du Parlement a été comme la préface du coup d’État de Maupeou ; mais, cette fois, l’opinion publique ne suivit pas l’impulsion que Voltaire avait voulu lui donner, et le rétablissement de l’ancien parlement fut, comme l’on sait, l’un des premiers actes du successeur de Louis XV.
L.M.
L’Histoire du Parlement de Paris, par M. l’abbé Big…, parut en 1769, Amsterdam, deux volumes in-8°. Les Mémoires secrets, connus sous le nom de Bachaumont, en parlent à la date du 25 juin ; mais l’ouvrage circulait dès le mois de mai ; et, avant la fin de l’année, la cinquième édition avait vu le jour. Les trois lettres Big…, et le nombre des points qui les suivent, semblaient indiquer l’abbé Bignon. Sur le frontispice de la huitième édition, qui est de 1770, on lit en toutes lettres : Par M. l’abbé Bigore.
Wagnière, secrétaire de Voltaire, nous apprend que l’Histoire du Parlement fut composée, non sur les matériaux fournis par le ministère, mais à son instigation. Ce n’était pas la faute de l’auteur si le parlement n’avait pas à se louer de la manière dont il y est traité. Voltaire n’avait pu dissimuler la guerre de la Fronde, ni mentir, pour plaire à messieurs, dont il n’avait assurément pas à se louer.
On sut bientôt d’où venait le livre ; on en nommait l’auteur, et comme il était question de poursuites contre lui, il crut les prévenir par des aveux qui furent insérés au Mercure.
Le parlement toutefois renonça, pour le moment, à l’inutile cérémonie de brider le libelle, et au soin plus sérieux d’en rechercher l’auteur.
Mais lorsqu’en octobre 1770 l’avocat général Séguier vint à Ferney, il dit à Voltaire que quatre conseillers le pressaient continuellement de requérir qu’on brûlât l’Histoire du Parlement, et qu’il serait forcé de donner un réquisitoire vers le mois de février 1771. Voltaire crut prudent de déclarer n’avoir aucune part à cette histoire, qu’il regardait d’ailleurs comme très véridique, ajoutant que s’il était possible qu’une compagnie eût de la reconnaissance, le parlement devait des remerciements à l’écrivain qui l’avait extrêmement ménagé. Voltaire avait, en effet, beaucoup ménagé le parlement. Il avait passé sous silence des faits dont il avait parlé dans d’autres ouvrages. Il n’avait rien dit des jugements récents de Lally et de La Barre, qui l’indignaient tant.
Le réquisitoire de Séguier n’eut pas lieu parce que on requit autre chose en ce temps-là de ces messieurs, et la France en fut délivrée.
Histoire du Parlement n’avait, en 1769, que soixante-sept chapitres. Ce fut en 1770 que l’auteur ajouta ce qui forme aujourd’hui le chapitre XLIII.
Dès la seconde édition, qui est de 4769, il avait changé les quatre premières pages du dernier chapitre (aujourd’hui le LXVIIIe). J’ai recueilli cette importante variante.
Le chapitre LXIX a été ajouté dans l’édition encadrée de 1775. Comme j’ai indiqué dans l’ouvrage les changements faits successivement à ce chapitre, il est inutile d’en parler ici.
L’Histoire du Parlement n’est peut-être pas lue autant qu’elle mérite de l’être. Cet ouvrage est exact et piquant. Ce n’est pas moi qui porte ce jugement, mais un homme qui n’est ni enthousiaste de Voltaire, ni ennemi des parlements : « Quoique cet ouvrage, dit M. le président Desportes, soit un tissu d’épigrammes, peu dignes d’un pareil sujet, le récit des faits y est d’une grande exactitude. »
J’ai, d’après les éditions données du vivant de Voltaire, rétabli les notes indicatives de la date de quelques faits.
B.
Ce 24 auguste 1829.
Il n’appartient qu’à la liberté de connaître la vérité et de la dire. Quiconque est gêné, ou par ce qu’il doit à ses maîtres, ou par ce qu’il doit à son corps, est forcé au silence ; s’il est fasciné par l’esprit de parti, il ne devient que l’organe des erreurs.
Ceux qui veulent s’instruire de bonne foi sur quelque matière que ce puisse être doivent écarter tous préjugés autant que le peut la faiblesse humaine. Ils doivent penser qu’aucun corps, aucun gouvernement, aucun institut n’est aujourd’hui ce qu’il a été, qu’il changera comme il a changé, et que l’immutabilité n’appartient point aux hommes. L’empire est aujourd’hui aussi différent de celui de Charlemagne que de celui d’Auguste. L’Angleterre ne ressemble pas plus à ce qu’elle était du temps de Guillaume le Conquérant que la France ne ressemble à la France du temps de Hugues Capet ; et les usages, les droits, la constitution, sous Hugues Capet, n’ont rien des temps de Clovis : ainsi tout change d’un bout de la terre à l’autre. Presque toute origine est obscure, presque toutes les lois se contredisent de siècle en siècle. La science de l’histoire n’est que celle de l’inconstance ; et tout ce que nous savons bien certainement, c’est que tout est incertain.
Il y a bien peu de lois chez les peuples de l’Europe, soit civiles, soit religieuses, qui aient subsisté telles qu’elles étaient dans le commencement. Qu’on fouille les archives des premiers siècles, et qu’on voie si l’on y trouvera des évêques souverains, disant la messe au bruit des tambours, des moines princes, des cardinaux égaux aux rois et supérieurs aux princes.
Il fallut toujours rendre la justice : point de société sans tribunal ; mais qu’étaient ces tribunaux ? et comment jugeaient-ils ? Y avait-il une seule juridiction, une seule formalité qui ressemblât aux nôtres ?
Quand la Gaule eut été subjuguée par César, elle fut soumise aux lois romaines. Le gouvernement municipal, qui est le meilleur parce qu’il est le plus naturel, fut conservé dans toutes les villes : elles avaient leur sénat, que nous appelons conseil de ville, leurs domaines, leurs milices. Le conseil de la ville jugeait les procès des particuliers, et dans les affaires considérables on appelait au tribunal du préteur, ou du proconsul, ou du préfet. Cette institution subsiste encore en Allemagne, dans les villes nommées impériales ; et c’est, je crois, le seul monument du droit public des anciens Romains qui n’ait point été corrompu. Je ne parle pas du droit écrit, qui est le fondement de la jurisprudence dans la partie de l’Allemagne où l’on ne suit pas le droit saxon ; ce droit romain est reçu dans l’Italie et dans quelques provinces de France au-delà de la Loire.
Lorsque les Sicambres, ou Francs, dans la décadence de l’empire romain, vinrent des marais du Mein et du Rhin subjuguer une partie des Gaules, dont une autre partie avait été déjà envahie par des Bourguignons, on sait assez dans quel état horrible la partie des Gaules nommée France fut alors plongée. Les Romains n’avaient pu la défendre ; elle se défendit elle-même très mal, et fut la proie des barbares.
Les temps, depuis Clovis jusqu’à Charlemagne, ne sont qu’un tissu de crimes, de massacres, de dévastations et de fondations de monastères, qui font horreur et pitié ; et après avoir bien examiné le gouvernement des Francs on n’y trouve guère d’autre loi bien nettement reconnue que la loi du plus fort. Voyons, si nous pouvons, ce que c’était alors qu’un parlement.
Presque toutes les nations ont eu des assemblées générales. Les Grecs avaient leur église, dont la société chrétienne prit le nom ; le peuple romain eut ses comices ; les Tartares ont eu leur cour-ilté, et ce fut dans une de ces cours-iltés que Gengis-kan prépara la conquête de l’Asie. Les peuples du Nord avaient leur vittenagemoth ; et lorsque les Francs, ou Sicambres, se furent rendus maîtres des Gaules, les capitaines francs eurent leur parliament, du mot celte parler ou parlier, auquel le peu de gens qui savaient lire et écrire joignirent une terminaison latine ; et de là vint le mot parlamentum dans nos anciennes chroniques, aussi barbares que les peuples l’étaient alors.
On venait à ces assemblées en armes, comme en usent encore aujourd’hui les nobles polonais, et presque toutes les grandes affaires se décidaient à coups de sabre. Il faut avouer qu’entre ces anciennes assemblées de guerriers farouches et nos tribunaux de justice d’aujourd’hui il n’y a rien de commun que le nom seul qui s’est conservé.
Dans l’horrible anarchie de la race sicambre de Clovis, il n’y eut que les guerriers qui s’assemblèrent en parlement, les armes à la main. Le major, ou maire du palais, surnommé Pipinus, que nous nommons Pepin le Bref, fit admettre les évêques à ces parliaments, afin de se servir d’eux pour usurper la couronne. Il se fit sacrer par un nommé Boniface, auquel il avait donné l’archevêché de Mayence, et ensuite par le pape Étienne, qui, selon Éginhard, secrétaire de Charlemagne, déposa lui-même le roi légitime Childéric III, et ordonna aux Francs de reconnaître à jamais les descendants de Pepin pour leurs souverains.
On voit clairement par cette aventure ce que c’était que la loi des Francs, et dans quelle stupidité les peuples étaient ensevelis.
Charlemagne, fils de Pepin, tint plusieurs fameux parlements, qu’on appelait aussi conciles. Les assemblées de villes prirent le nom de parlement, et enfin les universités s’assemblèrent en parlement.
Il existe encore une ancienne charte d’un Raimond de Toulouse, rapportée dans Ducange, qui se termine par ces mots : « Fait à Toulouse, dans la maison commune, en parlement public. Actum Tolosæ, in domo communi, in publico parlamento. »
Dans une autre charte du Dauphiné, il est dit que l’université s’assembla en parlement au son de la cloche.
Ainsi le même mot est employé pour signifier des choses très différentes. Ainsi diocèse, qui signifiait province de l’empire, a été depuis appliqué aux paroisses dirigées par un évêque. Ainsi empereur (imperator), mot qui ne désignait qu’un général d’armée, exprima depuis la dignité d’un souverain d’une partie de l’Europe, de l’Asie, et de l’Afrique. Ainsi le mot βασιλευς, rex, roi, a eu plusieurs acceptions différentes, et les noms et les choses ont subi les mêmes vicissitudes.
Lorsque Hugues Capet eut détrôné la race de Pepin, malgré les ordres des papes, tout tomba dans une confusion pire que sous les deux premières dynasties. Chaque seigneur s’était déjà emparé de ce qu’il avait pu, avec le même droit que Hugues s’était emparé de la dignité de roi. Toute la France était divisée en plusieurs seigneuries, et les seigneurs puissants réduisirent la plupart des villes en servitude. Les bourgeois ne furent plus bourgeois d’une ville, ils furent bourgeois du seigneur. Ceux qui rachetèrent leur liberté s’appelèrent franc-bourgeois. Ceux qui entrèrent au conseil de ville furent nommés grands-bourgeois, et ceux qui demeurèrent serfs, attachés à la ville comme les paysans à la glèbe, furent nommés petits-bourgeois.
Les rois de France ne furent longtemps que les chefs très peu puissants de seigneurs aussi puissants qu’eux. Chaque possesseur d’un fief dominant établit chez lui des lois selon son caprice ; de là viennent tant de coutumes différentes et également ridicules. L’un se donnait le droit de siéger à l’église parmi des chanoines, avec un surplis, des bottes, et un oiseau sur le poing. L’autre ordonnait que pendant les couches de sa femme tous ses vassaux battraient les étangs pour faire taire les grenouilles du voisinage. Un autre se donnait le droit de marquette, de cuissage, de prélibation, c’est-à-dire de coucher avec toutes ses vassales, la première nuit de leurs noces.
Au milieu de cette épaisse barbarie, les rois assemblaient encore des parlements, composés des hauts-barons qui voulaient bien s’y trouver, et des évêques et abbés. C’était, à la vérité, une chose bien ridicule de voir des moines violer leurs vœux de pauvreté et d’obéissance pour venir siéger avec les principaux de l’État ; mais c’était bien pis en Allemagne, où ils se firent princes souverains. Plus les peuples étaient grossiers, plus les ecclésiastiques étaient puissants.
Ces parlements de France étaient les états de la nation, à cela près que le corps de la nation n’y avait aucune part : car la plupart des villes, et tous les villages sans exception, étaient en esclavage.
L’Europe entière, excepté l’empire des Grecs, fut longtemps gouvernée sur ce modèle. On demande comment il se put faire que tant de nations différentes semblassent s’accorder à vivre dans cette humiliante servitude, sous environ soixante ou quatre-vingts tyrans qui avaient d’autres tyrans sous eux, et qui tous ensemble composaient la plus détestable anarchie. Je ne sais d’autre réponse, sinon que la plupart des hommes sont des imbéciles, et qu’il était aisé aux successeurs des vainqueurs, Lombards, Vandales, Francs, Huns, Bourguignons, étant possesseurs de châteaux, étant armés de pied en cap, et montés sur de grands chevaux bardés de fer, de tenir sous le joug les habitants des villes et des campagnes qui n’avaient ni chevaux, ni armes, et qui, occupés du soin de gagner leur vie, se croyaient nés pour servir.
Chaque seigneur féodal rendait donc justice dans ses domaines comme il le voulait. La loi en Allemagne portait qu’on appelât de leurs arrêts à la cour de l’empereur ; mais les grands terriens eurent bientôt le droit de juger sans appel, jus de non appellando ; tous les électeurs jouissent aujourd’hui de ce droit, et c’est ce qui a réduit enfin les empereurs à n’être plus que les chefs d’une république de princes.
Tels furent les rois de France jusqu’à Philippe-Auguste. Ils jugeaient souverainement dans leurs domaines ; mais ils n’exerçaient cette justice suprême sur les grands vassaux que quand ils avaient la force en main. Voyez combien il en coûta de peines à Louis le Gros pour soumettre seulement un seigneur du Puiset, un seigneur de Montlhéry.
L’Europe entière était alors dans l’anarchie. L’Espagne était encore partagée entre des rois musulmans, des rois chrétiens, et des comtes. L’Allemagne et l’Italie étaient un chaos ; les querelles de Henri IV avec le pontife de Rome, Grégoire VII, donnèrent commencement à une jurisprudence nouvelle et à cinq cents ans de guerres civiles. Cette nouvelle jurisprudence fut celle des papes, qui bouleversèrent la chrétienté pour y dominer.
Les pontifes de Rome profitèrent de l’ignorance et du trouble pour se rendre les juges des rois et des empereurs ; ces souverains, toujours en guerre avec leurs vassaux, étaient souvent obligés de prendre le pape pour arbitre. Les évêques, au milieu de cette barbarie, établissaient une juridiction monstrueuse ; leurs officiers ecclésiastiques, étant presque les seuls qui sussent lire et écrire, se rendirent les maîtres de toutes les affaires dans les États chrétiens.
Le mariage étant regardé comme un sacrement, toutes les causes matrimoniales furent portées devant eux ; ils jugèrent presque toutes les contentions civiles, sous prétexte qu’elles étaient accompagnées d’un serment. Tous les testaments étaient de leur ressort, parce qu’ils devaient contenir des legs à l’Église ; et tout testateur qui avait oublié de faire un de ces legs, qu’on appelle pieux, était déclaré déconfès, c’est-à-dire, à peu près sans religion ; il était privé de la sépulture, son testament était cassé, l’Église en faisait un pour lui, et s’adjugeait ce que le mort aurait dû lui donner.
Voulait-on s’opposer à ces violences, il fallait plaider à Rome, et l’on y était condamné.
Les inondations des barbares avaient sans doute causé des maux affreux ; mais il faut avouer que les usurpations de l’Église en causèrent bien davantage.
Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans ces recherches dont toutes les histoires sont pleines ; contentons-nous d’examiner quels furent les parlements de France, et quels furent les tribunaux de justice.
Les parlements furent toujours les assemblées des hauts-barons. Cette police fut celle de toute l’Europe depuis la Vistule jusqu’au détroit de Gibraltar, excepté à Rome, qui était sous une anarchie différente, car les empereurs prétendaient en être les souverains. Les papes y disputaient l’autorité temporelle, le peuple y combattait souvent pour sa liberté ; et tandis que les évêques de Rome, profitant des troubles et de la superstition des autres peuples, donnaient des couronnes avec des bulles, et se disaient les maîtres des rois, ils n’étaient pas les maîtres d’un faubourg de Rome.
L’Allemagne eut ses diètes, l’Espagne eut ses cortès, la France et l’Angleterre eurent leurs parlements. Ces parlements étaient tous guerriers, et cependant les évêques et les abbés y assistaient, parce qu’ils étaient seigneurs de fiefs, et par là même réputés barons : et c’est par cette seule raison que les évêques siègent encore au parlement d’Angleterre, car le clergé n’a jamais fait, dans cette île, un ordre de l’État.
Dans ces assemblées, qui se tenaient principalement pour décider de la guerre et de la paix, on jugeait aussi des causes ; mais il ne faut pas s’imaginer que ce fussent des procès de particuliers, pour une rente, pour une maison, pour des minuties dont nos tribunaux retentissent : c’étaient les causes des hauts-barons mêmes et de tous les fiefs qui rassortissaient immédiatement à la couronne.
Nicole Gilles rapporte qu’en 1241 Hugues de Lusignan, comte de la Marche, ayant refusé de faire hommage au roi saint Louis, on assembla un parlement à Paris, dans lequel même les députés des villes entrèrent.
Ce fait est rapporté très obscurément ; il n’est point dit que les députés des villes aient donné leur voix. Ces députés ne pouvaient être ceux des villes appartenantes aux hauts-barons ; ils ne l’auraient pas souffert. Ces villes n’étaient presque composées alors que de bourgeois, ou serfs du seigneur, ou affranchis depuis peu, et n’auraient pas donné probablement leur voix avec leurs maîtres. C’étaient, sans doute, les députés de Paris et des villes appartenantes au roi ; il voulait bien les convoquer à ces assemblées. Les grands-bourgeois de ces villes étaient affranchis, le corps de l’hôtel de ville était formé. Saint Louis put les appeler pour entendre les délibérations des barons assemblés en parlement.
Les députés des villes étaient quelquefois, en Allemagne, appelés à l’élection de l’empereur ; on prétend qu’à celle de Henri l’Oiseleur les députés des villes d’Allemagne furent admis dans le champ d’élection ; mais un exemple n’est pas une coutume. Les droits ne sont jamais établis que par la nécessité, par la force, et ensuite par l’usage ; et les villes, en ces temps-là, n’étaient ni assez riches, ni assez puissantes, ni assez bien gouvernées, pour sortir de l’abaissement où le gouvernement féodal les avait plongées. Nous savons bien que les rois et les hauts-barons avaient affranchi plusieurs de leurs bourgeois, à prix d’argent, dès le temps des premières croisades, pour subvenir aux frais de ces voyages insensés. Affranchir signifiait déclarer franc, donner à un Gaulois subjugué le privilège d’un Franc. Francus tenens, libere tenens. Un des plus anciens affranchissements dont la formule nous ait été conservée est de 1185 : « Franchio manu et ore, manumitto a consuetudine legis salicæ Johannem Pithon de vico, hominem meum, et suos legitimos natos, et ad sanum intellectum reduco, ita ut suæ filiæ possint succedere ; dictumque Johannem et suos natos constituo homines meos francos et liberos, et pro hac franchesia habui decem et octo libras viennensium bonorum. – J’affranchis de la main et de la bouche, je délivre des coutumes de la loi salique Jean Pithon de vie (ou de ce village), mon homme, et ses fils légitimes, je les réintègre dans leur bon sens, de sorte que ses filles puissent hériter ; et je constitue ledit Jean et ses fils mes hommes francs et libres, et pour cette franchise j’ai reçu dix-huit bonnes livres viennoises. »
Les serfs qui avaient amassé quelque argent avaient ainsi acheté leur liberté de leurs rois ou seigneurs, et la plupart des villes rentraient peu à peu dans leurs droits naturels, dans leur bon sens, in sanum intellectum : en effet le bon sens est opposé à l’esclavage.
Le règne de saint Louis est une grande époque ; presque tous les hauts-barons de France étant morts, ou ruinés dans sa malheureuse croisade, il en devint plus absolu à son retour, tout malheureux et tout appauvri qu’il était. Il institua les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre-le-Moutier, et de Mâcon, pour juger en dernier ressort les appels des justices des seigneurs qui n’eurent pas assez de puissance pour s’y opposer ; et au lieu qu’auparavant les barons jugeaient souverainement dans leurs terres, la plupart furent obligés de souffrir qu’on appelât de leurs arrêts aux bailliages du roi.
Il est vrai que ces appels furent très rares : les sujets qui osaient se plaindre de leur seigneur dominant au seigneur suzerain se seraient trop exposés à la vengeance.
Saint Louis fit encore une autre innovation dans la séance des parlements. Il en assembla quelquefois de petits, où il convoqua des clercs qui avaient étudié le droit canon ; mais cela n’arrivait que dans des causes particulières qui regardaient les droits des prélats. Dans une séance d’un parlement, on examina la cause de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire ; et les clercs, maître Jean de Troyes, et maître Julien de Péronne, donnèrent leurs avis avec le connétable, le comte de Ponthieu, et le grand-maître des arbalétriers.
Ces petits parlements n’étaient point regardés comme les anciens parlements de la nation : on les appelait parloirs du roi, parloirs au roi ; c’étaient des conseils que le roi tenait, quand il voulait, pour juger des affaires où les baillis trouvaient trop de difficulté.
Tout changea bien autrement sous Philippe IV, surnommé le Bel, petit-fils de Saint-Louis. Comme on avait appelé du nom de parlements ces parloirs du roi, ces conseils où il ne s’agissait pas des intérêts de l’État, les vrais parlements, c’est-à-dire les assemblées de la nation, ne furent plus connus que sous le nom d’états généraux, nom beaucoup plus convenable puisqu’il exprimait à la fois les représentants de la nation entière et les intérêts publics. Philippe appela, pour la première fois, le tiers état à ces grandes assemblées (1302). Il s’agissait en effet des plus grands intérêts de l’État, de réprimer le pape Boniface VIII, qui osait menacer le roi de France de le déposer ; et surtout il s’agissait d’avoir de l’argent.
Les villes commençaient alors à devenir riches, depuis que plusieurs des bourgeois avaient acheté leurs franchises, qu’ils n’étaient plus serfs mainmortables, et que le souverain ne saisissait plus leur héritage quand ils mouraient sans enfants. Quelques seigneurs, à l’exemple des rois, affranchirent aussi leurs sujets, et leur firent payer leur liberté.
(28 mars 1302) Les communes, sous le nom de tiers état, assistèrent donc par députés aux grands parlements ou états généraux tenus dans l’église de Notre-Dame. On y avait élevé un trône pour le roi ; il avait auprès de lui le comte d’Évreux son frère, le comte d’Artois son cousin, les ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Lorraine, les comtes de Hainaut, de Hollande, de Luxembourg, de Saint-Pol, de Dreux, de la Marche, de Boulogne, de Nevers : c’était une assemblée de souverains. Les évêques, dont on ne nous a pas dit les noms, étaient en très petit nombre, soit qu’ils craignissent encore le pape, soit que plutôt ils fussent de son parti.
Les députés du peuple occupaient en grand nombre un des côtés de l’église. Il est triste qu’on ne nous ait pas conservé les noms de ces députés. On sait seulement qu’ils présentèrent à genoux une supplique au roi, dans laquelle ils disaient : « C’est grande abomination d’ouïr que ce Boniface entende malement, comme bougre, cette parole d’espéritualité : ce que tu lieras en terre sera lié au ciel ; comme si cela signifiait que s’il mettait un homme en prison temporelle, Dieu, pour ce, le mettrait en prison au ciel. »
Au reste, il faut que le tiers état ait fait rédiger ces paroles par quelque clerc ; elles furent envoyées à Rome en latin : car à Rome on n’entendait pas alors le jargon grossier des Français ; et ces paroles furent sans doute traduites depuis en français thiois, telles que nous les voyons.
Les communes entraient dès lors au parlement d’Angleterre : ainsi les rois de France ne firent qu’imiter une coutume utile, déjà établie chez leurs voisins. Les assemblées de la nation anglaise continuèrent toujours sous le nom de parlements, et les parlements de France continuèrent sous le nom d’états généraux.
Le même Philippe le Bel, en 1305, établit ce qu’il s’était déjà proposé en 1302, que les parloirs au roi (comme on disait alors), ou parlamenta curiæ, rendraient justice deux fois l’an à Paris : vers Pâques, et vers la Toussaint. C’était une cour de justice suprême, telle que la cour du banc du roi en Angleterre, la chambre impériale en Allemagne, le conseil de Castille ; c’était un renouvellement de l’ancienne cour palatine.
Voici comme s’exprime Philippe le Bel dans son édit de 1302 : « Propter commodum subditorum nostrorum, et expeditionem causarum, proponimus ordinare quod duo parlamenta Parisiis, duo scacaria Rotomagi, dies Trecenses bis tenebuntur in anno ; et quod parlamentum Tolosæ tenebitur, sicut solebat teneri temporibus retroactis. – Pour le bien de nos sujets, et l’expédition des procès, nous nous proposons d’ordonner qu’il se tienne deux fois l’an deux parlements à Paris, deux scacaires (échiquiers) à Rouen, des journées (grands jours) à Troyes, et un parlement à Toulouse, tel qu’il se tenait anciennement. »
Il est évident, par cet énoncé, que ces tribunaux étaient érigés pour juger les procès, qu’ils avaient tous une juridiction égale, qu’ils étaient indépendants les uns des autres.
Celui qui présida à la juridiction royale du parlement de Paris et qui tint la place du comte palatin fut un comte de Boulogne, assisté d’un comte de Dreux ; un archevêque de Narbonne et un évêque de Rennes furent présidents avec eux, et parmi les conseillers on comptait le connétable Gaucher de Châtillon.
Précisément dans le même temps et dans le même palais, le roi Philippe créa une chambre des comptes. Cette cour, ou chambre, ou parloir, ou parlement, eut aussi des hauts-barons et des évêques pour présidents. Elle eut, sous Philippe de Valois, le privilège royal de donner des lettres de grâce, privilège que la chambre de parlement n’avait pas : cependant elle ne prétendit jamais représenter les assemblées de la nation, les champs de mars et de mai. Le parlement de Paris ne les a jamais représentées ; mais il eut d’ailleurs de très hautes prérogatives.
Les séances du parlement duraient environ six semaines ou deux mois. Les juges étaient tous des hauts-barons. La nation n’aurait pas souffert d’être jugée par d’autres : il n’y avait point d’exemple qu’un serf, ou un affranchi, un roturier, un bourgeois, eût jamais siégé dans aucun tribunal, excepté quand les pairs bourgeois avaient jugé leurs confrères dans les causes criminelles.
Les barons étaient donc seuls conseillers-jugeurs, comme on parlait alors. Ils siégeaient l’épée au côté, selon l’ancien usage. On pouvait en quelque sorte les comparer à ces anciens sénateurs romains qui, après avoir fait la fonction déjugés dans le sénat, allaient servir ou commander dans les armées.
Mais les barons français étant très peu instruits des lois et des coutumes, la plupart même sachant à peine signer leur nom, il y eut deux chambres des enquêtes, dans lesquelles on admit des clercs et des laïques, appelés maîtres ou licenciés en droit. Ils étaient conseillers-rapporteurs : ils n’étaient pas juges, mais ils instruisaient les causes, les préparaient, et les lisaient ensuite devant les barons conseillers-jugeurs. Ceux-ci, pour former leur avis, n’écoutaient que le bon sens naturel, l’esprit d’équité, et quelquefois leur caprice. Ces conseillers-rapporteurs, ces maîtres furent ensuite incorporés avec les barons ; c’est ainsi que dans la chambre impériale d’Allemagne et dans le conseil aulique il y a des docteurs avec des gens d’épée. De même, dans les conciles, le second ordre fut presque toujours admis comme le plus savant. Il y eut presque dans tous les États des grands qui eurent l’autorité, et des petits qui, en se rendant utiles, finirent par la partager.
Les chambres des enquêtes étaient présidées aussi par des seigneurs et par des évêques. Les clercs ecclésiastiques et les clercs laïques faisaient toute la procédure. On sait assez qu’on appelait clercs ceux qui avaient fréquenté les écoles, quoiqu’ils ne fussent pas du clergé. Les notaires du roi s’appelaient les clercs du roi : il avait dans sa maison les clercs de cuisine, c’est-à-dire des gens qui, sachant lire et écrire, tenaient les comptes de la cuisine ; il y en a encore chez les rois d’Angleterre, qui ont conservé beaucoup d’anciens usages entièrement perdus à la cour de France.
La science s’appelait clergie, et de là vient le terme de Mauclerc, qui signifiait un ignorant, ou un savant qui abusait de son érudition.
Les rapporteurs des enquêtes n’étaient donc pas tous des clercs d’église ; il y avait des séculiers savants dans le droit civil et le droit canon, c’est-à-dire un peu plus instruits que les autres dans les préjugés qui régnaient alors.
Le comte de Boulainvilliers et le célèbre Fénelon prétendent qu’ils furent tous tirés de la condition servile ; mais certainement il y avait alors dans Paris, dans Orléans, dans Reims, des bourgeois qui n’étaient point serfs ; et c’était sans contredit le plus grand nombre. Aurait-on admis en effet des esclaves aux états généraux, au grand parlement, ou états généraux de France, en 1302 et en 1355 ?
Ces commissaires-enquêteurs, qui firent bientôt corps avec le nouveau parlement, forcèrent, par leur mérite et par leur science, le monarque à leur confier cet important ministère, et les barons-juges à former leur opinion sur leur avis.
Ceux qui ont prétendu que la juridiction appelée parlement, s’assemblant deux fois par an pour rendre la justice, était une continuation des anciens parlements de France, paraissent être tombés dans une erreur volontaire, qui n’est fondée que sur une équivoque.
Les pairs-barons, qui assistaient aux vrais parlements, aux états généraux, y venaient par le droit de leur naissance et de leurs fiefs ; le roi ne pouvait les en empêcher ; ils venaient joindre leur puissance à la sienne, et étaient bien éloignés de recevoir des gages pour venir décider de leurs propres intérêts au champ de mars et au champ de mai. Mais dans le nouveau parlement judiciaire, dans cette cour qui succéda aux parloirs du roi, aux conseils du roi, les conseillers recevaient cinq sous parisis chaque jour. Ils exerçaient une commission passagère, et très souvent ceux qui avaient siégé à Pâques n’étaient plus juges à la Toussaint.
(1320) Philippe le Long ne voulut plus que les évêques eussent le droit de siéger dans ce tribunal, et c’est une nouvelle preuve que le nouveau parlement n’avait rien des anciens que le nom : car si c’eût été un vrai parlement de la nation, ce qui est impossible, le roi n’aurait pu en exclure les évêques, qui, depuis Pepin, étaient en possession d’assister de droit à ces assemblées.
En un mot, un tribunal érigé pour juger les affaires contentieuses ne ressemble pas plus aux états généraux, aux comices, aux anciens parlements de la nation entière, qu’un préteur de Strasbourg ne ressemble aux préteurs de la république romaine, ou qu’un consul de la juridiction consulaire ne ressemble aux consuls de Rome.
Le même Philippe le Bel établit, comme on a vu, un parlement à Toulouse pour le pays de la langue de oc, comme il en avait établi un pour la langue de oui. Peut-on dire que ces juridictions représentaient le corps de la nation française ? Il est vrai que le parlement de Toulouse n’eut pas lieu de longtemps : malgré l’ordonnance du roi, on ne trouva point assez d’argent pour payer les conseillers.
Il y avait déjà à Toulouse une chambre de parlement ou parloir, sous le comte de Poitiers, frère de saint Louis ; nouvelle preuve que les mêmes noms ne signifient pas les mêmes choses. Ces commissions étaient passagères comme toutes les autres. Ce parloir du comte de Poitiers, comte et pair de Toulouse, est appelé aussi chambre des comptes. Le prince de Toulouse, quand il était à Paris, faisait examiner ses finances à Toulouse. Or quel rapport peut-il se trouver entre quelques officiers d’un comte de Toulouse et les anciens parlements francs ? Ce ne fut que sous Charles VII que le parlement de Toulouse reçut sa perfection.
Enfin les grands jours de Troyes, établis aussi par Philippe le Bel, ayant une juridiction aussi pleine et aussi entière que le parlement de Paris, achèvent de prouver démonstrativement que c’est une équivoque puérile, une logomachie, un vrai jeu de mots, de prendre une cour de justice appelée parlement pour les anciens parlements de la nation française.
Nous avons encore l’ordonnance de Philippe le Long au sujet des requêtes du palais, de la chambre de parlement, et de celles des comptes du trésor ; en voici la traduction, telle qu’elle se trouve dans Pasquier :
« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, faisons savoir à tous que nous avons fait extraire de nos ordonnances, faites par notre grand conseil, les articles ci-après écrits, etc. » Or quel était ce grand conseil qui donnait ainsi des lois au parlement, et qui réglait ainsi sa police ? C’étaient alors les pairs du royaume, c’étaient les grands officiers que le roi assemblait : il avait son grand conseil et son petit conseil ; la chambre du parlement obéissait à leurs ordres, donc elle ne pouvait certainement être regardée comme les anciennes assemblées du champ de mai, puisqu’elle obéissait à des lois émanées d’un conseil qui, lui-même, n’était pas l’ancien, le vrai parlement de la nation.
Lorsque Philippe le Bel institua la juridiction suprême du parlement de Paris, il ne paraît pas qu’il lui attribua la connaissance des causes criminelles : et en effet on n’en voit aucune jugée par lui dans ces premiers temps. Le procès des templiers, cet objet éternel de doute et d’infamie, est une assez forte preuve que le parlement ne jugeait point alors les crimes. Il y avait plus de clercs que de laïques dans cette compagnie ; il y avait des chevaliers et des jurisconsultes ; rien ne lui manquait donc pour être en état de juger ces templiers, qui étaient à la fois sujets du roi et réputés un ordre ecclésiastique : cependant ils ne furent jugés que par des commissaires du pape Clément V.
(13 octobre 1307) D’abord le roi fit arrêter les templiers par ses baillis et par ses sénéchaux. Le pape lui-même interrogea, dans la ville de Poitiers, soixante et douze de ces chevaliers, parmi lesquels il est à remarquer qu’il y avait des prêtres : ils furent gardés au nom du pape et du roi. Le pape délégua, dans chaque diocèse, deux chanoines, deux jacobins, deux cordeliers, pour condamner, suivant les saints canons, ces guerriers qui avaient versé leur sang pour la religion chrétienne, mais qui étaient accusés de quelques débauches et de quelques profanations. Le roi lui-même, croyant faire un acte d’autorité qui éludait celle du pape, en se joignant à lui, fit expédier, par son conseil privé, une commission à frère Guillaume Parisius, inquisiteur du pape en France, pour assister à l’interrogatoire des templiers, et nomma aussi des barons dans la commission, comme Bertrand de Agassar, chevalier, le sénéchal de Bigorre, le sénéchal de Beaucaire.
(1308) Le roi convoqua une grande assemblée à Tours, pour résoudre, en la présence du pape et en la sienne, quel usage on ferait du bien des templiers mis en séquestre. Plusieurs hauts-barons envoyèrent des procurations. Nous avons encore à la Bibliothèque du roi celle de Robert, comte de Flandre ; de Jeanne de l’Isle, dame de Mailly ; de Jean, fils aîné du duc de Bretagne ; d’Élie de Talleyrand, comte de Périgord ; d’Artus, comte de Richemont, prenant depuis le titre de duc de Bretagne ; d’un Thibaut, seigneur de Rochefort ; enfin de Hugues, duc de Bourgogne.
À l’égard du jugement prononcé contre les templiers, il ne le fut que par les commissaires du pape, Bernard, Étienne, et Landulphe, cardinaux, quelques évêques et des moines inquisiteurs. Les arrêts de mort furent portés en 1309, et non en 1307 : les actes en font foi, et la Chronique de Saint-Denis le dit en termes exprès. On dit que l’Église abhorre le sang ; elle n’a pas apparemment tant d’horreur pour les flammes. Cinquante-neuf chevaliers furent brûlés vifs à Paris, à la porte Saint-Antoine, tous protestant de leur innocence, tous rétractant les aveux que les tortures leur avaient arrachés.
Le grand-maître Jacques Molai, égal par sa dignité aux souverains, Gui, frère du dauphin d’Auvergne, furent brûlés dans la place vis-à-vis laquelle est aujourd’hui la statue de Henri IV. Ils prirent Dieu à témoin, tant qu’ils purent parler, et citèrent au jugement de Dieu le roi et le pape.
Le parlement n’eut aucune part à ce procès extraordinaire, témoignage éternel de la férocité où les nations chrétiennes furent plongées jusqu’à nos jours. (1312) Mais lorsque Clément V, dans le concile général de Vienne, abolit l’ordre des templiers, de sa seule autorité et malgré la réclamation du concile entier, dans lequel il n’y eut que quatre évêques de son avis ; lorsqu’il fallut disposer des biens-fonds des chevaliers ; lorsque le pape eut donné ces biens aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, le roi ayant accédé à cette donation, le parlement mit en possession les hospitaliers par un arrêt rendu en 1312, le jour de l’octave de Saint-Martin, arrêt dans lequel il n’est parlé que de l’ordre du roi, et point du tout de celui du pape : il ne participa ni à l’iniquité des supplices, ni à l’activité des procédures sacerdotales ; il ne se mêla que de la translation des biens d’un ordre à un autre ; et on voit que dès ce temps il soutint la dignité du trône contre l’autorité pontificale, maxime dans laquelle il a toujours persisté sans aucune interruption.
Dans les horribles malheurs qui affligèrent la France sous Charles VI, toutes les parties de l’administration furent également abandonnées. On oublia même de renouveler les commissions aux juges du parlement, et ils se continuèrent eux-mêmes dans leurs fonctions, au lieu de les abandonner. C’est en quoi ils rendirent un grand service à l’État, ou du moins aux provinces de leur ressort, qui n’auraient plus eu aucun recours pour demander justice.
Ce fut dans ce temps-là même que les seigneurs qui étaient juges, obligés l’un après l’autre d’aller défendre leurs foyers à la tête de leurs vassaux, quittèrent le tribunal. Les jurisconsultes qui, dans la première institution, ne servaient qu’à les instruire, se mirent à leur place : ceux qui devinrent présidents prirent l’habit des anciens chevaliers ; les conseillers retinrent la robe des gradués, qui était serrée comme elle l’est encore en Espagne, et ils lui donnèrent ensuite plus d’ampleur.
Il est vrai qu’en succédant aux barons, aux chevaliers, aux seigneurs, qu’ils surpassaient en science, ils ne purent participer à leur noblesse : nulle dignité alors ne faisait un noble. Les premiers présidents Simon de Bussy, Bracq, Dauvet, les chanceliers mêmes Guillaume de Dormans et Arnaud de Corbie, furent obligés de se faire anoblir.
On peut dire que c’est une grande contradiction que ceux qui jugent souverainement les nobles ne jouissent pas des droits de la noblesse ; mais enfin telle fut leur condition dans un gouvernement originairement militaire, et j’oserais dire barbare. C’est en vain qu’ils prirent les titres de chevaliers ès lois, de bacheliers ès lois, à l’imitation des chevaliers et des écuyers ; jamais ils ne furent agrégés au corps de la noblesse ; jamais leurs enfants n’entrèrent dans les chapitres nobles. Ils ne purent avoir de séance dans les états généraux ; le baronnage n’aurait pas voulu les recevoir, et ils ne voulaient pas être confondus dans le tiers état. (1355) Lors même que les états généraux se tinrent dans la grande salle du palais, aucun membre du parlement, qui siégeait dans la chambre voisine, n’eut place dans cette salle. Si quelque baron conseiller y fut admis, ce fut comme baron, et non comme conseiller. Marcel, prévôt des marchands, était à la tête du tiers état, et c’est encore une confirmation que le parlement, suprême cour de judicature, n’avait pas le moindre rapport aux anciens parlements français.
Lorsque Édouard III disputa d’abord la régence, avant de disputer la couronne de France à Philippe de Valois, aucun des deux concurrents ne s’adressa au parlement de Paris. On l’aurait certainement pris pour juge et pour arbitre s’il avait tenu la place de ces anciens parlements qui représentaient la nation. Toutes les chroniques de ce temps-là nous disent que Philippe s’adressa aux pairs de France et aux principaux barons, qui lui adjugèrent la régence. Et quand la veuve de Charles le Bel, pendant cette régence, eut mis au monde une fille, Philippe de Valois se mit en possession du royaume sans consulter personne.
Lorsque Édouard rendit si solennellement hommage à Philippe, aucun député du parlement n’assista à cette grande cérémonie.
Philippe de Valois, voulant juger Robert, comte d’Artois, convoqua les pairs lui-même par des lettres scellées de son sceau, « pour venir devant nous, en notre cour, suffisamment garnie de pairs ».
Le roi tint sa cour au Louvre ; il créa son fils Jean pair de France, pour qu’il pût assister à cette assemblée. Les magistrats du parlement y eurent place comme assesseurs versés dans les lois ; ils obtinrent l’honneur de juger avec le roi de Bohême, avec tous les princes et pairs. Le procureur du roi forma l’accusation. Robert d’Artois n’aurait pu être jugé dans la chambre du parlement, ce n’était pas l’usage, et il ne pouvait se tenir pour jugé si le roi n’avait été présent.
Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, Marguerite de Bourgogne, femme de Louis Hutin, duc d’Alençon, accusées précédemment d’adultère, n’avaient point été jugées par le parlement ; ni Enguerrand de Marigny, comte de Longueville, accusé de malversations sous Louis Hutin ; ni Pierre Remi, général des finances, sous Philippe de Valois, n’eurent la chambre de parlement pour juge. Ce fut Charles de Valois qui condamna Marigny à mort, assisté de quelques grands officiers de la couronne, et de quelques seigneurs dévoués à ses intérêts. (1315) Il fut condamné à Vincennes. (1328) Pierre Remi fut jugé de même par des commissaires que nomma Philippe de Valois.
(1409) Le duc de Bourgogne fit arrêter Montaigu, grand-maître de la maison de Charles VI, et surintendant des finances. On lui donna des commissaires, juges de tyrannie, comme dit la chronique, qui lui firent subir la question. En vain il demanda à être jugé par le parlement, ses juges lui firent trancher la tête aux halles. C’est ce même Montaigu qui fut enterré aux Célestins de Marcoussis. On sait la réponse que fit un de ces moines à François Ier. Quand il entra dans l’église, il vit ce tombeau ; et comme il disait que Montaigu avait été condamné par justice : « Non, sire, répondit le bon moine, il fut condamné par commissaires. »
Il est sûr qu’alors il n’y avait point encore de chambre criminelle établie au parlement de Paris. On ne voit point qu’en ces temps-là il ait seul jugé personne à mort. C’était le prévôt de Paris et le Châtelet qui condamnaient les malfaiteurs. Cela est si vrai que le roi Jean fit arrêter son connétable, le comte d’Eu, pair de France, par le prévôt de Paris. (1350) Ce prévôt le jugea, le condamna seul en trois jours de temps, et on lui trancha la tête dans la propre maison du roi, qui était alors l’hôtel de Nesle, en présence de toute la cour, sans qu’aucun des conseillers de la chambre du parlement y fût mandé.
Nous ne rapportons pas ce trait comme un acte de justice ; mais il sert à prouver combien les droits du nouveau parlement, sédentaire à Paris, étaient alors peu établis.
Par une fatalité singulière, le parlement de Paris, qui n’avait jamais, dans sa chambre, jugé aucun pair du royaume, devint juge du dauphin de France, héritier de la couronne (1420). Voici le détail de cette étrange aventure :
Louis duc d’Orléans, frère du malheureux roi Charles VI, avait été assassiné dans Paris par ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, qui fut présent lui-même à l’exécution de ce crime (en 1407). Il ne se fit aucune procédure au parlement de Paris touchant cet assassinat du frère unique du roi. Il y eut un lit de justice qui se tint au palais dans la grand-chambre ; mais ce fut à l’occasion de la maladie où retomba alors le roi Charles VI. On choisit cette chambre du palais de saint Louis pour tenir l’assemblée, parce qu’on ne voulait pas délibérer sous les yeux du roi même, dans son hôtel de Saint-Paul, des moyens de, gouverner l’État pendant que sa maladie l’en rendait incapable ; on ménageait sa faiblesse. Tous les pairs qui étaient à Paris, tous les grands officiers de la couronne, le connétable à leur tête, tous les évêques, les chevaliers, les seigneurs du grand conseil du roi, les magistrats des comptes, des aides, les officiers du trésor, ceux du Châtelet, y prirent tous séance : ce fut une assemblée de notables, où l’on décida qu’en cas que le roi restât malade, ou qu’il mourût, il n’y aurait point de régence, et que l’État serait gouverné comme il l’était par la reine et par les princes du sang, assistés du connétable d’Armagnac, du chancelier, et des plus sages hommes du conseil : décision qui, comme l’a très bien remarqué l’auteur d’une nouvelle Histoire de France, ne servait qu’à augmenter les troubles dont on voulait sortir.