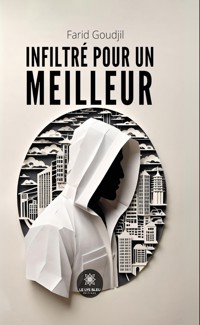
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Djamel, toujours flic, mène ses enquêtes avec passion et bienveillance, naviguant jadis sur le fil entre le bien et le mal. Perturbé par ses missions policières et d’infiltration aux frontières de l’éthique, il s’efforce de faire le bien autour de lui, parfois en tentant de sortir les petits malfrats de leur mauvaise voie lors de ses investigations. Hanté par la mort des jeunes corrompus par le trafic de drogue, il s’est donné un ultime objectif : combattre ce fléau et convaincre les décideurs. Cependant, pour un flic, il existe des limites à ne pas franchir, même dans cette quête.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Farid Goudjil débute sa carrière d’animateur à l’antenne d’une radio FM. Adolescent passionné d’écriture, il exprime ses réflexions sur la société à travers des textes. Il explore divers horizons artistiques : écriture, théâtre, cinéma, télévision et slam. Son engagement l’amène à parcourir la France pour rencontrer son public, accompagné de ses romans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Farid Goudjil
Infiltré pour un meilleur
Roman
© Lys Bleu Éditions – Farid Goudjil
ISBN : 979-10-422-3834-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivante du Code de la propriété intellectuelle.
Note de l’auteur
Je suis, tu es, nous sommes la France
titre mon précédent roman.
Si vous avez tourné les pages
Alors, vous étiez du voyage
Ainsi vous avez découvert les personnages
Avec eux, vous avez traversé les émotions de la vie
Si vous n’avez pas pu suivre les protagonistes
Ce n’est pas bien grave
Vous les découvrirez au fil de cette histoire
Ainsi vous serez du voyage
Et si vous souhaitez les connaître davantage
Dans mon précédent roman, ils évoluent de page en page.
Prologue
De nos jours
Mohamed le Chibani1 se tenait debout face à la tombe de ses parents : il en avait des choses à leur raconter. Il avait accompli son devoir ; d’ailleurs, la transmission était une obligation ! Une mission que certains accomplissent avec bonheur et enthousiasme, comme l’avait fait notre ami le Chibani. Une besogne pas si simple à exécuter : le Chibani avait pris le temps avant de réussir à l’accomplir. Mohamed avait bien compris qu’il fallait prendre le temps d’échanger, et avec les siens en particulier. Malheureusement, de nos jours, tout va trop vite, le tourbillon de la vie nous embarque dans son sillon, sans même que nous puissions nous en rendre compte. Le Chibani avait son propre adage : savoir d’où l’on vient, connaître ses origines peut nous aider à nous construire. Le Chibani n’avait de cesse de se soucier de sa famille, surtout dans le monde actuel, parfois cruel. Le vieil homme s’était retrouvé à l’hôpital sans savoir de quel mal il était atteint, si ce n’était la fatigue. Il avait profité de son séjour pour convier ses petits-enfants, Kahina, Slimane et Jules, afin de leur conter l’histoire de sa famille, plus précisément celle de son jeune frère Djamel.
Djamel, Caroline et Osman étaient des amis d’enfance, amis pour la vie, se disaient-ils. Ils fréquentaient le même collège, habitaient le même quartier, ils étaient un peu à part. Djamel et Osman marchaient sur un fil entre le bien et le mal, tels des funambules : les deux compères voulaient se démarquer, ne manquer de rien. Ils achetaient de la marchandise dernier cri, tout ce qui pouvait se revendre ; ils avaient un deal exceptionnel avec les commerçants sur les marchés de Paris : ils payaient les articles uniquement après les avoir vendus. Comme tous les bons entrepreneurs, nos deux acolytes réalisaient de bons profits.
Caroline faisait en sorte de garder l’équilibre, elle prenait soin de ses amis. Un beau jour, une idée lui avait traversé l’esprit et elle en avait parlé à Djamel et Osman. Ils avaient pour projet d’aller à la rencontre de leur histoire, mais ce n’était pas si simple de poser des questions à son père ou à sa mère. La mission semblait même quasiment impossible pour Djamel et Osman. Ils ne se voyaient pas interroger leurs parents. Trop de principes, trop de pudeur, ils avaient là devant eux une montagne infranchissable. Armés de caméras et d’une stratégie, nos trois amis avaient réalisé des interviews croisées. Caroline avait tout manigancé : Djamel et Osman interrogeraient la famille de Caroline ; elle, elle irait voir le grand frère de Djamel ; Djamel, enfin, interviewerait la famille d’Osman. Ils avaient là un beau projet, ils ont ensuite passé des moments inoubliables et en ont gardé des souvenirs indélébiles.
Les petites affaires rondement menées par nos inséparables avaient fait écho : Djamel était devenu plus raisonnable au contact de Caroline. Cependant, Osman s’était laissé dépasser par l’appât du gain et embarqué par de gros trafiquants, des mafieux. En effet, il ne connaissait pas vraiment les règles du jeu. Djamel et Osman avaient formé un duo dans le bizness. Ils étaient complémentaires : Djamel était le stratège, le penseur ; Osman, dit OS pour les intimes, avait l’œil américain, était observateur, à l’affût, scrutait les moindres détails.
Osman avait totalement manqué de vigilance ; il avait des œillères comme ceux des chevaux de trait que les fermiers plaçaient afin qu’ils se concentrent sur la route et ne soient pas distraits. Osman était absorbé, guidé par la couleur de l’argent. Il voulait tout arrêter ce jour-là, mais c’était trop tard : l’arme pointée sur son bas-ventre avait décidé pour lui.
Osman ne pouvait pas en parler à ses amis, car il voulait les préserver et rester seul face à ces malfrats. Il aurait pu se contenter de la commande faite par les mafieux, mais il avait été gourmand et voulait gagner plus. Il avait saisi une opportunité qui, en réalité, n’en était pas une. Osman jouait dans la cour des grands sans en avoir ni l’âge ni la maturité. Ses amis l’avaient pleuré à chaudes larmes.
Djamel allait et venait tel un fou furieux. Il arpentait les rues de la ville, celles de Paris, il recherchait les meurtriers de son ami, il voulait savoir comment Osman avait pu se mettre dans une telle situation, il se posait des tonnes de questions, toutes restées sans réponse. De son côté, Caroline devenait instable. Elle avait dû quitter la région parisienne afin de poursuivre ses études à Aix-en-Provence dans la maison familiale. Djamel et Caroline s’étaient perdus de vue, tous deux étaient hantés par le fantôme d’Osman. Caroline avait des sautes d’humeur : elle passait du rire aux larmes. Ses collègues enseignants avaient un peu de mal à la comprendre. Personne à Aix-en-Provence ne connaissait le passé de Caroline, excepté sa famille.
Djamel tournait en boucle. Fred, inspecteur de police et ami de son frère Mohamed le Chibani, l’avait alors pris sous son aile, Djamel était devenu flic, de manière improbable, car il avait auparavant entamé des études dans le domaine du sport. C’était un bon policier : il était juste et endossait souvent des rôles d’infiltré qu’il menait avec enthousiasme et passion. Il se prenait au jeu. Le hasard pour certains, le destin pour d’autres allait placer les meurtriers de son ami Osman sur son chemin.
Peu à peu, Caroline et Djamel s’étaient retrouvés. Osman avait emporté le mal avec lui pour ne laisser que le bien à Djamel. La vie avait repris son cours pour nos deux amis qui avaient passé de bons moments, s’étaient rapprochés en se remémorant leurs souvenirs d’enfance.
Algérie – Village kabyle
Cette après-midi-là, il y avait du monde dans le cimetière. On enterrait Jugurtha, le fils d’Arezki, un ami du Chibani. La maladie l’avait frappé et emporté. Son corps avait voyagé entre Lille, Paris et Alger. Jugurtha n’était plus revenu en Algérie depuis sa tendre enfance, et il avait laissé dans l’oubli sa Kabylie natale, la terre de ses ancêtres.
L’émotion et la tristesse envahissaient le cimetière, l’âme de Jugurtha planait : c’est comme si sa voix résonnait dans la plaine. Elle disait alors : « Merci de m’avoir accueilli, merci de m’avoir fait confiance. Ensemble, vous irez loin, gardez espoir et marchez la main dans la main. »
Le visage larmoyant, une femme se tenait devant la sépulture, entourée par une dizaine de personnes. Les yeux au ciel, tous avaient une pensée commune pour un homme qui avait œuvré pour le village. Un homme qu’ils avaient découvert et tant apprécié. La femme sécha discrètement ses larmes et récita des vers de Jean Amrouche.
En vain, les oiseaux me visitent
Tu les charges en vain de messages
Voici deux jours survint ta lettre
Depuis deux jours, mes larmes coulent
Mère de l’exil, je souffre
Le seigneur nous a séparés
Jean Amrouche était né le 7 février 1906 à Ighil Ali, en Algérie, dans la vallée de la Soummam, une région de Kabylie. Il était décédé d’une leucémie en 1962 à Paris. Il était enseignant, poète, écrivain, journaliste, homme de radio.
Mohamed le Chibani observait la sépulture de ses parents. Il avait hâte de relater à ses défunts les moments passés auprès de ses petits-enfants, Kahina, Slimane et Jules. Le regard figé sur les pierres tombales, il ferma les yeux et se revit dans la chambre d’hôpital en région parisienne où il avait séjourné quelques jours.
Submergé par l’émotion, saisi par cette chaleur aride, il se mit néanmoins à raconter avec bonheur et humour les instants passés auprès de ses petits-enfants. Assis à son chevet, ils avaient commenté son récit et l’histoire était devenue interactive : ses chérubins étaient très attentifs.
Le cimetière se situait à l’entrée du village. À l’extrémité se trouvait un mausolée, dans lequel il y avait le cercueil d’un homme très important aux yeux des habitants du village. Cet homme appelé Cheikh2veillait sur eux. Pour les non-croyants, il avait un pouvoir à la limite du surnaturel ; pour les autres, c’était l’un des représentants du bienfaiteur.
Retour aux sources
Dans tout le village, Mohamed était appelé le sage. C’était une marque de confiance, car il inspirait la bienveillance, la sagesse. En France, dans la cité où il vivait, on l’appelait le Chibani : son état d’esprit avait traversé la Méditerranée.
Mohamed se dirigea vers l’épicerie du village, où il retrouva son ami Arezki. Il y avait bien longtemps que ces deux compères ne s’étaient pas vus. Ce local, dans lequel on pouvait quasiment tout acheter et prendre un café, était le centre du village, un lieu de vie, de socialisation. Les soirées d’été, on pouvait y apercevoir de nombreuses personnes, et les parties de jeux de cartes ou de dominos y étaient interminables.
Dans l’arrière-boutique, il y avait une salle de réunion dans laquelle se tenait l’assemblée générale du village. Les représentants de chaque famille siégeaient, c’était en quelque sorte un mini conseil municipal. On y débattait, faisait voter des cotisations, améliorait le cadre de vie des habitants du village.
Mohamed le sage était assis au fond de l’épicerie et discutait avec son ami Arezki. Mohamed avait quitté l’Algérie précipitamment. Il avait vécu des épreuves difficiles à l’époque où il aidait les combattants de l’indépendance avec son père et son oncle. Ils traversaient les forêts, ravitaillaient les familles ; son oncle avait été lâchement assassiné et son père avait frôlé la mort. Arezki était arrivé en France des années après. L’indépendance avait bel et bien sonné : le malheur des uns avait fait le bonheur des autres.
Arezki se mit à raconter :
« Le frère de ma femme vivait à Bruxelles, donc nous avions envisagé de nous y installer. Comme Jugurtha était petit, nous sommes restés un mois à Marseille. Nous avions sympathisé avec un couple qui venait d’Algérie, de la ville de Tizi-Ouzou à quelques kilomètres de notre village. Ce couple d’amis devait emménager à Lille, car il connaissait un employé de la commune. Six mois plus tard, nous sommes devenus voisins de palier.
Nous allions souvent en Belgique rendre visite au frère de ma femme, Jugurtha s’était fait des amis à Bruxelles et restait souvent dormir chez sa tante. Il a fait des études dans le marketing et il était passionné par le sport automobile. À sa majorité, nous lui avons même offert un stage de pilotage. Jugurtha se débrouillait très bien au volant : il conduisait avant même d’avoir son permis de conduire, ce que nous avions appris par le journal télévisé ! L’information venait de Bruxelles : les autorités belges avaient arrêté un jeune qui prenait les rues de la ville pour un circuit automobile. Fort heureusement, il n’y avait pas eu d’accident et Jugurtha avait été ramené à la frontière, où la police française l’attendait.
Nous n’avions pas les moyens de financer une école de pilotage. Jugurtha serait peut-être encore de ce monde si nous nous étions sacrifiés davantage… »
Arezki se sentait coupable de la perte de son enfant, et il se laissait déborder par ce sentiment. Mohamed était attentif : en réconfortant son ami, il se rappelait la mort d’Osman, l’ami d’enfance de son frère Djamel.
Arezki poursuivit son récit :
« Malgré nos recommandations et celles des autorités, Jugurtha continua de conduire comme un pilote automobile dans les rues de la ville. C’était comme une drogue, il était en manque. Il avait besoin de ressentir l’adrénaline, il participait à des courses illégales. La compétition se déroulait dans les environs de Bruxelles, dans un patelin retiré et éloigné des habitations. Les participants venaient des quatre coins du pays, quelques-uns arrivaient du nord de la France. Jugurtha faisait partie des meilleurs pilotes, il s’était même fait un nom : les coureurs automobiles l’appelaient Djug.
L’événement a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Un homme qui travaillait dans le milieu des courses automobiles a approché Jugurtha. Les moteurs des bolides vrombissaient, les voitures dérapaient les unes après les autres, la poussière envahissait l’atmosphère. Les spectateurs, masqués pour la plupart, circulaient entre les voitures au risque de se faire renverser. Il y avait du monde ce jour-là : la vidéo a fait le tour de la toile. La police est arrivée sur les lieux assez rapidement et le public a détalé dans tous les sens, les voitures ont disparu dans un nuage de poussière laissant un jeune homme à terre. Un individu se tenait debout face aux agents de police : il avait vu la course, il ne dit pas un mot, c’était le contact de Jugurtha.
Quelques mois plus tard, Jugurtha nous a invités à déjeuner à Bruxelles et il nous a présenté son amie qui était étudiante. Nous avions passé un moment agréable.
Jugurtha n’avait plus de nouvelles du journaliste, car l’arrivée de la police l’avait éloigné. Le reporter était un novice. L’article aurait pu être un tremplin, une nouvelle vie pour Jugurtha.
Jugurtha était un homme libre, sans contrainte, tel un aigle déployant ses ailes dans un ciel bleu azuré. La liberté était parfois un luxe qu’on ne pouvait pas préserver ; l’insouciance, l’inconscience sont rarement sans danger.
Jugurtha était loin de la maison et ses fréquentations laissaient à désirer, il se laissait parfois entraîner sans savoir où cela pouvait l’emmener.
Le frère de son amie trempait dans le milieu du banditisme et connaissait le talent de Jugurtha : il lui a proposé une affaire. Jugurtha a participé à un braquage, il devait conduire une voiture. Il voyait là une opportunité de gagner de l’argent facile, c’était pour lui un moyen de participer à des courses de voitures et de devenir un pilote professionnel. »
Double peine3
Anvers, Belgique – quelques années plus tôt
Jugurtha était au volant d’une voiture de sport et il attendait au coin d’une rue d’Anvers, la ville du diamant. Le frère de son amie et ses complices étaient entrés dans une bijouterie. L’un d’entre eux avait un dossier en main et se faisait passer pour un ancien diamantaire projetant l’organisation d’un salon du diamant à Paris.
Les malfrats étaient bien renseignés : ils avaient effectué un repérage de la bijouterie et l’un des complices s’était procuré un faux dossier dans lequel se trouvaient des photos de diamants, des fichiers, une analyse et un plan de la salle. Sur la page de garde était inscrit « Salon du diamant international » avec les informations nécessaires à l’organisation d’un salon du diamant. Un des malfaiteurs endossait l’espace d’un instant le rôle d’un directeur d’agence ; il avait bien ficelé son projet et connaissait son dossier par cœur.
Dans la bijouterie, le braqueur, l’esprit commercial, avait réussi à tromper l’employé en présentant son projet : réunir les plus prestigieux diamantaires de la planète. Le malfaiteur était à l’aise, un peu trop peut-être. Le directeur de la joaillerie suivait la scène avec attention, invisible derrière la vitre sans tain, le miroir du silence. La main proche du bouton d’alerte, il attendait : il se doutait que quelque chose n’allait pas.
De son côté, Jugurtha patientait à l’angle de la rue, aussi nerveux que sa voiture. Il voulait se dégourdir les jambes, mais il y avait du passage dans la ruelle et il ne devait pas se faire remarquer. Il prenait son mal en patience et mâchait un chewing-gum.
L’employé de la bijouterie présenta des photos aux malfaiteurs. Vêtus comme des commerciaux, ils devaient choisir parmi les clichés les diamants souhaités pour l’organisation de leur salon. Un des malfrats commença à perdre patience et demanda nerveusement à l’employé de lui amener les pierres précieuses pour que le choix soit plus simple. L’employé lui indiqua que c’était la procédure : il fallait prendre rendez-vous pour pouvoir observer les diamants dans la salle du coffre.
Envahi par le stress, le malfaiteur s’agaça et menaça l’employé avec une arme à feu. Le coup partit quasiment tout seul : il n’avait pas senti son doigt presser nerveusement la gâchette. La balle traversa la vitrine de bijoux, et le bruit retentit dans toute la rue. Il y eut un moment de panique dans la bijouterie : le directeur appuya alors fermement sur le bouton rouge et l’alarme fit fuir les malfrats. Ils s’échappèrent en emportant quelques bijoux.
À l’angle de la rue, Jugurtha fit tourner le moteur à pleins gaz, le pied sur la pédale d’accélérateur. Les mains sur le volant, il démarra en trombe. Jugurtha était très énervé, car leur plan d’action était clair : il ne devait pas y avoir de revolver. Il roula à vive allure dans les rues d’Anvers, essayant d’échapper à la police. Il ferma un instant les yeux, respira fortement et ressentit la montée d’adrénaline. Le volant bien en main, Jugurtha tira sur le frein à main au premier virage, la voiture opéra alors un demi-tour. Pied au plancher, le bolide s’élança à grande vitesse laissant ses poursuivants loin derrière elle.
La voiture des malfrats s’arrêta dans un sous-bois. Personne à l’horizon. Ils changèrent les plaques d’immatriculation du véhicule et reprirent la route. Jugurtha roula sereinement en direction de Lille, pensant que les ennuis étaient derrière lui. C’était mal connaître les forces de l’ordre ; un bolide pareil, il n’y en avait pas beaucoup dans la région.
Les malfaiteurs firent une halte dans une petite ville avant la frontière française, à trente minutes approximativement de Lille. Le centre-ville était calme, les commerçants accueillants. Cependant, la police n’était pas loin, au volant d’une voiture banalisée, dans laquelle les policiers attendaient le bon moment pour arrêter les malfrats. Jugurtha et ses complices étaient plus calmes, ils ne se doutaient de rien. Ils se mêlèrent à la population, comme de vrais touristes. Les passants contemplèrent la belle voiture, un jeune demanda même à l’un des malfaiteurs s’il pouvait prendre une photo. Les quatre agents de police observaient la scène. L’un d’eux se fit passer pour un passionné de voiture automobile et discuta avec Jugurtha, pendant que les trois autres policiers se mêlaient aux passants, se rapprochant ainsi subtilement. L’arrestation se passa presque normalement : les badauds observèrent la scène dans un silence absolu.
Le protagoniste du braquage fut condamné à une peine de dix ans de prison. Il expliqua lors de son procès qu’il ne voulait pas se servir de l’arme à feu. Elle était juste là pour impressionner l’employé de la bijouterie, dit-il, ajoutant que le coup de feu était parti par accident. Ses complices, connus des forces de l’ordre, écopèrent d’une peine de cinq ans de prison. Jugurtha fut lui condamné à quatre ans à la prison de Saint-Gilles, à Bruxelles.
Le trafic était organisé à la prison de Saint-Gilles. Les braqueurs d’Anvers faisaient entrer de la marchandise, et la drogue circulait dans les cellules. Jugurtha essaya de rester en retrait et n’attendait qu’une chose : sortir de prison. Il recevait du courrier provenant de Lille, où sa famille s’impatientait de le voir rentrer à la maison. Il n’avait pas d’amis en prison, si ce n’était ses complices, ne sachant que faire Jugurtha se laissa embarquer dans ce commerce illicite.
Le bizness prenait de l’ampleur dans la prison de Saint-Gilles : l’un des gardiens réorganisa la combine. Ce n’était pas sans mal, l’argent circulait. Les braqueurs d’Anvers furent écartés, ce qui arrangeait Jugurtha mais en aucun cas le frère de son amie, mécontent de la tournure que prenaient les affaires, il dénonça le bizness aux yeux de tous : le trafic fût démantelé et Jugurtha fût transféré à la prison de Lille. Jugé pour trafic de stupéfiants, il purgea une peine de quatre années supplémentaires. Le jugement était sévère pour Jugurtha. Après sa détention, il serait expulsé vers l’Algérie, le pays qui l’avait vu naître. La double peine avait frappé : sa carte de résidence lui avait été retirée provisoirement.
Algérie – Village kabyle – quelques années plus tard
Jugurtha avait délaissé sa Kabylie natale. La seule chose qu’il restait de kabyle en lui, c’était son prénom. Jugurtha était un grand guerrier berbère, brave et courageux. Quand il comprit que ce guerrier berbère était le petit fils du roi numide Massinissa, plus tard devenu le roi de la Numidie, il en tomba de sa chaise, stupéfait. « Et, moi, qui suis-je ? » se demanda-t-il à voix haute.
Au fin fond des montagnes de Kabylie, Jugurtha était perdu. Il ne savait que faire et marchait des heures dans la plaine du Djurdjura ; il était très seul. Il habitait dans la maison familiale, avec la sœur de son père et son oncle. Djamila, sa tante, était mariée et travaillait à la ville. Tous les matins aux aurores, elle prenait le temps de préparer le petit déjeuner de son neveu.
Elle versait de la semoule dans un récipient, y ajoutait une cuillère de sel et de l’huile d’olive. Une fois le tout bien absorbé, elle versait de l’eau et mélangeait, puis elle pétrissait la pâte jusqu’à en faire une boule qu’elle laissait reposer. Avec la paume de ses mains, elle aplatissait la boule pour en faire une galette qu’elle faisait ensuite cuire sur une plaque au coin du feu. Jugutha observait sa tante, fasciné. Djamila faisait pivoter régulièrement la galette de pain dans le sens des aiguilles d’une montre, la retournait sur l’autre face et la faisait tourbillonner. Le pain était prêt à être dégusté, le lait venait tout juste d’être trait. L’odeur du pain se mêlait à celui du café : il y avait toujours là de quoi se régaler.
Le mari de Djamila vendait des fruits et légumes à l’entrée de la ville, sur un étal au bord de la route. Son patron l’approvisionnait chaque matin. Le couple possédait une vache et quelques poules.
Jugurtha avait tout gâché : la vie de ses parents, la sienne. Il était dépassé, mais l’adrénaline montait parfois en lui, et l’envie de conduire des voitures, de grosses cylindrées, l’envahissait. Le seul engin qu’il pouvait maintenant conduire était le tracteur du village. Jugurtha ne parlait pas kabyle, cette langue si chère aux habitants de la région : il n’en comprenait pas un mot. Il devait s’intégrer, participer à la vie du village. Pour passer le temps, Jugurtha répara le tracteur garé dans le hangar depuis quelques années. Il prenait goût à sa nouvelle vie, Jugurtha avait du temps devant lui, et qu’en faire se disait-il chaque jour. Il commença par apprendre la langue de ses parents. Chaque soir, après le dîner, sa tante l’initiait au langage kabyle. Il apprenait les expressions courantes, les mots essentiels, ceux de tous les jours : l’apprentissage se passait au fil du temps.
Jugurtha avait donné une nouvelle jeunesse au tracteur, qui était un peu plus puissant, plus nerveux. Au volant de son nouveau bolide, il sillonna les allées de la forêt à la frontière du village. Un matin, il aperçut au loin un groupe de jeunes avec des sacs à la main. Âgés pour la plupart d’une vingtaine d’années, ils n’avaient pas d’emploi, ni de ressources financières. Les habitants contribuaient financièrement à la vie du village : ceux qui n’avaient pas de travail participaient activement, leurs talents étaient mis à contribution, c’était un moyen de les valoriser. Ces jeunes-là étaient à l’initiative d’un grand nettoyage. Une fois triées, les ordures étaient ramassées par les cantonniers pour être amenées à la décharge. Jugurtha s’approcha du groupe, chargea dans la remorque les sacs pleins de déchets et les déposa à la sortie du village.
Il fit ensuite plus ample connaissance avec ses voisins en discutant, la plupart d’entre eux s’exprimaient en français. Jugurtha prenait plaisir à les écouter, à répondre à leurs questions. Quelques jeunes étaient étonnés par son retour : revenir au pays alors que d’autres font tout pour le quitter restait une interrogation. Très peu de personnes connaissaient sa mésaventure.
Jugurtha changea jour après jour ; le grand air lui faisait le plus grand bien. Tous les soirs, il retrouvait ses cousins et ses nouveaux amis à l’épicerie. Les villages kabyles regorgeaient de talents. Dans l’arrière-salle de l’épicerie, les villageois pouvaient se produire et, de temps à autre, ce lieu accueillait des artistes. La France lui manquait, il appelait régulièrement ses parents, ses amis. Jugurtha était triste, il regrettait ses actes passés. Il aurait aimé passer plus de temps en Algérie, avec la liberté d’aller et venir à sa guise.
En Algérie, Jugurtha ne travaillait pas, mais il aidait son oncle et sa tante à la maison et œuvrait également pour le village. Sa famille de France lui faisait parvenir quelques billets de banque, des euros bien sûr. Jugurtha gagnait au change, il avait là de quoi vivre. Les représentants du village l’avaient missionné pour l’organisation des fêtes, et il en était heureux. Jugurtha devenait incontournable, sollicité de part et d’autre : il conseillait les plus jeunes, rassurait les plus âgés, et faisait même de la médiation au sein de l’assemblée du village. Jugurtha suscitait de la jalousie.
« Il vient de France, il n’a rien à nous apprendre », clamaient quelques jeunes. « Non, il est né ici et c’est chez lui », rétorquaient les autres. « Qu’il soit né en Algérie ou en France, Jugurtha est de notre village, vous connaissez bien ses parents alors pourquoi tout ce raffut ? » expliquait la fille d’un des représentants du village.
Le ton montait et la tension était à son comble. Jugurtha ne voulait pas voir ses amis et ses voisins se disputer ainsi. Les deux clans s’étaient rassemblés à la sortie du village, il fallait rester discret. Les jeunes étaient assis sur de petits rochers. La place était retirée, à l’écart du bruit, des allées et venues, et elle ressemblait à une arène. C’était le lieu où se déroulaient les fêtes du village. Lors des événements, les habitants pouvaient y réciter quelques poèmes. Une fille à peine plus âgée que Jugurtha y prodiguait chaque vendredi une initiation au théâtre. Le vendredi était le premier jour du week-end en Algérie. Cette jeune femme n’était pas diplômée, mais férue de théâtre, de poésie, notamment celle de Mohand U M’hand. Elle affectionnait tout particulièrement ce poète berbère.





























