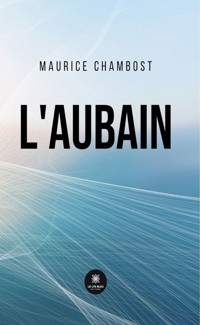
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"L’aubain" retrace le parcours d’une dynastie royale en pleine mutation. Guldur, héritier admirant son père, roi couronné à l’issue des « Guerres », voit son estime ébranlée lorsque ce dernier devient un obstacle au sein de la cour. Aux prises avec les intrigues du pouvoir et les enjeux de la succession, Guldur se retrouve face à des choix déterminants. Sera-t-il en mesure de revendiquer le trône qui lui revient ou succombera-t-il aux machinations qui l’entourent ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice Chambost se sert de sa carrière professionnelle riche en expériences pour nourrir son écriture. À travers ses œuvres, il partage des idées qui allient réflexion et imagination.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Chambost
L’aubain
Roman
© Lys Bleu Éditions – Maurice Chambost
ISBN : 979-10-422-4384-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À ma lignée…
« Mon metre…
mon cher metre…
oui je deuvraipas comencé ma letre…
vou pesté et gartifié d’une insulte…
mon trè cher metre…
oui je sè…
vou naime pa quan je di mon metre…
vou traité de sau et me reproche vou rabaissé come gourou qui tien sé fidèle…
je veu dire : c’est trè dificile indépendent…
justeman, je veu dire, c’est trè dificile je sui indépendent…
quan on croit…
mené sa barque qune tempête…
mon cher metre…
oui je sè…
vou pesté et… »
Chapitre I
Guldur était fils de roi.
Il aimait à se promener dans la ville, son violon sous le bras, pour se remplir, disait-il, de l’énergie qui émanait de ces inconnus, travailleurs pressés, écoliers bruyants, oisifs, insouciants ou commerçants bonimenteurs. Il les imaginait tous convaincus, du moins se plaisait-il à le croire, que de leur vitalité et de leur foi en l’avenir, surgirait, tôt ou tard, un pays aux lendemains lumineux et producteur de nouveautés, toutes humainement surprenantes et universellement bonnes.
Il se mêlait souvent aux attroupements des passants qui, au coin d’une rue, écoutaient dans un silence recueilli, les petits diseurs de journaux débitant, sur un ton toujours outrageusement dramatique, les articles appris par cœur, le matin même, de la bouche des journalistes.
D’autres fois, il préférait laisser courir son chiouche le long du déambulatoire lorsqu’il avait comme aujourd’hui besoin de méditer ou de se sentir seul, loin du palais et de ses pesanteurs protocolaires.
Le déambulatoire, auquel on accédait par des passerelles, était un étroit couloir, réservé aux piétons, juste assez large pour permettre le passage de deux personnes de front. Il avait été aménagé au-dessus du fleuve à l’époque où on avait décidé de recouvrir celui-ci pour le reconvertir en voies expresses. Celles-ci sillonnaient la ville d’un bout à l’autre, en suivant l’ancien tracé naturel du cours d’eau.
Alors qu’autrefois ce lieu débordait de véhicules, offrant un perpétuel ballet bruyant, puant, affairé et toujours changeant, le trafic se réduisait désormais, à un maigre flux irrégulier et saccadé. Le royaume n’était qu’un grand corps malade, difficilement irrigué par des artères exsangues, ne parvenant qu’à maintenir un semblant de vie.
Parfois en tendant l’oreille, Guldur croyait percevoir le clapotis de l’eau qui coulait sous ses pieds. Il imaginait alors ce monde souterrain, effrayant et sombre, dont parlait la rumeur. Elle disait que des êtres y avaient trouvé refuge et y menaient une existence hors de la lumière solaire.
En frissonnant, il appela sa bête pour qu’elle le rassure de sa présence.
Le chiouche était issu d’un croisement inattendu et involontaire.
On avait longtemps cru qu’il était impossible de croiser des espèces différentes entre elles. Mais un jour, dans un laboratoire du G.E.N.E. (Génétique expérimentale nucléaire extensive), sans doute mal entretenu par un personnel de service en nombre insuffisant par suite de restrictions budgétaires, une mouche avait pondu ses œufs au fond d’un tube dans lequel marinaient des gamètes oubliés de chien.
Et hop ! Le chiouche était né !
Les spécialistes y allèrent tous de leurs communiqués définitifs.
Les uns pensaient que la mouche avait été irradiée, d’autres affirmant que des poussières auraient eu un rôle de catalyseur. Jusqu’au concierge du labo qui tenta d’inscrire son nom à la postérité en expliquant qu’ayant la charge de nettoyer les éprouvettes, il avait pris l’habitude, pour économiser les produits détergents, de crachoter sur son chiffon pour l’humidifier. Ainsi, y avait-il forcément des traces de son ADN qui barbotait dans le tube (?).
Ce fut ensuite un jeu d’enfant de développer et de diversifier la race par quelques manipulations cellulaires.
De taille variable, allant de la boîte d’allumettes au polochon, le chiouche clappait plus fort qu’une mouche, mais volait bien plus haut qu’un chien. D’où l’importance d’un très bon dressage dès les premiers mois d’existence de l’animal, car un chiouche qui n’a pas appris à obéir, s’envole et ne revient plus.
Le chiouche de Guldur, à la robe châtaigne parsemée de tachettes blanches, s’appelait Bibull. Il était de taille moyenne, de bonne composition et présentait un vol à la fois léger et puissant.
Le prince marchait sans but, absorbé par des pensées vivaces et désordonnées qu’il ne parvenait pas à domestiquer.
Depuis la veille, il tortillait dans sa tête un début de lettre qu’il désespérait de pouvoir mettre en forme. Ce qui le préoccupait était si difficile à exprimer qu’il se perdait dans des explications hors sujet, espérant plus ou moins consciemment que le destinataire du courrier comprendrait l’origine de son désarroi sans qu’il l’ait réellement abordé.
Sans compter qu’il lui fallait veiller à ne pas employer de mots à l’orthographe trop compliquée.
Levant la tête, il fut surpris de constater qu’il approchait du « Quartier Réservé aérien ». Le spectacle de ces taudis, de ces cabanes crasseuses, de ce cloaque où grouillait la vie comme les vers sur le cadavre d’un chiouche, le fascinait. Cette vision le révoltait, mais il savait qu’en ces temps de transition, personne ne pouvait rien pour modifier cette situation, et lui pas plus qu’un autre.
L’endroit était devenu une dangereuse cour des miracles depuis qu’aux victimes des guerres, estropiés ou enfants nés difformes, étaient venus se mêler ; tout ce que la région comptait en tricheurs, voleurs, abuseurs de toutes espèces et même criminels ou repris de justice. Ceux-là, intègres de corps et d’esprit, avaient eu beau jeu d’asservir cette populace de gueux et de malheureux, brisés par le destin.
Guldur fit prudemment demi-tour en se promettant que les premières décisions du « roi Guldur », quand un jour, il succéderait à son père, seraient pour nettoyer cet îlot de vices et de misères. Cette présence désespérait les sujets sains du royaume de recouvrer espoir et foi en l’homme.
C’est en tout cas ce qu’il pensait.
S’accroupissant, il laissa glisser lentement son instrument au sol, et extirpa de sa poche arrière un petit carnet qu’il plaça en équilibre sur ses genoux. À l’aide d’un morceau de fine craie enserré dedans, il nota d’une écriture appliquée, mais malhabile : « pansé o q r ».
Soudain, il aperçut dans les ruines qui bordaient les voies expresses, une silhouette familière. Les risques que représentait la proximité du « Quartier Réservé aérien » avaient transformé ces kilomètres carrés de maisons détruites en un lugubre no man’s land où jamais personne n’osait s’aventurer.
Aussi la surprise pour Guldur fut-elle de taille !
« Beau ? » murmura-t-il tout à la fois étonné et inquiet.
Il siffla Bibull qu’il tenait à garder près de lui et se précipita sur la première passerelle rouillée qui enjambait les voies tout en appelant, mais sans crier : « Mon Maître ! Oh ! Oh ! C’est moi Guldur… »
L’homme n’entendit rien, occupé à tenter de déplacer un énorme bloc de béton à l’aide d’une simple barre à mine. Ce rapport de forces inégales aurait rebuté n’importe quel prétentieux en mal d’exploit sportif. Mais Beau avait toute sa vie développé une énergie déconcertante et s’était forgé au fil des années un optimisme inoxydable. Il prétendait que la vie sur Terre avait passé son temps à démontrer le postulat selon lequel avec du temps et de la réflexion, l’imagination pouvait lever tous les obstacles (!). Si bien qu’il n’était pas loin de considérer que les capacités de l’être humain étaient sans limite. De fait, il se lançait allègrement dans des entreprises, parfois désespérées, qu’il menait pour la plupart à terme.
Il releva la tête à l’approche de Bibull et manifesta sa joie en apercevant le prince qui, pourtant, s’autorisait un ton de reproches :
« Mais que faites-vous ici, mon Maître… et tout seul ?
— Prince ! Quel bon vent vous amène ? »
Guldur serra respectueusement la main de celui qu’il appelait « mon Maître » et le salua de ces mots :
« Bien le bonjour Beau, je ne m’attendais pas à vous rencontrer dans cet endroit. Du coup, il me paraît presque hospitalier. »
Beau parti d’un grand rire sonore, effrayant Guldur qui aurait souhaité moins de tapage.
Beau, Beau Prexfou, affichait un nombre d’années déjà fort respectable.
Sa qualité d’historien donnait l’illusion qu’il était de tous les temps. Il fallait trois chiffres pour inscrire son âge ! Maigre et grand, il s’était voûté à force de baisser la tête pour franchir les portes ou se mettre à la portée de ses contemporains. Il aimait à caresser avec douceur le sommet brillant de son crâne chauve, ou à lisser du plat de la main les quelques beaux restes de sa chevelure, autrefois blonde, qu’il conservait sur la nuque. Il soignait également sa petite moustache blanche qu’il voulait discrète, ainsi que son cou qu’il protégeait en permanence d’un foulard de soie, noué.
« C’est terrible à avouer, dit-il en parcourant du regard le décor inerte qui les entourait, mais ce champ de ruines est une mine inépuisable pour un fouineur de mon espèce. En détruisant le présent, les bombes font resurgir le passé ! »
Ses yeux, d’un bleu distingué, reflétaient la malice de son esprit qui vous fouettait un auditoire autant qu’une badine sur des mollets. Son âme curieuse se tenait à l’écoute de toutes les choses humaines.
Il paraissait encore très jeune !
Bibull voletait autour de Beau et quémandait des caresses en lui servant des coups de tête sur ses mains rugueuses. Beau répliqua en lui flattant la truffe, puis se mit à le repousser de plus en plus haut comme on le ferait d’un gros ballon plus léger que l’air. Le chiouche, ravi, s’abandonnait, se contentant de quelques battements d’ailes afin de retomber juste à l’aplomb du vieil homme pour l’inciter à poursuivre ce jeu le plus longtemps possible.
« N’aviez-vous pas envisagé le port d’une prothèse ? » demanda Beau tout à son amusement.
Cet apparent détachement dissimulait mal la sincère compassion et le profond sentiment d’injustice qu’il éprouvait instantanément à chaque rencontre avec le prince. Celui-ci répondit avec la même désinvolture affectée :
« Ainsi je suis né, ainsi je reste ! La nature l’a voulu. »
Guldur ne souhaitait pas entamer une conversation de salon à deux pas du « Q. R. aérien ». Il redoutait à chaque instant de voir surgir un groupe de gueules cassées aux ordres de quelques gibiers de potence, capables d’ôter la vie pour une paire de chaussures même dépareillées ou un bijou fantaisie un peu trop brillant.
L’insouciance de Beau l’agaçait. Il s’en prit à son chiouche.
— Allons, Bibull cesse d’accaparer mon Maître !
— Guldur est le maître de Bibull et Beau est le maître de Guldur, ironisa le vieil homme en faisant mine de s’adresser à l’animal.
— Vous souhaitez sans doute rentrer en ville à présent ? fit le prince comme s’il n’avait pas entendu.
— Certainement pas ! dit Beau en délaissant le chiouche, je dois d’abord en terminer avec ce « caillou ». Je veux ce trésor qu’il refuse de me rendre depuis deux heures.
— Un trésor ! Ici ?
— Voyez vous-même.
Beau désigna du doigt la partie apparente d’un objet noir, bizarre, qu’un bloc de béton écrasait et déformait sans le briser.
Guldur n’avait jamais rien vu de semblable et se montra sceptique sur la valeur réelle de cette découverte.
« Ensemble, nous devrions en venir à bout, affirma Beau. Vous avez plus de force dans votre seul bras que bien des jeunes qui en possèdent le double. »
En riant, Beau avait saisi la barre à mine, recalé d’un vigoureux coup de pied le pavé qui servait de point d’appui et ordonna :
« Attrapez la barre, prince, le plus haut que vous le pouvez ainsi que je le fais, et à mon signal, vous tirerez avec l’énergie de l’espoir. »
Guldur déposa à l’écart et avec précaution, son instrument sur un morceau de planche grise et ridée, et prit position selon les directives de Beau.
« Tirons, prince ! »
Le bloc trembla sous l’assaut.
« Encore, encore… Il bouge ! »
— Bibull ! s’écria Guldur sans faiblir, prends la chose, prends…
La bête attentive à ce qui se déroulait sous ses yeux depuis que le jeu était fini, pensa qu’une nouvelle partie débutait. Prompte à obéir, elle se rua sur « la chose », l’enserra dans ses mâchoires et banda les muscles de son corps pour l’arracher au béton.
« Tous ensemble ! cria Beau. TIRONS ! »
Tout à coup, le bloc de béton lâcha prise, catapultant Bibull qui partit en roulade arrière, entraînant avec lui la chose noire.
Oubliant toute prudence, les deux hommes poussèrent un cri de joie et éclatèrent de rire en voyant le chiouche qui tentait désespérément de se dégager de l’objet entièrement rond qui enserrait son cou comme un énorme collier, lourd, épais et disgracieux.
Guldur délivra sans peine Bibull qui s’ébroua, puis se mit à grogner.
« Non, Bibull ! gronda Guldur, ceci n’est pas à toi…
— Il nous prévient d’un danger, rectifia Beau. Des gens approchent ! Vite, à ma monobile ! »
Il s’empara de l’objet, de crainte que le prince ne l’abandonne sur place, et entreprit de sauter de bloc en bloc, avec la souplesse d’un jeune homme.
« On va être terriblement serré ! fit remarquer Guldur.
— À votre convenance, répliqua Beau qui s’éloignait en bondissant. »
Bibull poussa alors un hurlement sinistre et, dans l’instant, une pièce métallique de plusieurs kilos, aux formes imprécises, vint s’abattre aux pieds de son maître dans un bruit sourd. Des silhouettes menaçantes apparurent à quelques dizaines de mètres de lui.
« Vole, Bibull ! cria Guldur en attrapant son violon, vole ! » Ce que la bête avait appris à traduire par il y a danger à rester ici !
Le prince prit la fuite au milieu d’une pluie de pierres, de bouts de bois et d’une multitude d’autres projectiles qu’il ne s’attarda pas à observer de près.
Quelques minutes plus tard, collés épaule contre épaule dans le minuscule habitacle de la monobile, les deux hommes savouraient le plaisir d’avoir échappé à un danger mortel, tandis que Bibull volait au-dessus d’eux, comme un ange protecteur.
« Vous m’avez épaté, assura Beau tout en pilotant, vous êtes parti bien trente secondes après moi et pourtant vous avez eu le temps de mettre l’appareil en marche avant que je n’arrive ! Même Bibull était derrière vous ! »
Ils partirent d’un rire gai et nerveux.
— Vous portiez « la chose », ça vous alourdissait, fit remarquer Guldur hilare. Ces gens ne pensent qu’au mal, commenta Guldur redevenu sérieux. C’est bien une sale manie ça d’agresser tout ce qui bouge, ne croyez-vous pas ?
— C’est une manie qui leur vient de la nuit des temps… et je crois que, fort heureusement, nos ancêtres, proches ou lointains, l’avaient aussi… Sinon, ni vous ni moi ne serions là !
— De quoi parlez-vous ?
— De l’obstination à vouloir survivre à tout prix ! Même dans les pires conditions : vivre coûte que coûte !
— Alors, vous pensez ça normal, mon Maître ?
— Crotte de chiouche ! dit Beau, il me donne encore du « maître » ! Pour votre punition, vous m’accompagnerez la prochaine fois !
— La prochaine fois ! s’écria Guldur, vous comptez revenir dans ce coin ?
— Certainement, affirma Beau, je pense être tombé sur un gisement.
— Un gisement de… de choses comme celle-ci ? fit Guldur l’air dégoûté. Et vous appelez ça comment ?
— Un pneumatique ! répondit Beau triomphalement. Celui-ci est intact et complet ! Une pièce magnifique ! Et il y en a d’autres !
— Un quoi ? fit le prince.
Chapitre II
Guldur était fils de roi parce qu’un jour, son père, « lassé d’être inactif », paraît-il, s’en était allé dans la campagne environnante en demandant aux gens : « Ça vous dirait d’avoir un roi… et que ça soye Moi ? » (sic)
C’était, en tout cas, la version courte que sa majesté Le-Crack-Roi-Blagard se plaisait à raconter les soirs de réception, au grand désespoir de son bio-conteur officiel, Tine Doul, homme à la mémoire prodigieuse, à qui bien au contraire, il ne fallait pas moins de trois heures pour relater en trois actes et douze tableaux « La Subtile, Prodigieuse Et Providentielle Prise Du Pouvoir Par Blagard-L’Indispensable ».
Et croyez-moi, il ne décrivait pas l’affaire comme une simple balade nonchalante au cœur d’un plat pays tout acquis d’avance !
Dans un style très diversifié, alternant des textes grandioses avec d’autres bavards et insipides, Doul contait la saga des épreuves de Blagard, qui l’amenèrent à lancer au premier acte « l’Appel du 18 juillet », pour au second former « L’Unité » et finir en apothéose au troisième avec « Le Salut ».
Blagard n’assistait jamais à cet interminable récit de Ses propres exploits et tout le monde y voyait une preuve de Sa grande modestie d’autant qu’Il n’en faisait non plus jamais aucun commentaire.
En fait, Blagard était monté sur le trône quelques mois après « la vraie Paix » alors que sur l’ensemble du globe, les rescapés, hébétés, erraient au milieu d’une désorganisation planétaire totale qui allait perdurer de très nombreuses années.
On disait aussi bien « les Guerres » que « les Paix », car ce fut durant des années, une alternance de conflits sévères et violents avec de longs épisodes de paix relatives et instables. Les deux dernières périodes (2952-2961 et surtout 2969-2973) ayant à elles seules, causé plus de morts et de dégâts que toutes les autres réunies !
Chacun notera que l’auteur ne s’étend pas sur les origines de ces conflagrations, les experts eux-mêmes ayant encore à ce jour d’âpres échanges de vues sur le sujet. Et puis, ça ne changerait rien à son récit, mais il est certain que la surpopulation généralisée avait déjà été par le passé, à l’origine de nombreuses et vilaines chamailleries plus ou moins étendues.
Dans les derniers mois de 2973, de petites communautés s’étaient formées dans les méga villes dévastées et y survivaient en fouillant les décombres, obligées de réapprendre à tâtons, les gestes ancestraux de la cueillette et de la chasse.
Ceux du combat n’ayant jamais été oubliés, l’habitude fut reprise de lancer des raids de pillage sur les groupes voisins que l’on croyait toujours plus riches, plus favorisés ou plus faibles !
Mais ça-et-là des hommes et des femmes s’étaient levés, clamant leur lassitude de guerroyer à coup de lance-pierres ou de gros bâtons, disant qu’il valait mieux s’entendre et s’entraider. Avaient alors fleuri des États, des Principautés, des Seigneuries, territoires plus ou moins vastes aux frontières parfois imprécises et l’on avait songé à tout reconstruire.
Après réflexion, la populace aurait répondu : « Un roi ? C’est bien, ça ferait chic ! Ça donnerait l’impression qu’on serait heureux. »
Sans doute ces petites gens s’imaginaient-elles confusément que la misère est plus supportable à l’ombre des fastes d’une cour royale, forcément rutilante, laquelle tirerait vers le haut, sinon leur pouvoir d’achat, du moins leurs espoirs et leurs rêves de grandeurs.
Et Blagard était devenu monarque sous le nom de Blagard III pour créer l’illusion d’une dynastie déjà longue.
Dans un premier temps, Il S’était attelé patiemment, avec l’aide de Tine Doul, à maîtriser la langue, à former correctement ses phrases et à employer des mots pourtant simples, dont il ne connaissait même pas la signification.
Puis Il avait essayé d’organiser, de remettre sur pied et de revitaliser Son royaume sans trop savoir jusqu’où il s’étendait. Ainsi, Il partait parfois en tournée droit devant Lui pour le simple plaisir d’être acclamé par Son peuple et lorsque les badauds n’applaudissaient plus, qu’Il lisait sur leur visage une expression étonnée, ou entendait des murmures :
« Mais on n’a pas de roi… on a un président ! » Il s’excusait et faisait demi-tour.
Issu d’une longue lignée de commerçants, Blagard aurait pu devenir un brave homme.
Son ancêtre, Erick Van Den Roulmoule, d’origine hollandaise, s’était installé en France au 22e siècle, suite à de très mauvaises affaires. Il avait éprouvé le besoin de franciser son nom en Eric Abdel-Roulmoul.
Promis à une petite vie sans histoire, les Guerres allaient donner à Blagard l’occasion de devenir héros par hasard, avant de coiffer presque sans coup férir, une gentille couronne qui, certains jours, cependant, pèsera bien lourd sur son crâne.
Adulé et respecté comme chef de guerre, Blagard en tant que roi, n’était ni cru ni craint.
Au lendemain de Son accession, Son tout premier gouvernement se renforçait chaque jour de ministres, de secrétaires, de hauts fonctionnaires dont Il ne connaissait ni le nom ni l’attribution. Toutes les semaines, on faisait état du passage ici ou là, d’individus se déclarant « roi Blagard » et levant pour leur compte personnel qui un impôt sur les habits neufs, qui une taxe sur les cheveux longs ou les moustaches, qui une redevance sur les bavards ! De même, on ne comptait plus les prétendus pères, mères ou frères du roi qui monnayaient frauduleusement d’hypothétiques faveurs royales.
Mais la reine Titi, Tinette de son prénom, qui ne souhaitait pas devenir un personnage d’opérette, fit comprendre à son époux que le pouvoir suprême se confisque ou s’abandonne et que si on veut le garder il faut s’en donner les moyens.
Descendante d’une famille de la haute bourgeoisie d’avant-guerres, celle qui allait devenir la reine Titi, avait rejoint dès 69 les « Forces Combattantes Libres » après s’être évadée des geôles où l’avait jetée un certain ignoble, Ness Grocule. Celui-ci s’était constitué un fameux trésor de guerre grâce aux fortes rançons qu’il réclamait en échange de la libération de ses prisonniers et plus souvent de ses prisonnières.
Après la soixantaine, la reine Titi s’était légèrement enveloppée, mais son visage conservait les traits réguliers de sa beauté d’autrefois. Les pattes d’oie qui prolongeaient l’amande de ses yeux, et qui avaient charmé tant de prétendants, nous donnaient à tous, l’impression d’un sourire permanent.
Blagard fit alors le ménage dans son entourage royal, donna priorité à la construction de prisons, constitua une machine policière musclée, institua le crime de lèse-confiance et décréta la confiscation des biens de tous ceux qui se laisseraient berner par méconnaissance de la généalogie des Abdel-Roulmoul.
« Être roi est un métier », répétera souvent Blagard grassement payé pour le savoir. Et d’ajouter, sûr de déclencher des bordées d’éclats de rires obséquieux : « Mais on est en examen tous les jours ! »
Après bien des années de règne, Il fera graver sur Son trône une paire de pantoufles, symbole naïf illustrant à Ses yeux le fait que tout choix implique des sacrifices et que, tôt ou tard, vient le moment où les regrets sautent à la gorge de votre orgueil.
Un jour, en plus d’être roi, Blagard devint papa. En 2981.
Mais il était trop tard !
Blagard avait pris goût à l’affaire : les priorités du monarque étranglèrent les velléités affectives du père.
Il afficha un mouvement de recul devant le berceau du bébé qu’Il se décida cependant à soulever à bout de bras, pour l’examiner comme on le ferait d’un bien de consommation.
Le descendant de la Société de Négoce Van Den Roulmoule et Cie fit la moue devant l’état de la marchandise.
Il reposa l’enfant.
Ce fut Son dernier contact corporel avec Son héritier.
La reine Titi reçut cette répulsion en plein visage, prenant pour elle, ce rejet du nourrisson par son géniteur.
Ce fils devint peu à peu pour elle, son unique raison de vivre, sa source d’oxygène, son présent et son avenir et la principale cause de ses insomnies.
Chapitre III
Guldur était né avec un seul bras, deux jambes, mais les pieds légèrement en dedans.
Un peu poitrinaire, de santé hésitante, craignant également les courants d’air et les coups de soleil, le prince se mit dès sa petite enfance à consommer des suppositoires comme d’autres des sucreries.
À sept ans, il commença à perdre ses cheveux, et son père, mi-taquin mi-cruel, lui disait : « Ils ne vont pas bien bas tes cheveux, mon prince, ils tombent sur tes oreilles ! »
Effectivement, Guldur avait les oreilles très recouvertes d’un duvet qui, en prenant de l’âge, ressemblait plutôt à de la fourrure que le coiffeur royal s’efforçait, régulièrement, de faire disparaître.
Mais l’enfant ne se vexait pas des moqueries paternelles, car il possédait en entier le sens de l’humour.
Pour vous dire à quel point il appréciait la plaisanterie et prouver que la rancune ne logeait pas chez lui, on rapporte qu’il menaçait parfois son royal géniteur en ces termes malicieux :
« Je vais Vous mordre ! » tout en montrant les mâchoires.
Ceci était fort drôle, car il présentait des dents toutes petites et ciselées, un peu voyez, comme s’il avait utilisé une râpe à fromage en guise de brosse à dents.
Cette particularité lui conférait un sourire de scie sauteuse dont il n’était pas avare.
Et chacun de ces sourires illuminait un regard tel que vous n’en avez jamais vu dans votre miroir le matin.
Oh ! Ces couleurs !
D’un côté, le bleu rosé des mers chaudes d’avant.
De l’autre, le tendre céladon du « Ciel d’hiver » suspendu dans le hall d’entrée du musée royal des Œuvres Sauvegardées.
Lorsque le prince posait sur vous ses yeux vairons, immanquablement vous songiez au génie du bijoutier qui avait ainsi placé ces deux pierres précieuses dans un pilulier de bazar.
Et il en jouait le bougre.
Comme il impressionnait avec ce regard fixe qui semblait refléter des rêves accessibles à nul autre que lui !
Guldur aimait peu les rencontres et les causeries mondaines, mais se pliait aux exigences de sa charge.
Étant loin d’être sot, il passait pour un garçon charmant, à la conversation agréable, ne laissant pas insensibles les jeunes filles.
On recherchait sa compagnie au grand dam de sa maman qui se plaignait de ne pas « voir » son fils assez souvent.
En vérité, la reine Titi avait cessé de le voir quelques mois après sa naissance.
La reine Titi était devenue aveugle des suites de « sa maladie », comme elle disait pudiquement, et ses orbites étaient désormais garnies de billes de verres, joliment polies, mais inertes. « Voir » son Guldur signifiait l’écouter, sentir la chaleur de son souffle et le frôler du bout des doigts. Combien de chagrins n’avait-elle pas décelés uniquement en caressant le visage de son fils ? Un tremblement de la joue, une larme mal séchée, un sentiment un peu trop à fleur de peau…
Guldur s’imposait une règle de vie, une seule !
Aucun protocole ni aucune exigence diplomatique n’avait jamais pu la remettre en cause : après s’être fait raser les oreilles (de temps en temps), il réservait chaque matin sa première visite à sa mère.
Souvent d’ailleurs son emploi du temps princier ne prévoyait rien d’autre pour la journée.
La reine Titi était petite pour une reine : 1m81.
Aussi veillait-elle à toujours se rehausser.
Par le bas à l’aide de semelles épaisses, et par le haut grâce à des chignons. Elle les montait avec délicatesse et habileté en piquant adroitement quelques épingles dans ses cheveux noirs après les avoir torsadés, spiralés puis ramenés sur le sommet du crâne en récupérant au passage une mèche-anguille qui aussitôt s’échappait à nouveau et venait barrer son regard éteint.
La reine entendait résonner longtemps à l’avance le pas de son fils dans les couloirs du palais. Lorsqu’elle l’avait suffisamment « observé », ce n’était alors entre eux que murmures complices, éclats de rires enfantins, mots chuchotés à l’oreille, allées et venues au bras l’un de l’autre. Ils faisaient ainsi quotidiennement provision de tendresse.
Après cela, la reine était prête à passer majestueusement une longue et pénible journée. Active malgré sa cécité, elle présidait de très nombreuses associations et s’obligeait à visiter tout ce que le royaume comptait en hospices, crèches et même prisons. Elle avait, par ailleurs, récupéré le ministère de la Famille et du Partage. Elle œuvrait au sein d’une petite équipe de fonctionnaires, à l’amélioration des conditions de vie de chacun des sujets de son mari, depuis leur procréation jusqu’à leur mort, ainsi qu’à une juste répartition des maigres richesses du royaume.
Autant dire qu’il n’y avait pas grand-chose à faire !
Le prince aurait aimé être plus près de son père, mais le roi n’avait jamais de temps à lui consacrer ne « vivant que pour Ses Sujets ».
Il n’était pas non plus le bienvenu dans la salle du trône dont l’accès était strictement réservé aux ministres et hautes personnalités.
Toutefois, Blagard tenait à avoir le dauphin à ses côtés lors d’événements mondains ou lorsqu’Il savait que la foule se déplacerait. Ces manifestations n’apportaient pas au prince le réconfort qu’il en attendait, mais le renforçait dans l’idée que ce qui était arrivé de mieux à ce royaume depuis « la vraie Paix » était bien l’accession paternelle au destin suprême.
Un jour, le roi inaugura une rue de la ville à son nom.
Il y avait déjà une avenue Blagard III, un boulevard Blagard III, un passage Blagard III, un quai Blagard III, une promenade Blagard III, mais pas d’impasse, le roi s’y opposant formellement.
Profitant de la prise d’assaut du buffet par une foule plus attirée par la perspective de manger quelque chose que par la présence du roi, le ministre des Finances lui fit part de son inquiétude :
« Sire, voyez comme tous ces gens se jettent sur la nourriture. Une imposition supplémentaire, même minime, ne serait pas supportable. Déjà, le peuple vit sur ses réserves. Si on grève davantage ses maigres économies, il n’aura plus rien à mettre de côté pour les mauvais jours. »
— Les mauvais jours ! Quels mauvais jours ? Pourquoi faudrait-il mettre de côté pour les mauvais jours ?
Puis, toujours maugréant et en se tournant vers son fils : « Non, vraiment ! Retiens bien cette leçon Guldur. Lorsque tu régneras, ne place jamais un pessimiste aux finances ! »
Ce genre de phrase chavirait Guldur.
Au détour d’une discussion, il était ainsi explicitement désigné pour la succession.
Imaginer que lui, qui s’était contenté de naître et de couler une vie tranquille de nanti, prendrait un jour les rênes du royaume, lui donnait le vertige.
Il estimait ne pas être digne d’une telle charge si pleinement magnifiée par son père, le roi.
Il ne tenait pas la comparaison devant un tel personnage, célébrissime résistant, combattant redouté, chef obéit.
Il n’avait rien fait de toute sa vie pour mériter une telle fonction.
Pas encore !
Chapitre IV
« Sans mentir, mon Maître, voilà bien deux mois que j’ai inscrit dans mon carnet : “visit Bau”, et puis le temps passe… »
Guldur parlait, tout en se livrant à l’une de ses activités favorites : se promener dans l’appartement de Beau.
On s’y déplaçait d’ailleurs, un peu comme sur le champ de ruines qu’ils venaient de quitter précipitamment : il fallait enjamber, contourner, regarder où on posait les pieds, parfois se baisser. Il y avait tellement d’objets amoncelés que l’on pouvait aller du Salon-Reine-Titi à la Cuisine-Pingo sans toucher le sol.
Le risque n’était pas nul d’être enseveli par les tonnes de bric-à-brac déposés, pêle-mêle, sur des quantités d’étagères cintrées, qui garnissaient les murs jusqu’au plafond, si l’une d’elles venait à céder.
Lorsque la fatigue vous prenait, il était inutile d’espérer vous reposer sur un fauteuil ou même sur une simple chaise : ils étaient tous envahis par des dizaines de très vieux livres, de vrais livres ! Support papier, imprimé à l’encre et tout… attendant d’être lus, dépoussiérés, rafistolés, répertoriés, classés… un jour.
« Je prépare un bouillon de carotte, lança Beau de sa Cuisine-Pingo (du nom d’un compagnon de combat qu’il citait encore souvent, trente ans après sa mort). En voulez-vous ?
— Volontiers, Beau, s’empressa de répondre Guldur qui détestait le bouillon de carotte. Un petit verre. »
Beau exprimait son admiration aux quelques personnes, vivantes ou décédées, qui à ses yeux valaient la peine qu’il ne les oubliât pas, en placardant leur nom au-dessus des portes. Outre le Salon-Reine-Titi (la plus grande pièce) et la Cuisine-Pingo, il vivait ainsi, entre la Chambre à coucher – Thierry (poète du XXVIe), la Salle de bains – Madame et Monsieur (c’est ainsi qu’il désignait ses parents) et le Bureau-M-F-B (dont on ne savait rien), pièces que desservait le Couloir-Jean-François (utopiste-pacifiste de la Triste Époque).
Il avait par ailleurs, et de façon unique, tenu à crier son aversion en baptisant ses… commodités : « WC-professeur Buff. »
De tous ces objets invraisemblables, parfois rouillés, souvent brisés, Guldur n’en connaissait aucun. Mais il savait que petits ou grands, ils avaient été les compagnons de ses ancêtres, outils de travail ou instruments de loisir, et il passait des heures à tenter d’imaginer leur fonctionnement ou leur finalité. Il demandait bien parfois à Beau le nom de tel ou tel, ou l’usage qu’il s’en faisait, mais s’empressait de tout oublier, afin que resurgisse le mystère.
Par ses connaissances et ses recherches, Beau était le témoin d’un temps que Guldur savait révolu à jamais et l’acharnement avec lequel son vieux maître se battait pour sortir ce passé du néant l’inquiétait presque.
« L’Humanité, disait Beau, est face à une situation qu’Elle n’avait jamais connue depuis que le monde existe. Elle s’est elle-même privée de son passé. Après avoir confié toute sa mémoire à des machines, Elle a détruit les machines ! »
Lorsque le prince lui pointait qu’on vivait dans le présent et non dans le passé, il haussait le ton et rétorquait : « Et comment voulez-vous affronter l’avenir si on ignore d’où l’on vient ? Aucune civilisation n’a jusqu’ici été assez folle pour se priver des apports de ses Anciens… sauf la nôtre ! »
Ainsi s’échinait-il depuis des mois à tenter de redonner vie à un vieil écran, plus que tricentenaire, de programmes-à-rétention, récupéré on ne savait où.
« Tout ce que cet appareil à diffuser, expliquait-il avec une passion gourmande, est dedans. Quelle richesse si on pouvait le réactiver !
— J’ai l’impression que vous recherchez plus la compagnie des morts que celle des vivants, lui reprochait parfois Guldur.
— Non, prince, on ne vit pas avec les morts, mais on vit grâce à eux ! Tout ce qu’ils ont, avec peine et patience, inventé, construit, imaginé, leur survit et nous sert aujourd’hui. Ou nous servirait, si on n’avait pas l’habitude de toujours casser ce qui fonctionne bien. »
C’est Beau qui apprenait à Guldur à lire et à pratiquer les quatre opérations, enfin les trois… Car Guldur ne parvenait pas à assimiler la division. Ceci avait toujours plongé Beau dans un abîme de perplexité et après de nombreuses tentatives infructueuses, il était parvenu à la conclusion que le prince avait connu dans son existence, ou peut-être avant, un « événement mystérieux » qui lui interdisait la mentalisation de l’acte de partager. L’intelligence du prince n’y était pour rien, pas plus que son altruisme, car, bien que fils unique pendant les onze premières années de sa vie, il était tout sauf un égoïste et le don était pour lui un geste aussi familier que pour d’autres se fourrer le doigt dans le nez.
Il lui apprenait aussi à écrire, ce qui ne se pratiquait plus depuis belle lurette. Les scriptographes-à-voix avaient lentement, mais inexorablement rangé l’écriture au rayon des « grandes inventions d’autrefois ». Mais par un superbe caprice du destin, les quelques passéistes-ringards qui se battaient obstinément depuis des décennies pour maintenir l’écriture en vie étaient devenus des personnages de la plus haute importance avec la destruction des usines fabriquant les scriptvox et à mesure que ceux en service devenaient « sourds » par manque de pièces de rechange.
Beau avait ainsi hérité du titre envié (par les autres) d’« écrivain personnel de la reine ». Celle-ci faisait appel à lui pour des correspondances particulièrement sensibles qui demandaient une discrétion absolue de la part du scribe et une confiance totale de la reine envers ledit scribe. Ce qui avait le don d’irriter le roi !
Lorsque Beau, quittant sa cuisine, rejoignit le prince, celui-ci était en arrêt devant une petite statue déposée sur la table du salon. C’était bien le seul meuble à n’être jamais entièrement encombré et cela conférait à cette statuette une importance toute particulière.
« J’ai failli ne pas vous remettre, dit Beau, tenant un plateau sur lequel il avait placé deux bols d’un jus orange et fumant. Vous ne m’aviez pas habitué à porter un chapeau… il vous va magnifiquement bien… il vous masque un peu le visage, mais il vous va bien.
— Mon miroir n’était pas en grande forme ce matin, expliqua Guldur en réchauffant sa main sur le bol. »
Le visage du vieil homme devint grave.
Jamais le prince n’avait semblé souffrir de son apparence physique.
« Vous me paraissez bien soucieux aujourd’hui, jeune Guldur ! » dit Beau.
Le prince eut un petit sourire.
Il songea à cette phrase que Beau se plaisait à lui répéter souvent : Je lis en vous comme dans un livre !
C’était tellement vrai !
Combien de fois son maître s’était-il excusé, en le recevant, de ne pas avoir une minute à lui consacrer parce que trop occupé, débordé par son ouvrage ? Ne lui prêtant aucune attention, il le laissait fouiner en silence dans son capharnaüm. À l’instant où son jeune ami prenait congé, Beau relevait la tête et disait : « Bon… voyons donc ce problème qui vous agite tant mon petit prince ! »
« La grande nuit approche, esquiva Guldur, je ne voudrais pas être déçu…
— Déçu ? répéta Beau, ce sera une fête magnifique ! La première depuis les Guerres.
— Bien sûr ! Mais il me semble que chacun croit que tout sera différent après… que le nouveau millénaire va nous apporter de grands et positifs changements, un bonheur inconnu et facile.
— Les hommes sont prompts à mettre de la magie dans une simple date de calendrier uniquement parce qu’elle comporte une série de chiffres identiques, approuva Beau le regard perdu dans les volutes de son breuvage chaud. Ils se demandent rarement en quoi ils peuvent être utiles aux autres ! Alors que c’est peut-être la seule chose qui nous différencie de l’animal : nous choisissons ce que nous devenons ! »
Guldur but son bouillon de carotte sans même grimacer.
« Vous le pensez vraiment Maître, chacun de nous peut décider ?
— Chacun croit qu’il peut changer dès demain, répliqua Beau… ce n’est pas si simple… Il n’est pas nécessaire d’attendre un nouveau millénaire pour se transformer, chaque jour est nouveau… mais s’il n’y a pas d’événement qui oblige à la réflexion, d’élément qui amène à regarder la situation en face ou de réalité qui vous dégoûte de vous-même…
L’avenir, reprit-il après un silence, ne nous apporte jamais rien d’autre que nous n’avons nous-mêmes semé. D’ailleurs, je pense un peu comme vous. Les hommes n’ont besoin de personne pour détruire, mais ils comptent toujours sur le Destin pour leur offrir des jours meilleurs et les tirer d’affaire ! comme ça… dit-il en faisant claquer ses doigts. »
Guldur ne l’écoutait plus. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Il n’avait pas tout dit à Beau. Beau le savait et percevait son embarras. Il eut envie de lui parler de cette lettre qu’il ne parvenait pas à lui écrire.
« Surtout qu’un jour, il faut vivre à deux… »
Beau haussa les sourcils, ce qui signifiait dans leur code de communication : je ne suis pas sûr de vous comprendre, soyez plus précis.
« Je… Il est l’heure… je vais chercher Mag à son travail », dit Guldur rougissant.
Le maître eut un large sourire. Le prince réservait ses secrets à son autre confident.
« Embrassez-le fort pour moi, dit-il.
— À bientôt, mon M… Il s’interrompit. Donnez-moi un peu de temps, j’ai besoin de vous.
— C’est bien fait pour moi ! s’exclama Beau feignant de ne pas avoir perçu le ton pathétique du prince, je n’ai pas été à la hauteur. C’est d’accord ! Je veux bien vous entendre m’appeler “mon maître” quelque temps encore. Mais il faudra songer à quitter le nid.
— J’y songerai, mon Maître, s’exclama joyeusement Guldur comme s’il avait marqué un point. Prenez soin de vous.
— Et vous, faites comme l’eau du ruisseau : changez, mais restez le même, répondit Beau. »
Guldur s’empara de son violon, réveilla Bibull et se dirigea vers la porte.
Avant de la franchir, il se retourna.
Fixant la statuette sur la table, il dit songeur : « C’est étrange n’est-ce pas ? Cet homme nu, fixé sur une croix… »
Chapitre V
Guldur avait quitté Beau sans oser lui parler.
Il n’avait pu lui dire à quel point il se sentait petit et misérable tant il redoutait de décevoir ce maître aimé qui depuis toujours lui enseignait à se connaître et à se découvrir, condition première, disait-il, pour affronter la vie et les hommes.
Or, ce qui s’était passé quarante-huit heures auparavant, précisément par le beau matin de ses dix-huit ans, l’avait tellement bouleversé qu’il se sentait étranger dans son propre corps, ne maîtrisant plus ni ses sentiments ni le cours de son existence.
Ce jour-là, le prince avait percuté quelqu’un en montant à reculons à la tour Réffel.
Vieille de deux siècles et demi, les mauvaises langues prétendaient que la tour Réffel avait été construite tout en plaques et en poutres de conneries pour bien montrer, à l’époque, qu’on en possédait de grosses réserves et qu’on ne risquait pas d’en manquer !
Emporté par son élan, Guldur s’était allongé de tout son long sur la personne, la couchant sur les marches.
Les deux corps s’étaient mêlés le temps pour lui de se ressaisir.
« Excusez-moi, mademoiselle », avait-il dit, confus, avant de se taire, incapable d’articuler un mot de plus tellement il avait été subjugué par la beauté de la jeune fille, dès l’instant que son regard s’était posé sur elle. Il ne comprit pas tout de suite l’origine de cette chaleur qui emplissait ses entrailles, mais déjà il aurait voulu la serrer dans son bras.
Il faut dire qu’elle était belle comme une veille de vacances.
Elle était vêtue d’un large pull noir qui épousait agréablement le relief généreux de son buste, et d’une longue jupe légère qui au moindre mouvement d’air, dessinait le galbe de ses jambes. Détails anatomiques que le corps du prince avait furtivement appréciés au moment du contact et qui, insidieusement, étaient en train de s’engrammer dans sa chair.
Profondément troublé, le visage empourpré, il la regardait comme un enfant regarde la boîte de friandises qu’on vient de lui offrir.
Cela eût pu d’ailleurs lui coûter la vie, car, oubliant les marches sur lesquelles il se tenait, il faillit basculer. Quand il parvint à rétablir son équilibre, elle avait disparu de sa vue, dansant quelque part dans l’immense escalier en colimaçon qui résonnait du claquement de ses semelles de bois.
Guldur reprit son ascension, si pantelant et désorienté qu’en atteignant le sommet, il ne savait plus pourquoi il était là.
Il se sentait léger, léger.
Il envisagea même un instant de franchir la balustrade, persuadé de pouvoir planer et rêver tout à loisir de celle qu’il venait de croiser. Mais il savait bien que ce genre de manifestation euphorique avait toutes les chances de mal se terminer et il pensa que les employés, responsables du nettoiement, en bas, avaient bien assez de travail avec les crottes du pigeon.
Puis il ressentit comme une souffrance, et cru que cette impression de manque venait du bras qu’il n’avait pas.
Pour la première fois, il se sentait incomplet.
C’est un Guldur soucieux et désemparé qui redescendit de la tour.
Il songea qu’il était peut-être temps désormais pour lui de devenir adulte, que dix-huit ans étaient un âge propice pour jeter les bases d’une vie d’homme, qu’il devrait bien un jour renoncer aux charmes trompeurs de l’enfance et s’ouvrir à la vraie vie.
Docteur en psychologie minérale, ayant même passé avec succès une très rare spécialité en psychologie comportementaliste des matériaux inorganiques, Guldur savait pertinemment qu’aucun poste, ni dans l’enseignement ni dans le secteur privé, n’était à pourvoir dans sa branche. Aussi, pour ne pas vivre aux crochets de la liste civile de son père, avait-il suivi pendant six semaines, au sortir de son doctorat, un stage de reconversion pour devenir jeteur de pierres. La profession jouissait d’un grand prestige, mais n’avait finalement qu’un avenir limité. Au moins conservait-il quelques attaches avec le monde minéral qu’il connaissait si bien.
Parmi les nombreuses pertes pour le genre humain qu’avaient occasionné les Guerres, il y en eut une qui passa, dans un premier temps, inaperçue, mais qui se révéla à l’usage catastrophique : l’impossibilité technique de matérialiser les radiations d’un atome de Krypton 86.
En d’autres termes, il n’existait plus de mètre étalon.
Des gens sans scrupules abusèrent bientôt de la situation, jetant le trouble ici ou là en déclarant non réglementaires les instruments utilisés pour mesurer. Tout y passait : mètre de couturière, double décimètre, décamètre… et l’on ne savait plus à quelle graduation se fier. Il devenait impossible d’acheter un lopin de terre, tant ses dimensions semblaient élastiques selon que l’on était acheteur ou vendeur. Le moindre morceau de tissu faisait l’objet de tractations hargneuses à n’en plus finir, qui tournaient souvent au pugilat, le geste expert de la marchande ne tombant jamais d’accord avec l’œil précis de la cliente.
Jusqu’aux forces de l’ordre qui, voulant verbaliser des excès de vitesse, s’entendaient opposer des réflexions du genre : « Cent vingt peut-être, mais d’après le système métrique de l’Association des Usagers de la Route, je roulais à quatre-vingts… pas plus. »
Aussi avait-on à la hâte, créé de toutes pièces, un nouveau corps de métier : les Maîtres-Mètres, assermentés, chargés de régler tous les litiges, aux décisions souveraines et sans appel. La nouvelle dans le public de l’arrivée de cette troupe d’élite de la mesure suffit à calmer les esprits et très vite, la contestation prenant fin, le rôle des M-M. se cantonna à ce qui n’était au début qu’une petite partie de leurs prérogatives : le métrage de terrains.
Il se pratiquait à l’aide d’une pierre que l’on jetait devant soi. L’espace parcouru par le caillou constituait l’unité de longueur. On achetait un pré mesurant trois jets de pierre de long sur deux de large. Toute la difficulté consistait à reproduire des lancers toujours identiques, sans faiblir même après de nombreuses heures de métrage, tout en ayant bonne vue pour repérer son outil-mesureur dans les buissons, sans y passer la matinée !
Tout cela Guldur l’avait appris au cours de son stage et il était devenu un habile « jeteur-de-pierre », très recherché.
Il ne se séparait jamais de son galet de forme oblongue, joliment poli, noir et gris aux nervures blanches, avec lequel il se targuait d’effectuer des jets aux caractéristiques toujours constantes en longueur et hypogée.
Bien sûr, le prince avait dû prêter serment de ne jamais favoriser l’une ou l’autre des parties, de ne pas lancer par grand vent ou en souffrant de douleurs rhumatismales et de ne jamais utiliser d’autres moyens de propulsion que sa propre force musculaire.
Mais lancer des pierres ne nourrissait pas son homme.
« Au plus, ça peut constituer une activité d’appoint, mais sûrement pas assurer la subsistance d’une famille », s’avoua Guldur.
Il fallait que son esprit soit bel et bien chiffonné pour se laisser aller à concevoir des inquiétudes aussi dramatiquement roturières.
Tout ceci dénotait un bouleversement bien plus grand qu’il n’y paraissait de prime abord. De telles pensées n’auraient pas dû se frayer un passage vers son cerveau de prince, choyé et guidé jusque dans ses rêves de gloire.
On ne lui avait jamais demandé d’imaginer son futur, ou d’échafauder des projets d’avenir. Son père s’en chargeait. Il n’avait pas été élevé pour s’émanciper dès la venue du premier poil de barbe ou pour se laisser tenter par les attraits du mot autonomie.
Encore moins pour s’émouvoir au passage d’un jupon inconnu !
Pire ! il passa aux actes.
Il se rendit directement au Bureau des Grandeurs-de-Véhicules. Cela lui semblait être le plus urgent.
L’employée du Bureau ressemblait beaucoup à une femme.
Bien qu’apparemment bougonne et revêche, elle avait les gestes à la fois délicats et précieux d’une vieille dame pudique.
Le prince la salua par un : « Bonjour, madame. Je possède un permis de conduire les véhicules à une place et je désirerais obtenir l’autorisation pour les véhicules à deux places », expliqua-t-il.
Une vieille loi remontant à l’époque où plus aucun axe urbain ne parvenait à écouler un trafic devenu hyperdense, avait proscrit les déplacements d’une personne seule dans des engins prévus pour quatre ou cinq. Les constructeurs avaient dû s’adapter en quelques années, et proposer sur le marché des monoplaces, des biplaces, des triplaces… de même standing, mais moins encombrant.
Depuis la fin du conflit, même aux « heures de pointe », on voyait des enfants jouer à la guerre et mimer le « héros-mort » sur le bitume, sans craindre pour leur vie, tellement le parc des véhicules avait souffert. Les modèles neufs étaient aussi rares que les accidents aux carrefours, et ce malgré la volonté et le désir du roi de recréer une industrie automobile.
Bien que caduc, personne n’avait songé à abroger cette loi que les agents de la circulation appliquaient avec d’autant plus de rigueur que les contrôles en étaient grandement facilités.
« Pour quel motif ? » lui avait demandé l’employée froidement efficace en saisissant un petit imprimé sur lequel étaient schématiquement représentés trois véhicules de face. Rien de plus.
On distinguait dans le premier deux silhouettes stylisées, une seule dans le second et dans le troisième, la même silhouette accompagnée d’une deuxième en pointillé.
« Quel motif ? répéta-t-elle comme si elle était pressée, mariage, naissance, prise de poids excessif ou dédoublement de la personnalité ?
— Euh… ! avait fait Guldur embarrassé, mais sur un ton intelligent, ça se rapprocherait plutôt de… mariage.
— C’est-à-dire ? avait demandé l’employée agacée.
— C’est-à-dire que… avait-il prétendu en rougissant, je suis fiancé !
— QUELLE CATÉGORIE ? s’était énervée l’autre, depuis longtemps insensible aux émotions de ses clients, fiancé par intérêt ou fiancé par amour ? »
Guldur avait pris le temps de la réflexion pour ne pas dire de bêtise.
« Par amour, avait-il murmuré à mi-voix.
— Dans ce cas, je ne peux pas vous accorder le permis deux places, mais uniquement le permis une place et demie. C’est bien suffisant, vous n’en utilisez jamais plus, déclara la fonctionnaire sur un ton revanchard, tout en barrant sèchement les deux premiers pictogrammes de l’imprimé. »
Guldur avait remarqué la façon dédaigneuse dont elle avait dit « vous », « vous les amoureux », comme si elle ne l’avait jamais été ni jamais connu le plaisir de monter dans un véhicule étroit qui vous évite une longue perte de temps en vous plaquant d’office contre le corps de l’autre.
Il se contenta de répondre :
« Mais cela me convient tout à fait.
— Il-est-bien-évident-que-vous-ne-devrez-pas-vous-séparer-de-votre-permis-une-place-car-si-vous-roulez-avec-le-une-place-et-demi-seul-et-sans-pouvoir-justifier-que-vous-allez-chercher-votre-fiancée-ou-que-vous-venez-tout-juste-de-la-déposer-vous-seriez-en-infraction-avec-le-code-de-la-circulation-en-milieu-urbain. »
Elle avait débité son texte de la voix monocorde d’une machine habituée à répéter inlassablement la même chose.
« Je vous rappelle, en outre, que ce même code interdit la conduite aérienne dans les agglomérations et leurs abords », avait-elle précisé, l’air suspicieux, en tendant à Guldur le formulaire en deux exemplaires.
À sa grande surprise, il y apposa une vraie signature ne se contentant pas, comme elle le voyait généralement, d’une croix maladroitement tracée.
« Vous pourrez retirer votre permis, fit-elle sur un ton presque radouci, dès que votre fiancée sera venue signer. »
Guldur la regarda fixement de son regard bicolore, et déclara froidement :
« Merci pour tout. Vous êtes charmante. »
Ceci eut pour effet de déclencher, in extremis, un frémissement musculaire qui éclaira furtivement le visage de la fonctionnaire, un court instant rosé et déridé.
Le prince s’en alla, satisfait, songeant à cette maxime de son maître :
C’est sur les lèvres des grincheux qu’il est bon de faire naître un sourire.
Chapitre VI
Mag était fonctionnaire au service de l’Ennuagement.
Il y tenait depuis peu une place de première importance.
Le service de l’Ennuagement avait été créé quatre siècles auparavant (vers 2550) pour pallier le manque de nuages naturels et l’amincissement alarmant des couches de l’atmosphère qui ne filtraient plus guère les rayons nocifs du soleil.
Les débuts du service de Paris, premier du genre au monde, avaient été laborieux et guignolesques.
Les spécialistes mondiaux de l’époque avaient eu les pires difficultés à mettre au point la technique pour fixer à une altitude convenable, les nuages artificiels qui s’obstinaient à flotter au ras du sol. Ils avaient dû ensuite contrôler leur épaisseur, afin de ne pas plonger le pays dans l’obscurité totale, comme ce fut le cas lors de l’hiver 2574/75 qui débuta par le fait en juillet et se termina en avril suivant.
Enfin, on attendait de ces nuages fabriqués qu’ils jouent leur rôle d’arrosoirs ainsi que les vrais d’autrefois. Tantôt, les pluies qu’ils déversaient étaient trop abondantes et submergeaient tout (inondations de 2576, 2577 et 2578), tantôt, mal équilibrées chimiquement et thermiquement lors de leur élaboration, elles détruisaient ce qu’elles auraient dû rafraîchir (catastrophe de 2576 et de l’été 2582 qui resta de sinistre mémoire à la suite d’un orage torrentiel de pluies bouillantes au-dessus des plages surchargées de vacanciers !).
Mag était intarissable sur ces pionniers qui avaient laissé dans l’opinion publique l’image de savants pataugeant dans leurs calculs, dépassés par la complexité effroyable du problème, ne pouvant que procéder par essais et erreurs. Erreurs qui soulevaient des vagues d’indignation et d’impitoyables campagnes de presse, au cours desquelles on les gratifiait de tous les noms que la décence et la censure autorisaient.
Il ne manquait cependant jamais de rappeler que ses lointains prédécesseurs avaient eu à juguler, en un temps record, avec le peu de connaissances sur la question et les faibles moyens à leur disposition en ces années tragiques, la plus sérieuse et la plus redoutable catastrophe écologique que le globe ait jamais connue !
Mag portait souvent au-dessus de sa tête, le petit nuage synthétique qui le suivait dans tous ses déplacements.
C’était le symbole du service et l’honneur de ses deux ou trois Hauts Responsables que tout le monde respectait.
Et Mag, plus que tout autre, car il était sans doute le plus habile, capable de vous générer un nuage gorgé d’eau au-dessus d’une piscine privée ou de déclencher une chute de neige sur une rue en pente pour le simple plaisir des gamins du quartier.
Il existait ainsi huit services de l’Ennuagement de par le monde.
Un accord international, signé en 2691, les ayant reconnus d’utilité mondiale, avait réparti leur gestion entre tous les États et déclaré les bâtiments Propriété de l’Humanité, neutre et inviolable.
Ces accords furent d’ailleurs universellement piétinés pendant les Guerres, de nombreux belligérants ayant osé prendre le risque de s’attaquer à ces centres, pourtant vitaux pour l’humanité tout entière. Leur contrôle constituant un tel atout stratégique, ils furent la cible de toutes les convoitises. Fort heureusement, le risque pour l’assaillant inconscient était énorme : soit de souffrir lui-même des conséquences de leur destruction, soit de voir se dresser contre lui des ennemis d’hier réunis dans une coalition aussi globale que contre nature.
Ce qui fut le cas à maintes reprises.
Du coup, certains services sortirent presque indemnes des Guerres.
Ils furent les seuls !
Les toutes premières négociations, dès la mise en place, ici ou là, d’autorités aptes à négocier, assurèrent leur bon fonctionnement malgré la nouvelle répartition des états, la disparition de nombre d’entre eux et l’émergence d’une constellation d’entités autonomes.
Le teint pâle, les traits fins, presque féminins, les lèvres étroites et à peine rosées, posées au-dessus d’un menton discrètement effilé, Mag était un garçon imprévisible.
Parfois mû par une douceur et une gentillesse que n’égalait que la tristesse qu’on lisait souvent dans ses yeux sombres.
Parfois habité d’une hyperactivité et d’une fureur de fauve blessé.
Il faut préciser que sa naissance n’était pas passée inaperçue et que ce genre d’entrée dans le monde vous poursuit jusqu’à la sortie.
Avant même de savoir ce que souffrir veut dire, il avait été l’objet de sarcasmes et de méchantes plaisanteries qui allaient, pour la vie, marquer au fer rouge, son âme sensible d’orphelin.
Mag était l’enfant d’un malheur.
Un seul, mais un grand !
Il était né par hasard.
Dans les années d’après-guerres, un savant biologiste à la mode, dont le nom va vous dire quelque chose : Marcel Buff (mais si… ! Les « WC-Professeur-Buff » de Beau) défrayait la chronique par ses travaux sur le spermatozoïde de synthèse.





























