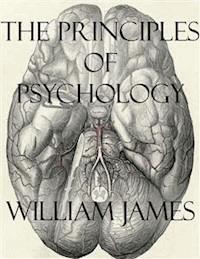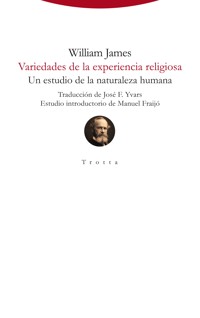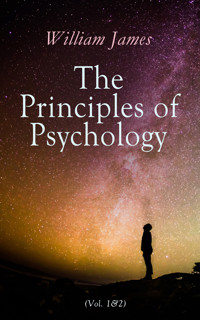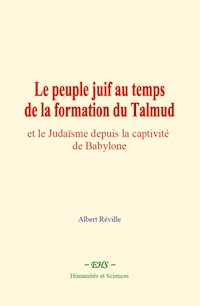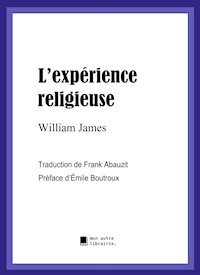
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Suite de conférences données à Édimbourg en 1901 et 1902, entièrement remaniée par le traducteur, en accord avec l'auteur, pour en faire un ouvrage suivi. Sur la base d'une étude psychologique empirique du fait religieux, l'auteur réussit à fonder rationnellement - et paradoxalement - le surnaturalisme. Une démonstration brillante, et qui a fait date.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 904
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’expérience religieuse
Essai de psychologie descriptive
William James
Traduction de Frank Abauzit
Préface d’Émile Boutroux
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Alcan, Paris, 1906.
Les notes entre crochets sont du traducteur.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2022, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-041-7
Table des matières
Préface
Avant-propos du traducteur
Introduction : Délimitation du sujet
Chapitre I – Névrose et religion
Chapitre II – La religion comme fait
psychologique
Première partie : Les faits
Chapitre III – La réalité de l’invisible
Chapitre IV – L’optimisme religieux
Chapitre V – Les âmes douloureuses
Chapitre VI – La volonté partagée et son retour à l’unité
Chapitre VII – La conversion
Seconde partie : Les fruits
Chapitre VIII – La sainteté
Chapitre IX – Critique de la sainteté
Chapitre X – Mysticisme
Chapitre XI – Spéculation
Chapitre XII – Religion pratique
Conclusion
Valeur de la Vie Religieuse
Préface
C’est en juin 1902 que parut pour la première fois, à New-York, l’ouvrage de l’illustre professeur de l’Université Harvard, intitulé The varieties of religiousexperience ; et aujourd’hui il en est peu qui soient plus répandus et lus plus avidement dans le monde entier. Tandis que les savants y goûtent une érudition étendue et sagace mise au service d’une philosophie vigoureuse et originale, les gens du monde, les consciences passionnées de vie intérieure, les femmes, y cherchent des lumières et des forces pour réaliser, en accord avec les idées modernes, l’idéal religieux. Il était à souhaiter qu’un ouvrage aussi universellement apprécié fût mis, chez nous-mêmes, à la portée de tous ; et c’est ce qui a lieu aujourd’hui grâce à la traduction très pénétrante, très vivante, ingénieusement exacte dans sa libre allure, qu’en donne M. Frank Abauzit.
Le point de vue où se place M. James marque dès l’abord la nouveauté et l’opportunité de son ouvrage. Les religions ont été largement étudiées aux points de vue théologique, philosophique, historique. Il n’a pas manqué de savants qui les ont envisagées en physiologistes et en médecins, et qui en ont fait ressortir l’élément névropathique ou hystérique. De nos jours, la sociologie a revendiqué les religions comme lui appartenant en propre, et les a traitées comme des phénomènes essentiellement sociaux. Diverses faces de la réalité donnée ont été, de la sorte, tour à tour vivement éclairées, et une connaissance de plus en plus complète a été obtenue. Mais outre les aspects que nous venons d’indiquer, la religion en présente certainement un autre, qu’il est impossible de laisser de côté. Traditions sociales ou manifestations pathologiques, les religions sont, tout d’abord, des états de conscience, des formes de la vie intérieure, qui concernent spécialement le psychologue. Les documents relatifs à la religion abondent en descriptions minutieuses de ces phénomènes ; mais ces descriptions sont l’œuvre du sujet lui-même, présentant les choses telles qu’elles lui apparaissent : il reste à classer, analyser et interpréter ces données au point de vue de la science, c’est-à-dire avec une précision, une objectivité, une préoccupation des rapports de connexion causale, analogues à celles qui caractérisent les sciences physiques.
C’est à cette tâche, encore peu abordée, que s’est consacré le professeur James. Sa maîtrise en psychologie le désignait pour un tel travail. Il a, de plus, un esprit singulièrement ouvert et exempt de préjugés. Il entre avec autant de pénétration que de sympathie dans les pensées et les sentiments les plus divers. Élevé dans le protestantisme, il comprend en perfection les mobiles et le sens intime des pratiques du catholicisme. Il étudie, par exemple, l’ascétisme avec une liberté de jugement peu commune, démêlant en lui une expression du spiritualisme, une forme de la lutte et de l’héroïsme qui, aujourd’hui encore, a sa place et son rôle dans la vie de l’humanité. C’est d’ailleurs sur le terrain le plus propice que s’exercent ces remarquables facultés de psychologue et de moraliste. La vie religieuse se manifeste en Amérique avec une intensité particulière. Plus qu’une doctrine, une tradition, ou une institution, la religion est, pour l’Américain du Nord, un élément de sa vie, une réalité concrète, où il puise la santé, la force et la joie. La seule contribution vraiment originale du peuple américain à la philosophie systématique de la vie, dit M. James, est le mouvement auquel se rattache ce qu’on appelle la Mind-cure, à savoir une philosophie religieuse.
Tant de conditions réunies donnent à l’œuvre de notre auteur une très haute portée, encore accrue, s’il est possible, par la forme si souple, si vivante, si délicate, ingénieuse et captivante, dont ses idées sont revêtues. Rien de scolastique, rien de convenu. C’est ici vraiment un homme et non un auteur. Tout part directement de l’âme qui sent, et de l’intelligence qui voit. Il semble que cet écrivain ait fait lui-même, pour s’y exprimer en toute liberté et sincérité, la langue dont il se sert. Aussi ne lit-on pas cet ouvrage comme on s’applique sur un traité de philosophie. On est intéressé, touché, remué, pressé de rentrer en soi-même et de s’interroger pour son propre compte, charmé aussi et parfois amusé par la fantaisie aimable du conférencier, lequel vraiment parle et s’épanche dans ces pages, comme il parlait à Édimbourg, devant son auditoire transporté.
Il est impossible de donner, par un résumé, une idée de l’intérêt que présente cet ouvrage, où les détails, tous puisés directement dans la perception des réalités, sont aussi importants que l’ensemble. Peut-être les quelques traits que je vais marquer suffiront-ils à montrer combien il répond à nos préoccupations actuelles.
M. James place le fait religieux proprement dit dans l’expérience individuelle. Ce n’est pas là, chez lui, un artifice de méthode, propre à faire rentrer les choses de la religion dans le domaine de la psychologie expérimentale. Il est certain que, dans la vie de St-Paul, St-Augustin, Luther, l’expérimentation intérieure a joué un rôle considérable. On sait que, pour Pascal, physicien et mystique, c’est une expérience, disposée comme celle du Puy-de-Dôme, qui doit convaincre les incrédules. « J’aurais bientôt quitté les plaisirs, disent-ils, si j’avais la foi. Et moi je vous dis : vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté les plaisirs. Or c’est à vous à commencer. Si je pouvais, je vous donnerais la foi. Je ne puis le faire, ni, partant, éprouver la vérité de ce que vous dites. Mais vous pouvez bien quitter les plaisirs, et éprouver si ce que je vous dis est vrai. » Chez les mystiques en particulier, la vie religieuse est une continuelle expérimentation. Eux-mêmes décrivent ce travail intérieur avec une finesse, une subtilité, une pénétration extraordinaires. Quelle tâche plus digne d’un psychologue que de se pencher avec amour, non plus sur des doctrines et des formules, résidus figés de la pensée et de l’action, mais sur la vie elle-même, prise dans sa source pure et jaillissante !
M. James ne se borne pas à analyser, en les classant à part, les manifestations religieuses proprement dites. Il éclaire cet ordre de phénomènes en le considérant, autant qu’il est possible, non séparément, mais dans l’ensemble concret dont il fait partie. C’est, en effet, l’idée maîtresse de W. James, que nos conceptions approchent d’autant plus de la réalité qu’elles représentent davantage, non les prétendus éléments simples des choses, fictions de notre entendement débile, mais les touts riches et féconds donnés immédiatement dans la conscience. Fidèle à cette pensée, W. James supprime les barrières que notre langage et nos habitudes d’esprit élèvent entre les phénomènes religieux et tels phénomènes, autrement dénommés, mais en réalité connexes. Dans ses manifestations les plus matérielles et extérieures le phénomène religieux se distingue mal de certains phénomènes peut-être purement physiologiques et pathologiques. L’extase de Ste-Thérèse rappelle des états de conscience qui se produisent chez les hystériques. W. James rattachera donc les phénomènes religieux à ces manifestations inférieures, comme à leurs premiers rudiments, ou plutôt comme à la matière dans laquelle ils germent. L’unique nouveauté, dit-il, à laquelle puissent prétendre ces conférences, c’est la largeur du champ embrassé. Les expériences religieuses y sont présentées avec leur contexte.
Quoi qu’en dise l’auteur, cette nouveauté est loin d’être la seule. Une autre, non moins considérable, c’est l’élargissement du sujet conscient du côté interne, par le lien que James établit entre les phénomènes religieux et les phénomènes subconscients. Je ne puis, dit-il, m’empêcher de croire que le progrès le plus important qu’ait réalisé la psychologie depuis le temps où j’étais étudiant, est la découverte, faite en 1886, que, chez certains sujets à tout le moins, la conscience ordinaire n’est pas toute la conscience, mais qu’en dehors de cette conscience première il existe des sentiments et des idées qui doivent être tenus pour des faits conscients en quelque manière, capables de révéler leur présence par des signes irrécusables. Or, cette idée d’une conscience subliminale, comme l’appelle Myers, jette une lumière inattendue sur maints phénomènes d’expérience religieuse. Les conversions, par exemple, deviennent l’explosion, dans la conscience ordinaire, d’impressions subconscientes, qui ont acquis par incubation ou qui possédaient d’emblée un degré de tension considérable. Quelle est l’origine de ces impressions ? Pour la conscience religieuse, elles viennent de la divinité elle-même. Pour le psychologue, leur propagation à travers la sphère de la subconscience, considérée comme seule directement ouverte à l’action des esprits, explique très bien, et l’apparence de transcendance que revêt pour la conscience ordinaire la grâce divine, et la persistance des mystiques à affirmer qu’ils se sentent véritablement en communion avec la divinité.
L’expérience religieuse, telle que l’entend W. James, comprend ainsi, outre les faits religieux clairement caractérisés, les manifestations physiologiques ou pathologiques qui s’en rapprochent, et les faits subconscients qui les prolongent. Elle va du dehors au dedans sans connaître de limite précise ni d’un côté ni de l’autre, imitant en cela la réalité, qui procède par changements insensibles. Rien de plus riche, de plus instructif, de plus attachant, que les analyses faites par l’auteur dans ce champ d’études. Mais l’intérêt même qu’excitent ces descriptions rend d’autant plus pressante une question qui s’impose à quiconque prend au sérieux et la science et la vie. Quelle est la valeur de ces phénomènes, si curieux, si intenses, si difficiles à définir ? Leur analogie avec certains phénomènes pathologiques, leur parenté avec le mystérieux inconscient ne tendent-elles pas à les rendre particulièrement suspects ? Ne seraient-ce pas de simples états de conscience subjectifs, nés de certaines conditions physiologiques ou sociales, et teints d’une couleur particulière par des superstitions traditionnelles ? Après comme avant les savantes descriptions de James, ne peut-on pas tenir les religions pour de simples survivances du passé, résultat de la lenteur avec laquelle l’imagination suit d’ordinaire les progrès de la raison ? « The imagination lags behind the reason » : Telle est pour Leslie Stephen l’explication du semblant de vie que possèdent encore les religions.
Cette question de la valeur, W. James n’a garde de l’écarter : il expose, à ce sujet même, des vues d’une grande importance. Dans les écoles tant empiristes que rationalistes on a coutume de juger de la valeur des idées d’après leur origine. Telles idées sont vraies et stables, disent les uns, parce qu’elles procèdent de la nature, ou de la raison, ou de Dieu. Elles sont contingentes et caduques, disent les autres, parce qu’elles s’expliquent entièrement par l’expérience. Des deux côtés on cherche une autorité pour garantir la valeur des croyances. Cette autorité, les uns croient la découvrir, les autres déclarent qu’elle n’existe pas. Mais nulle autorité, fût-ce celle de Dieu, ne peut rendre une croyance valable et nous fournir une raison de la maintenir. Que le mal vienne de Dieu, ou de l’homme, ou des choses : il n’en est pas moins le mal, et nous faisons sagement de le combattre. Si tel commandement est censé nous venir de Dieu, son existence est expliquée par là ; mais nous ne savons si ce commandement est l’acte d’une volonté arbitraire ou d’une raison sage et bonne qu’après l’avoir confronté avec nos conditions d’existence. La considération de l’origine donne lieu à des jugements existentiels, c’est-à-dire expliquant l’apparition des phénomènes, mais non à des jugements spirituels, appréciant la valeur. Que signifient, dès lors, les griefs contre le génie, contre la sainteté, contre l’enthousiasme religieux, tirés de la condition plus ou moins pathologique des sujets où ces phénomènes se produisent ? Les grands initiateurs, certes, ont été, en général, des névropathes. Sans doute la puissance de leur pensée et de leur volonté dépassait-elle les forces normales de l’homme. D’ailleurs, certains états pathologiques apparaissent comme favorables au développement de cette vie subconsciente, de laquelle émergent les hautes inspirations. L’alcool n’a-t-il pas, plus d’une fois, favorisé l’originalité et la profondeur de la conception ? Je ne sais si j’entrerais dans la pensée de W. James en signalant, à ce sujet, le contre-sens que nous faisons d’ordinaire sur l’adage : mens sana in corpore sano. Juvénal ne prétend pas, comme on aime à le lui faire dire, qu’un corps sain entraîne avec lui un esprit sain, mais simplement que, si nous tenons absolument à adresser des prières aux dieux, le mieux est de leur demander un esprit sain dans un corps sain, comme deux choses compatibles, sans doute, mais distinctes. Que s’il s’agit d’un esprit, non seulement sain, mais supérieur, rarement le corps qui doit subvenir à ses exigences conservera assez de forces pour s’épanouir dans une pleine santé.
S’il est impossible de juger de la valeur des phénomènes religieux par leur origine et leurs conditions d’existence, n’est-il pas juste, du moins, de les apprécier d’après la légitimité ou la fausseté des croyances qui s’y manifestent ? Dans tout sentiment ou acte religieux est engagée une métaphysique où sont posés comme existants des objets surnaturels : Dieu, la Providence, l’Immortalité, sans parler des mille déterminations de ces objets qui se rencontrent dans les dogmes des religions positives. Si la réalité de ces essences surnaturelles est indémontrable, que valent les sentiments et les pratiques dont la fin est de nous mettre en rapport avec elles, de nous approprier leur puissance ? La mort des dogmes est la mort des religions : ce qui en survit ne peut être que vaine routine et tremblante agonie.
Ainsi juge-t-on parfois, parce que l’on suppose que, dans une religion, la partie affective et active résulte, comme du principe l’application, de la partie intellectuelle. Mais il suit précisément de la doctrine psychologique de W. James que les sentiments et l’action, au contraire, sont, dans les religions, l’élément primordial ; et que les théories et les dogmes ne sont imaginés qu’après coup, pour satisfaire tant bien que mal à la question : pourquoi ? que notre intelligence pose à propos de toutes choses. La ruine des dogmes, si elle était consommée, n’entraînerait pas plus la disparition des phénomènes religieux que la destruction de la théorie aristotélicienne de la gravité n’a empêché les corps de tomber.
Où se trouve donc le critérium de la valeur des états religieux ? Ce serait déroger à la méthode empirique, la seule valable selon notre auteur, que de chercher ce critérium ailleurs que dans les conséquences positives des phénomènes en question. « Vous jugerez l’arbre à ses fruits », dit l’Évangile. Ce principe, en religion, est fondamental. Il s’agit ici de vie, de joie, de paix intérieure, de puissance. La seule question est de savoir si les états dont il s’agit produisent la vie, la puissance et la joie. On peut, dit W. James, ramener à trois principaux les caractères nécessaires et suffisants pour qu’un phénomène religieux soit reconnu comme légitime. Ces caractères sont : une illumination immédiate, la conformité à la raison, et la capacité de conférer la force morale. Nul doute que ces caractères ne se trouvent parfois réalisés. Là où ils existent, on arguerait en vain de l’état nerveux de l’individu ou de la fragilité de ses concepts métaphysiques. On est en présence d’une chose qui vit, et dont la force de résistance est apte à surmonter les plus rudes assauts. C’est assez pour que tombent impuissantes nos objections abstraites de dialecticiens.
La constatation de la force et de la persévérance dans l’être, toutefois, peut-elle suffire à un homme qui pense ? N’arrive-t-il pas que nous nous inclinions devant ce qui n’est pas mais mériterait d’être, de préférence à ce qui est, mais nous semble indigne de l’existence ? Et une conception, si utile et salutaire qu’on la suppose, a-t-elle définitivement conquis ses titres aux yeux de l’esprit humain, tant qu’elle n’a pas été confrontée avec la vérité, au sens intellectuel du mot ? La valeur pratique, en un mot, peut-elle dispenser de la valeur théorique ?
Le professeur James se propose de traiter pour elle-même cette question suprême dans un second ouvrage ; mais dans celui-ci même il s’en montre grandement préoccupé, et y touche en plus d’un endroit.
Il serait insuffisant, pour apprécier la valeur théorique des conceptions religieuses, de les considérer en elles-mêmes, ou de les comparer à je ne sais quel type abstrait de la valeur objective. La manière pratique et actuelle de traiter cette question est d’envisager la religion dans ses rapports avec la science. Étant donné l’état d’esprit des générations contemporaines, le jugement qu’elles porteront sur les religions dépendra nécessairement de l’accord ou du désaccord que celles-ci feront paraître avec ce qui, pour nous, renferme la somme des vérités réellement acquises, à savoir la science proprement dite, ou connaissance objective et expérimentale des phénomènes. Aussi W. James indique-t-il à plusieurs reprises l’idée qu’il se fait des rapports de la religion et de la science.
Il importe de remarquer que, pour un empiriste pragmatique tel que notre auteur, la science ne saurait être la représentation immédiate et adéquate de la réalité dans l’intelligence humaine. L’action que nous accomplissons est la seule réalité que nous saisissions immédiatement. La pensée n’est qu’une méthode tendant à la production d’habitudes actives. La science est la coordination des moyens dont nous disposons pour agir sur les phénomènes, grâce aux rapports de connexion qui les relient entre eux. De ce que nous possédons cette méthode de communiquer avec la réalité, comment s’ensuivrait-il que nous n’en possédions point d’autre ? Ce que montre l’expérience, c’est que le monde où nous vivons peut être traité suivant différents systèmes d’idées, dont chacun apporte avec lui tel avantage en laissant échapper tel autre. La science nous donne la télégraphie, la lumière électrique, la médecine. La religion, sous telle de ses formes, nous donne la sérénité, l’équilibre moral, le bonheur ; même elle guérit certaines maladies aussi bien ou mieux que la science, chez une certaine classe d’individus. Religion et science sont deux clefs dont nous disposons pour ouvrir les trésors de l’univers. Et pourquoi le monde ne se composerait-il pas de sphères de réalités distinctes mais interférentes, si bien que nous ne pourrions, nous, l’appréhender qu’en usant alternativement de différents symboles et en prenant des attitudes diverses ? À ce compte, religion et science, vérifiées, chacune à sa manière, d’heure en heure, d’individu en individu, seraient coéternelles.
Pouvons-nous, toutefois, nous en tenir à cette conception, surtout négative, du rapport de la religion et de la science ? Le surnaturalisme dualiste est certes très commode dans les joutes scolastiques ; mais est-il propre à satisfaire une conscience avide d’intelligence et d’unité ?
Le pivot de la vie religieuse est l’intérêt que prend l’individu à sa destinée personnelle. Les dieux sont des esprits avec lesquels communique la personne humaine. Personnalité, telle est la forme de l’être dans le monde de la conscience. Or la science consiste précisément à dépersonnaliser les êtres de la nature. Elle dissout tout ce qui est unité complexe et vivante, pour tendre à n’admettre comme réels que des éléments simples et des rapports. Il semble donc qu’il y ait entre la science et la religion, non seulement différence, mais incompatibilité, et qu’une pensée soucieuse de cohérence soit obligée d’opter entre elles.
Mais selon W. James, il est impossible que cette option tourne contre la religion. Entre celle-ci et la science la vraie différence est du concret à l’abstrait. La religion concerne la vie même de l’âme, telle qu’elle est donnée immédiatement à la conscience : la science se rapporte à l’objet de notre conscience, isolé artificiellement du support subjectif sans lequel il n’existerait pas. La science n’a donc pas pour matière des faits complets et réels, mais des extraits, des symboles de faits, qui perdent en réalité, en vérité, ce qu’ils gagnent en simplicité et en clarté. Or la partie ne peut impliquer la négation du tout, le conditionné ne peut supprimer la condition. Il y aurait sans doute contradiction entre la science et la religion si elles avaient le même objet, car un même être envisagé au même point de vue ne peut être à la fois personnel et impersonnel. Mais le fait que la science conçoit comme impersonnels les éléments qu’elle imagine ne peut s’opposer à ce que l’être réel, qui crée, et la science, et la religion, et la morale, et l’art, soit lui-même un individu, et ne se puisse concevoir que comme individu.
La religion comporte donc une vérité, qui, sans doute, est d’un autre ordre que la vérité scientifique, mais qui ne s’impose pas moins fortement à notre adhésion.
Il y a plus. On ne peut, certes, rigoureusement démontrer, mais il est très raisonnable de croire que, plus ou moins directement, et, en particulier par l’intermédiaire de notre moi subconscient, le divin agit sur le détail même des phénomènes de ce monde, et qu’il y a ainsi quelque chose de fondé dans la croyance du vulgaire à la possibilité du miracle. Entre le surnaturalisme dualiste et universaliste des savants et le surnaturalisme soi-disant grossier qui admet la Providence spéciale, W. James ne craint pas de se prononcer pour le second. Son empirisme pragmatique lui interdit d’étendre à la réalité même le déterminisme mécanique que la science impose aux relations de ses éléments ; et la valeur que prend à ses yeux l’élément subjectif de la conscience lui permet de considérer comme fondée la conviction naturelle où nous sommes que nos idées, nos inspirations, les secours que nous puisons à des sources supérieures, influent sur le cours des phénomènes, et réalisent des formes d’existence que les seules lois de la nature physique n’auraient pu produire.
On voit assez, d’après ces très sèches indications, quel intérêt présente l’ouvrage de W. James. Avant tout, c’est une description très pénétrante, sympathique et scientifique des phénomènes religieux individuels les plus caractéristiques. L’ouvrage, d’après son titre, ne prétend pas à être autre chose. Mais en réalité, il soulève et aborde de façon profonde et originale plusieurs des grandes questions de la philosophie religieuse.
À cet égard, l’apparition du livre et son très grand succès sont des évènements qui font honneur à notre époque. Il est nécessaire de traiter avec respect, avec piété les croyances dont ont vécu les meilleurs d’entre les hommes, qui ont présidé aux grandes créations morales des sociétés, et qui, aujourd’hui encore vraisemblablement, projettent devant nos yeux les fins idéales vers lesquelles nous nous glorifions de marcher. En lisant W. James, nous entrons de nous-mêmes dans ces dispositions sérieuses, et nous réprimons le sourire que pourrait inspirer à notre légèreté la ressemblance de certains états mystiques avec des états classés par la pathologie.
La position prise par le philosophe américain semble d’ailleurs singulièrement forte. S’il est illégitime de juger de la valeur des choses par leur origine, que deviennent les critiques ordinaires, fondées sur l’incertitude des sources, sur le rôle que l’ignorance, l’imagination, l’intérêt, l’exaltation, la folie, en même temps que l’autorité et la force, ont joué dans la formation, dans l’expansion et dans le maintien des croyances et des institutions religieuses ? En réduisant délibérément la question de valeur à la question d’utilité, et en plaçant cette utilité elle-même dans ce qui donne à l’homme la force morale et la joie, W. James rend la valeur de la religion sensible et comme tangible à chacun de nous. Cette valeur même devient affaire d’expérience. Quant aux objections que l’on tirerait de la caducité des dogmes ou de l’antagonisme de la science, elles s’évanouissent devant une psychologie qui ne voit dans les dogmes qu’un épiphénomène et non l’essence de la religion, devant une philosophie de la science qui fait de celle-ci une simple organisation de nos représentations, tendant, comme la religion elle-même, à la réalisation de nos fins personnelles et pratiques.
Et l’avenir de la religion n’est-il pas indéfiniment garanti par cette doctrine originale, qui fait jaillir du subconscient l’inspiration, la foi et l’ardeur religieuse ? Nous constatons, objectons-nous, au sein de nos sociétés, l’affaiblissement de la foi et la décadence des institutions religieuses ; et, nous abandonnant à une induction naïve, nous prédisons la disparition plus ou moins prochaine des religions. Prédiction vaine, répondra un disciple de W. James. Il est dans l’ordre que les produits de la vie, s’ils s’isolent de la vie elle-même, se figent, se désagrègent et tombent en poussière. Mais la vie ne s’éteint pas du même coup. Elle demeure, infinie et toujours prête à faire explosion, dans les profondeurs de l’inconscient et du divin qui le pénètre. Et toujours reste possible ce rajeunissement de la foi et de l’amour, cette résurrection triomphante, cette renaissance incessante, qui, en ce monde, dont la pente naturelle est la dissolution, la routine et la mort, constitue, pour un esprit, la condition de la force, de la santé et de l’existence même.
Remarquerons-nous, après cela, que le livre de M. James, s’il contente sur beaucoup de points notre désir de savoir et de comprendre, le tient plutôt, sur d’autres, dans un état d’éveil et d’attente ? Nous savons que ce volume n’a d’autre objet propre que la description psychologique des phénomènes, et qu’à un livre futur est réservée la partie plus spécialement philosophique et explicative. Mais dès maintenant l’œuvre de W. James nous invite à réfléchir sur plusieurs questions de cet ordre, qu’elle soulève.
Qu’est-ce, au fond, par exemple, que cette expérience spéciale, dénommée expérience religieuse ? N’est-ce qu’un état purement subjectif, ou est-ce une communication effective avec quelque être différent ou distinct du sujet conscient proprement dit ? Ne semble-t-il pas que, de même que Locke et Kant ont institué la critique de l’expérience sensible, il soit légitime et nécessaire, pour un philosophe, de procéder à la critique de l’expérience religieuse ?
D’ailleurs, en quel sens convient-il de voir, dans l’expérience religieuse individuelle, le point de départ et le fond des religions ? Il faut avouer que toutes ces âmes qui s’analysent si subtilement et obstinément elles-mêmes nous paraissent bien attachées à leur moi, bien absorbées dans la conscience de leur infinie valeur. N’y a-t-il pas au moins autant de religion chez celles qui se replient moins sur elles-mêmes, et sont plus occupées de vivre dans les autres ? Le premier mot de la prière que Jésus enseigne à ses disciples n’est-il pas : Père ! Que ton règne descende du ciel sur notre terre ! C’est-à-dire : puissent les hommes, en toi, s’aimer et être heureux ! La religion est-elle, par-dessus tout, un phénomène individuel, ou est-elle le retentissement, dans l’âme individuelle, d’une vie interne commune, d’une certaine nature, qui s’établit dans une société d’hommes ? Ne serait-ce pas cette participation même à une existence plus haute et plus large qui transforme l’individu, et y produit cette orientation comme surnaturelle, ou cette seconde naissance, qui offre à la réflexion une si riche et sublime matière ?
À ces questions bientôt en succèdent d’autres : Qu’est-ce précisément, nous demandons-nous, que la vérité en matière religieuse ? Si la religion a sa base dans le sentiment tout nu, comporte-t-elle, à un degré quelconque, vérité ou erreur ? Le sentiment est-il capable de ces prédicats ? Mais est-ce bien un pur sentiment qui est au fond de la religion, et ne serait-ce pas plutôt un sentiment déjà mélangé d’idée et de représentation, donc ayant affaire à la vérité au sens intellectuel du mot ?
Et encore, si la vérité religieuse, par la place prépondérante qu’y tiennent la vie et l’utilité, a, malgré tout, ses caractères propres, quel est au juste le rapport de cette vérité à la vérité scientifique ? Il n’est pas aisé de faire admettre au savant, possesseur d’un type de vérité éprouvé et universellement reconnu, l’existence de types très différents, qui peut-être lui apparaissent comme vagues et contradictoires. Quant à isoler complètement la religion de la science, selon les principes d’un dualisme radical, c’est un parti qui paraît plus commode que satisfaisant, parce qu’à ce compte la religion ne peut plus être distinguée des états purement subjectifs du moi individuel. Si la religion doit avoir une valeur universelle, il faut que la vérité en soit liée, de quelque manière intelligible, à celle de la science. Que s’il est désormais démontré que la certitude religieuse, essentiellement pratique, ne peut rentrer dans la certitude scientifique, il convient alors de se demander si la certitude scientifique ne serait pas elle-même un cas et une dérivation de la certitude pratique. Quand on cherche une certitude fondamentale, est-ce dans la connaissance théorique qu’on la trouve, ainsi que l’ont cru les philosophes dits dogmatistes ; ou est-ce dans les conditions de l’action proprement dite, dans le possible et l’idéal ?
L’idéal comme puissance, comme force, comme facteur de notre vie subconsciente et consciente, comme providence intervenant dans le détail même des évènements de ce monde, c’est le dernier mot du livre de W. James : c’est aussi l’enseignement le plus précieux qu’on puisse offrir aux hommes. En attendant que la science physique ait ramené à des éléments purement mécaniques, et entièrement dissous, en tant que force efficace, tout ce qui est individualité, vie, fin, action, idée, amour et dévouement, il importe que les hommes continuent de croire à leur existence d’hommes, afin de conserver l’élan, les forces et la joie que donnent seuls la foi, la jeunesse, l’enthousiasme, l’héroïsme et l’abnégation, liés à la conscience de cette dignité même. Nulle part cette cause, qui est celle de l’humanité, n’aura été plaidée avec plus de science, de liberté d’esprit et de vigueur que dans le présent ouvrage du professeur James.
Émile Boutroux
Paris, 18 Octobre 1905.
Avant-propos du traducteur
Ce livre est la traduction légèrement abrégée des Varieties of Religions Expérience de William James. Il a reproduit dans cet ouvrage deux séries de conférences données en 1901 et 1902 à Édimbourg.
J’ai tâché de faire passer en français tout l’esprit et même toute la saveur du texte original. Sur l’invitation expresse de M. James, j’ai usé de quelque liberté en ce qui concerne les mots, les métaphores et la disposition des phrases. En me donnant gracieusement l’autorisation de le traduire, il m’exprima sa vive répugnance à voir transcrire mot à mot et calquer servilement sa libre prose. À plusieurs reprises, lorsque je lui communiquai des fragments de ma traduction, il me pressa d’être plus hardi, m’assurant qu’il se fiait à moi sans réserve pour les modifications qui me paraîtraient opportunes. J’usai discrètement de ce droit redoutable. Je crus, néanmoins, en ce qui concerne certains détails de style et de composition, qu’il convenait de suivre les habitudes françaises, plus méthodiques, plus scrupuleuses et pour ainsi dire plus classiques, afin de donner à ce livre si captivant un tour qui ne sentît pas trop la traduction.
Qu’on se rassure d’ailleurs : les changements les plus notables ont été ou bien proposés ou bien acceptés par l’auteur. C’est d’un commun accord que nous avons choisi le titre français du livre, et c’est lui-même qui a eu l’idée du sous-titre. Le Sommaire du début a été rédigé par moi ; il diffère un peu de l’ordonnance du volume anglais ; j’ai voulu rendre plus apparent le plan de l’ouvrage. M. William James m’a dit qu’il approuvait pleinement cette distribution nouvelle et les titres de mes chapitres.1 Enfin, malgré ses travaux et ses fatigues, il a consenti à lire en épreuves les 144 premières pages de ma traduction, en la comparant à son texte, et m’a exprimé son sentiment dans une lettre qu’il m’autorise à publier :
Cambridge (Massachusetts), 10 juillet 1905.
Mon cher Abauzit,
Vous avez exaucé ma prière de ne pas me défigurer auprès du public français par une de ces traductions mot-à-mot dont j’ai déjà été plus ou moins la victime. Jamais traduction ne m’avait autant satisfait. Vous avez par endroits donné un peu plus de concision à mon style, et par là, vous l’avez amélioré. Vous avez opéré quelques transpositions que je trouve heureuses. Somme toute j’estime, d’après les 144 pages que je viens de lire, que votre travail est, en son genre, un chef-d’œuvre.
Toujours à vous,
William James.
Pour les nombreuses citations, si bien choisies et si bien traduites par M. James, qui font de son livre comme une anthologie d’expériences religieuses, je ne pouvais user de la même liberté. J’ai cru devoir les traduire aussi littéralement que possible, avec le scrupule qu’on apporte à la transcription d’un texte classique ou d’un document psychologique. Je me suis même imposé larègle de remonter aux sources, partout où je le pouvais. Cela m’a procuré le plaisir de traduire sur le grec quelques vers d’Homère, de Sophocle et de Palladas, des bribes de Platon et d’Aristote, des maximes de Jésus et de Saint Paul, d’Épictète et de Marc-Aurèle, des fragments de Philon, de Plotin, du pseudonyme Denys l’Aréopagite ; sur le latin des pages de Saint Augustin, de l’Imitation, de Luther, de Van Helmont, une anecdote du Speculum Perfectionis ; sur l’allemand des récits ou des élévations de mystiques (Suso, Deutsche Theologia, Hilty), des propos de Luther, de Wolff, de Gœthe, de Malwida von Meysenbug, de Nietzsche, de Harnack ; sur le hollandais un paragraphe de Spinoza. Pour l’hébreu (Job, l’Ecclésiaste, les Prophètes), pour l’espagnol (Sainte Thérèse), pour le russe (Tolstoï), je me suis fait aider par des amis compétents.2 De toutes les citations françaises j’ai pu retrouver et j’ai scrupuleusement reproduit le texte original. Même pour les citations anglaises, qui sont fort nombreuses, je n’ai jamais eu recours aux traductions déjà existantes.
Suivant un désir de M. James, j’ai ajouté au bas des pages quelques extraits et quelques indications propres à intéresser le lecteur français. J’ai mis ces notes entre crochets pour les distinguer de celles de l’auteur.
Il me serait doux de nommer ici tous ceux qui m’ont aidé, qui m’ont procuré ou copié des textes, qui m’ont encouragé de biendes manières dans le cours de mon travail. Mais ils sont trop nombreux et j’aurais trop à dire. Je veux pourtant exprimer à M. Théodore Flournoy, de Genève, mon affectueuse et profonde reconnaissance. Sans lui, je n’aurais jamais entrepris cette œuvre de longue haleine. Il m’a durant ces trois années soutenu de ses conseils et de son amitié. Je veux aussi remercier mon ancien élève M. Raymond Chalmel ; il m’a prêté le secours d’un jugement très sûr et d’une inlassable patience pour revoir et pour achever avec moi cette traduction. Sans lui, je n’aurais jamais pu la mener à bien.
F. A.
Alais, le 3 novembre 1905
Introduction : Délimitation du sujet
Chapitre I – Névrose et religion
Les tendances religieuses de l’homme présentent au moins autant d’intérêt pour le psychologue qu’aucun autre fait de l’esprit humain. Je me propose de les étudier en les prenant uniquement comme des faits de conscience. Mon étude étant toute psychologique, ce ne sont pas les institutions, mais plutôt les sentiments et les instincts religieux qui en feront l’objet ; je m’en tiendrai donc à ces phénomènes subjectifs qui n’apparaissent qu’aux degrés les plus avancés du développement religieux et que nous connaissons par les témoignages écrits d’hommes arrivés à la pleine conscience d’eux-mêmes, c’est-à-dire par la littérature religieuse et notamment par des autobiographies. Malgré l’intérêt que présentent l’origine et les premiers degrés d’un développement, il convient, quand on se préoccupe avant tout de pénétrer le sens d’une chose, de s’adresser aux formes les plus parfaites et les plus complètement épanouies. Les documents les plus importants pour notre étude seront ceux qui proviendront des hommes les plus avancés dans la vie religieuse et capables de rendre compte clairement de leurs idées et de leurs motifs. Ce seront ou bien des auteurs relativement modernes, ou bien, parmi les auteurs plus anciens, ceux qui sont devenus classiques en fait de religion. Les documents humains qui nous instruiront le plus n’exigeront pas l’érudition d’un spécialiste : ils sont dans le domaine courant, accessibles à tous. Je prendrai donc mes citations, mes exemples d’expériences religieuses, dans des livres qui se trouvent entre toutes les mains, et cela ne diminuera pas la valeur de mes conclusions.
La nature psychologique des tendances religieuses et leur signification philosophique sont deux questions d’ordre différent ; à ne pas s’en rendre compte, on risque de tomber dans des confusions graves. Aussi je voudrais insister un peu sur ce point avant d’aborder l’étude des documents qui serviront de matériaux à notre recherche. On est d’accord aujourd’hui pour distinguer deux ordres de recherches sur n’importe quel objet. D’une part, quelle est sa nature, son origine, son histoire ? D’autre part, quelle est son importance, sa dignité, sa valeur ? La réponse à la première question est un jugement d’existence ou de constatation, la réponse à la seconde question est un jugement de valeur ou d’appréciation. Ces deux jugements ne peuvent pas se déduire immédiatement l’un de l’autre. Ils procèdent de deux préoccupations intellectuelles tout à fait distinctes ; l’esprit doit les former chacun séparément avant de pouvoir les ajouter l’un à l’autre.
En matière de religion, il est facile de distinguer ces deux ordres de questions. Tout phénomène religieux a son histoire et dérive d’antécédents naturels. Ce qu’on appelle aujourd’hui la critique biblique est simplement une étude de la Bible au point de vue historique, étude trop négligée par l’Église jusqu’aux temps modernes. Quelle a été l’histoire de chacun des auteurs dont les divers écrits composent le saint livre ? Qu’y avait-il exactement dans l’esprit de chacun d’eux ? Ce sont là des questions de fait ; aucune réponse qu’on y pourra faire ne résoudra sur le champ l’autre question, la question de valeur. L’origine de la Bible une fois connue, à quoi ce livre doit-il nous servir, soit pour nous guider dans la vie, soit pour nous révéler ce que nous voudrions savoir ? Il faut, pour répondre, avoir déjà construit une théorie générale sur ce qui peut constituer une source de révélation ; et cette conception elle-même serait ce que j’appelle un jugement de valeur. En la combinant avec des jugements d’existence, on pourrait en déduire une appréciation portant sur la valeur même de la Bible. Par exemple, si cette théorie impliquait qu’un livre, pour posséder la valeur d’une révélation, doit avoir été inspiré d’en haut et composé sans liberté de la part de l’écrivain, ou bien ne doit contenir aucune erreur scientifique, ne doit exprimer aucune passion individuelle, aucun préjugé local, il est probable que la Bible serait jugée sévèrement. Mais si, au contraire, la théorie admettait qu’un livre peut contenir une révélation malgré ses erreurs, malgré les passions qu’il manifeste, malgré des traces évidentes de libre composition humaine, pourvu qu’il rapporte fidèlement les crises intérieures de grandes âmes aux prises avec leur destinée, alors le verdict serait beaucoup plus favorable. Tous ceux qui sont vraiment compétents en fait de critique biblique distinguent avec soin la question de fait et la question de valeur. Avec les mêmes conclusions par rapport aux faits qu’ils étudient, les uns apprécient d’une manière et les autres d’une autre la valeur de la Bible comme révélation.
Si j’ai fait cette remarque sur les deux sortes de jugements, c’est qu’il existe beaucoup d’esprits, notamment des esprits religieux, qui n’ont pas encore appris à se servir couramment de cette distinction et qui pourront être d’abord un peu effarouchés par la méthode strictement positive que j’emploierai dorénavant. Quand je traiterai les phénomènes d’expérience religieuse en biologiste et en psychologue, comme si ce n’étaient que des faits curieux dans l’histoire d’un individu, quelques-uns pourront penser que je rabaisse un sujet sublime et me soupçonner, avant que j’aie pu pleinement exprimer ma pensée, de dénigrer la religion. Rien n’est plus éloigné de mon intention ; je tiens à le dire, car un tel préjugé dans l’esprit de mes lecteurs pourrait les empêcher de me bien comprendre.
Je vais consacrer ce chapitre à l’étude des rapports qu’il semble y avoir, chez certains individus, entre les phénomènes religieux et l’état plus ou moins pathologique de l’organisme, notamment du système nerveux. C’est un fait incontestable que, lorsque la vie religieuse absorbe toute la pensée et toute l’activité d’un individu, elle tend à le rendre excentrique. Je ne parle pas du croyant vulgaire qui pratique extérieurement, comme tout le monde, la religion de son pays. Que cette religion soit le bouddhisme, le christianisme ou le mahométisme, ce n’est pas lui qui se l’est faite ; d’autres l’ont créée pour lui, il l’a reçue par tradition, et la conserve par habitude. De quel profit serait-il d’étudier cette religion de seconde main, peu à peu stéréotypée par l’imitation ? Nous chercherons plutôt les expériences religieuses originales qui ont servi de modèle à tous ces sentiments suggérés, à toutes ces pratiques machinalement répétées. Or, on ne peut rencontrer de telles expériences que chez des individus en qui la religion existe, non point émoussée comme une simple habitude, mais bien plutôt à l’état aigu de fièvre mentale. Ce sont des génies dans l’ordre religieux, et, comme tant d’autres dont l’activité fut assez féconde pour que leurs noms soient inscrits aux pages de l’histoire, ces grands initiateurs ont souvent présenté des symptômes d’instabilité nerveuse. Peut-être sont-ils, plus encore que les autres génies, sujets à des phénomènes psychiques anormaux. Ils ont toujours une sensibilité fort exaltée ; souvent leur vie intérieure est déchirée de contradictions ; plusieurs souffrent de mélancolie durant une partie de leur carrière. Ils ne connaissent pas de mesure, ils sont sujets aux obsessions, aux idées fixes ; ils tombent en extase, ils ont des visions, ils entendent des voix, ils présentent toutes sortes de symptômes classés comme pathologiques. Il convient d’ajouter que ces phénomènes morbides ont souvent augmenté leur succès et leur influence.
Si l’on veut un exemple concret, il n’en est pas de meilleur que celui de George Fox. La religion des Quakers, qu’il fonda, est une chose que l’on ne saurait trop admirer ; dans une époque de mensonge et d’hypocrisie, ce fut une religion de véracité, prenant ses racines dans la vie spirituelle la plus intime et se rapprochant de l’évangile primitif plus qu’aucune des religions connues en Angleterre jusque-là. Le protestantisme contemporain, en évoluant dans le sens de la liberté, ne fait que revenir à l’attitude que Fox et les Quakers avaient prise il y a si longtemps. Assurément, l’esprit de Fox était d’une vigueur et d’une pénétration peu communes. Tous ceux qui eurent affaire avec lui, depuis Olivier Cromwell jusqu’aux juges et aux geôliers de petite ville, semblent avoir reconnu sa supériorité. Et cependant, la constitution de Fox était celle d’un névropathe, d’un « détraqué ». Son journal abonde en passages de ce genre :
« Comme je me promenais avec quelques amis, je levai la tête, je vis les flèches de trois clochers et cela me remua jusqu’aux moelles. Je leur demandai : Quel endroit est-ce là ? Ils me répondirent : Lichfield. Immédiatement la parole du Seigneur m’ordonna de m’y rendre. Arrivés à la maison où nous allions, je priai mes amis d’entrer, sans leur dire ce que je voulais faire. Dès qu’ils furent entrés, je m’en allai, et, marchant droit devant moi à travers haies et fossés, j’arrivai à un mille de Lichfield ; là, dans un grand champ, des bergers gardaient leurs moutons. Alors le Seigneur m’ordonna d’ôter mes souliers. J’hésitai, car c’était l’hiver ; mais la parole du Seigneur était comme un feu en moi. J’ôtai donc mes souliers et les laissai auprès des bergers ; ces pauvres gens tremblaient d’étonnement. Puis je marchai environ un mille et dès que je me trouvai dans la ville, la parole du Seigneur parvint de nouveau jusqu’à moi et me dit : Crie : « Malheur à Lichfield, cette ville de sang ! » Je parcourus donc les rues en tous sens, criant bien haut : Malheur à Lichfield, cette ville de sang ! Comme c’était jour de marché, je me rendis sur la place et je m’y promenai, m’arrêtant çà et là, en criant toujours : Malheur à Lichfield, cette ville de sang ! Personne ne mit la main sur moi. Et comme j’allais, criant ainsi à travers les rues, il me semblait qu’il y courait un ruisseau de sang et que la place du marché n’était qu’une mare de sang. Quand j’eus ainsi proclamé le message qui pesait sur moi, je me sentis soulagé, et je sortis en paix de la ville ; je revins vers les bergers et je leur repris mes souliers, en leur donnant quelque argent. Mais le feu du Seigneur était sur mes pieds et sur toute ma personne, au point que je ne tenais pas à remettre mes souliers et que je restai sans savoir s’il fallait les remettre ou non, jusqu’au moment où je sentis que le Seigneur me permettait de le faire ; alors, après m’être lavé les pieds, je remis mes souliers. Je tombai ensuite dans une profonde méditation, cherchant pour quelle raison j’avais pu être envoyé à cette ville, pour lui crier qu’elle était une ville de sang. Car, malgré que beaucoup de sang y eût été répandu pendant les guerres entre le parlement et le roi, qui se disputaient le pouvoir, il ne s’y était rien passé de plus qu’en maint autre endroit. Mais j’appris plus tard qu’au temps de l’empereur Dioclétien, un millier de chrétiens avaient subi le martyre à Lichfield. C’est pour cela que j’avais dû aller et traverser pieds nus leur sang qui coulait dans les rues, qui formait une mare sur la place du marché ; que j’avais dû évoquer le souvenir du sang versé plus de mille ans auparavant, qui gisait encore tout refroidi sur le pavé de ces rues. Voilà comment je sentais peser sur moi le remords de ce sang, voilà comment je dus obéir à la parole du Seigneur. »
Nous nous proposons d’étudier ensemble des faits positifs qui conditionnent la vie religieuse ; il est impossible que nous en passions sous silence les aspects pathologiques. Nous devons les décrire et les dénommer exactement comme si nous les rencontrions chez des hommes non religieux. Il est vrai que nous répugnons instinctivement à voir un objet qui tient aux fibres les plus profondes de notre âme classé par l’intelligence, c’est-à-dire rangé dans la même case que d’autres objets. Or, quand une chose a pour nous une importance infinie et que tout notre être s’incline devant elle, il nous semble évident qu’elle doit être unique et suigeneris. Il est probable qu’un crabe se sentirait indignement outragé s’il entendait avec quelle désinvolture nous le classons une fois pour toutes parmi les crustacés. « Vous vous trompez tout à fait, dirait-il ; je suis moi-même, moi-même, vousdis-je, et rien d’autre ».
Après avoir classé ses objets, l’intelligence s’occupe de rechercher les causes qui leur ont donné naissance. Spinoza disait : « J’examinerai les actions et les appétits des hommes, comme s’il était question de lignes, de plans ou de solides ».3 Les conséquences de nos passions découlent de leur nature « aussi nécessairement qu’il résulte de la nature du triangle que ses trois angles soient égaux à deux droits... J’examine les passions humaines et leurs propriétés, exactement comme les autres phénomènes naturels ».4 Taine nous dit, dans l’Introduction à l’Histoire de la littératureanglaise : « Que les faits soient physiques ou moraux, il n’importe, ils ont toujours des causes ; il y en a pour l’ambition, pour le courage, pour la véracité, comme pour la digestion, pour le mouvement musculaire, pour la chaleur animale. Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre ». Devant ces prétentions de l’intelligence à vouloir assigner les conditions matérielles de toute chose, nous nous sentons heurtés, diminués dans notre vie intime. Et je ne dis rien de la légitime impatience que provoque en nous la disproportion quelque peu ridicule entre le programme de ces auteurs et son exécution. De telles comparaisons, froidement instituées, sont à nos yeux une menace pour ce que notre âme a de plus précieux. Il semble qu’en expliquant leur origine, on en détruise du même coup la valeur, en les réduisant au rang de ces produits utiles et vulgaires auxquels Taine les compare.
L’idée que les choses perdent toute leur dignité dès qu’elles sont réputées de basse extraction est une idée courante, qui se manifeste en particulier dans les commentaires auxquels les esprits positifs se livrent si souvent sur le compte de leurs parents et amis plus idéalistes. Si Alfred croit si fermement à l’immortalité de l’âme, c’est qu’il est d’un tempérament trop émotif. Fanny est trop consciencieuse tout bonnement à cause de sa grande nervosité. La philosophie mélancolique de William est due à ses mauvaises digestions ; il doit avoir un engorgement du foie. Le vif plaisir qu’Élisa prend à fréquenter l’église est un symptôme de sa constitution hystérique. Pierre serait moins tourmenté au sujet de son âme s’il prenait plus d’exercice au grand air. Un autre exemple du même raisonnement, c’est la manie, commune à beaucoup d’écrivains contemporains, de faire la critique des émotions religieuses en montrant qu’elles ont un rapport étroit avec la vie sexuelle. La conversion serait une crise d’adolescence et de puberté. Les macérations des saints et le dévouement des missionnaires ne seraient que des déviations de l’instinct qui porte les parents à se sacrifier pour leurs enfants. La nonne hystérique, condamnée à la vie la plus anormale, affamée d’amour, trouverait en Jésus-Christ le succédané imaginaire d’un objet d’affection plus terrestre.
Comme il arrive souvent pour les idées qui sont dans l’air, cette conception semble se dérober aux formules précises : elle ne s’exprime que d’une façon incomplète et par des insinuations. Il me semble qu’il y a peu de conceptions plus vides de sens que cette manière d’interpréter la religion comme une perversion de l’instinct sexuel. La brutalité avec laquelle elle est souvent présentée fait penser à ce reproche fameux lancé par les catholiques : On ne saurait comprendre la Réforme si l’on oublie son vrai point de départ, à savoir que Luther s’était mis en tête d’épouser une religieuse. En pareil cas, les effets observés sont infiniment plus grands que les prétendues causes, et pour la plupart d’une tout autre nature. Il est vrai que dans l’ensemble des phénomènes religieux il en est quelques-uns qui, sans contredit, sont en rapport direct avec l’instinct sexuel ; par exemple le culte, accompagné de rites obscènes, de certaines divinités du polythéisme qui symbolisent la génération ; ou encore certains états d’extase chez un petit nombre de mystiques chrétiens, qui se sentent unis au Christ d’une façon quasi charnelle.5 Mais alors nous pourrions aussi bien dire que la religion est une aberration de la fonction digestive, et prouver notre thèse par l’adoration de Bacchus et de Cérès, ou par les émotions extatiques de quelques autres mystiques au sujet de l’Eucharistie. Il faut bien que le langage religieux se serve d’images empruntées à notre pauvre vie. L’organisme entier frémit et résonne toutes les fois que l’esprit, fortement remué, veut exprimer son émotion. Les métaphores tirées du boire et du manger sont probablement aussi fréquentes dans la littérature religieuse que celles empruntées à l’union des sexes. « Goûtez, dit le Psalmiste, et voyez combien le Seigneur est bon ».6 – « Mon âme a soif du Dieu vivant ».7 – « Heureux, dit Jésus, ceux qui ont faim et soif de justice ; car ils seront rassasiés ».8
« Lait spirituel pour les nourrissons Américains, découlant des deux mamelles de la Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament », tel est le sous-titre d’un petit livre jadis renommé où les enfants de la Nouvelle-Angleterre apprenaient à lire. Les livres de dévotion chrétienne sont, à bien des pages, inondés de ce lait, et l’avidité du nourrisson à téter sa nourrice sert à exprimer la pieuse ardeur du mystique buvant son Dieu. Sainte Thérèse décrit en ces termes l’oraison de quiétude :
« L’âme en cet état est comme un enfant à la mamelle, quand sa mère, pour le régaler, fait couler le lait dans sa bouche sans qu’il remue seulement les lèvres. De même, dans cette oraison, la volonté aime sans que l’entendement travaille ; le Seigneur veut que, sans penser à lui, l’âme sente qu’elle est avec lui, boive le lait que ce grand Dieu lui verse dans la bouche, en goûte la douceur et, voyant que c’est du Seigneur que lui vient cette grâce, en jouisse délicieusement. »9
Et Saint François de Sales :
« Si vous prenez garde aux petits enfants unis et joincts au sein de leurs mères, vous verrez que de temps en temps ils se pressent et serrent par de petits eslans que le plaisir de tetter leur donne. Ainsi en l’oraison le cœur uny à son Dieu fait maintes fois certaines recharges d’union par des mouvements avec lesquels il se serre et presse davantage en sa divine douceur. »10
Une telle façon de raisonner serait aussi concluante que celle des partisans de la théorie sexuelle. – Mais, répliqueront-ils, vous ne trouverez nulle part d’argument parallèle à celui-ci : les deux faits cardinaux de la vie religieuse, à savoir la mélancolie et la conversion, sont essentiellement des phénomènes d’adolescence, et il y a un synchronisme remarquable entre ces faits et le développement de la vie sexuelle. – En admettant même que ce synchronisme fût partout constaté, il faut remarquer que ce n’est pas seulement la vie religieuse, mais toute la vie supérieure de l’esprit qui s’éveille durant l’adolescence. On devrait donc soutenir que le goût des sciences exactes, des sciences naturelles, de la philosophie, qui éclate en même temps que le goût de la poésie et de la religion, est une perversion de l’instinct sexuel : ce serait trop absurde. Enfin, si nous devons trancher la question par un synchronisme, que ferons-nous de ce fait que la période religieuse par excellence paraît être la vieillesse, alors que le bouillonnement de la vie sexuelle s’est apaisé ?11
Quand il s’agit de comprendre la religion, il n’y a qu’une chose à faire : c’est d’étudier le contenu immédiat de la conscience religieuse. Dès qu’on procède ainsi, on voit qu’en somme il y a bien peu de rapports entre la conscience religieuse et la vie sexuelle. Tout diffère, l’objet de la pensée, l’attitude de l’esprit, les facultés intéressées, et les actes auxquels on est poussé. Il est impossible d’assimiler l’un à l’autre deux états d’esprit dont le contraste est si vif qu’il va souvent jusqu’à la complète hostilité. Si maintenant les défenseurs de la théorie sexuelle prétendent que tout cela ne saurait renverser leur thèse, puisque sans les éléments chimiques que les organes sexuels déversent dans la circulation, le cerveau ne recevrait pas la nourriture appropriée à son fonctionnement religieux, – que cette dernière affirmation soit vraie ou fausse, en tout cas elle est incapable de nous instruire quant à la valeur propre de la religion. On pourrait aussi bien dire que la vie religieuse dépend de la rate, du pancréas ou des reins ; et, de toute la théorie, il ne resterait plus que cette assertion vague et générale que, d’une manière ou d’uneautre, l’esprit dépend de l’organisme.
Cette façon de discréditer les états d’esprit qui nous sont antipathiques nous est sans doute plus ou moins familière. Nous l’employons tous pour critiquer ceux dont les idées ou les sentiments nous paraissent exagérés. Mais quand les autres à leur tour viennent critiquer notre enthousiasme, ne voulant y voir que l’expression de nos dispositions organiques, nous sommes froissés, blessés, car nous savons que nos états de conscience possèdent par eux-mêmes une valeur, comme révélation de la réalité ; et nous voudrions faire taire tout ce matérialisme médical. Le terme me paraît juste, en effet, pour désigner cette façon de juger vraiment simpliste. Le matérialisme médical croit avoir dit le dernier mot sur Saint Paul, en qualifiant sa vision sur la route de Damas de décharge épileptiforme dans l’écorce occipitale. Dédaigneusement, il traite Sainte Thérèse d’hystérique et Saint François d’Assise de dégénéré héréditaire. La répulsion de Georges Fox pour l’hypocrisie de son époque et son douloureux effort vers la sincérité spirituelle ne sont que des symptômes de désordres intestinaux. Les profonds accents de désespoir de Carlyle s’expliquent par un catarrhe gastroduodénal. Bref, chacun de ces cas d’hypertension mentale n’est au fond que la manifestation d’une diathèse, d’une auto-intoxication, due à un trouble fonctionnel de diverses glandes ; diathèse que la physiologie finira bien par découvrir. Le matérialisme médical estime avoir ainsi réduit à néant l’autorité spirituelle des grandes personnalités.12
Reprenons à notre tour la question, d’un point de vue aussi large que possible. La psychologie moderne, ayant constaté la réalité de certaines relations psychophysiques, admet comme une hypothèse commode la dépendance universelle des états mentaux à l’égard des conditions organiques. Si nous adoptons ce postulat, les assertions du matérialisme médical doivent être vraies d’une façon générale, sinon dans tous les détails. Saint Paul a certainement eu un accès épileptique ou tout au moins épileptoïde ; George Fox était un dégénéré héréditaire ; Carlyle souffrait d’une auto-intoxication provenant d’un viscère quelconque, et ainsi des autres. Mais cette explication positive des faits qui constituent l’histoire d’un esprit peut-elle trancher la question de leur valeur spirituelle ? D’après notre postulat, qui est à la base de toute la psychologie moderne, il n’y a pas un de nos états de conscience, normaux ou pathologiques, depuis les plus vulgaires jusqu’aux plus élevés, qui n’ait pour condition quelque processus organique. Cela peut se dire des opinions scientifiques aussi bien que des émotions religieuses ; et si nous avions une connaissance assez intime des faits psychophysiques, nous nous rendrions compte que l’état du foie exerce une influence aussi décisive sur les assertions de l’athée le plus farouche que sur celles du méthodiste tourmenté de son salut. Quand le foie modifierait d’une façon le sang qui le traverse, on aurait la tournure d’esprit du méthodisme ; on aurait celle de l’athéisme, quand il le modifierait d’autre façon. Il en est de même pour tous nos enthousiasmes et toutes nos sécheresses, pour nos aspirations et nos angoisses, pour nos doutes et nos croyances. Que leur contenu soit ou non religieux, tous ces faits psychiques ont également dans l’organisme leurs conditions immédiates. Il est donc tout à fait illogique et arbitraire d’invoquer les causes organiques d’un état de conscience religieux pour contester sa valeur spirituelle. Il faudrait avoir préalablement construit une théorie générale rattachant toutes les valeurs spirituelles à des processus physiologiques déterminés. Autrement il n’y aurait pas une de nos pensées ou de nos émotions, pas une de nos doctrines scientifiques, pas une de nos croyances, qui pût conserver aucune valeur comme révélation de la vérité ; car toutes sans exception découlent de l’état corporel où se trouvait l’individu au moment où elles occupaient son esprit.
Il n’est guère besoin de dire que le matérialisme médical ne songe aucunement à aller si loin, à balayer, par ces conclusions sceptiques, toute espèce d’affirmation. Le matérialisme est convaincu comme le vulgaire que certains états d’esprit ont sur les autres une supériorité intrinsèque, nous révèlent davantage la vérité ; en cela, il énonce simplement un jugement de valeur. Il ne possède, sur l’origine des états d’esprit auxquels il donne la préférence, aucune théorie psycho-physiologique qui légitime cette préférence. La tentative de discréditer les états de conscience qui lui déplaisent en les associant vaguement aux nerfs ou au foie, en leur appliquant des épithètes péjoratives, empruntées au vocabulaire médical, est illogique et contradictoire.
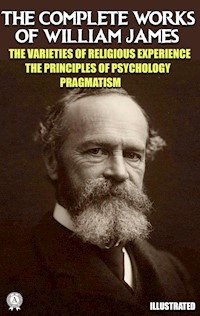

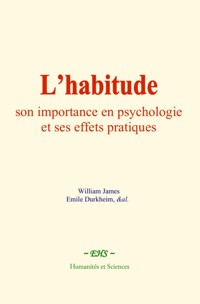
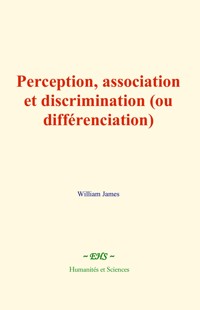
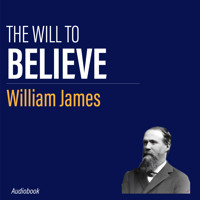
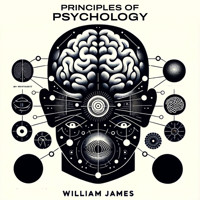
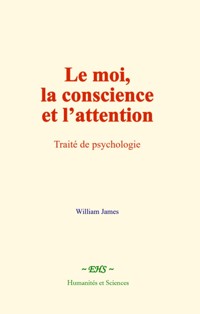
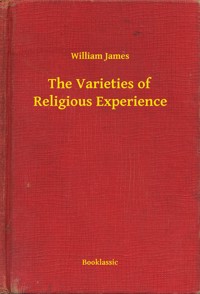
![A Pluralistic Universe [Halls of Wisdom] - William James - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/417cf18ca0d020e7eb589b5daad74b5f/w200_u90.jpg)