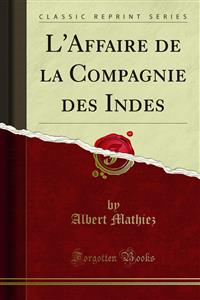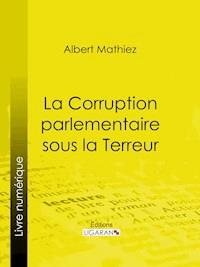
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"La Corruption parlementaire sous la Terreur de Albert Mathiez est un ouvrage captivant qui plonge le lecteur au cœur d'une période sombre de l'histoire de la France.
Dans ce livre, l'auteur, historien renommé, explore avec minutie et rigueur la question de la corruption parlementaire pendant la période de la Terreur, qui a suivi la Révolution française. Mathiez met en lumière les mécanismes insidieux qui ont conduit à la dégradation de l'intégrité des députés et sénateurs de l'époque, et analyse les conséquences désastreuses de cette corruption sur la vie politique et sociale de la nation.
À travers une recherche approfondie et une analyse pointue des sources historiques, Mathiez dévoile les pratiques corrompues qui ont gangrené les institutions parlementaires de l'époque. Il met en évidence les stratégies utilisées par certains élus pour s'enrichir illicitement, les compromissions politiques qui ont sapé la confiance du peuple envers ses représentants, et les conséquences désastreuses de cette corruption sur la stabilité du pays.
Ce livre offre une lecture passionnante et éclairante sur un aspect souvent méconnu de la Révolution française. Mathiez démontre avec brio que la corruption parlementaire n'est pas un phénomène nouveau, mais qu'elle a des racines profondes dans l'histoire politique de la France. Il nous invite à réfléchir sur les dangers de la corruption pour la démocratie et à tirer des leçons de cette période tumultueuse.
La Corruption parlementaire sous la Terreur est un ouvrage incontournable pour tous les passionnés d'histoire, les étudiants en sciences politiques et tous ceux qui s'intéressent aux enjeux de la démocratie. Albert Mathiez nous offre une analyse brillante et éclairante, qui nous pousse à réfléchir sur les dérives du pouvoir et les moyens de les prévenir.
Extrait : ""Plus d'un parmi vous s'est sans doute demandé en lisant l'affiche de la Faculté pourquoi j'ai choisi comme sujet de mon cours public La Corruption parlementaire sous la Terreur. Ce n'est pas, je voudrais que vous en fussiez bien convaincus, pour le plaisir facile de faire naître dans vos esprits les allusions malignes ou de raconter des anecdotes scandaleuses."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MESDAMES, MESSIEURS,
Plus d’un parmi vous s’est sans doute demandé en lisant l’affiche de la Faculté pourquoi j’ai choisi comme sujet de mon cours public La Corruption parlementaire sous la Terreur. Ce n’est pas, je voudrais que vous en fussiez bien convaincus, pour le plaisir facile de faire naître dans vos esprits les allusions malignes ou de raconter des anecdotes scandaleuses. Ceux qui voudront bien me suivre jusqu’au bout s’apercevront vite que le sujet est plus austère qu’ils ne croient. Je ne me sens pourtant aucune vocation pour la prédication et je vous promets que je ne vous ferai pas de leçons de morale. Il y a longtemps, n’est-ce pas, que la preuve est faite que les formes politiques, que les systèmes de gouvernement sont impuissants à changer la substance de l’humanité ? Tous les régimes ont eu leurs corrupteurs et leurs corrompus. Sous l’ancienne monarchie, on achetait comme on pouvait, parfois très cher, les grâces des courtisans. Les favorites distribuaient jusqu’aux mitres épiscopales. Dans les démocraties, les gouvernants ont aussi leurs flatteurs et leurs tentateurs. Si on ne présente plus officiellement les favorites, comme à la cour de Louis XIV, si elles n’ont plus rang dans la hiérarchie protocolaire, elles n’en jouent pas moins un rôle considérable qu’un historien informé ne saurait négliger. L’argent, la femme, sous toutes les latitudes, sous tous les gouvernements, à toutes les époques, sont les deux grands moyens de séduction, les deux pièges souverains où se prennent les consciences.
Qu’y a-t-il donc d’étonnant, Mesdames et Messieurs, que parmi ces conventionnels qui, dans le lointain de l’histoire, nous paraissent si grands, d’une grandeur farouche, se soient glissées des brebis galeuses ? La Révolution, a dit un homme politique célèbre par ses mots, est un bloc. Soit ! Si on ne considère que son œuvre, que les institutions qu’elle a fondées. Mais le point de vue de l’homme politique n’est pas celui de l’historien. Il n’y a pas de bloc que la critique historique ne dissocie pour en analyser les éléments parfois fort disparates.
La Convention nationale et dans la Convention la Montagne elle-même ne comprit pas que des législateurs incorruptibles uniquement dévoués au bien public. Lui retirerons-nous pour autant toute notre admiration ? Les Français de 1793 étaient des hommes après tout et des hommes qui avaient grandi au spectacle de l’ancienne monarchie où tout se vendait et où tout s’achetait. Qu’ils n’aient pas tous résisté à la tentation de mettre au service de leurs intérêts privés, de leurs passions et de leurs vices, la toute puissance que leur avait confiée la Nation, que quelques-uns aient imité les mœurs de ces courtisans dont ils avaient pris la place, la chose est si naturelle qu’il faudrait ne rien connaître de la vie pour s’en montrer surpris.
Ce qui vous surprendra bien au contraire, Mesdames et Messieurs, ce qui vous fera sourire, c’est l’inexpérience dont font preuve certains de ces hommes politiques, corrupteurs ou corrompus, que je ferai défiler devant vous, la candeur de leurs aveux, l’ingénuité de leurs procédés de défense. À cette aurore du régime parlementaire, les illusions étaient générales. Si la République était belle sous l’Empire, combien plus belle encore était-elle le 22 septembre 1792, quand elle fut proclamée pour la première fois à la face du vieux monde, aux échos du canon de Valmy !
Les patriotes croyaient que la République, comme d’un coup de baguette magique, transformerait, régénérerait la France et l’Univers. Les députés, qui s’appelaient alors d’un nom emphatique les Législateurs, par comparaison avec Moïse, Lycurgue, Solon, se considéraient et étaient considérés comme des sortes de prêtres du bonheur social. Ils se prenaient très au sérieux : « Représentants du peuple, s’écrie l’un d’eux, le Girondin Manuel, le 21 septembre 1792, la mission dont vous êtes chargés exigerait et la puissance et la sagesse des dieux. Lorsque Cinéas entra dans le Sénat de Rome, il crut voir une assemblée de rois. Une pareille comparaison serait pour vous une injure. Il faut voir ici une assemblée de philosophes occupés à préparer le bonheur du monde ». « Notre mission est grande, elle est sublime », ajoutait après Manuel le Montagnard Couthon.
Tout remplis de Montesquieu et de J.-J. Rousseau, les Législateurs savaient que la vertu, autrement dit le dévouement au bien général, est l’âme des Républiques et ils s’efforçaient sinon d’être vertueux, du moins de le paraître. Les plus candides se mettaient à la recherche des moyens d’empêcher la corruption de pénétrer dans le sanctuaire des lois.
Le vénérable vieillard Raffron du Trouillet, député Montagnard de Paris, au moment où on discutait la Constitution de 1793, proposait d’instituer au-dessus de l’Assemblée législative une sorte de tribunal des mœurs, une censure nationale qui surveillerait les députés et les révoquerait au premier soupçon. Raffron n’avait oublié qu’une chose, c’est que son tribunal des mœurs aurait besoin à son tour d’être surveillé. Robespierre, avec beaucoup de ménagements, lui fit remarquer que sa proposition était impraticable. Cependant, pour lui donner satisfaction, le Comité de Salut public proposa d’insérer dans la Constitution une série d’articles qui instituaient la censure du peuple sur ses élus. Après chaque législature, tout député devait être jugé par ses électeurs qui l’acquittaient ou le condamnaient. Le député condamné ne pouvait plus être réélu ni nommé à aucune fonction publique. Le projet, il est vrai, fut écarté pour des raisons surtout politiques. On était alors en pleine insurrection fédéraliste. Les Montagnards craignirent que dans maints départements la censure du peuple ne s’exerçât à leur détriment.
Ils ne renoncèrent qu’à regret à l’institution préventive rêvée. L’un d’eux Guyomar avait déclaré dans la discussion qu’« il était nécessaire de trouver un moyen d’empêcher le Corps législatif d’abuser des pouvoirs immenses qui lui sont confiés ». C’était un sentiment alors général. Jean-Jacques Rousseau avait montré dans le Contrat social qu’un peuple qui délègue ses pouvoirs à des représentants se donne en réalité des maîtres. Montesquieu avait dit avec plus de force et de concision : « Quand le trésor public devient le patrimoine des particuliers, la république est une dépouille et sa force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous ».
L’idée qu’il fallait se prémunir contre la dictature irresponsable des représentants qui laissait tant de ressources à la corruption, cette idée était si profondément sentie qu’elle reparut à toutes les grandes crises qui prirent ainsi l’aspect de crises de moralité. Au plus fort de la lutte des Girondins et des Montagnards, le 14 mai 1793, Buzot, l’ami de Mme Roland, dénonça les démagogues qui se servaient de la popularité pour parvenir à la fortune : « Avec des phrases que nous connaissons très bien depuis quatre ans, dit-il, il est très possible de tromper le peuple, de parler même de Sans-Culotterie et de piller le Trésor public en amassant une grosse fortune. Il est tel homme qui aujourd’hui tient bonne table, qui a voiture et qui, avant le 10 août, avant la Révolution, n’avait rien, absolument rien. » Buzot conclut en proposant que tous les députés, même ceux qui avaient siégé à la Constituante et à la Législative, fussent tenus de déclarer dans le délai d’un mois l’état de leur fortune, sous peine de dix ans de fers et de la confiscation de leurs biens. Buzot fut très applaudi. Cambacérès cependant fit observer que la mesure qu’il proposait était immorale, « car elle ne tendait à rien moins qu’à compromettre la propriété et la sûreté de chacun de nous », et qu’elle était aussi dangereuse, « car elle exposerait le crédit des commerçants et produirait des effets funestes dans des temps de troubles et d’agitations ». Cambon dit avec plus de force encore : Acquéreur d’un bien national, chargé dans l’Assemblée législative et dans la Convention de plusieurs missions importantes, je m’oppose au décret qui vous est présenté, parce que je ne veux pas que par des décrets inexécutables on avilisse la Convention. Veut-on désigner les individus ? eh bien, qu’on s’explique franchement, qu’on dise : Un tel n’avait rien lorsqu’il a été député et maintenant il a telle et telle chose. Rendons justice au peuple, il accueillera celui qui fera des déclarations importantes. Le mauvais citoyen, le voleur sait bien trouver les moyens de cacher sa fortune ; il n’achète pas, il enfouit son or, en attendant un temps plus opportun pour jouir de ses rapines. Quant à moi, je déclare à la Convention que le bilan de ma fortune sera imprimé ; il le sera avec exactitude, parce que j’ai des associés. » Thuriot tenta une diversion en proposant de faire renvoyer au Comité de Salut public les dénonciations portées contre les membres de la Convention. Mais Barbaroux reprit les arguments de Buzot et la Convention décréta que « les représentants du peuple étaient à chaque instant comptables à la Nation de l’état de leur fortune ». Ce n’était qu’une déclaration de principe. Le mode d’application du décret restait à voter. Quand Raffron, nous l’avons vu, proposa son tribunal censorial, il n’obtint aucun succès. Mais l’idée qu’il fallait rendre effective la responsabilité des représentants subsistait vivace dans les esprits. Elle ne tarda pas à reparaître.
Quand les Montagnards commencèrent à se diviser, quand les hébertistes reprochèrent aux dantonistes leur indulgence pour l’aristocratie et leurs compromissions avec les gens d’affaires, le vénérable Raffron voulut prévenir les fatals déchirements qu’il prévoyait. Il reprit son projet de tribunal censorial. Les électeurs nommeraient un citoyen par département pour former ce tribunal.
Parmi les 83 citoyens ainsi nommés le Corps législatif choisirait 21 noms. Les 21 juges désignés viendraient siéger dans la capitale à côté des députés. Quand une dénonciation se produirait contre un député, le corps législatif tirerait au sort 15 noms parmi les 21 censeurs et les 15 sortis se constitueraient en tribunal pour juger dans le jour le député dénoncé. Ils se borneraient dans le jugement à déclarer que l’inculpé avait conservé ou perdu la confiance publique. Le député flétri par la censure serait immédiatement déchu de ses fonctions.
Pas plus en novembre 1793 qu’en juin de la même année, l’institution du tribunal de censure ne fut adoptée par la Convention. C’est qu’il y avait un autre tribunal, bien plus efficace, croyait-on, pour punir les suspects, il y avait le tribunal révolutionnaire qui venait de condamner les députés girondins à l’échafaud.
Malgré tout, c’était à regret que la Convention livrait ses membres à la hache de Sanson. Elle aurait préféré des moyens plus doux et prévenir les crimes plutôt que les réprimer.
Au lendemain encore de la double exécution des Hébertistes et des Dantonistes, l’idée d’une censure publique revient sur l’eau à la tribune de la Convention. Le terrible Vadier propose que chaque député « rende compte au peuple de sa vie politique et privée et présente l’état de sa fortune ». Le « vertueux » paralytique Couthon, au milieu des applaudissements, appuie Vadier : « Oui, citoyens, rendons tous un compte moral de notre conduite politique ; faisons connaître au peuple ce que nous avons été avant la Révolution et ce que nous sommes devenus, quelle a été notre profession, quelle a été notre fortune, si nous l’avons augmentée et par quels moyens, ou si nous ne sommes devenus plus riches qu’en vertus ; que chacun de nous fasse imprimer ce compte moral et qu’il dise : C’est la vérité que je vous présente ; si je vous trompe seulement dans une syllabe, j’appelle la vengeance nationale. » La salle, dit le Moniteur, retentit alors des plus vifs applaudissements. Tous les membres se lèvent par un mouvement spontané et votent par acclamation la proposition de Couthon. Vote stérile, qui fut rapporté quelque temps après, quand Robespierre, avec son froid bon sens, eût montré aux jacobins que les fripons sauraient mieux que les honnêtes gens présenter au public le compte moral qu’on exigeait d’eux !
Robespierre, Mesdames et Messieurs, avait raison. On ne cultive pas la vertu, on ne la fait pas naître artificiellement. Il est bien difficile d’arrêter la corruption par des moyens préventifs. Mais les préoccupations et les faits que j’ai rappelés suffiront à montrer, je pense, quel fonds d’honnêteté foncière résidait dans l’âme de la grande majorité des Conventionnels. S’il y a eu, dans le nombre, des corrompus, et nous les connaîtrons bientôt, ils n’ont jamais bénéficié comme d’autres, en des temps plus heureux, de l’indulgence souriante et sceptique de leurs collègues et de l’opinion. Bien au contraire, ils vivront dans la crainte continuelle, obsédante, que leurs friponneries soient dévoilées et certains trembleront si fort qu’ils ne pourront calmer leurs frayeurs qu’en dénonçant leurs complices et en se dénonçant eux-mêmes du même coup !
Je devais ces explications préliminaires, Mesdames et Messieurs, à ceux d’entre vous, qui auraient pu s’imaginer, en lisant le titre de mon cours public La Corruption parlementaire sous la Terreur, que je nourrissais quelques mauvais desseins contre le bon renom de la Convention nationale.
Mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi j’ai choisi ce sujet.
Je l’ai choisi parce qu’il est encore à traiter. Aucun historien, à ma connaissance, n’a tenté de l’aborder. C’est un sujet vierge ou presque. Plus je l’ai étudié, plus il m’a semblé intéressant, je dirai même révélateur. Il permet de rectifier sur l’histoire de la Terreur des erreurs graves qui ont cours partout. Il jette quelque clarté dans une ombre épaisse et mystérieuse.
On s’explique aisément que les révolutionnaires aient brandi la hache nationale contre les ennemis de la Révolution. On s’explique encore que les Montagnards aient traité les Girondins comme des aristocrates, puisque les Girondins soulevaient les départements et s’alliaient partout aux royalistes. On s’explique plus difficilement que les Montagnards victorieux se soient presque aussitôt divisés et qu’ils aient employé les uns contre les autres le suprême argument de la guillotine. Hébertistes et Dantonistes se succèdent à l’échafaud et y précèdent de bien peu les Robespierristes.
Pourquoi ces hécatombes ? Pourquoi des hommes qui, la veille, s’estimaient comme des frères et poursuivaient en apparence le même idéal s’entretuent-ils avec fureur le lendemain ?
Il y a une explication commode qui a déjà beaucoup servi et qui servira longtemps encore, parce qu’elle s’adresse aux intelligences paresseuses. Elle consiste à rejeter toutes les responsabilités sur un bouc émissaire, sur Robespierre, qu’on représente comme un ambitieux effréné, un hypocrite sans scrupules, un tigre altéré de sang, que sais-je encore ?
L’ambition de Robespierre ! Le dernier historien de la Révolution la dénonce partout. Il la découvre dans la journée du 2 juin 1793 qui précipita les Girondins du pouvoir, dans le vote du 10 juillet qui exclut Danton du Comité de Salut public, dans la double exécution enfin des Hébertistes et des Dantonistes qui serait due à ses calculs machiavéliques. Robespierre se serait d’abord servi des Dantonistes contre les Hébertistes, puis de ceux-ci contre ceux-là et les aurait ruinés les uns par les autres afin d’établir à son profit une sorte de dictature politico-religieuse qui aurait trouvé son expression dans le culte de l’Être suprême. Ainsi, si la démocratie s’est divisée, si ses divisions l’ont perdue, si elle a reculé sans cesse après thermidor jusqu’au Consulat et à l’Empire, c’est la faute à l’ambition de Robespierre.
L’ambition de Robespierre ! C’est une sorte de tarte à la crème qui explique tout et qui n’explique rien. Car enfin, pourquoi le Comité de Salut public, pourquoi la Convention, pourquoi l’opinion publique ont-ils suivi Robespierre ? C’est donc que les arguments que Robespierre mettait en avant avaient un poids singulier ! Quels étaient ces arguments ? On ne prend pas la peine de les examiner, on se contente d’y faire une allusion très discrète, une allusion voilée.
L’ambition de Robespierre ? Mais les historiens qui la dénoncent sont les mêmes à prétendre que Robespierre était un homme fort médiocre, presque sans moyens, même oratoires, à les entendre. Singulière contradiction entre la petitesse de l’homme et les vues qu’on lui prête et les évènements qu’il aurait provoqués et dirigés !
Les adversaires de Robespierre ne s’aperçoivent pas qu’à représenter ainsi leur victime comme une sorte de génie du mal, ils lui dressent un piédestal. Le gavroche des Misérables chantait : C’est la faute à Rousseau, nos graves historiens répètent avec le même esprit : C’est la faute à Robespierre.
Ces historiens oublient que l’homme qu’ils dénoncent rétrospectivement avec une âpreté de procureurs, avait personnifié la Révolution dans tout ce qu’elle portait en elle de plus pur et de plus noble, que sa popularité fut immense, que la plupart des thermidoriens eux-mêmes qui ont participé à sa chute, comme Barras, Barère, Cambon, ont regretté plus tard la faute qu’ils avaient commise au 9 thermidor, que tous les grands démocrates de la première moitié du XIXe siècle, que les hommes de 1830 et de 1848, depuis Armand Carrel jusqu’à Louis Blanc, se sont réclamés hautement des enseignements et de l’exemple de l’Incorruptible et ont professé un culte pour sa mémoire.
Les grandes crises politiques et sociales ne peuvent être réduites que par des historiens à courte vue aux proportions d’un conflit de personnes. Les divisions de la Montagne eurent des causes multiples. L’ambition de Robespierre, si cette ambition a jamais existé, n’y a de toute façon joué qu’un rôle très accessoire.
Il y a de ces fatales divisions une explication que les acteurs eux-mêmes ont donnée et que les contemporains ont adoptée. C’est la corruption, à la fois financière et politique, qui a introduit le poison du soupçon et de la défiance parmi les amis de la veille. C’est la corruption parlementaire qui explique pour une bonne part le recul et la perte de la démocratie. Grande leçon !
Dès le lendemain de la chute de la Gironde, dans les mois de juillet et d’août 1793, au moment des grands périls intérieurs et extérieurs, on dénonce aux jacobins et bientôt à la tribune de la Convention l’existence d’une faction d’hommes d’affaires qui s’efforce de s’emparer du gouvernement pour agioter à son aise. On ajoute que ces hommes d’affaires qui s’infiltrent dans tous les Comités, partout où il y a une autorité à exercer et un bénéfice à recueillir, ne pensent pas seulement à faire leur fortune, mais qu’ils reçoivent l’inspiration « d’agents de l’étranger », d’agents de Pitt et de Cobourg, et que ces agents préparent par leur entremise la restauration de la monarchie. On murmure bientôt les noms de ces parlementaires corrompus, de ces pourris comme on dit d’un mot énergique et on désigne aussi les agents de l’étranger qui les inspirent. Les pourris, c’est le député Delaunay d’Angers qui spécule sur les actions de la compagnie des Indes, – c’est le député-poète Fabre d’Églantine qui agiote concurremment avec Delaunay et vend des souliers à l’armée pour payer ses dettes criardes et entretenir ses actrices, Caroline Remy ou la Morency, – c’est le député Julien de Toulouse, le protecteur attitré du fournisseur infidèle d’Espagnac, l’amant de la ci-devant comtesse de Beaufort, – c’est le député Chabot, ancien capucin perdu de mœurs, célèbre par ses dénonciations contre le Comité Autrichien sous la Législative et par son rôle au 10 août, qui monnayait maintenant sa réputation de patriotisme en épousant avec une dot de 200,000 livres la sœur des banquiers autrichiens Frey, juifs d’origine morave établis depuis peu à Paris et d’un jacobinisme très écarlate, – c’est le député Basire, ami de Chabot et amant de la baronne Palm d’Ælders, une intrigante pensionnée par le gouvernement hollandais et une apôtre du féminisme, – c’est Courtois, le « pays » de Danton, député de l’Aube qui fournit des bœufs à l’armée et ne remplit pas les conditions de ses marchés, Courtois qui entretient avec la duchesse de Choiseul des relations très amicales et d’autant plus suspectes que, la duchesse étant très vieille, on en cherche le motif ; – les pourris, c’est Rovère et Poultier qui dans leur mission en Vaucluse s’emparent des biens nationaux, – c’est Barras et Fréron qui, à Marseille et à Toulon, font main basse sur les meubles et l’argenterie des ci-devant, – c’est Tallien, l’amant de la belle Teresa Cabarrus, qui vend aux aristocrates bordelais la mise en liberté, – c’est le liégeois Robert, de journaliste devenu député de Paris, et qui paie ses dettes en accaparant le rhum, – c’est le bel Hérault de Séchelles, l’ancien protégé de Marie-Antoinette, qui siège maintenant sur la Montagne et que ses collègues du Comité de Salut public soupçonnent d’être vendu à l’étranger, – c’est l’Alsacien Reubell qui a ramené de Mayence des malles pleines d’argenterie, – c’est le Lorrain Merlin de Thionville, son digne compagnon, qui mène un train princier dans son bien national du Mont-Valérien. À la liste on ajoute encore le nom de Danton, de Danton le tribun tonitruant qui depuis longtemps a rentré son tonnerre et qui s’est constitué l’ami et le protecteur de tous les parlementaires suspects, de tous ceux que j’ai nommés, Delaunay, Julien, Chabot, Basire, Fabre d’Églantine, Rovère, Barras, Fréron, Courtois, Tallien… Danton, dit le Père Duchêne, a pillé la Belgique avec son ami Delacroix, à la veille de la trahison de Dumouriez dont il a pris la défense. Danton n’a jamais rendu un compte exact des dépenses secrètes qu’il fit comme ministre de la Justice après le 10 août. Danton, qui ne possédait rien avant 1789, est devenu un riche propriétaire dans l’Aube et à Paris. Il a donné à la jeune femme qu’il vient d’épouser en secondes noces une grosse somme dans le contrat pour payer sa jeunesse.
Nous connaissons les pourris, voici maintenant les « agents de l’étranger » qu’on se désigne à l’oreille. C’est le juif bordelais Pereira, l’acteur dramatique Dubuisson, le belge Proli, le négociant en vins Desfieux qui ont été chargés de missions plus ou moins secrètes par le Comité de Salut public, quand Hérault ou Danton y faisaient encore la loi. Proli, dit-on, est le bâtard du prince de Kaunitz et par sa mère, comtesse belge qui habite Bruxelles, il continue d’entretenir des intelligences avec l’Autriche. Il habite chez Hérault qui n’a pas de secrets pour lui. Les agents de l’étranger, c’est encore les frères Frey, beau-frères de Chabot, le danois Diedrichsen qui leur sert de bras droit et qu’ils ont amené de Vienne avec eux, c’est Guzman, un grand d’Espagne déclassé qui a cherché une situation dans les troubles de la Belgique et qui fait maintenant la banque et l’intrigue, c’est le baron prussien De Trenck, célèbre par ses aventures romanesques et ses prisons, qui est venu depuis peu rédiger à Paris un journal sans lecteurs, c’est le banquier Anglais Boyd qu’on accuse de correspondre avec Pitt. C’est, derrière eux tous, le fameux baron de Batz, ancien Constituant, qui déploie au service de la famille royale une remarquable ingéniosité jointe à un sens supérieur des affaires.
Pourris et agents de l’étranger agissent de concert pour s’emparer de tous les rouages du gouvernement et de l’administration. Les pourris sont membres de tous les Comités importants, Comité de sûreté générale qui surveille les suspects, met leurs biens sous séquestre, décerne des mandats d’arrêt, Comité des marchés qui négocie avec les fournisseurs et leur délivre des mandats de paiement, Comité des finances, Comité des approvisionnements et des charrois, etc. Les personnages équivoques, qu’on soupçonne d’être des agents de Pitt et de Cobourg, ont fait des Jacobins leur quartier général. En même temps qu’ils s’emparent des places dans les ministères et dans les administrations, ils sollicitent les missions dans les départements ou à l’étranger.
Les corrompus supportent impatiemment la surveillance gênante du Comité de Salut public. Ils cherchent à le renverser et à s’y introduire. Ils l’attaquent avec énergie dès le mois de septembre. Ils sont vaincus, mais ils recommencent en novembre avec plus de machiavélisme. Ils déchaînent alors le mouvement de déchristianisation, qui ne fut qu’une savante surenchère dont le but était de permettre à ses auteurs de détourner les soupçons élevés contre leur intégrité et de se débarrasser du Comité qu’ils s’efforcèrent de faire passer pour réactionnaire parce qu’il s’opposait à la fermeture des églises et aux violences contre les prêtres.
En même temps, comme les Jacobins étaient restés fidèles au Comité et à Robespierre son chef, les « agents de l’étranger » formaient dans chaque section de la capitale une société populaire et fédéraient toutes ces nouvelles sociétés dans un comité central sur lequel ils mettaient la main. Le Comité central des sociétés populaires secondait de l’extérieur par des pétitions habiles et menaçantes, l’action des pourris dans l’Assemblée.
Le Comité de Salut public est ainsi distrait de ses immenses travaux par le souci permanent de sa propre défense. Il se sent environné d’intrigues. Il soupçonne la fidélité des agents qu’il est obligé d’employer. Il sent la trahison jusque dans son sein. Il est convaincu que les assauts qu’on dirige contre sa politique ont une origine impure. Dès le 14 septembre, ses amis font renouveler le Comité de Sûreté générale, dont sont exclus Basire, Chabot et Julien de Toulouse. Les scellés sont mis sur les papiers de Julien de Toulouse le 17 septembre. On y découvre une correspondance compromettante avec le fournisseur d’Espagnac et avec une ci-devant, la comtesse d’Abzac.
Le Comité de Salut public ne peut croire que le désir de s’enrichir soit l’unique cause des attaques perfides et réitérées dirigées contre sa politique. Il remarque que ses adversaires emploient simultanément ou successivement deux tactiques opposées. Les uns poussent aux mesures extrêmes, à la suppression du culte, à l’épuration de la Convention par l’expulsion et même le meurtre des 73 Girondins qui ont protesté contre l’insurrection du 2 juin. Il leur faut la tête de la reine et celle de Madame Elisabeth. Ils réclament la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, ce qui désarmerait la Révolution devant l’ennemi intérieur et extérieur. Ils proposent la suppression du Conseil exécutif dont les pouvoirs passeraient au Comité de Salut public, laissant à celui-ci toutes les responsabilités sans couverture. D’autres, au contraire, pleurent la mort des 22 Girondins, s’apitoyent sur les suspects dont ils sollicitent la liberté, demandent qu’à la terreur on fasse enfin succéder la clémence, réclament l’abolition des lois révolutionnaires, dénoncent journellement les patriotes énergiques.
Le Comité de Salut public soupçonne que, derrière la double opposition qui le harcèle, il y a un complot royaliste. Les ultra-révolutionnaires dépopularisent la Révolution par leurs excès. Si on les laisse faire, ils priveront la Convention de tout appui, de tout crédit dans le peuple effrayé et désemparé. En même temps les citra-révolutionnaires, les indulgents énervent tous les ressorts de l’autorité et augmentent l’audace des aristocrates en ouvrant les prisons et en persécutant les patriotes. Les deux tactiques produisent le même résultat. Quand la Convention sera avilie dans l’opinion, une journée populaire la dispersera et le dauphin sera proclamé.
Le complot royaliste est permanent. Les officiers municipaux, les gardes nationaux qui gardent le Temple ne sont pas sûrs. Le 28 février 1793, l’officier municipal Toulan conduit M. de Jarjayes au Temple auprès de Marie-Antoinette. Le 28 août, l’officier municipal Michonis introduit à la Conciergerie, où Marie-Antoinette a été transférée, le chevalier de Rougeville qui lui remit un billet caché dans un œillet. Entre ces deux dates, au début de Juillet, a été découvert un complot formé par le général Arthur Dillon, grand ami de Camille Desmoulins, pour délivrer la reine. C’est même pour déjouer le complot que Marie-Antoinette a été transférée à la Conciergerie.
Dans la situation terrible où il se débat, le Comité de Salut public s’imagine naturellement que ses adversaires à la Convention et aux Jacobins sont les auxiliaires masqués des tentatives royalistes.
Ses soupçons prirent une consistance singulière quand un des principaux parmi les députés d’affaires, quand François Chabot, sur le point d’être découvert, vint révéler, d’abord à Robespierre, ensuite au Comité de Sûreté générale, l’existence d’un grand complot, où il n’était entré, disait-il, que pour le déjouer, et quand son ami Basire vint confirmer sa dénonciation. On était juste au début du mouvement de déchristianisation, au lendemain de l’abjuration de Gobel et de la fête de la Raison : c’étaient les 25 et 26 brumaire.
Chabot et Basire dénonçaient leurs collègues Julien de Toulouse et Delaunay d’Angers comme des agioteurs qui leur avaient offert des sommes considérables pour favoriser leurs spéculations sur les compagnies financières, Compagnie des Indes, Caisse d’Escompte, Caisse d’assurances sur la vie. Pour preuve qu’il disait vrai, Chabot présentait au Comité un paquet d’assignats de 100 000 livres que Delaunay lui avait remis, disait-il, pour acheter la complaisance de Fabre d’Églantine et son silence sur un décret frauduleux réglant la liquidation de la Compagnie des Indes.
Il ajoutait que les députés corrompus n’étaient que les agents du baron de Batz qui rédigeait leurs rapports et les réunissait à sa table dans sa maison de Charonne. Le complot d’agiotage avait un but contre-révolutionnaire. En même temps qu’il corrompait les députés, Batz faisait dénoncer leur corruption par des agents qu’il avait aux Jacobins. Sa conspiration avait deux branches, une branche corruptrice et une branche diffamatrice.
Chabot et Basire répandaient le soupçon sur plusieurs jacobins de marque, sur le procureur général syndic du département de Paris Lullier, familier de Batz à les en croire, sur Dufourny, autre membre du département de Paris, qui auraient reçu 200 000 livres, insinuaient-ils, pour faire une motion contre les banquiers, sur la femme d’Hébert qui vivait en trop bons termes avec la maîtresse de Delaunay, sur Hébert lui-même contre lequel Chabot invoquait une conversation avec la ci-devant duchesse de Rochechouart, sur le peintre et député David coupable de fréquenter Delaunay, sur les chefs des sociétés populaires et particulièrement sur Proly qui avait demandé à voir Batz. Basire avait même prononcé le nom de Danton comme celui d’un homme sur lequel comptaient Delaunay et Julien. Mais dans la mise au net de sa dénonciation, il raya les phrases accusatrices.
Le but des conjurés était de semer la division parmi les Montagnards et de les conduire à l’échafaud les uns après les autres par des dénonciations vraies ou fausses. Quand la Convention serait affaiblie, décapitée de ses chefs, déconsidérée dans l’opinion, une journée sectionnaire la disperserait.
La dénonciation de Chabot et de Basire eut un retentissement énorme. Elle exerça sur la suite des évènements l’action la plus considérable. Elle donna corps aux soupçons qui flottaient dans l’air. Elle accrut les défiances, exaspéra les divergences politiques entre les Montagnards, juste au moment où commençaient la campagne d’Hébert contre les Indulgents et la campagne du Vieux Cordelier contre les Exagérés. Elle empoisonna les relations des députés, détruisit tout abandon, fit planer sur toutes les paroles, sur tous les actes des arrière-pensées scélérates, des calculs profonds. Elle rendit l’air de la Montagne irrespirable. Elle est à l’origine de tous les drames qui vont se succéder.
Les Comités de Salut public et de Sûreté générale arrêtèrent d’abord les dénoncés et les dénonciateurs, Basire et Chabot, Delaunay et Julien. Julien s’échappa, mais Delaunay alla rejoindre Chabot et Basire au Luxembourg transformé en prison.
L’occasion était bonne de se débarrasser des chefs des sociétés populaires qui portaient ombrage au gouvernement et aux Jacobins, Proly, Dubuisson, Pereira, Desfieux, Frey, Diedrichsen d’autres encore furent mis sous les verrous. L’enquête se poursuivit longuement pendant plusieurs mois avec des soubresauts et des revirements. Fabre d’Églantine, qui avait d’abord été adjoint au Comité de Sûreté générale pour poursuivre l’instruction de l’affaire, fut arrêté à son tour après la découverte chez Delaunay de la minute du faux décret réglant la liquidation de la Compagnie des Indes. Hérault de Séchelles, protecteur de Proly, est arrêté peu après. Puis c’est le tour des chefs hébertistes. Considérés comme faisant partie de la branche diffamatrice de la conspiration, ils ne tardent pas à rejoindre en prison les pourris qu’ils ont dénoncés. Danton et Camille Desmoulins, déjà très compromis par leurs liaisons, commettent l’imprudence de prendre la défense de Basire et de Chabot et de demander qu’ils soient entendus devant la Convention. Ils sont considérés comme leurs complices et jetés comme eux en prison. Les Comités frappent à droite et à gauche sur les deux branches de la conspiration, qu’ils élargissent sans cesse au point d’y comprendre tous leurs adversaires.
Robespierre et Saint-Just partirent de la dénonciation de Chabot et de Basire pour systématiser le plan de contre-révolution qu’elle avait révélé. Il n’est pas vrai qu’ils se soient servis des Dantonistes contre les Hébertistes et réciproquement. La vérité, c’est qu’ils attaquèrent de front les deux factions qui, pour eux, n’en faisaient qu’une. À la grande séance du 18 nivôse aux jacobins, Robespierre résumait sa pensée en ces termes : « Deux espèces de factions sont dirigées par le parti étranger. Voici comme ils raisonnent : tous moyens sont bons pourvu que nous parvenions à nos fins. Ainsi, pour mieux tromper le public et la surveillance du patriotisme, ils s’entendent comme des brigands dans une forêt. Ceux qui sont d’un génie ardent et d’un caractère exagéré proposent des mesures ultra-révolutionnaires : ceux qui sont d’un esprit plus doux et plus modéré proposent des moyens citra-révolutionnaires. Ils se combattent entre eux ; mais que l’un ou l’autre soit victorieux, peu leur importe ; comme l’un ou l’autre système doit également perdre la République, ils obtiennent un résultat également certain, la dissolution de la Convention nationale ». Saint-Just, un mois après, le 23 ventôse, dans son rapport contre les hébertistes, disait de même : « La faction des indulgens qui veulent sauver les criminels et la faction de l’étranger qui se montre hurlante parce qu’elle ne peut faire autrement sans se démasquer, mais qui tourne la sévérité contre les défenseurs du peuple, toutes ces factions se retrouvent la nuit pour concerter leurs attentats du jour ; elles paraissent se combattre pour que l’opinion se partage entre elles ; elles se rapprochent ensuite pour étouffer la liberté entre deux crimes ».
Robespierre et Saint-Just ne faisaient qu’exprimer en un raccourci saisissant l’opinion générale des milieux patriotiques. Ils étaient de bonne foi.
La conspiration permanente de l’étranger ne fut pas anéantie par la double exécution des Dantonistes et des Hébertistes. Elle dura autant que la Terreur elle-même. Toutes les conspirations qui viennent successivement échouer au tribunal révolutionnaire, la conspiration des prisons où sont mélangés la veuve d’Hébert et la veuve de Camille Desmoulins, le général Arthur Dillon et le constituant Thouret, l’affaire Cécile Renault et Amiral terminée par le fameux procès des chemises rouges, le 9 thermidor lui-même sont présentés par les Comités et par Fouquier-Tinville comme des accès d’une seule et même maladie qui reparaît sans cesse et que la guillotine est impuissante à guérir. Cette maladie s’appelle Corruption et Contre-révolution.
Telle est la thèse des Comités de gouvernement, la thèse Robespierriste. Il serait naïf de l’accepter telle quelle. Ses outrances sont manifestes. Un robespierriste aussi convaincu que Buonarroti ne l’a acceptée lui-même que sous réserves. Il consent que les Dantonistes aient été en majorité des corrompus mais il proteste que les hébertistes n’étaient pas des agents de l’étranger. Ils furent seulement leurs dupes.
Vous comprenez maintenant, Mesdames et Messieurs, les raisons qui m’ont déterminé à traiter devant vous ce sujet : La Corruption parlementaire sous la Terreur. Ce n’est pas une vaine curiosité qui m’a poussé, mais la conviction que les problèmes les plus troublants de cette époque terrible ne peuvent se résoudre et même se comprendre qu’en changeant de point de vue pour les aborder, que si on les examine non plus seulement du point de vue politique, mais du point de vue moral.
Les Montagnards qui gouvernaient se défiaient de tous et se défiaient d’eux-mêmes. Ils voyaient la trahison les envelopper. Ils vivaient dans le soupçon et dans la crainte. Pour juger les hommes, ils n’avaient qu’un criterium, qu’une pierre de touche, la valeur morale, la vertu. Critérium fragile qui les exposa hélas ! à bien des erreurs. Ils prirent souvent l’apparence pour la vertu.
Mais si nous voulons, nous, qui les jugeons dans le lointain du temps en toute sérénité d’esprit, si nous voulons leur être équitables, tâchons de les comprendre, tâchons de nous remettre à leur place, posons-nous les mêmes questions qu’ils se sont posées, ces questions terribles que le salut de la France leur faisait un devoir de résoudre sur l’heure.
Nous nous demanderons donc, dans les leçons qui vont suivre, si réellement il y avait dans la Convention ou plutôt dans la Montagne des députés d’affaires, s’ils formaient un parti ou du moins une bande, un syndicat, comme nous dirions, si ces pourris étaient vraiment en rapports avec l’étranger, si les Comités de gouvernement avaient raison de soupçonner la trahison, si les conspirations dont la Terreur est pleine n’ont existé que dans le cerveau surchauffé de ceux qui les ont dénoncées et châtiées.
Je ne me flatte pas, Mesdames et Messieurs, de dissiper toutes les obscurités, de répondre à toutes les questions. La vérité historique est toujours difficile à découvrir. Pour des périodes aussi troublées, aussi tragiques, la difficulté est encore bien plus grande.
L’enquête à laquelle je me suis livré n’est d’ailleurs pas terminée. Il me reste de longues recherches à faire dans les archives françaises et étrangères. Si je n’avais consulté que moi-même, je n’aurais pas osé vous apporter dès cette année les conclusions fragmentaires et décousues auxquelles je serai forcément réduit, j’aurais ajourné à plus tard ce cours public dont la préparation est, je dois le dire, insuffisante. Vous me pardonnerez, Mesdames et Messieurs, d’avoir cédé à d’amicales instances et d’avoir peut-être trop présumé de mes forces.
Quelle naïveté de croire qu’un tel homme ait reçu de l’argent de la Cour !
A. Aulard. Études et leçons, I.
C’était une sorte d’article de foi chez les républicains des générations héroïques que Danton, le Mirabeau de la populace comme on l’appelait, avait été un homme d’argent, un homme de plaisir accessible à toutes les séductions. Thiers et Mignet, Buchez et Roux, Louis Blanc et Laponneraye, Esquiros et Hauréau, sans parler de Lamartine et de Victor Hugo, admettent qu’il a été payé par la Cour et Michelet lui-même ne repousse pas l’inculpation.
Les contemporains appartenant aux opinions les plus diverses, Mirabeau et Brissot, Mme Roland et Robespierre, Saint-Just et Paganel, lord Holland et Garat, La Révellière-Lépeaux et Lafayette, Buonarroti et Bertrand de Moleville, Malouet et Barère, Rœderer et Mme Cavaignac, sont unanimes à considérer comme une chose prouvée, comme une vérité courante que Danton accepta l’argent de la liste civile et du duc d’Orléans, qu’il tripota en Belgique, s’entoura d’hommes véreux et reçut de toutes mains pour payer ses dettes, entretenir ses maîtresses et s’enrichir.
Les contemporains ne pouvaient pas oublier que, même sous la Convention thermidorienne, les amis de Danton n’avaient pas osé prendre sa défense. Le II vendémiaire an IV, un mois avant de se séparer, la grande Assemblée avait célébré une fête funèbre en l’honneur des « victimes de la tyrannie décemvirale ». Sur la proposition du Girondin Hardy, elle décida ce jour-là de réhabiliter la mémoire de ceux de ses membres qui avaient péri « dans les prisons, dans les forts ou sur les échafauds » ou « qui avaient été réduits à se donner la mort ». La liste officielle de ces victimes honorées et regrettées par l’Assemblée comprend 48 noms. Les Girondins y figurent et même le député de l’Aube Perrin, condamné pour concussion à dix ans de fers et mort au bagne. Camille Desmoulins et Philippeaux y figurent aussi. Mais on y cherche en vain les noms de Chabot, de Basire, de Delaunay d’Angers, de Fabre d’Églantine et de Danton. Personne ne se leva dans l’Assemblée pour réparer ces omissions. C’est donc que, pour les conventionnels, Danton était un de ces députés d’affaires, un de ces pourris, comme on disait d’un mot énergique, qui avaient trafiqué de leur mandat au cours de ces fructueuses opérations qui s’appelaient la démonétisation des assignats à face royale, l’arrestation des banquiers, la suppression des compagnies financières, la liquidation de la Compagnie des Indes, etc.
Ce n’est que dans le dernier quart du dernier siècle, à une époque où les souvenirs des hommes et des choses de la Révolution étaient déjà passablement obscurcis, que la mémoire de Danton a trouvé des défenseurs, d’abord dans la petite église positiviste qui le considérait avec les yeux de la foi comme un précurseur authentique de son fondateur Auguste Comte, ensuite parmi certains hommes politiques, fortement imbus eux aussi de l’esprit positiviste et heureux de prendre pour modèle et d’invoquer comme un précédent un tribun si habile et si souple qu’on pouvait le considérer comme le véritable créateur de l’opportunisme et comme un virtuose de l’adaptation.
Il semble aujourd’hui que Danton ait cause gagnée. La ville de Paris lui a élevé en 1891 une statue, parce qu’il fut l’homme de la défense nationale. Cette statue nous consolait un peu de nos revers de 1870. En magnifiant Danton, il semblait qu’on magnifiait Gambetta. Les manuels scolaires de nos jours sont pleins de louanges enthousiastes à l’adresse du « grand Français », du « grand républicain », du « grand homme d’État », etc. Robespierre, au contraire, qui n’a pas encore de statue, même à Arras, est représenté comme un homme d’ancien régime qui tenait encore aux prêtres. L’École laïque triomphante ne pouvait pardonner à l’Incorruptible l’Être suprême.
La Révolution française, qui s’incarnait pour les démocrates d’autrefois dans le groupe robespierriste, tourne aujourd’hui autour des Dantonistes. L’axe de cette histoire a été déplacé.
Devons-nous croire que nos modernes professeurs, hommes politiques et journalistes, sont mieux informés des choses et des hommes de la Révolution que ne l’étaient les révolutionnaires eux-mêmes et leurs successeurs immédiats, les républicains de 1830 et de 1848 ?
Le positiviste docteur Robinet, que M. Aulard lui-même au cours d’une polémique qualifia d’esprit religieux dénué de tout sens critique, a prétendu laver Danton de tout soupçon de vénalité dans un volume de trois cents pages intitulé Mémoire sur la vie privée de Danton. Jusqu’à présent, personne n’a examiné de près cet ouvrage, qui est une apologie et ses conclusions sont parole d’évangile.