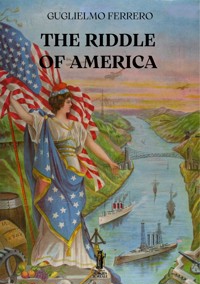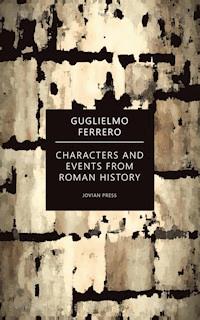Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"La Guerre européenne de Guglielmo Ferrero est un ouvrage incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Publié pour la première fois en 1914, ce livre offre une analyse approfondie et nuancée des causes et des conséquences de la Première Guerre mondiale.
Ferrero, historien et politologue italien renommé, examine les tensions politiques, économiques et sociales qui ont conduit à l'éclatement du conflit en Europe. Il explore également les rivalités entre les grandes puissances, les alliances complexes et les erreurs diplomatiques qui ont alimenté la montée des tensions.
Ce qui distingue La Guerre européenne, c'est la capacité de Ferrero à présenter une vision globale de la guerre, en tenant compte des différents acteurs et en analysant les conséquences à long terme sur l'Europe et le monde. Il met en lumière les bouleversements politiques et sociaux qui ont suivi la guerre, notamment l'émergence de nouveaux États et les changements de frontières.
En plus de son analyse rigoureuse, Ferrero offre également des réflexions profondes sur la nature de la guerre et de la violence humaine. Il soulève des questions essentielles sur la responsabilité des dirigeants politiques et la fragilité des institutions internationales.
La Guerre européenne est un livre essentiel pour comprendre les racines de la Première Guerre mondiale et ses répercussions durables sur l'Europe et le monde. Il offre une perspective unique et éclairante sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire contemporaine.
Extrait : ""Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie remettait à la Serbie la note qui a provoqué la guerre. Cette note produisit l'impression la plus profonde dans toute l'Europe. Elle sembla très grave non seulement par les demandes qu'elle contenait, mais aussi par le délai extrêmement court qu'elle concédait à la Serbie pour y répondre."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016390
©Ligaran 2015
Si on compare la guerre européenne aux guerres qui l’ont précédée, elle semble un drame incompréhensible et presque absurde dans son immensité. Ses origines et son développement ne répondent en rien à l’idée que les hommes s’étaient faite d’un conflit armé entre les grands États de l’Europe. Comment la guerre a pu éclater, c’est déjà une première énigme. Il est évident que le peuple qui a pris l’initiative de cette fabuleuse aventure, était celui qui avait le plus grand intérêt à conserver la paix du monde. Pourquoi a-t-il voulu jouer toute sa fortune sur un coup de dés si hasardeux ? Depuis dix-huit mois le monde reste perplexe devant ce problème ; et il se demande s’il ne doit pas croire à un accès de folie, dont tout un peuple aurait été saisi ; singulier aboutissement des efforts accomplis depuis un siècle pour faire de la raison la force souveraine de l’histoire !
Le développement de la guerre n’a pas moins surpris les esprits que ses origines. Les prévisions les plus sérieuses et les plus autorisées ont été brutalement démenties par les faits. On s’attendait à une guerre très violente mais courte ; on disait que les ressources de l’Europe s’épuiseraient rapidement et que les pays industriels ne pourraient tenir plus de trois mois ; on prévoyait toute sorte de difficultés politiques… Depuis dix-huit mois tous les États belligérants ont gagné et perdu plus de batailles qu’il n’en aurait fallu autrefois pour conclure dix traités de paix ; et la guerre continue, acharnée, impitoyable. On dirait que les victoires et les défaites ne font plus sur les belligérants l’effet qu’elles faisaient dans les guerres précédentes. La résistance économique n’a pas moins étonné que la résistance morale. On serait parfois tenté de dire que l’état des choses qui nous semblait, il y a deux ans, devoir être le plus anormal, est devenu presque normal.
Mais la plus singulière surprise de la guerre, c’est le changement qu’elle a fait, en quelques semaines, dans les idées et dans les sentiments. Si la guerre n’a pas encore bouleversé la carte de l’Europe, elle a complètement changé son état d’âme. Chacun de nous n’a qu’à se rappeler comment il voyait son pays, l’Europe, le monde, la vie et ses devoirs dans la première moitié de 1914 et à comparer ce qu’il pensait alors avec ce qu’il pense à présent. Quelle différence ! Combien les temps avant la guerre nous semblent éloignés ! Il n’y a pas une personne, médiocrement habituée à la réflexion, qui n’ait aujourd’hui le sentiment d’avoir vécu la première partie de son existence dans l’illusion et dans l’erreur, et d’avoir été réveillée brusquement à la vérité par une violente secousse.
Le plus surprenant de tous les revirements auxquels nous avons assisté est celui qui concerne les deux antagonistes principaux de cette lutte gigantesque : la France et l’Allemagne. Il n’est point douteux que, pendant les dix ans qui ont précédé la guerre européenne, l’Allemagne avait beaucoup monté dans l’opinion du monde, tandis que la France baissait. Partout le courant germanophile gagnait du terrain irrésistiblement. De plus en plus, toutes les classes, toutes les professions, tous les partis s’accordaient, en Europe et en Amérique, à reconnaître dans l’Allemagne un grand modèle. L’industrie, le commerce, la banque, la science, l’école, l’armée, la marine marchande, la marine de guerre, beaucoup d’institutions sociales de l’Allemagne étaient l’objet d’une admiration croissante dans tout le monde. À peine osait-on remarquer que la diplomatie du puissant empire n’était pas toujours adroite, que les attitudes de l’empereur étaient souvent peu sérieuses, que l’industrie et le commerce allemands cherchaient à se développer à l’aide d’expédients compliqués et laborieux. Très souvent on finissait même par trouver, dans ces critiques de détails, l’occasion de nouveaux éloges du peuple. Si le gouvernement avait des faiblesses, le peuple était admirable ! Dans tous les domaines de l’activité humaine, il donnait un effort prodigieux ! Même les partis révolutionnaires, qui pourtant ne pouvaient pas avoir une sympathie bien vive pour les institutions féodales de l’Allemagne, étaient devenus plus ou moins germanophiles. L’organisation du parti socialiste et sa force apparente, la loi des retraites ouvrières, les efforts faits par le gouvernement et les municipalités pour résoudre le problème des habitations populaires et pour assurer aux masses des conditions hygiéniques d’existence, avaient touché les cœurs révolutionnaires les plus endurcis. À leur tour les classes conservatrices admiraient l’Allemagne comme le dernier pays de l’Europe où l’État ne tremblait pas encore devant ceux auxquels il doit commander. L’admiration pour l’Allemagne était devenue si grande, qu’on comptait sur elle pour tout, même pour la conservation de la paix. Le 30 juillet 1914 il y avait encore en Europe des hommes d’État, aussi inexpérimentés que naïfs qui croyaient que la guerre n’éclaterait pas, parce que l’Allemagne était le gardien fidèle de la paix.
Au contraire une méfiance croissante entourait la France. Sans doute on s’accordait à reconnaître aux Français l’intelligence, la culture, le goût, en général les qualités agréables et brillantes ; mais on leur déniait les qualités solides et sérieuses : l’énergie, la persévérance, l’audace, l’ampleur de vues nécessaires aux entreprises de grande envergure. Parcimonieuse, prévoyante, prudente jusqu’à la timidité, déchirée par les luttes religieuses et politiques, affaiblie par les idéologies démocratiques, la France semblait un pays de petite industrie, de fortunes moyennes, de routine, destiné à s’effacer de plus en plus devant des rivaux mieux doués. On lui reprochait d’être un pays arriéré, malgré toutes les révolutions qu’elle avait faites. On reconnaissait qu’elle était très riche, mais on attribuait ses richesses tant enviées à la faiblesse de l’esprit d’initiative, qui portait la France à économiser, comme si les pièces d’or tombaient du ciel sur ce sol privilégié pour y être ramassées par un peuple d’heureux fainéants ! On la considérait encore, après tant d’années, comme le grand danger de la paix européenne, à cause de ses aspirations inassouvies à une revanche impossible, mais on était en même temps persuadé que sa puissance militaire avait été détruite par la richesse, les plaisirs, l’antimilitarisme, l’esprit démocratique et la désorganisation incurable de l’armée. Il y avait entre ces deux reproches une contradiction évidente, mais l’Europe ne semblait pas s’en apercevoir. On répétait partout, en même temps, que la France voulait la guerre et qu’elle ne savait plus la faire.
Combien de fois ai-je discuté ces questions passionnantes en Europe, en France même, et pendant mes voyages dans les deux Amériques ! Mais tous les arguments se brisaient contre une espèce de méfiance invincible. Il a fallu la guerre européenne – rien moins qu’un cataclysme historique – pour convertir les esprits endurcis dans l’erreur ! Le revirement a été si brusque et si complet, qu’il ne faut pas s’étonner si beaucoup de convertis ont fini par croire que ce n’était pas leur opinion qui avait changé, mais la France, et qu’un miracle s’était produit !
Comment s’expliquent tous ces phénomènes singuliers ? Les lois qui régissent le monde des idées et des passions ont-elles tout à coup changé en Europe, en bouleversant la stratégie et la politique, les mœurs et les besoins ? C’est peu vraisemblable. Il y a un moyen plus simple d’expliquer toutes ces surprises : c’est de se convaincre que la guerre européenne n’est pas seulement une guerre dans le sens précis du mot, c’est-à-dire un simple conflit armé entre plusieurs États, déterminé par une lutte d’intérêts politiques ou économiques bien définis. La guerre européenne est aussi un conflit armé entre États, et le plus sanglant des conflits ; mais elle est en outre quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus complexe : une de ces grandes crises de l’histoire, qui de temps en temps bouleversent une partie du monde et modifient profondément la marche des civilisations ; une des crises par lesquelles se dénouent violemment les difficultés accumulées peu à peu par les erreurs, les imprévoyances, les mauvaises passions, les intérêts égoïstes de plusieurs générations.
Ce livre a été écrit justement pour démontrer que la guerre européenne est une de ces crises ; qu’elle a pris pour le moment la forme de la plus immense et de la plus sanglante entre les guerres ; mais que ses causes sont beaucoup plus profondes et compliquées, que ses conséquences seront beaucoup plus grandes et inattendues que celles des autres guerres. Le livre se compose de plusieurs études, qui furent publiées séparément, sauf celle sur l’Italie dans la guerre européenne qui est inédite ; et de trois discours, dont le premier fut prononcé avant la guerre et les deux autres après. Mais il devrait néanmoins présenter les caractères d’une œuvre pourvue d’unité ; car toutes ces études et ces discours ne font qu’appliquer à la guerre européenne, sous des formes différentes et à des points de vue divers, certaines idées qui, bonnes ou mauvaises, avaient été conçues et exposées avant la guerre. Le cours de l’histoire aurait, d’après ces idées, changé depuis deux siècles beaucoup plus que ne le supposent ceux qui ont une connaissance trop superficielle des civilisations anciennes. Les principes sur lesquels l’ordre social était fondé depuis le commencement de l’histoire ont été presque tous retournés par la plus audacieuse des révolutions, entre autres la grande conception pessimiste de la nature humaine de laquelle s’étaient inspirées presque toutes les religions, les philosophies et les législations du passé. Une fois admis que la nature humaine était mauvaise, les civilisations anciennes et le christianisme en avaient déduit qu’il fallait se méfier d’elle, la surveiller, multiplier les freins et les limites autour de ses instincts pervers, surtout en dompter l’orgueil et la cupidité. Un optimisme exalté réussit au contraire, pendant le XVIIIe et le XIXe siècle, à convaincre une partie de l’humanité que la nature humaine en elle-même était bonne, que délivrée de toutes les entraves dont l’avaient entourée la méfiance des lois et des religions, abandonnée à ses instincts, elle s’améliorerait continuellement et créerait autour d’elle, par une espèce de nécessité intérieure, le bonheur.
Encouragée par les grands évènements politiques de la fin du XVIIIe siècle, par les découvertes de la science, le développement de la grande industrie et l’augmentation de la richesse, notre époque a tiré de cette doctrine la grande idée qui domine aujourd’hui l’Europe et l’Amérique : l’idée du progrès. Le monde progresse ; et le principal devoir des peuples et des États est de le faire progresser le plus rapidement et dans la plus large mesure possible. Mais l’idée du progrès, tout en agissant avec une grande force sur les esprits, est restée toujours vague et imprécise. Notre époque n’aurait pu la définir avec précision, qu’en partant d’une doctrine claire du bien et du mal. Un siècle comme le nôtre, qui a affaibli toutes les autorités politiques, intellectuelles et morales, qui a été sans cesse troublé par tant de luttes politiques, religieuses, intellectuelles et économiques, presque toutes restées inachevées ; qui a voulu tant de choses contradictoires, ne pouvait pas créer cette doctrine. La France a fait de grands efforts, après la Révolution, pour créer une théorie du progrès qui mettrait l’ordre dans le monde et donnerait le bonheur aux hommes. Ces efforts n’ont pas peu contribué aux évènements de 1848, dont mon ami Henry Moysset donnera à la France, je l’espère, après la guerre, la grande histoire. Mais même ces efforts ne réussirent pas à tirer ce mot de la nuageuse imprécision dans laquelle les hommes aimaient à l’adorer. Faute d’une doctrine plus élevée et plus précise, l’Europe et l’Amérique ont fini, suivant la loi du moindre effort, par se contenter de la définition la plus simple, la plus facile et la plus grossière, d’une définition purement quantitative qui faisait consister le progrès dans l’accroissement de la richesse et dans le perfectionnement des machines qui la produisent.
C’est cette idée purement quantitative du progrès qui a dominé entièrement les esprits dans les derniers trente ans. C’est cette idée qui a été la force et la ruine de l’Allemagne, en même temps qu’une des causes profondes de la catastrophe actuelle. Pour quelle raison a-t-on tellement admiré l’Allemagne pendant les derniers vingt ans ? Parce que l’Allemagne était le pays de l’Europe où le prodigieux pullulement de la population se traduisait plus rapidement en un développement vertigineux de l’industrie, du commerce et de la richesse. La population se multipliant rapidement sur un sol étroit mais très riche en charbon, l’Allemagne avait pu et su devenir, en trente ans, la première puissance métallurgique de l’Europe et la seconde du monde. Le développement de la métallurgie avait eu comme conséquence le développement rapide d’un grand nombre d’autres industries et de tous les services publics dont le fer est l’élément principal. Le pays avait été couvert de chemins de fer et d’usines de toute espèce ; l’armée avait été augmentée sans cesse ; on avait créé en peu d’années une énorme marine marchande et la seconde flotte de guerre du monde ; presque toutes les villes avaient grandi et avaient été reconstruites ; la richesse du pays augmentait réellement chaque année, mais elle semblait s’accroître davantage, parce que la vitesse de la circulation augmentait avec sa masse. Et le monde, dominé par l’idée quantitative du progrès, concluait que l’Allemagne représentait la jeunesse et le progrès.
Pour la même raison, la France était la vieillesse et la décadence. Ce qui avait surtout nui à la France, c’était la lenteur du développement, qui se rattachait au phénomène démographique opposé. Sur beaucoup de statistiques, la France, qui occupait il y a quarante ans la première ou la seconde place, était descendue à la troisième ou à la quatrième. Le fait était inévitable, étant donné que la population n’avait pas augmenté, tandis qu’elle avait augmenté dans d’autres pays. Il est même étonnant que la France ait réussi, avec une population stationnaire, à développer un certain nombre d’industries, comme elle l’a fait dans les derniers quarante ans. Mais le monde ne s’attardait pas à des réflexions de cette espèce ; il constatait que dans certaines statistiques la France avait été dépassée par d’autres peuples, et hochait la tête en prononçant le mot « décadence ». À des esprits ainsi prévenus, toutes les manifestations particulières de la vie française semblaient des phénomènes de décomposition et des symptômes du désordre moral ; surtout les luttes politiques et religieuses, qui pourtant ont été très vives en France dans toutes les époques, même dans les plus florissantes.
En même temps qu’elle inspirait à notre époque des jugements très superficiels sur la valeur des peuples et des civilisations, cette doctrine du progrès exaltait la passion, que les religions d’autrefois avaient redoutée comme une des plus dangereuses : l’orgueil. Fidèle à sa théorie optimiste de la nature humaine, notre époque ne s’est point méfiée de l’orgueil humain ; elle en a fait au contraire une des grandes forces motrices de la civilisation contemporaine ; elle a encouragé tous les peuples à se croire les premiers du monde et à ambitionner une supériorité universelle, à mesure que leurs richesses augmentaient, que leur outillage industriel se perfectionnait et qu’ils se persuadaient de progresser. Les peuples de l’Europe ont fait de grandes choses sous l’aiguillon de l’orgueil exalté ; mais ils ont aussi peu à peu délaissé les autels des vieux Dieux auxquels les hommes d’autrefois attachaient de temps en temps quelques couronnes : l’Honneur, la Justice, la Foi, la Pitié. Et nul peuple n’est devenu aussi orgueilleux que le peuple qui s’était imaginé d’être le modèle de l’univers parce qu’il avait réussi à fabriquer chaque année plus de 15 millions de tonnes de fer et à remplir le monde d’une quantité presque incalculable d’objets de qualité inférieure ! Mais l’orgueil allemand, sur lequel M. Maurice Muret a écrit un livre si pénétrant, a été une des causes principales du grand conflit. C’est l’orgueil qui a fait croire au peuple allemand qu’il aurait droit à dompter l’Europe et à s’imposer au monde par tous les moyens, depuis la ruse et la perfidie jusqu’au fer, au feu et aux gaz asphyxiants ; c’est l’orgueil qui lui a donné la fatale confiance de réussir en quelques mois à réaliser son rêve chimérique.
Il a donc semblé à l’auteur qu’il pourrait, dans une série d’écrits différents, appliquer ces idées aux évènements dont nous sommes témoins, sans mériter le reproche d’avoir recueilli des études fragmentaires ni de parler sur le plus grave des sujets qui puissent aujourd’hui attirer l’attention, d’après des points de vue improvisés. Il est vrai que ces réflexions peuvent paraître un peu trop théoriques, dans les circonstances présentes. Elles le sont pourtant moins qu’il ne semble. Cette crise exige de tout le monde un grand esprit de sacrifice et une grande patience. Tout ce qui sert à soutenir la force morale des peuples n’est donc pas inutile. Or un certain nombre d’esprits au moins pourront puiser dans des réflexions de cette espèce l’énergie, la persévérance, la sérénité qui sont nécessaires dans la terrible époque où nous vivons. La guerre européenne est sans doute bien longue, si on la compare aux grandes guerres du XIXe siècle. Mais qui pourra encore s’étonner de sa longueur et des cruels sacrifices qu’elle impose, si on pense que cette guerre est une grande crise historique, produite, comme toutes les grandes crises, par les imperfections intellectuelles et morales de notre civilisation ? Que l’Europe expie en ce moment les erreurs et les fautes d’un siècle ? Que nous souffrons non seulement pour rétablir la paix entre les grands États de l’Europe, mais pour résoudre un certain nombre de problèmes essentiels, desquels dépend la destinée même de notre civilisation ?
De même les surprises futures de la guerre trouveront mieux préparés ceux qui se seront rendu compte que nous vivons au milieu d’une immense crise historique. La guerre a été une suite ininterrompue de surprises agréables ou désagréables pour tous les belligérants. Il est fort possible que la série n’en soit point épuisée, et que même la paix ne sera que la dernière et la plus agréable des surprises que cette crise nous ménage. Si la guerre européenne a été si différente des guerres qui l’ont précédée par son développement, elle pourrait aussi leur ressembler peu dans sa fin. Il est évident d’ailleurs que le mot paix aura une signification toute spéciale dans le cas présent. Dans les guerres qui sont de simples conflits armés entre États pour des intérêts bien définis, la paix signifie surtout la fin des hostilités et la résolution, provisoire ou définitive, d’une ou de plusieurs questions données. Dans le cas présent elle signifiera aussi le commencement d’un immense travail de réorganisation et de reconstruction. L’Europe dans laquelle nous sommes nés est en grande partie croulée. Les traités d’alliance, les traités de commerce, les principes politiques et juridiques, l’organisation de l’industrie et de la banque, les traditions historiques, les conventions sociales, les rapports entre les États, les peuples, les classes, tout a été détruit, suspendu, bouleversé, retourné. La paix posera des problèmes formidables, dont la solution se rattache en partie au bouleversement produit par la guerre, en partie aux causes profondes qui ont engendré la catastrophe. Se rendre compte de ces causes profondes, c’est se préparer à la tâche de demain, qui ne sera pas moins difficile que celle d’aujourd’hui.
Turin, 1er février 1916.
G.F.
Cette étude fut publiée dans la Revue des deux Mondes du 15 décembre 1914, sous le titre : Le conflit européen d’après les documents diplomatiques. Elle a été retouchée, pour y introduire des documents tirés du Livre Rouge austro-hongrois, qui n’avait pas encore paru, à la fin de 1914. Les recueils de documents diplomatiques qui ont servi pour cette étude sont les suivants :
a) Le Livre blanc allemand, dans la traduction anglaise publiée par le gouvernement impérial, sous le titre : The German White Book. The only authorised translation, Liebheit et Thiessen, Berlin.
b) Les trois White papers publiés par le gouvernement anglais : c’est-à dire le Miscellaneous N° 6 (1914) [ Ed 7467 ] ; le Miscellaneous N° 8 (1914) [ Ed 7445 ], le Miscellaneous N° 10 (1914) [ Ed 7596 ]. Le gouvernement anglais les a recueillis dans une brochure, Great Britain and the European crisis, en les faisant précéder par une exposition historique des évènements qui ont abouti à la guerre européenne. C’est cette brochure qui est citée dans l’étude, avec le signe Great Br.
c) Le Livre Orange, publié par le gouvernement russe, sous le titre : Recueil de documents diplomatiques. Négociations ayant précédé la guerre, Petrograd, imprimerie de l’État.
d) Le Livre Jaune, publié par le gouvernement français sous le titre Documents diplomatiques. La guerre européenne, Paris, Imprimerie nationale.
e) Le Livre Rouge publié par le gouvernement austro-hongrois. On a utilisé la traduction italienne faite par les soins du gouvernement.
Le 23 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie remettait à la Serbie la note qui a provoqué la guerre. Cette note produisit l’impression la plus profonde dans toute l’Europe. Elle sembla très grave non seulement par les demandes qu’elle contenait, mais aussi par le délai extrêmement court qu’elle concédait à la Serbio pour y répondre. L’intention de remporter par surprise un grand succès diplomatique sur la Serbie et sur la Russie parut d’autant plus évidente que le gouvernement autrichien avait cherché à faire croire aux Puissances de la Triple Entente que la note serait conciliante et modérée. Mais si la surprise ne réussissait pas, si la Russie refusait d’abandonner la Serbie à son sort, l’Europe ne serait-elle pas exposée au danger d’une guerre générale ? Le 24 juillet, Sir Edward Grey le dit très clairement à l’ambassadeur d’Autriche, qui était venu lui remettre le document. Tout en reconnaissant que, dans la question de l’assassinat de l’archiduc, l’Autriche-Hongrie avait droit à la sympathie des autres pays, Sir Edward Grey déclara qu’il n’avait pas encore vu un État indépendant adresser à un autre État indépendant un document of so formidable a character. Il ajouta que l’Angleterre pourrait se désintéresser du conflit, tant qu’il resterait limité à l’Autriche et à la Serbie ; mais que, si la Russie venait, elle aussi, à y être impliquée, l’Angleterre chercherait à se mettre en communication avec les autres Puissances, pour voir ce qu’on pourrait faire. Le même jour, avant de voir l’ambassadeur d’Allemagne, Sir Edward Grey exposa ce point de vue à l’ambassadeur de France et précisa avec lui ses projets d’action. Il s’agissait de proposer à la France, à l’Allemagne et à l’Italie de se joindre à l’Angleterre pour agir ensemble et en même temps à Vienne et à Saint-Pétersbourg, – la capitale de la Russie s’appelait encore de ce nom, à cette époque, – dans un sens favorable à la paix. M. Cambon approuva ; mais il fit la remarque qu’il était impossible d’agir à Saint-Pétersbourg avant que la Russie eût manifesté une opinion ou accompli une action quelconque. Or le délai accordé par l’Autriche était si court qu’il devenait presque impossible d’arranger les choses avant son expiration ; et si, à l’expiration du délai, l’Autriche déclarait la guerre à la Serbie, la Russie serait obligée par l’opinion publique à agir. La chose la plus urgente à faire était donc de convaincre l’Autriche de la nécessité d’accorder un prolongement du délai ; et il n’y avait qu’une Puissance capable d’obtenir cette concession de l’Autriche, c’était l’Allemagne. Ces remarques semblèrent justes à Sir Edward Grey, qui en tint compte dans la conversation qu’il eut ce jour même avec l’ambassadeur d’Allemagne. Il lui dit que, si les relations entre la Russie et l’Autriche prenaient un caractère menaçant, il ne voyait d’autre moyen de sauver la paix qu’une intervention des quatre Puissances à Vienne et à Saint-Pétersbourg. Il ajouta que, pour le moment, il était urgent de convaincre l’Autriche de n’accomplir aucun acte décisif après l’expiration du délai ; et il pria le gouvernement allemand de vouloir bien se charger de cette tâche.
Ainsi, le 24 juillet, à peine la crise ouverte, l’Angleterre avait entamé son œuvre de paix, en cherchant à s’assurer l’appui de l’Allemagne en vue d’une action commune. Que faisaient, pendant cette même journée, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie ? Le gouvernement allemand a toujours affirmé qu’il n’avait pas connu la note autrichienne avant sa publication et qu’il avait été, tout comme les Puissances de la Triple Entente, surpris par l’action de son alliée. Il faut reconnaître qu’aucun document n’a contredit, jusqu’à présent, d’une manière décisive, cette affirmation. Il est tout de même surprenant que, s’il n’avait pas été mis au courant par l’Autriche de ce qui allait se passer, le gouvernement allemand ait pu déjà, le 23, le jour même où l’ultimatum autrichien était remis à la Serbie, envoyer de Berlin la longue note, qui a été communiquée, le 24, aux Cabinets de Paris, de Londres et de Saint-Pétersbourg. Après une apologie de l’Autriche et de son action, la note précisait le point de vue allemand dans une conclusion qui ne manque pas de clarté. « Le Gouvernement Impérial désire affirmer avec la plus grande énergie qu’il s’agit d’un conflit dans lequel l’Autriche-Hongrie et la Serbie seules sont intéressées et que les Grandes Puissances doivent s’efforcer de le limiter à ces deux Puissances. Le Gouvernement Impérial désire la localisation du conflit parce que l’intervention d’une autre Puissance pourrait amener, en raison des alliances, des conséquences incalculables. » Tandis que l’Angleterre prépare une intervention des Puissances, l’Allemagne prend position pour le principe de la localisation du conflit qui était particulièrement favorable aux intérêts de l’Autriche ; et elle cherche à imposer ce principe par la menace voilée, mais déjà assez claire, contenue dans l’allusion aux « conséquences incalculables ». Il n’est pas difficile de deviner son but ; paralyser par les menaces les puissances de la Triple Entente tandis que l’Autriche agirait. L’Autriche-Hongrie, au contraire, cherche à rassurer la Russie par des promesses. Le 24, le comte Berchtold a une conversation très cordiale avec le chargé d’affaires de Russie à Vienne ; et il lui déclare que l’Autriche-Hongrie ne se propose en aucune manière de prendre des territoires serbes ou d’altérer l’équilibre des Balkans, mais qu’il désire seulement en finir avec les intrigues de la Serbie. Il fait même davantage : il charge l’ambassadeur à Londres de dire à Sire Ed. Grey, en choisissant le bon moment, que – je traduis le texte de la dépêche – « la note présentée hier à Belgrade ne doit pas être considérée comme un ultimatum, mais comme une note exigeant une réponse dans un délai déterminé. Votre Excellence voudra faire savoir à Sir Ed. Grey, en secret, que si la réponse n’est pas satisfaisante, l’Autriche-Hongrie se bornera pour le moment à rompre les rapports diplomatiques et à commencer les préparatifs militaires nécessaires ».
Il ne semble pourtant pas que ni les menaces voilées de la note allemande, ni les déclarations rassurantes du comte Berchtold, aient produit, le 24 juillet, un effet quelconque sur le gouvernement russe. L’opinion était très excitée en Russie. L’ambassadeur d’Allemagne à Saint-Pétersbourg discuta longuement la note de son gouvernement avec M. Sazonoff, mais sans réussir à le convaincre. M. Sazonoff lui déclara très clairement, –most positively, – que la Russie n’aurait jamais consenti, à aucune condition, à laisser l’Autriche et la Serbie vider seules leur querelle ; et, le même jour, il demanda à l’Autriche-Hongrie un prolongement du délai accordé à la Serbie. La dépêche du 24 au chargé d’affaires russe à Vienne résume si clairement le point de vue russe qu’il faut en connaître le texte :
Veuillez transmettre au ministre des Affaires étrangères d’Autriche-Hongrie ce qui suit :
« La communication du Gouvernement austro-hongrois aux Puissances le lendemain de la présentation de l’ultimatum à Belgrade ne laisse aux Puissances qu’un délai tout à fait insuffisant pour entreprendre quoi que ce soit d’utile pour l’aplanissement des complications surgies.
« Pour prévenir les conséquences incalculables et également néfastes pour toutes les Puissances qui peuvent suivre le mode d’action du Gouvernement austro-hongrois, il nous paraît indispensable qu’avant tout, le délai donné à la Serbie pour répondre soit prolongé. L’Autriche-Hongrie, se déclarant disposée à informer les Puissances des données de l’enquête sur lesquelles le Gouvernement Impérial et Royal base ses accusations, devrait leur donner également le temps de s’en rendre compte.
« En ce cas, si les Puissances se convainquaient du bien-fondé de certaines des exigences autrichiennes, elles se trouveraient en mesure de faire parvenir au Gouvernement serbe des conseils en conséquence.
« Un refus de prolonger le terme de l’ultimatum priverait de toute portée la démarche du Gouvernement austro-hongrois auprès des Puissances et se trouverait en contradiction avec les bases mêmes des relations internationales. »
Communiqué à Londres, Rome, Paris, Belgrade.
Signé : Sazonoff.
Le point de vue russe était l’opposé du point de vue allemand. L’Allemagne soutenait que les Puissances ne devaient pas s’immiscer dans le conflit austro-serbe ; la Russie répondait que ce conflit intéressait toute l’Europe. Il fallait donc discuter ces deux thèses ; mais, pour les discuter et trouver moyen de les concilier, il fallait du temps. C’est ce que la Russie, l’Angleterre et la France demandaient à l’Autriche. La demande ne paraîtra pas excessive, puisqu’il s’agissait de la paix du monde.
Mais le sort d’une demande si raisonnable fut assez curieux. Un singulier changement de rôles se produisit, le 25, entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. L’Allemagne qui, le 24, avait posé le principe de la localisation du conflit avec une rudesse menaçante, semble se laisser gagner, le 25, par un optimisme ondoyant, nonchalant et dilatoire qui caractérisera pendant plusieurs jours sa politique. Était-ce l’effet des déclarations si nettes et si précises de M. Sazonoff à l’ambassadeur d’Allemagne ? Y a-t-il eu, à Berlin, un moment d’hésitation et de perplexité ? A-t-on voulu calmer les inquiétudes naissantes ? Toujours est-il que, le 25 juillet, M. de Jagow, le ministre prussien des affaires étrangères, déclara à l’ambassadeur d’Angleterre à Berlin que le Gouvernement Impérial consentait à transmettre à Vienne la demande russe pour le prolongement du délai, tout en doutant qu’elle pût arriver à temps. Il ajouta que les déclarations du comte Berchtold sur les intentions de l’Autriche calmeraient l’opinion russe ; il tâcha de convaincre l’ambassadeur que même une attaque de l’Autriche contre la Serbie ne pourrait pas, après les déclarations du comte Berchtold, amener une guerre générale ; il se montra persuadé que le conflit serait en tout cas localisé ; il déclara que l’Allemagne ne voulait pas la guerre et qu’elle était prête à agir à Vienne et à Saint-Pétersbourg, dès que les relations entre la Russie et l’Autriche menaceraient de se rompre. Il admit enfin que la note autrichienne laissait à désirer, comme document diplomatique ; mais il nia l’avoir connue avant sa publication. Il répéta les mêmes choses au chargé d’affaires russe. Comparé avec la note du 23, ce langage était conciliant. Le même jour, à midi, l’ambassadeur d’Allemagne à Paris alla protester au Quai d’Orsay contre un article de l’Écho de Paris qui qualifiait de « menace allemande » la communication du jour précédent sur les « conséquences incalculables » de l’intervention d’une Puissance quelconque dans le conflit austro-serbe. Il n’y avait eu ni « concert » entre l’Autriche et l’Allemagne, ni « menace » allemande : « le gouvernement allemand s’était contenté d’indiquer qu’il estimait désirable de localiser le conflit ».
En somme, en comparaison de la note du jour précédent, l’attitude de l’Allemagne est assez conciliante, le 25. Quelle est la raison de ce changement ? Voilà le premier mystère de cette ténébreuse affaire. Par malheur, la netteté et la résolution qui semblent faire défaut, en ce moment, à la politique allemande, se retrouvent dans la politique autrichienne, qui le jour précédent, avait paru vouloir ménager les susceptibilités de la Russie. Le 25, au contraire, l’Autriche-Hongrie lui refuse catégoriquement le prolongement du délai. Le comte Berchtold avait pensé aller, ce jour-là, à Ischl ; le chargé d’affaire russe, M. Koudachew, ne put lui remettre la dépêche de son ministre et fut obligé de la lui télégraphier ; la réponse fut négative.
L’Allemagne parlait avec sagesse, mais son alliée, l’Autriche, agissait comme une ennemie. Sir Edward Grey, dès qu’il sut que l’Autriche-Hongrie avait refusé de prolonger le délai, considéra la situation comme très sérieuse. Ce fut en vain que l’ambassadeur d’Autriche, croyant venu le bon moment, exécuta les instructions du comte Berchtold, et lui révéla que son gouvernement rappellerait le ministre de Belgrade, mais n’entamerait point les opérations militaires. Ces subtilités diplomatiques ne rassurèrent point le ministre anglais.
Sir Edward Grey, comme tout le monde d’ailleurs, ne croyait pas que la Serbie se soumettrait à l’ultimatum autrichien. Dès qu’il eut appris que l’Autriche-Hongrie refusait le prolongement du délai, il ne douta plus que dans quelques heures la rupture diplomatique entre les deux pays serait un fait accompli, et que cette rupture entraînerait comme conséquence la mobilisation de l’Autriche et celle de la Russie. Devant une telle situation, il ne voulut pas perdre de temps, car, en vérité, il n’y avait pas de temps à perdre. L’ambassadeur d’Autriche une fois parti, il s’adressa à l’ambassadeur d’Allemagne. Il lui dit que la Russie et l’Autriche-Hongrie mobiliseraient d’un moment à l’autre, et lui précisa le plan d’action qu’il proposait pour sauver la paix de l’Europe, si cette redoutable éventualité se réalisait. Les quatre Grandes Puissances devaient s’engager mutuellement à ne point mobiliser, et s’unir pour demander à la Russie et à l’Autriche-Hongrie de s’abstenir de tout acte d’hostilité, tant qu’elles tâcheraient elles-mêmes de trouver un terrain de conciliation. Il insista surtout sur une collaboration active de la part de l’Allemagne, en démontrant que, sans elle, aucune action sérieuse en faveur de la paix n’était possible. Le prince Lichnowsky lui lut d’abord une dépêche de M. de Jagow affirmant que le gouvernement allemand n’avait point connu la note autrichienne avant qu’elle fût remise, mais que, puisqu’elle l’avait été, l’Allemagne se sentait obligée à soutenir son alliée. Il reconnut ensuite que l’Autriche-Hongrie pouvait accepter la proposition anglaise, car il s’agissait d’une médiation des Grandes Puissances entre la Russie et l’Autriche-Hongrie, et non pas d’une médiation entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie. Il déclara donc l’approuver.
Sir Edward Grey avait eu raison de faire sans retard cette démarche auprès de l’ambassadeur d’Allemagne, car ses prévisions pessimistes du premier moment ne tardèrent pas à se réaliser. Le 25, le ministre d’Autriche-Hongrie quittait Belgrade. La rupture des rapports diplomatiques entre la Serbie et l’Autriche-Hongrie était un évènement d’autant plus grave que la Serbie avait donné à la note autrichienne une réponse beaucoup plus conciliante que les Puissances de l’Entente n’avaient espéré. Elle avait accepté la note autrichienne presque complètement. Si l’Autriche n’avait pas trouvé cette réponse satisfaisante, sous prétexte qu’elle ne pouvait croire à sa sincérité, c’est qu’elle voulait faire la guerre et troubler l’équilibre des Balkans. Ce fut la conclusion de beaucoup de spectateurs désintéressés. Il ne fallait donc plus perdre un instant, et faire un effort décisif pour essayer d’arriver le plus rapidement possible à un accord.
Le 26 en effet Sir Ed. Grey soumit aux cabinets de Rome, de Paris et de Berlin une proposition officielle. Les ambassadeurs de France, d’Italie et d’Allemagne devaient s’unir à Londres avec lui en conférence pour trouver une solution pacifique du conflit, et ils demanderaient à Belgrade, à Vienne et à Saint-Pétersbourg de suspendre toutes les opérations militaires, tant que la conférence siégerait. Le même jour, M. Sazonoff élaborait un autre projet : celui d’une conversation directe entre Vienne et Saint-Pétersbourg. Il télégraphiait, le 26, à l’ambassadeur de Russie à Vienne :
J’ai eu aujourd’hui un long entretien sur un ton amical avec l’ambassadeur d’Autriche-Hongrie. Après avoir examiné avec lui les dix demandes adressées à la Serbie, j’ai fait observer qu’à part la forme peu habile sous laquelle elles sont présentées, quelques-unes parmi elles sont absolument inexécutables, même dans le cas où le Gouvernement serbe déclarerait les vouloir accepter. Ainsi, par exemple, les points 1 et 2 ne pourraient être exécutés sans un remaniement des lois serbes sur la presse et sur les associations, pour lequel le consentement de la Skoupchtina pourrait être difficilement obtenu ; quant à l’exécution des points 4 et 5, elle pourrait produire des conséquences fort dangereuses et même faire naître le danger d’actes de terrorisme dirigés contre les membres de la Maison Royale et contre Pachitch, ce qui ne saurait entrer dans les vues de l’Autriche. En ce qui regarde les autres points, il me semble qu’avec certains changements dans les détails, il ne serait pas difficile de trouver un terrain d’entente si les accusations y contenues étaient confirmées par des preuves suffisantes.
Dans l’intérêt de la conservation de la paix, qui, au dire de Szapary, est précieuse à l’Autriche au même degré qu’à toutes les Puissances, il serait nécessaire de mettre le plus tôt possible fin à la situation tendue du moment. Dans ce but, il me semblerait très désirable que l’ambassadeur d’Autriche-Hongrie fût autorisé à entrer avec moi dans un échange de vues privé, aux fins d’un remaniement en commun de quelques articles de la note autrichienne du 10 (23) juillet. Ce procédé permettrait peut-être de trouver une formule qui fût acceptable pour la Serbie, tout en donnant satisfaction à l’Autriche quant au fond de ses demandes. Veuillez avoir une explication prudente et amicale dans le sens de ce télégramme avec le ministre des Affaires étrangères.
Communiqué aux Ambassadeurs en Allemagne, en France, en Angleterre et en Italie.
Signé : Sazonoff.
Le projet de Sir Edward Grey et celui de M. Sazonoff étaient différents et ils pouvaient se nuire, dans un moment si critique où il ne fallait ni perdre une minute ni disperser les efforts. Mais tous les deux prouvent du moins combien la Russie et l’Angleterre désiraient trouver une solution pacifique du conflit. Par malheur, Sir Ed. Grey ne s’était pas trompé quand il avait prévu que la rupture diplomatique entre la Serbie et l’Autriche, aurait provoqué des préparatifs militaires soit en Autriche, soit en Russie. Le 26, l’Autriche-Hongrie commence à mobiliser une partie de son armée ; et la Russie prend des dispositions préparatoires pour mobiliser à la frontière autrichienne. Que fait pendant cette journée le gouvernement allemand ? Les évènements du 25 n’ont point ébranlé son optimisme ; mais son attitude change encore une fois. Si, le 24, il semblait vouloir imposer à la Russie, par des menaces voilées, la localisation du conflit ; si, le 25, il s’était enfermé dans un optimisme passif et avait déclaré que, en cas de grave danger pour la paix européenne, il aurait consenti à intervenir avec les autres Puissances entre la Russie et l’Autriche, le 26, il revient à l’idée d’amener la Russie à abandonner la Serbie à son sort, mais par des procédés plus aimables. Il ne menace plus : il affirme qu’il veut la paix et que son désir de paix n’est même pas diminué par les premières nouvelles de la mobilisation russe qui, pendant la journée, commencent à arriver à Berlin ; mais il s’efforce de convaincre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg que, l’Autriche-Hongrie ayant déclaré ne pas poursuivre en Serbie des ambitions territoriales, la Russie n’a plus aucune raison d’intervenir. Toute la responsabilité d’une conflagration européenne pèserait sur elle, si la Russie persistait dans son attitude. C’est la thèse que le sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, M. Zimmermann, développe, le 26, au chargé d’affaires anglais. M. Sazonoff a déclaré à l’ambassadeur d’Allemagne que la Russie ne pourrait rester indifférente si l’Autriche s’annexait une partie du territoire serbe ; mais l’Autriche n’a nullement cette intention : donc…. C’est la thèse que, le même jour, le chancelier de l’Empire fait présenter aux cabinets de Londres et de Paris, en les priant de la recommander à Saint-Pétersbourg. Il est intéressant de lire dans le Livre Orange comment l’ambassadeur d’Allemagne à Paris s’est acquitté de sa mission :
Aujourd’hui l’ambassadeur d’Allemagne a de nouveau rendu visite au gérant du Ministère des Affaires étrangères et lui a fait les déclarations suivantes :
« L’Autriche a déclaré à la Russie qu’elle ne recherche pas des acquisitions territoriales et qu’elle ne menace pas l’intégrité de la Serbie. Son but unique est d’assurer sa propre tranquillité. Par conséquent, il dépend de la Russie d’éviter la guerre. L’Allemagne se sent solidaire avec la France dans le désir ardent de conserver la paix et espère fermement que la France usera de son influence à Pétersbourg dans un sens modérateur. »
Le ministre fit observer que l’Allemagne pourrait de son côté entreprendre des démarches analogues à Vienne, surtout en présence de l’esprit de conciliation dont a fait preuve la Serbie. L’ambassadeur répondit que cela n’était pas possible, vu la résolution prise de ne pas s’immiscer dans le conflit austro-serbe. Alors le ministre demanda si les quatre Puissances, – l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et la France, – ne pouvaient pas entreprendre des démarches à Saint-Pétersbourg et à Vienne, puisque l’affaire se réduisait en somme à un conflit entre la Russie et l’Autriche. L’ambassadeur allégua l’absence d’instructions. Finalement, le ministre refusa d’adhérer à la proposition allemande.
Signé : Sevastopoulo.
En somme l’Allemagne priait la France d’expliquer à la Russie son point de vue et de la convaincre de sa justesse. En même temps elle chargeait son ambassadeur en Russie de faire une démarche, à laquelle le Livre Blanc allemand se garde bien de faire allusion, mais qui nous est révélée par une dépêche de l’ambassadeur austro-hongrois à Saint-Pétersbourg, publiée dans le Livre Rouge. C’est la dépêche 28, dont je traduis le commencement :
Saint-Pétersbourg, 26 juillet 1914.