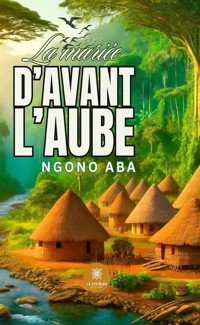
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans les contrées de l’Afrique centrale à la fin du XIX siècle, près de Kribi, deux grands chefs polygames règnent en maîtres, alors que les migrations des Boulou arrivent à leur terme. Une promesse entre Mbili et Ndongo, les deux monarques et amis, scelle le destin d’une jeune fille, l’entraînant dans un tourbillon d’alliances, d’intrigues et de traditions ancestrales. Entre amour et trahison, découvrez le récit palpitant de cette descente aux enfers où le courage et la détermination seront mis à rude épreuve.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Ngono Aba est auteure de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur les littératures francophones écrites, les littératures orales et écrites dans les langues fang-boulou-beti (Afrique centrale). Elle est également romancière, nouvelliste, poète, dramaturge, traductrice et préfacière.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ngono Aba
La mariée d’avant l’aube
Roman
© Lys Bleu Éditions – Ngono Aba
ISBN : 979-10-422-3020-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Je préfère te mettre en garde, toi qui veux devenir mon complice dans cette aventure au cœur de l’Afrique de mes ancêtres. Toi qui as connu Descartes, Voltaire et toutes ces têtes qui savent bien penser, garde-toi de les amener avec toi, ils te feront alors manquer ton rendez-vous avec moi, avec cette Afrique que nous ne voyons que par des clichés. Chez nous, on pense aussi, mais avec les organes de sens chaque fois exacerbés, sollicités au point que quelqu’un avait dit de nous : « nous sommes des hommes de la danse ».
Si tu es de ceux qui pensent comme Dom Juan de Molière que « deux et deux sont, quatre » et non cinq, je te prie de l’oublier, car tu ne me suivras plus dans les méandres d’une pensée dans laquelle la palabre reste le fondement d’une transmission du savoir. Le doute va t’assaillir et planter un écran opaque entre toi et moi : alors tu seras responsable de notre échec si les relations nord-sud ne se nouent pas. Il faut voir et écouter, non pas avec ta foi, mais comprendre avec la croyance de l’autre. Tu vois, ce n’est que cela que je te demande. N’oublie pas que tu m’as contraint à t’écouter, et je l’ai fait ; j’ai même épousé tes points de vue et je suis devenu pratiquement ce que tu as voulu faire de moi, mais je ne peux pas en exiger autant, Zomeyo Mebe’e me Nkpwa Évo est grand ! Ta réticence naturelle ne voudra pas s’y prêter.
La généalogie
La saison sèche tire à sa fin. On a du mal à mettre quelques graines d’arachide dans la terre et à les recouvrir. Il faut creuser et le sol est dur, sec. Chaque coup de houe ne soulève que de la poussière. La semence refuse de se laisser enfouir facilement. On va à sa plantation tôt le matin pour n’en revenir que tard le soir. On se couche éreinté. Le repos nocturne qui se peuple de rêves et de cauchemars ne surprend plus. Maria se voit en train de gronder ces graines mises en terre qui continuent de lui faire des clins d’œil comme pour la narguer. Cela dure un moment puis elle plonge dans une phase de sommeil plus douce, jusqu’au lever du jour.
Il est six heures du matin. La nuit enveloppe encore le village à moitié endormi. Son obscurité se mêle à celle, épaisse, de la forêt équatoriale. Cependant les coqs et les poules, les plus bavardes, couvrent la cour de leurs caquètements. Les femmes sont vêtues uniquement d’une jupe de feuilles, certaines portant des tatouages sur le visage. Elles ont parcouru trois fois la distance entre leur maison et la source où elles doivent chercher l’eau, avec des calebasses ou des jarres en terre cuite, pour les diverses activités de la journée. Les enfants, surtout des petites dont l’unique vêtement se résume à une ceinture de cauris autour des reins, et certains adultes ont fait le tour des manguiers, une torche à la main et pieds nus. À cette heure de la matinée, les gens se déplacent plus par habitude. Ils connaissent les lieux où ils se rendent. Ils ne peuvent prétendre bénéficier de l’éclairage de la lune dont la lueur pâle, au contact du jour naissant, vire au rouge éclatant, promesse de bonheur.
À force d’exécuter des travaux pénibles, le corps des femmes, aguerri et musclé, témoigne de leur vivacité et de leur énergie. Dans cette zone des forêts et des rivières, la peau des habitants paraît plus claire, sans doute parce que les arbres les protègent du soleil. La chevelure abondante donne l’impression de jouir de l’humidité et du soleil comme les plantes. Le système pileux féminin profite aussi du climat.
Ce matin encore, le réveil a été d’une douceur féerique. Depuis quelques semaines, les nuits de Maria sont devenues plus calmes. On peut dire qu’il règne dans sa maison une atmosphère nouvelle qui surprend et se répercute dans tout ce que fait la vieille femme. En fredonnant des mélodies religieuses, elle se dépêche de nettoyer sa cuisine, de ranger la vaisselle. Elle réchauffe ensuite les restes du repas de la veille en guise de petit déjeuner qu’elle va offrir à sa « petite-fille » et à son homme. Celle que Maria appelle sa « petite-fille » n’est autre que la fille de sa nièce, Amélia, arrivée depuis quelques mois dans son existence terne. La tendresse que la vieille éprouve pour la nouvelle venue la mène régulièrement à se remémorer son existence passée. Quand elle décide d’évoquer sa famille paternelle et sa naissance, elle ne se doute pas que ses souvenirs vont la replonger dans d’affreuses douleurs.
Le polygame et patriarche Mbili jouissait de la propriété de nombreuses épouses. Il comptait des femmes âgées, des jeunes et celles qui attendaient de passer dans sa chambre pour les nuits de noces. Ces dernières vivaient dans sa cour, tandis que ses propres filles, mariées, demeuraient chez leurs époux. Il avait une progéniture immense. Parmi ses filles, nées de mères différentes, Maria et Emvoutou Mbili avaient le même âge. La première portait encore un nom courant de son clanà cette époque. Elle était Assomo Mbili. Les deux fillettes furent promises à leurs futurs époux au même moment. Leurs mères les portaient encore dans leur ventre. Si Ndongo avait mis une option sur l’enfant d’Abate, la future mère, une autre connaissance du père avait demandé en mariage celle qu’attendait Eboutou, la mère d’Emvoutou.
Pendant sa jeunesse, de nombreux signaux et qualités permirent de remarquer Mbili, tant dans la cour de son père, dont il prit la succession, que dans d’autres villages. Ses exploits et sa beauté le distinguaient de ceux de son âge. Si les filles n’étaient pas mariées pendant leur enfance, elles se le seraient disputé. Dans le sérail paternel, on trépignait à son passage. De la taille des habitants de la forêt qui passent leur vie sous les arbres, une taille moyenne qui excédait rarement un mètre soixante-dix, sa peau tirait vers un brun clair. On racontait qu’il étonna son clan au cours l’initiation de ceux de sa génération. On remarqua son intelligence, sa bravoure, sa force, son courage pendant les tests d’effort et d’endurance. Cette année-là, le clan de Mbili organisa les épreuves initiatiques pour le passage de l’enfance à l’âge d’homme avec celui de Ndongo. De cette période dataient leur amitié et leur complicité. Leur ressemblance trompa plus d’un. On croyait voir des jumeaux : même taille, même peau, mêmes rictus et force égale. Ils se réjouissaient quand ils pouvaient berner ceux qui ne les connaissaient pas. Son père mit en lui tous ses espoirs. Jamais le fils ne le déçut.
Maria et Emvoutou sont nées au même moment. Elles ont également quitté la cour familiale à la même période, lors de leur quatrième année. Cette séparation précoce ne leur permettait pas de se voir régulièrement. Alors que, pour la demi-sœur, tout se déroule sans problème, pour Maria, la vie s’est compliquée à partir du moment où elle a perdu sa tutrice. Jusque-là insouciante, la disparition de celle qui la défendait lui ouvre les yeux. La vieille femme a toujours fait office de paravent pour elle. Emvoutou a offert une confortable progéniture à son mari, dont Abeng, la maman d’Amelia. Celle-ci s’est également mariée jeune, dans le clan voisin de celui de son grand-père Mbili, mais des couches successives et rapprochées ont eu raison de sa santé. Elle laissait une douzaine d’enfants dont l’âge variait entre vingt ans et quelques mois. Il faut croire que son bonhomme de mari, soucieux de faire d’elle une souris, avait complètement feint d’ignorer les règles d’abstinence qui s’imposent après chaque naissance. Ou, comme le disait Maria : « cet individu avait tout simplement trouvé là un moyen idéal pour se débarrasser proprement de sa femme, sans être accusé de meurtre ».
Auraient-ils pu l’imaginer ?
Les migrations ont duré longtemps dans cette région, racontaient des générations d’anciens. Leurs récits renseignaient sur leurs origines. Ils venaient du levant et devaient atteindre le couchant. On parlait d’une mer de sel, d’attaques de personnes hissées sur leurs chevaux, la tête enturbannée. On évoquait les guerres de traversée, chantait les louanges de ces forgerons qui fabriquaient les armes avec lesquels les leurs malmenaient l’ennemi. D’aucuns se remémoraient la recommandation de l’ancêtre fondateur de la tribu fang-boulou-beti : marcher vers l’ouest et arriver au bord de la mer qui abrite le coucher du soleil. Les migrants devaient y trouver leur terre, celle qui leur était promise, et s’installer dans la zone de forêt, au pays des rivières. Il leur fallait franchir le fleuve aux eaux blanches, le Yom.
Les déplacements avaient duré longtemps, racontaient les descendants des générations de descendants. On s’arrêtait de temps en temps, pendant la durée des semailles et des récoltes, car les femmes ramassaient et emmagasinaient diverses graines et semences au cours de la traversée. Peuple de grands guerriers et d’habiles chasseurs, les hommes affichaient l’arrogance que leur conféraient leur force et les victoires successives accumulées. Leurs femmes et leurs filles se targuaient de l’élégance et de la beauté qu’elles cultivaient tout au long des déplacements. Elles savaient exploiter ce que mère nature produisait et leur offrait.
Leur marche fut longue, mais jamais ils n’avaient osé abandonner les ossements des ancêtres, précisait-on. Au fur et à mesure que la tribu se développait, elle se divisait également et créait de nouveaux villages qu’on abandonnait pour de nouvelles terres, plus fertiles, plus riches, offrant à l’homme et à la femme ce qui les l’aiderait à vivre. Si les aïeux de Mbili et de Ndongo croyaient en l’existence de Zomeyo Mebe’e me Nkpwa Evo, Créateur de toutes choses, ils redoutaient sa vengeance terrible. De nombreuses légendes narrent la vie de ce Créateur au milieu des siens qu’il a fini par abandonner à cause de leurs exigences et querelles.
Mbili et Ndongo viennent de loin. Les récits ne peuvent les situer ni dans l’espace parcouru par les leurs ni dans la durée de ces pérégrinations. Ils ne peinent à dater exactement le moment où leurs ancêtres se sont installés dans la forêt et sur les sites qu’ils occupent. Le peuple conserve la maîtrise des saisons et du temps, grâce aux conditions climatiques : la grande saison sèche, la petite saison sèche, la grande saison des pluies et la petite saison des pluies. Cette succession de périodes qui rythment les existences leur donne la notion d’un cycle complet. Ladite connaissance dicte les activités.
Mbili et Ndongo habitent une terre qui semble immense et vaste. S’ils savent lire dans le ciel, dans le vent et les orages ce que leur réserve la vie à court et à moyen terme, ils pensent que seuls ceux qui ont la couleur de leur peau habitent cet espace. Ils n’imaginent pas qu’ils vivent la fin d’un siècle, à savoir ici le XIXe. Ils ne s’imaginent pas qu’on puisse les empêcher de continuer leur exploration de la terre et de la forêt, parce qu’à côté d’eux existe désormais un pays voisin autonome, habité cependant par leur peuple. Ils ne soupçonnent pas qu’eux-mêmes sont circonscrits et attachés à un « bout de terre ». En effet, sans qu’ils en soient instruits, des gens d’une couleur de peau différente de la leur, vivant dans un pays qu’ils ne connaîtront jamais, de l’autre côté de la mer, viennent d’en décider ainsi. Pendant qu’ils jouissent encore de leur étendue abritée par les arbres et veinée par d’abondantes rivières, ils ne peuvent pas savoir que leur sort est hypothéqué. Ils ne verront jamais les changements occasionnés par l’équarrissage de leur terre mère, même s’ils sont prévenus du fait que de drôles d’individus, des fantômes ou des albinos, ont atterri chez eux.
Amélia et Maria
Amélia dort encore, enfouie dans une épaisse couverture en laine de mouton. Quelques poils dépassent et caressent doucement son jeune corps nu. Le drap est une invention inutile qui empêche de sentir la douceur de cette toison. Amélia a toujours pensé qu’il ne faut rien mettre entre le corps humain nu et la couverture. À chacun ses folies !
Amélia est une poupée vivante, d’une beauté et d’une grâce face à laquelle nul ne résiste. Elle a grandi très vite, comme ces plantes qu’une seule pluie suffit à faire pousser. Son existence avait mal commencé, car perdre sa mère dans ces lieux déstabilise tout enfant. Depuis qu’elle vit chez Maria, elle appréhende son avenir, plus exactement, la suite des jours, avec confiance.
Sa parente, dont la décision consista à déposer les charmes et de prendre sa retraite après de longues années de mariage, a mis fin à la fréquentation de la maison de Minta, son mari polygame. Celui-ci, comme le rappelle souvent la vieille femme, lui a sauvé la vie. Il lui a rendu son honneur. Cependant, sa stérilité se vit encore comme une douleur indélébile. Elle n’a pas donné une descendance à cet homme si bon. Minta l’a épousée au moment où elle s’est retrouvée veuve. Elle est bien lointaine, cette époque ! Mais, les blessures demeurent. Elle a ensuite demandé à se faire baptiser et, depuis lors, vit sa religion comme une âme qui cherche à se mortifier pour des fautes dont elle garderait le secret. Son nouveau statut lui interdit tout contact physique. Cela n’est pas grave puisqu’elle a cessé d’elle-même de se comporter comme une épouse. Ils continuent néanmoins à garder les meilleures relations possible, rapports mêlés de la complicité tendre des personnes qui se sont aimées et qui ont fait un bout de leur vie ensemble.
Maria a gardé un corps svelte de combattante. Sa beauté, depuis son enfance, incitait à la jalousie. Ceux et celles qui la voyaient grandir admiraient son corps ferme, son visage qui donnait l’impression d’avoir été dessiné. Elle avait pris chez son père cette part de virilité qui sommeille en chaque femme et qu’elle a développée. Elle était une très belle femme, comme sa mère et comme sa grand-mère. Enfant, il suffisait d’un collier de cauris ceint autour des reins pour mettre son corps et être en valeur. Ce corps parlait pour elle. Il recelait ce quelque chose que voulaient acquérir ses rivales, si elles ne l’atteignaient pas, le démolir. Malgré les quelques rides qu’installe la vieillesse sur sa peau autrefois éclatante, le temps a refusé d’effacer totalement sa grâce et sa beauté.
La fille de Mbili n’a jamais joué avec sa vie ni avec celle de femmes et d’hommes qui l’entourent. Fervente chrétienne catholique, bonne pratiquante, sa sincérité dans ses dialogues avec Dieu et au confessionnal où ses péchés apparaissent comme une ritournelle. Elle a calqué son existence sur celle des saintes dont les missionnaires ne cessaient de lui présenter les images et les actes de foi. La décision de se faire appeler Maria, en entendant les officiants des messes dire Sancta Maria, a été à la fois une voie de salut et une volonté de suivre sa patronne qui, comme elle, a perdu son unique enfant à cause des humains.
À cette époque, les célébrations religieuses catholiques avaient pour unique langue le latin. Les missionnaires, qui ne maîtrisaient pas la langue à tons de la forêt qu’ils jugeaient complexe, escamotaient autant que possible les mots qu’ils utilisaient. Leurs discours aboutissaient régulièrement au résultat inverse de leur propos ou à des énormités. Ils se retrouvaient à insulter, à humilier les fidèles et à parler du sexe sans le vouloir. Devant cette ferveur, les co-épouses et autres mauvaises langues soutiennent pourtant que Maria joue de la comédie, parce qu’une vieille femme ne pense à Dieu que lorsque les hommes ne s’intéressent plus à son corps.
Chaque matin, au moment de quitter le lit où elle vient de passer la nuit avec sa nièce, la vieille femme fait une courte prière par laquelle elle remercie le Seigneur et ses saints pour la nouvelle journée qui commence. Après avoir réfléchi un moment à la façon d’organiser ses activités, elle savoure cet instant qui lui semble le plus beau de son existence. D’un œil protecteur et attentif, elle observe le jeune corps recroquevillé de l’enfant. Il dessine une forme bien ronde, comme celle d’un chat qui attend une caresse. La fille ne laisse sortir de la couverture qu’un bout de son visage de bébé élevé au lait Guigoz. Mais à cette époque, les habitants de la forêt s’imaginaient qu’un animal peut nourrir un enfant d’humain. Par ailleurs, on ne boit pas de lait dans la forêt, car, dit-on, la mouche tsé-tsé y empêche tout élevage de bovin.
La satisfaction qu’éprouve Maria grandit tous les jours. Après avoir renoncé à tout plaisir charnel, elle a retrouvé la paix intérieure. Que peut-on souhaiter au moment où l’on a sensiblement commencé à descendre vers la Vallée du silence1 ? Il faut dire que l’âge, dont le signe le plus visible est la vieillesse, ne pardonne pas. Mais, malgré cette sérénité, Maria n’arrive pas vraiment à pardonner au temps qui n’a pas réparé son ventre.
Souvent sourire et larmes se mêlent pour transmettre sa joie muette et loquace à la fois. Chaque fois qu’elle le peut, Maria cherche à dissiper ce mal de vivre ancré au plus profond de son être, au plus intime de son âme. Dans son existence austère, elle a vécu l’arrivée de sa nièce comme une récompense qui viendrait un peu tard, lorsqu’on est fatigué de faire des efforts et qu’on a juré d’abandonner l’épreuve. La paix de Maria n’arrivait pas vraiment à occulter sa peine.
Par moments, Maria envie l’innocence et la confiance aveugles d’Amélia en tout être humain. Elle admire cette fragilité dans un corps, pourtant ferme, de jeune fille en bonne santé. De temps en temps, elle se demande si elle aurait été capable d’agir vis-à-vis de sa protégée comme d’autres l’ont fait à son égard. « La tradition ! », ne cesse-t-on pas de répéter autour d’elle. Qu’est-elle ? Une bête fantastique ! Elle se l’est toujours représentée avec mille visages, aussi flous et aussi peu nets les uns que les autres ! Amélia a beaucoup plus de chance. Elle est née pendant le règne des étrangers. À douze ans, elle n’est encore ni fiancée ni promise à un homme qui ne verrait d’elle que ce qui lui permet d’exalter sa virilité. Et malgré son corps où l’on perçoit les effets et les signes de la puberté, elle continue à jouer innocemment avec celles et ceux de son âge. Seul, le décès subit de sa mère l’a profondément perturbée.
L’odeur du repas chaud a si bien chatouillé et caressé l’odorat de la fille qu’elle remue doucement, puis s’éveille tout à fait. Elle se frotte les yeux, s’étire. Elle avoue qu’il y a du bon à dormir dans une cuisine. Il y fait plus chaud et seul fait sortir de la torpeur du sommeil l’arôme agréable du manioc ou du plantain qui grille sur le feu.
La grande tante Maria assiste attendrie à ce réveil qui n’est en rien différent de celui des autres jours, mais qui, chaque fois, l’émerveille et la fait fondre de douceur. Elle envie cette chance inouïe que sa petite-nièce ne peut deviner, elle qui est née après tout cela : oui, après la période inhumaine qu’elle a dû vivre. Ceci ne fait d’ailleurs que renforcer l’affection qui les unit. Leur différence d’âge aurait pourtant pu les éloigner. Maria trouve quelques avantages dans les mariages précoces chaque fois qu’elle regarde Amélia. Ce privilège viendrait de cette proximité générationnelle qui unit la vieille femme et sa petite nièce. Elle pense que lorsqu’on se marie tôt, qu’on a des enfants tout aussi tôt, les mères, les filles, les petites filles et les arrière-petites-filles, parfois, finissent par paraître de la même génération. Mais, en repensant à son vécu, elle que le sort a épargnée, elle efface cette idée de sa tête. On sait que le premier passage d’une fille dans la case de son vieux mari reste un moment traumatisant et révoltant.
« Amélia, ma mère, tu viendras à la plantation ce matin avec moi. Nous allons nous y rendre dès que tu auras fini de manger, car j’aimerais que tu rentres plus tôt au village. Ton “grand-père” doit aller dans sa famille d’alliance. N’oublie pas que je me fais vieille, que mes jambes me portent difficilement. Je ne peux plus marcher vite. Tu l’auras compris, ma petite, je suis devenue une bonne à rien, juste un moulin à paroles depuis que tu es arrivée dans ma vie, car, pendant des années, j’étais avare des mots. Le genre humain me faisait horreur. Regarde-moi, je suis passée de la méfiance absolue à cette confiance aveugle qui me perdit jadis ! »
Le « grand-père » dont parle Maria n’est autre que son mari, Minta. Il a vieilli. Peut-il en être autrement pour un polygame ? Les femmes qu’on épouse après un certain âge ne sont pas des agneaux. Elles cherchent à assurer leur place et celle de leur famille auprès de l’époux. Sachant que personne ne va pas céder gentiment la sienne, commencent des luttes sans cause, qui s’allument à partir de rien. Dans le même foyer, partageant une unique cour, les cuisines se côtoyant, les plantations s’étendant sur des superficies proches, chacune estime qu’elle mérite mieux. Alors naissent des alliances d’intérêts de deux personnes. Ces unions évitent de se constituer en trio, car, il arrive que la troisième personne se sente à l’écart. Rien de l’empêche de fournir des renseignements à l’époux. Le calme et le sens de l’équité qui caractérisent Minta n’éclipsent la valeur de cet homme qui a su se battre au côté de Mbili, son beau-père, pour sauver sa sœur et mériter la main de Maria. Il était jeune et bel homme à cette époque. Il mérite ce titre de « grand-père ».
Maria a dans sa tête une liste de petits noms pour manifester sa tendresse envers sa protégée qu’elle interpelle rarement par « Amélia ». Tantôt, « ma mère », tantôt « ma petite-fille », elle recourt souvent à sa devise, koú koù’oú koùkoú, propre à l’appel de loin ou par le tam-tam. Chaque membre de son ethnie en hérite à sa naissance. « Ma mère » comme dans un échange de rôles où l’enfant devient celle qui protège, apporte du bonheur, de la tendresse et de la chance. Amélia est celle qui lui donne une nouvelle vie.
La vieille accompagne ces paroles de caresses auxquelles la jeune fille a pris goût. Il faut dire que ces deux caractères se ressemblent. Maria a l’impression que le destin vient enfin de lui rendre une sœur, une jumelle, une autre elle-même, mais plus jeune, en la personne d’Amélia.
Comme au temps où elle était toute seule et avait l’habitude de soliloquer, elle poursuit, oubliant la présence de son interlocutrice :
« Il fallait pourtant que je continue à tenir ma place dans ce foyer polygame où Dieu et les humains n’ont jamais permis que mon clan soit représenté par des enfants, nombreux et robustes, que j’aurais donnés à mon mari et qui auraient marqué mon passage sur la terre. Malgré tout l’espoir que j’ai gardé au cours des années où il m’était encore possible de concevoir, je savais au fond de moi que cela n’arriverait plus. On m’a tuée sans m’ôter la respiration. Les femmes de la cour de Ndongo m’ont rendue inutile et sèche comme une liane d’igname pourrie. »
Ce n’est pas la première fois qu’Amélia entend ce discours. Depuis six mois qu’elle vit avec la vieille, elle a compris que sa tante a souffert par la faute des autres, qu’elle a gardé des séquelles d’une vie qui n’est chargée que de mauvais souvenirs. Elle sait que, lorsque Maria commence à parler de cette façon, la journée se déroulera comme un kaléidoscope des événements qui ont jalonné l’existence de cette femme qu’elle admire tant.
En dépit de la réitération des situations vécues par sa tante, Amélia sait aussi que ces retours fréquents dans le passé ont pour effet de la préserver de la tradition néfaste. Voilà pourquoi, sans oser l’interrompre, elle a pris l’habitude d’aller se mettre devant la sœur de sa grand-mère pour l’obliger à redescendre sur terre. Elle prend la liberté de se placer doucement face à elle, lui caresse la joue et finit par la réveiller. Quelquefois aussi, il arrive que, en proie à ses réflexions, la vieille, le regard dans le vide, engage des conversations comme un véritable zombie, avec des fantômes. Quelques minutes plus tard, elle ne peut plus répéter ce qu’elle vient de dire.
« Dépêchons-nous ! Voici que je me laisse encore aller au rêve. J’avoue qu’on ne change pas en vieillissant ! C’est tragique. Et puis, tous ces mauvais souvenirs ne font que réveiller ma rancœur et retourner le couteau dans cette vilaine plaie que le monde m’a faite au cœur. »
Maria, qui n’avait pas encore connu la religion importée, portait un nom de son clan, un patronyme fang-boulou-beti2 que ce récit ne retient pas. Jamais elle n’a cessé de se poser ces angoissantes questions : « pourquoi moi ? Que leur ai-je fait ? » Et plus elle voulait comprendre, moins elle saisissait ces actes gratuits par lesquels on arrive sciemment à rendre stérile une femme, par pure jalousie.
« Malgré ma jeunesse et l’espoir secret que j’avais gardé, au moment où je venais de perdre mon enfant, de pouvoir un jour en porter un de nouveau, je suis profondément déçue ». Elle a mis toute sa volonté en œuvre, pris des dispositions susceptibles de flatter le sort, elle constate aujourd’hui, avec beaucoup d’amertume, que tout a été vain. Elle l’a d’ailleurs toujours su, mais elle ne pouvait se résoudre à accepter les choses sans réagir. Cela lui était difficile de savoir qu’on ne la guérirait jamais. Le mal restait irréversible et sa vie devenait du même coup inutile, une mutilation qu’elle revivait chaque instant.
Au fil des ans, elle est devenue l’ombre d’elle-même, allant et venant comme une âme entre deux mondes, une âme de chrétien qui n’a cessé de se servir d’amulettes, de colliers et autres, qui auraient pu la guérir. Elle était une de ces âmes vagabondes telles qu’on en rencontrait dans les villages de la forêt, méconnues de Dieu et des ancêtres. Sa trop longue pratique hasardeuse du syncrétisme religieux avait tout brouillé. Dieu et les ancêtres, au comportement plein de sagesse, avaient dû voir une hésitation en ce mélange de croyances. Ils y avaient suspecté un refus de choix et une absence de franchise. Son visage s’était creusé, sa bouche semblait en permanence imprimer le dégoût de la vie et des humains. Des sillons profonds marquaient sa figure autant que son cœur, sillons de terre en poudre où rien ne pousse, figure de désert et de famine, image accablante de la stérilité et de la vieillesse.
Heureusement, pense-t-elle, la mort brutale de sa nièce vient de la rendre grand-mère d’une fille de douze ans. Un chef-d’œuvre tout prêt. Une occasion inespérée se présenta, car nulle femme n’osait jamais lui confier un bébé. Sa réputation de sorcière qui mange les enfants circulait d’une génération de femmes à l’autre. Dans cette forêt où elle vit, les mauvaises nouvelles circulent à l’allure du vent, s’éparpillent à chaque coup de balai. Dans cette forêt, même les animaux connaissent les humains et leurs agissements. On a révélé son passé aux jeunes enfants. Elle a quelquefois l’impression d’être nue devant les autres, malgré les vêtements qui protègent son corps. Elle a réclamé et obtenu la garde d’Amélia. Avec cette fille, tous les espoirs renaissent et les réveils ont pris la couleur de l’espoir.
On comprend pourquoi le matin est gai désormais. Les sillons qui parcouraient le visage se sont adoucis. Ils se sont progressivement transformés en rayons lumineux, reflétant une nouvelle façon de vivre : secrète et discrète. Tout est devenu signe d’une renaissance, comme les lignes d’une main, interrompues, qui repartiraient. Maria a retrouvé la jeunesse de l’âme, son corps réagit positivement et se ragaillardit.
« Je pense que la mort de ma nièce m’a été bénéfique. Ah, Dieu ! Que dis-je ? Toi seul… Seigneur… comprends le fond de ma pensée. Je ne veux pas signifier que j’aurais souhaité sa disparition pour lui voler ses biens. Je suis incapable de penser cela ! Non ! Je voudrais tout simplement la remercier de m’avoir redonné la vie. Sa mort m’a sauvée, comme celle du Christ a sauvé les humains. Je ne suis plus celle qu’on montre du doigt et qu’on esquive. J’ai cessé d’être maudite, désignée comme celle qui tue et mange les enfants des autres. Je me sens enfin femme, malgré mon âge avancé. »
Et elle se signe. Ce geste est devenu un réflexe si mécanique qu’elle ne peut plus en compter le nombre dans la journée. Il vient commencer et conclure toute démarche entreprise. Un véritable tic ! Ils sont si nombreux ces gestes que le Seigneur lui-même douterait de la foi qui les accompagne. Quel degré de superstition recèle-t-il ? Car ces manifestations trop démonstratives de sa foi ne relèvent ni de spiritualité africaine ni de la religion judéo-chrétienne.
Ce qui est terrible et qui condamne les autres à l’errance se révèle par la présence d’âmes bien pensantes, toujours promptes à raisonner pour les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Leur souci de sauvegarde des âmes perdues et leur projet de civilisation se voulaient indéfectibles. Elles ont pris soin de mettre en avant la notion de véritable religion, avec le vrai Christ, fils de son Père, Dieu. La croyance et la spiritualité des « autres » sont devenues animisme, fétichisme et superstition. Ces âmes étrangères à la tradition de la forêt ont trouvé indigne l’adoration des ossements des ancêtres. Il fallait les remplacer par de « très saintes » reliques. Des ossements aussi ! Quelle différence ? Ce sont de part et d’autre les mêmes objets, non ?
Maria parle à voix basse afin que la petite ne puisse pas saisir ces paroles qui, pourtant, ne l’auraient pas surprise, car elle connaît pratiquement par cœur ces rengaines. Elle s’est fait une raison, et, pour elle, ce n’est pas méchant.
Les deux femmes marchent sur le chemin de la plantation. Maria emprunte un sentier qui arpente les cacaoyères et les bois, éponge de ses vêtements la rosée matinale. En recevant cette eau bénite qui les mouille de la tête aux pieds, elles éprouvent une joie immense. Maria a toujours cru que ce liquide ne pouvait être que la salive que Zomeyo Mebe’e me Nkpwa Évo-Dieu et les ancêtres déposent pendant la nuit, sur les herbes, pour bénir celles et ceux qui se lèvent tôt et qui s’y baignent.
« Dépêche-toi, Amélia. Il faut que nous puissions travailler avant que le soleil ne soit au-dessus de nos têtes. Tu devras rentrer à la maison à ce moment-là. »
Ce n’est pas que la petite ne marche pas vite. Non ! Mais une attitude qui lui donne de l’assurance. Ce matin particulièrement, la joie que ressent Maria prend une allure curieuse. Elle la transporte au pays de ses malheurs, à l’époque où elle a attendu son enfant avec beaucoup de plaisir et la déception qui a suivi. Elle évoque son mariage par troc, comme cela se faisait à cette époque. Elle revoit la cérémonie au cours de laquelle ses parents l’ont installée chez son mari. La mort de son fils, puis celle de Ndongo constituent les principales raisons pour lesquelles elle a dû quitter le foyer conjugal. L’intervention déterminante des siens a pesé lourd sur ce retour chez ses parents.
Tant de choses défilent dans sa tête. Tout est clair, net, comme si ces événements dataient de peu. Sa mémoire l’a aidée à survivre autant que l’espoir. Il lui arrive de penser qu’elle est encore sur terre grâce à sa rage.
Le contrat de mariage
Alors qu’elle allait avoir quatre ans, Maria avait compris qu’elle devait quitter ses parents pour une nouvelle famille. Elle allait oublier Emvoutou, sa demi-sœur, mariée au même moment qu’elle. Elle partait aussi vers son foyer. Cela ne la surprenait pas quand on évoquait la nécessité d’un tel déplacement. On lui avait montré, dans la cour de son père, des petites filles dont les parents vivaient dans d’autres villages. Comment lui expliquer qu’elle était mariée étant encore dans le ventre de sa mère ? Elle n’aurait sûrement pas vu ce que cela signifiait. On ne sait pas qui on est quand on est dans le ventre d’une maman.
De toutes les façons, cela ne signifie rien à cet âge. Le mariage reste avant tout une affaire d’adultes dans laquelle les petites filles servent tout simplement de monnaie d’échange. Le consentement paternel à cette union remontait à une époque lointaine. Ndongo s’était présenté à son ami en tant que prétendant de la prochaine fille qui naîtrait chez Mbili. Tel était également la démarche du candidat à la future Emvoutou. Leur père était une grande figure de la région. Très riche, ses épouses occupaient un village entier réparti en quatre rangées de cases de femmes. Un soin particulier était donné à cette grande Habitation.
Chaque propriétaire de case jouissait d’une certaine liberté, autant qu’on peut la vivre dans un mariage polygame. Des passages étaient aménagés entre les « cuisines » de manière à ce que les murs de pailles et d’écorces d’arbres ne se touchent pas, afin d’éviter aux murs de tendre leurs oreilles. Les indiscrétions ne manquent pas dans une pareille promiscuité, mais il faut les éviter. C’est dans ces enceintes que les épouses vivent avec leur progéniture et les jeunes épouses qui leur sont confiées. Comme on le sait bien : la paix pour un homme qui épouse plusieurs femmes relève du vœu pieux, malgré l’épaisseur des écorces d’arbres emboîtées.
Le futur père de Maria rêvait de donner sa fille à son vieil ami Ndongo qui la lui avait demandée. Cet engagement ne se réalisa pas comme escompté. Chose surprenante, les femmes ne donnaient naissance qu’à des garçons. On aurait dit que leur géniteur restait immobilisé dans la même posture trop longtemps quand il recevait ses épouses dans sa maison. Son sang aurait alors circulé de façon à lui permettre de ne distribuer que la semence masculine. Il fallut attendre de nombreuses saisons sèches pour que Mbili puisse de nouveau retrouver la posture qui engendre le genre féminin.
« Les naissances vous savez, confia-t-il un jour à Ndongo et à ses autres amis en plaisantant, sont capricieuses. Je suis dans ma phase de fabrication des mâles, jusqu’à ce que le hasard me fasse retrouver la position qui engendre la gent féminine ».
Cet aveu déclencha une salve de filles après le passage des femmes au domicile du chef de famille. Les relations particulières entretenues par Mbili et Abôlô, sa jeune épouse enceinte, lui permirent de pressentir un changement dans l’arrivée des naissances. Aussi, lorsque Ndongo apprit à la grossesse de la jeune épouse de son ami, il se présenta chez lui. Les deux hommes avaient conclu le projet de maniage, mais sous réserve de deux conditions : la réalisation de l’annonce de l’homme-clinique et l’aval du Créateur tout-puissant.
Cependant, malgré la dot que Ndongo était susceptible verser et en dépit des cadeaux qu’il avait commencé à offrir aux beaux-parents, une question épineuse restait à résoudre. Mbili se sentait vieux et refusait désormais de prendre de nouvelles épouses. Il était de plus en plus écœuré à l’idée d’épouser des femmes qui avaient l’âge de ses arrières-arrière-petits-enfants. Non seulement il n’était plus sûr d’honorer celles qui vivaient et attendaient chez lui, ses épouses légitimes pourtant, mais il voulait aussi faire changer les traditions et mettre fin à un certain nombre de pratiques. Surtout celles que le sage trouvait insensées et odieuses. Les vieillards devaient laisser les jeunes filles épouser ceux de leur génération. Mais, allait-on l’entendre ? Pour l’heure, il avait fait une promesse à Ndongo, il devait la tenir. Ils avaient néanmoins discuté des malheurs que provoque le mariage précoce.
Les deux amis avaient convenu, entre hommes, que la dot consisterait à livrer, en échange de la future Maria, une enfant de sexe féminin, une fiancée qui aurait à peu près l’âge du bébé à naître. Mbili avait un garçon ayant subi avec succès les épreuves et rites d’initiation. Il venait de se marier pour la première fois et attendait éventuellement de prendre, en échange de sa sœur, l’une des filles de Ndongo. Il se trouva fort heureusement que l’une de ses épouses attendait un enfant. Le principe d’échange fut conclu, mais tout dépendait, comme toujours, de la volonté du Créateur.
On demanda avec force et insistance aux habiles guérisseurs d’œuvrer pour modifier le sexe des enfants attendus par les mères, si par malheur ils étaient contraires à ceux espérés. C’était le seul moyen de permettre que cette alliance vît le jour. Ainsi s’engagea une lutte indicible contre la nature. La naissance de Maria avait comblé de joie les deux familles. Une alliance, telle que celle qui se préparait, ne laissait personne indifférent.
Jusqu’à l’âge de quatre ans, Maria vécut auprès de ses parents, recevant régulièrement les visites de son « mari », comme sa demi-sœur recevait celles du sien. Les jeunes enfants appelaient ses hommes qui venaient les voir « père ». Pour elles, tout était clair : à leur âge, tout homme adulte est « père » et toute femme « mère ». Souvent, arrivait aussi dans la cour de Mbili la première épouse de Ndongo, Mendo. C’était la femme-mâle, la femme mère, bras droit de l’homme, confidente devant les ancêtres et les humains, son égale devant les siens. Son âge lui octroyait ces titres et statuts. La vieille femme avait acquis ce rang grâce aux services rendus à son mari et à la famille. Dans ces régions de la forêt, toute femme qui a cessé de voir la lune et dont le comportement est exemplaire peut jouir des mêmes prérogatives que les notables hommes. Elle peut rejoindre les conseils et les lieux où se réunissent ceux qui, par leur genre, n’ont jamais vu la lune.
Ces visites rendaient folle de joie cette petite créature fragile, au caractère bien affermi. Alors qu’à son âge les enfants dialoguaient rarement avec les adultes, elle était toujours aux côtés de son père. Elle ne voyait pas où était le mal. De toutes les façons, elle n’avait pas compris que sa destinée avait été fixée avant l’aube. Y aurait-elle changé quelque chose ? Sa place était certes à côté de sa mère qui devait l’élever dans l’esprit de soumission absolue à l’homme, mais cela ne la satisfaisait pas.
Ses questions et sa vivacité embarrassaient les plus sages, surtout qu’elle les regardait droit dans les yeux. Le contact avec les hommes lui était si facile que les autres petites filles ne la comprenaient pas. Elles qui s’étaient emmurées dans le silence, sans doute instruites par leurs mères, l’enviaient. Son comportement viril, son intelligence et sa spontanéité commencèrent à inquiéter sa mère et sa grand-mère. Dès que Maria voyait arriver ce nouveau « père » chez qui elle allait vivre, elle s’installait à côté de lui, posait des questions indiscrètes et quelque peu déconcertantes. Elle le trouvait gentil, et pour cause ! De tout temps, dans cette culture, on avait élevé les filles et les femmes pour obéir, être sous la domination de l’homme. Pourquoi Mbili et Ndongo l’avaient-ils laissée agir de cette façon ?





























