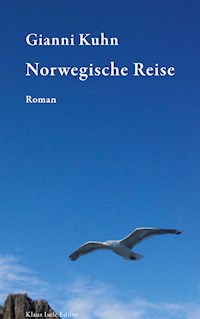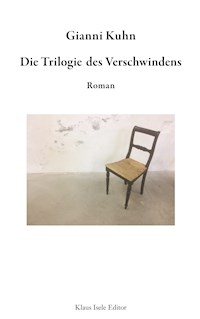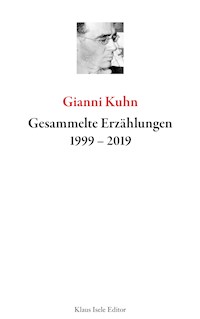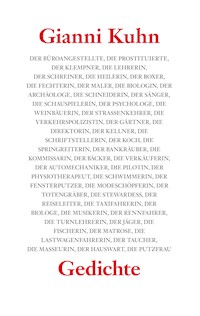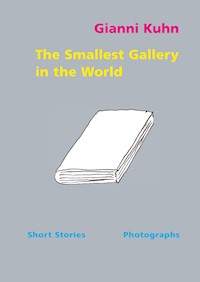8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Soyez prévenus! Si vous êtes inspirés par le mode d´emploi imprimé dans ce livre et qu´effectivement vous vous saisissez d´une paire de ciseaux pour délivrer les pages doubles de leur carcan broché, vous devez vous attendre à quelques surprises.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sommaire
Comment tout a commencé
Le galeriste
La proposition
La garde d’enfants
Addendum
Histoires courtes et photographies
À propos de l’auteur
Les œuvres littéraires de Gianni Kuhn
Recueils d’art, livres de photos et CD de l’auteur
Comment tout a commencé
Ce n’est pas comme si j’étais venu au monde en étant déjà écrivain. Même si l’idée que, tout de suite après ma naissance, fortifié par la première tétée au sein de ma mère, j’avais commencé de décrire la destinée qui m’avait mené jusque-là, est une idée séduisante : les neuf mois dans le ventre de ma mère, la gravitation dans cet océan toujours plus étroit, les tremblements de terre soudains, les remous, l’aspiration, le glissement, les contractions, l’apparition, la première goulée d’air, le cri.
Couché dans mon berceau, supposément en train de dormir profondément, j’étais impatient que ma mère quitte la chambre. J’ouvrais les yeux, choppais un petit carnet et avec un bout de crayon à papier que j’avais habilement caché au bord du petit matelas, je me mettais au travail. Je décrivais mes pensées, la relation à ma mère, qui me fournissait en lait, me souriait, me parlait, me chantait une comptine, changeait mes couches. Mais malheureusement je ne peux plus retrouver le « carnet des premières semaines ». Peut-être que ma mère, horrifiée, l’avait fait disparaître. Qui peut bien vouloir d’un bébé précoce. Quand, aujourd’hui, je lui parle de cela, elle dit que je rêve probablement et que j’avais toujours eu une imagination débordante.
Pourtant je me rappelle sans aucune ambiguïté possible les arbres qui se trouvaient devant la maison et leurs feuilles qui se balançaient dans le vent. Ma mère m’avait laissé à l’extérieur, dans ma poussette. J’étais sur le dos et je levais les yeux vers le feuillage ondoyant à travers lequel le soleil perçait de temps à autre. Mais savais-je ce qu’était un arbre, a fortiori un érable, savais-je ce qu’étaient les feuilles, ce qu’était le soleil ? Est-ce que je savais ce qu’étaient les couleurs, à quoi elles appartenaient, ce qu’elles signifiaient ? Avais-je connaissance de la photosynthèse, des phases du soleil et de la lune, reconnaissais-je le son du pivert, l’aboiement du chien, le hennissement du cheval ? Je ne pouvais pas encore parler, ne pouvais pas donner de nom aux choses, mais j’observais pleinement et plein de préjugés le spectacle se déroulant devant mes yeux. Et lorsque ma mère revenait pour me chercher, les choses se transformaient pendant le court trajet en poussette qui me ramenait à l’intérieur de la maison. D’autres formes apparaissaient, la lumière s’assombrissait puis s’éclaircissait de nouveau. Et la nuit, lorsque j’étais dans mon petit lit, un rayon balayait de temps en temps le plafond, un faisceau lumineux, accompagné d’une vibration qui traversait la chambre en s’élargissant et en rapetissant. Il provenait des tracteurs d’autres paysans, qui livraient à la fromagerie le lait frais dans des bidons. Mais savais-je ce qu’étaient des paysans ou même des tracteurs ?
L’odeur du fumier et de la paille, de l’huile de moteur et de la sciure, du café au lait et du saindoux revient à mes narines lorsque je repense à ma petite enfance. J’entends Max et Moritz, nos deux chevaux bais s’ébrouer. Leurs crinières presque blanches me fascinaient. Comme des voiles battant dans le vent. Mais est-ce que je savais ce qu’était un voilier, en avais-je déjà vu un ? Je suppose que même mon père qui, à l’époque, n’avait pas encore fait le chemin jusqu’à la mer n’aurait pu m’expliquer ce qui se cachait derrière les mots grand voilier, goélette ou clipper, ni encore moins dire ce que mât de hune, vergue, hauban ou étai signifiaient. Notre ferme n’était pas au bord de l’eau, elle n’était pas limitée par le rivage, mais elle était retirée, loin, à l’intérieur des terres, protégée au creux de douces collines. Ici, le vent ne poussait pas vers nous des vagues aussi hautes que des maisons, il avait jeté son dévolu sur la forêt qu’il transformait pendant les tempêtes d’automne en une mer terriblement mugissante.
L’été, à cause des taons importuns, les deux chevaux étaient souvent nerveux, ils piaffaient et agitaient leur queue. Pour tenir à distance les bestioles, mon père avait accroché à l’encolure des chevaux un petit seau rempli d’un liquide noir qui sentait horriblement mauvais. De temps en temps, mon père m’installait sur le dos d’un des chevaux qu’il menait au licol et qu’il faisait tourner dans le manège devant la grange. J’étais vraiment assis sur le dos large et chaud d’un cheval, j’étais un fier cavalier. De là-haut, le monde était totalement différent.
Alors que mes frères et sœurs aînés traversaient déjà la forêt pour descendre à l’école du village, la forêt devint pour moi mon royaume. Je connaissais le versant glaiseux qui menait au ruisseau, l’odeur de l’eau saumâtre, je connaissais les gués où poussaient de grosses fleurs jaunes aux feuilles géantes. Là, je pouvais facilement traverser le ruisseau. Mais je connaissais aussi les endroits secs, comme celui du sapin centenaire dont les branches touchaient le sol. Là, personne ne pouvait me voir, personne ne pouvait me trouver. Quand je marchais dans la forêt et que j’avisais une biche, quand le soleil à travers les branches et le feuillage des hêtres projetait comme par magie un jeu d’ombres et de lumières sur le sol de la forêt ou quand la pluie chantait une petite mélodie, j’étais dans un espace dans lequel mon intériorité et l’extérieur étaient étrangement mêlés, comme s’il n’y avait pas de frontière véritable.
Le galeriste
Vingt-cinq ans plus tard. Une tasse de thé vert fume devant moi, lorsque le téléphone sonne.