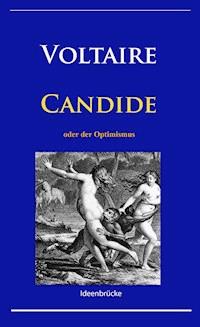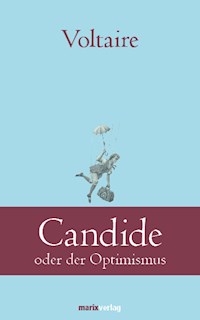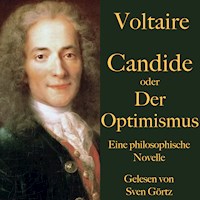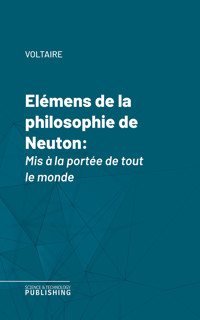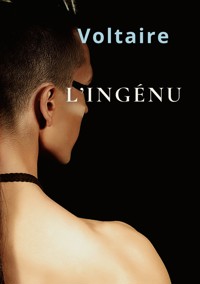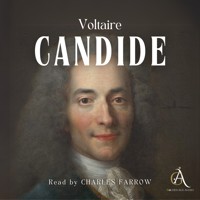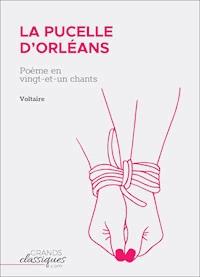
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Un des textes de Voltaire qui a fait le plus scandale.
POUR UN PUBLIC AVERTI.
La Pucelle d'Orléans est un poème héroï-comique en vingt-et-un chants, qui dépeint en vers satiriques la vie de Jeanne d'Arc. L'œuvre iconoclaste a scandalisé la cour de France, et son statut d'écrit licencieux censuré a encouragé la circulation de nombreuses versions clandestines et non reconnues à travers l'Europe.
Des poèmes érotiques voltairiens longtemps cantonnés dans « l'Enfer » de la Bibliothèque nationale de France.
EXTRAIT
L'âne plus fou revint vers la Pucelle
Jeanne s'émut, ses sens furent charmés ;
Les yeux en feu : « par saint Denis ! dit-elle,
Est-il bien vrai, monsieur, que vous m’aimez ? »
« Si je vous aime ! en doutez-vous encore ? »
Répondit l'âne. Oui, mon cœur vous adore
Ciel ! que je fus jaloux du cordelier ! »
À PROPOS DE L'AUTEUR
François Marie Arouet, dit
Voltaire (1694-1778), est un écrivain et philosophe français qui a incarné le siècle des Lumières. Grand anticlérical, il avait une pensée très libre, retranscrite dans son écriture et ses correspondances. Son œuvre littéraire est tout aussi riche que variée en productions théâtrales, longs poèmes épiques et contes philosophiques. Si l'on excepte
La Pucelle d'Orléans, le libertinage de Voltaire court en filigrane dans tous les genres abordés : du conte
Zadig (1747) à l'
Essai sur les mœurs (1756), dans les
Lettres philosophiques (1733) ou encore dans le
Dictionnaire philosophique (1764).
À PROPOS DE LA COLLECTION
Retrouvez les plus grands noms de la littérature érotique dans notre collection
Grands classiques érotiques.
Autrefois poussés à la clandestinité et relégués dans « l'Enfer des bibliothèques », les auteurs de ces œuvres incontournables du genre sont aujourd'hui reconnus mondialement.
Du Marquis de Sade à Alphonse Momas et ses multiples pseudonymes, en passant par le lyrique Alfred de Musset ou la féministe Renée Dunan, les
Grands classiques érotiques proposent un catalogue complet et varié qui contentera tant les novices que les connaisseurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface de Dom Apuléius Risorius, bénédictin (édition de 1762)
Remercions la bonne âme par laquelle une Pucelle nous est venue. Ce poème héroïque et moral fut composé vers l’an 1750, comme les doctes le savent, et comme il appert par plusieurs traits de cet ouvrage. Nous voyons dans une lettre de 1740, imprimée dans le Recueil des opuscules d’un grand prince, sous le nom du Philosophe de Sans-Souci, qu’une princesse d’Allemagne, à laquelle on avait prêté le manuscrit, seulement pour le lire, fut si édifiée de la circonspection qui règne dans un sujet si scabreux, qu’elle passa un jour et une nuit à le faire copier et à transcrire elle-même tous les endroits les plus moraux. C’est cette même copie qui nous est enfin parvenue. On a souvent imprimé des lambeaux de notre Pucelle, et les vrais amateurs de la saine littérature ont été bien scandalisés de la voir si horriblement défigurée. Des éditeurs l’ont donnée en quinze chants, d’autres en seize, d’autres en dix-huit, d’autres en vingt-quatre, tantôt en coupant un chant en deux, tantôt en remplissant des lacunes par des vers que le cocher de Vertamont sortant du cabaret pour aller en bonne fortune, aurait désavoués.
Voici donc Jeanne dans toute sa pureté. Nous craignons de faire un jugement téméraire en nommant l’auteur à qui on attribue ce poème épique. Il suffit que les lecteurs puissent tirer quelques instructions de la morale cachée sous les allégories du poème. Qu’importe de connaître l’auteur ? Il y a beaucoup d’ouvrages que les doctes et les sages lisent avec délices sans savoir qui les a faits, comme le Pervigilium Veneris, la satire sous le nom de Pétrone, et tant d’autres.
Ce qui nous console beaucoup, c’est qu’on trouvera dans notre Pucelle bien moins de choses hardies et libres que dans tous les grands hommes d’Italie qui ont écrit dans ce goût.
Verum enim vero, à commencer par le Pulci, nous serions bien fâchés que notre discret auteur eût approché des petites libertés que prend ce docteur florentin dans son Morgante. Ce Luigi Pulci, qui était un grave chanoine, composa son poème, au milieu du quinzième siècle, pour la signora Lucrezia Tornabuoni, mère de Laurent de Médicis le Magnifique ; et il est rapporté qu’on chantait le Morgante à la table de cette dame. C’est le second poème épique qu’ait eu l’Italie. Il y a eu de grandes disputes parmi les savants, pour savoir si c’est un ouvrage sérieux ou plaisant.
Ceux qui l’ont cru sérieux se fondent sur l’exorde de chaque chant, qui commence par des versets de l’Ecriture. Voici, par exemple, l’exorde du premier chant :
In principio era il Verbo appresso a Dio ;Ed era Iddio il Verbo, e’l Verbo lui.Questo era il principio al parer mio, etc.
Si le premier chant commence par l’Evangile, le dernier finit par le Salve Regina ; et cela peut justifier l’opinion de ceux qui ont cru que l’auteur avait écrit très sérieusement, puisque, dans ces temps-là, les pièces de théâtre qu’on jouait en Italie étaient tirées de la Passion et des Actes des saints.
Ceux qui ont regardé le Morgante comme un ouvrage badin n’ont considéré que quelques hardiesses trop fortes, auxquelles il s’abandonne.
Morgante demande à Margutte s’il est chrétien ou mahométan :
E se egli crede in Cristo o in Maometto.Rispose allor Margutte : A dirtel ho tosto,Io non credo più al nero che al azzuro,Ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto ;
…………………………………
Ma sopra tutto nel buon vino ho fede ;E credo che sia salvo chi gli crede.Or queste son tre virtù cardinale,La gola, e’l culo, e’l dabo, come io t’ho detto.
Vous remarquerez, s’il vous plaît, que le Crescimbeni, qui ne fait nulle difficulté de ranger le Pulci parmi les vrais poètes épiques, dit, pour l’excuser, qu’il était l’écrivain de son temps le plus modeste et le plus mesuré : « Il più modesto e moderato scrittore. » Le fait est qu’il fut le précurseur de Boyardo et de l’Arioste. C’est par lui que les Roland, les Renaud, les Olivier, les Dudon, furent célèbres en Italie, et il est presque égal à l’Arioste pour la pureté de la langue.
On en a fait depuis peu un e très belle édition con licenza de superiori. Ce n’est pas moi assurément qui l’ai faite ; et si notre Pucelle parlait aussi impudemment que ce Margutte, fils d’une prêtre turc et d’une religieuse grecque, je me garderais bien de l’imprimer.
On ne trouvera pas non plus dans Jeanne les mêmes témérités que dans l’Arioste ; on n’y verra point un saint Jean qui habite dans la lune, et qui dit :
Gli scittori amo e fo il debito mio,Che al vostro mondo fui scittore anche io.
……………………………………
E bon convenne ad mio lodato CristoRendermi guiderdon di si gran sorte, etc.
Cela est gaillard, et saint Jean prend là une licence qu’aucun saint de la Pucelle ne prendra jamais. Il semble que Jésus ne doive sa divinité qu’au premier chapitre de saint Jean , et que cet évangéliste l’ait flatté. Ce discours sent un peu son socinien. Notre auteur discret n’a garde de tomber dans un tel excès.
C’est encore pour nous un grand sujet d’édification, que notre modeste auteur n’ait imité aucun de nos anciens romans, dont le savant Huet, évêque d’Avranches, et le compilateur l’abbé Lenglet, ont fait l’histoire. Qu’on se donne seulement le plaisir de lire Lancelot du Lac, au chapitre intitulé Comment Lancelot coucha avec la royne, et comment le sire de Lagant la reprint, on verra quelle est la pudeur de notre auteur, en comparaison de nos auteurs antiques.
Mais Quid dicam de l’histoire merveilleuse de Gargantua, dédiée au cardinal de Tournon (9). On sait que le chapitre des Torche-culs est un des plus modestes de l’ouvrage.
Nous ne parlons point ici des modernes : nous dirons seulement que tous les vieux contes imaginés en Italie, et mis en vers par La Fontaine, sont encore moins moraux que notre Pucelle. Au reste, nous souhaitons à tous nos graves censeurs les sentiments délicats du beau Monrose ; à nos prudes, s’il y en a, la naïveté d’Agnès et la tendresse de Dorothée ; à nos guerriers, le bras de la robuste Jeanne ; à tous les jésuites, le caractère du bon confesseur Bonifoux ; à tous ceux qui tiennent une bonne maison, les attentions et le savoir-faire de Bonneau.
Nous croyons d’ailleurs ce petit libre un remède excellent contre les vapeurs qui affligent en ce temps-ci plusieurs dames et plusieurs abbés ; et quand nous n’aurions rendu que ce service au public, nous croirions n’avoir pas perdu notre temps.
CHANT PREMIER
ArgumentAmours honnêtes de Charles VII et d’Agnès Sorel. Siège d’Orléans par les Anglais. Apparition de saint Denys, etc.
Vous m’ordonnez de célébrer des saints :Ma voix est faible, et même un peu profane.Il faut pourtant vous chanter cette JeanneQui fit, dit-on, des prodiges divins.Elle affermit, de ses pucelles mains,Des fleurs de lys la tige gallicane,Sauva son roi de la rage anglicane,Et le fit oindre au maître-autel de Reims.Jeanne montra sous féminin visage,Sous le corset et sous le cotillon,D’un vrai Roland le vigoureux courage.J’aimerais mieux, le soir pour mon usage,Une beauté douce comme un mouton ;Mais Jeanne d’Arc eut un cœur de lion :Vous le verrez, si lisez cet ouvrage.Vous tremblerez de ses exploits nouveaux ;Et le plus grand de ses rares travauxFut de garder un an son pucelage.
O Chapelain, toi dont le violon,De discordante et gothique mémoireSous un archet maudit par ApollonD’un ton si dur a raclé son histoire Vieux Chapelain, pour l’honneur de ton artTu voudrais bien me prêter ton génie Je n’en veux point ; c’est pour la Motte-Houdart,Quand l’Iliade est par lui travestie
Le bon roi Charles, au printemps de ses jours,Au temps de Pâque, en la cité de Tours,A certain bal (ce prince aimait la danse)Avait trouvé, pour le bien de la France,Une beauté nommée Agnès Sorel.Jamais l’Amour ne forma rien de tel.Imaginez de Flore la jeunesse,La taille et l’air de la nymphe des bois,Et de Vénus la grâce enchanteresse,Et de l’Amour le séduisant minois,L’art d’Arachné, le doux chant des sirènes :Elle avait tout ; elle aurait dans ses chaînesMis les héros, les sages, et les rois.La voir, l’aimer, sentir l’ardeur naissanteDes doux désirs, et leur chaleur brûlante, Lorgner Agnès, soupirer et trembler,Perdre la voix en voulant lui parler,Presser ses mains d’une main caressanteLaisser briller sa flamme impatiente,Montrer son trouble, en causer à son tour,Lui plaire enfin, fut l’affaire d’un jour.Princes et rois vont très-vite en amour.Agnès voulut, savante en l’art de plaire,Couvrir le tout des voiles du mystère,Voiles de gaze, et que les courtisansPercent toujours de leurs yeux malfaisants.Pour colorer comme on put cette affaire,Le roi fit choix du conseiller Bonneau,Confident sûr, et très-bon Tourangeau :Il eut l’emploi qui certes n’est pas mince,Et qu’à la cour, où tout se peint en beau,Nous appelons être l’ami du prince,Mais qu’à la ville, et surtout en province,Les gens grossiers ont nommé maquereau.Monsieur Bonneau, sur le bord de la Loire,Était seigneur d’un fort joli château.Agnès un soir s’y rendit en bateau,Et le roi Charles y vint à la nuit noire.On y soupa ; Bonneau servit à boire ;Tout fut sans faste, et non pas sans apprêts.Festins des Dieux, vous n’êtes rien auprès !Nos deux amants, pleins de trouble et de joie,Ivres d’amour, à leurs désirs en proie,Se renvoyaient des regards enchanteurs,De leurs plaisirs brûlants avant-coureurs.Les doux propos, libres sans indécence,Aiguillonnaient leur vive impatience.Le prince en feu des yeux la dévorait ;Contes d’amour d’un air tendre il faisait,Et du genou le genou lui serrait.
Le souper fait, on eut une musiqueItalienne, en genre chromatique ;On y mêla trois différentes voixAux violons, aux flûtes, aux hautbois.Elles chantaient l’allégorique histoireDe ces héros qu’Amour avait domptés,Et qui, pour plaire à de tendres beautés,Avaient quitté les fureurs de la gloire.Dans un réduit cette musique était,Près de la chambre où le bon roi soupait.La belle Agnès, discrète et retenue,Entendait tout, et d’aucuns n’était vue.
Déjà la lune est au haut de son cours :Voilà minuit ; c’est l’heure des amours.Dans une alcôve artistement dorée,Point trop obscure, et point trop éclairée,Entre deux draps que la Frise a tissus,D’Agnès Sorel les charmes sont reçus.Près de l’alcôve une porte est ouverte,Que dame Alix, suivante très-experte,En s’en allant oublia de fermer.O vous, amants, vous qui savez aimer,Vous voyez bien l’extrême impatienceDont pétillait notre bon roi de France !Sur ses cheveux, en tresse retenus,Parfums exquis sont déjà répandus.Il vient, il entre au lit de sa maîtresse ; Moment divin de joie et de tendresse !Le cœur leur bat ; l’amour et la pudeurAu front d’Agnès font monter la rougeur.La pudeur passe, et l’amour seul demeure.Son tendre amant l’embrasse tout à l’heure.Ses yeux ardents, éblouis, enchantés,Avidement parcourent ses beautés.Qui n’en serait en effet idolâtre ?Sous un cou blanc qui fait honte à l’albâtreSont deux tétons séparés, faits au tour,Allant, venant, arrondis par l’Amour ;Leur boutonnet a la couleur des roses.Téton charmant, qui jamais ne reposes,Vous invitiez les mains à vous presser,L’œil à vous voir, la bouche à vous baiser.Pour mes lecteurs tout plein de complaisance,J’allais montrer à leurs yeux ébaudisDe ce beau corps les contours arrondis ;Mais la vertu qu’on nomme bienséanceVient arrêter mes pinceaux trop hardis.Tout est beauté, tout est charme dans elle.La volupté, dont Agnès a sa part,Lui donne encore une grâce nouvelle ;Elle l’anime : amour est un grand fard,Et le plaisir embellit toute belle.
Trois mois entiers, nos deux jeunes amantsFurent livrés à ces ravissements.Du lit d’amour ils vont droit à la table.Un déjeuner, restaurant délectable,Rend à leurs sens leur première vigueur ;Puis pour la chasse épris de même ardeur,Ils vont tous deux, sur des chevaux d’Espagne,Suivre cent chiens jappant dans la campagne.A leur retour, on les conduit aux bains.Pâtes, parfums, odeurs de l’Arabie,Qui font la peau douce, fraîche et polie,Sont prodigués sur eux à pleines mains.
Le dîner vient : la délicate chère,L’oiseau du Phase et le coq de bruyère,De vingt ragoûts l’apprêt délicieux,Charment le nez, le palais et les yeux.Du vin d’Aï la mousse pétillante,Et du Tokai la liqueur jaunissante,En chatouillant les fibres des cerveaux,Y porte un feu qui s’exhale en bons motsAussi brillants que la liqueur légèreQui monte et saute, et mousse au bord du verre :L’ami Bonneau d’un gros rire applauditA son bon roi qui montre de l’esprit.Le dîner fait, on digère, on raisonne,On conte, on rit, on médit du prochain,On fait brailler des vers à maître Alain,On fait venir des docteurs de Sorbonne,Des perroquets, un singe, un arlequin.Le soleil baisse ; une troupe choisieAvec le roi court à la comédie,Et, sur la fin de ce fortuné jour,Le couple heureux s’enivre encore d’amour.
Plongés tous deux dans l’excès des délices,Ils paraissaient en goûter les prémices.Toujours heureux et toujours plus ardents,Oint de soupçons, encor moins de querelles,Nulle langueur ; et l’Amour et le TempsAuprès d’Agnès ont oublié leurs ailes.Charles souvent disait entre ses bras,En lui donnant des baisers tout de flamme :« Ma chère Agnès, idole de mon âme,Le monde entier ne vaut point vos appas.Vaincre et régner, ce n’est rien que folie.Mon parlement me bannit aujourd’hui ;Au fier Anglais la France est asservie :Ah ! qu’il soit roi, mais qu’il me porte envie ;J’ai votre cœur, je suis plus roi que lui. »
Un tel discours n’est pas trop héroïque ;Mais un héros, quand il tient dans un litMaîtresse honnête, et que l’amour le pique,Peut s’oublier, et ne sait ce qu’il dit.Comme il menait cette joyeuse vie,Tel qu’un abbé dans sa grasse abbaye,Le prince anglais, toujours plein de furie,Toujours aux champs, toujours armé, botté,Le pot en tête, et la dague au côté,Lance en arrêt, la visière haussée,Foulait aux pieds la France terrassée.Il marche, il vole, il renverse en son coursLes murs épais, les menaçantes tours,Répand le sang, prend l’argent, taxe, pille,Livre aux soldats et la mère et la fille,Fait violer des couvents de nonnains,Boit le muscat des pères bernardins,Frappe en écus l’or qui couvre les saints,Et, sans respect pour Jésus ni Marie,De mainte église il fait mainte écurie :Ainsi qu’on voit dans une bergerieDes loups sanglants de carnage altérés,Et sous leurs dents les troupeaux déchirés,Tandis qu’au loin, couché dans la prairie,Colin s’endort sur le sein d’Égérie,Et que son chien près d’eux est occupéA se saisir des restes du soupé.
Or, du plus haut du brillant apogée,Séjour des saints, et fort loin de nos yeux,Le bon Denys, prêcheur de nos aïeux,Vit les malheurs de la France affligée,L’état horrible où l’Anglais l’a plongée,Paris aux fers, et le roi très-chrétienBaisant Agnès, et ne songeant à rien.Ce bon Denys est patron de la France,Ainsi que Mars fut le saint des Romains,Ou bien Pallas chez les Athéniens.Il faut pourtant en faire différence ;Un saint vaut mieux que tous les dieux païens.« Ah ! par mon chef, dit-il, il n’est pas justeDe voir ainsi tomber l’empire augusteOù de la foi j’ai planté l’étendard :Trône des lis, tu cours trop de hasard ;Sang des Valois, je ressens tes misères.Ne souffrons pas que les superbes frèresDe Henri cinq, sans droit et sans raison,Chassent ainsi le fils de la maison.J’ai, quoique saint, et Dieu me le pardonne,Aversion pour la race bretonne :Car, si j’en crois le livre des destins,Un jour ces gens raisonneurs et mutinsSe gausseront des saintes décrétales,Déchireront les romaines annales,Et tous les ans le pape brûleront.Vengeons de loin ce sacrilège affront :Mes chers Français seront tous catholiques ;Ces fiers Anglais seront tous hérétiques :Frappons, chassons ces dogues britanniques :Punissons-les, par quelque nouveau tour,De tout le mal qu’ils doivent faire un jour. »Des Gallicans ainsi parlait l’apôtre,De maudissons lardant sa patenôtre ;Et cependant que tout seul il parlait,Dans Orléans un conseil se tenait.Par les Anglais cette ville bloquéeAu roi de France allait être extorquée.Quelques seigneurs et quelques conseillers,Les uns pédants et les autres guerriers,Sur divers tons déplorant leur misère,Pour leur refrain disaient : « Que faut-il faire ? »Poton, La Hire et le brave Dunois, S’écriaient tous en se mordant les doigts :« Allons, amis, mourons pour la patrie ;Mais aux Anglais vendons cher notre vie. »Le Richemont criait tout haut : « Par Dieu,Dans Orléans il faut mettre le feu ;Et que l’Anglais, qui pense ici nous prendre,N’ait rien de nous que fumée et que cendre. »Pour La Trimouille, il disait : « C’est en vainQue mes parents me firent Poitevin ;J’ai dans Milan laissé ma Dorothée ;Pour Orléans, hélas ! je l’ai quittée.Je combattrai, mais je n’ai plus d’espoir :Faut-il mourir, ô ciel ! sans la revoir ! »Le président Louvet, grand personnage,Au maintien grave, et qu’on eût pris pour sage,Dit : « Je voudrais que préalablementNous fissions rendre arrêt de parlementContre l’Anglais, et qu’en ce cas énormeSur toute chose on procédât en forme. »Louvet était un grand clerc ; mais hélas !Il ignorait son triste et piteux cas :S’il le savait, sa gravité prudenteProcéderait contre sa présidente.Le grand Talbot, le chef des assiégeants,Brûle pour elle, et règne sur ses sens :Louvet l’ignore ; et sa mâle éloquenceN’a pour objet que de venger la France.Dans ce conseil de sages, de héros,On entendait les plus nobles propos ;Le bien public, la vertu les inspire :Surtout l’adroit et l’éloquent La HireParla longtemps, et pourtant parla bien ;Ils disaient d’or, et ne concluaient rien.
Comme ils parlaient, on vit par la fenêtreJe ne sais quoi dans les airs apparaître.Un beau fantôme au visage vermeil,Sur un rayon détaché du soleil,Des cieux ouverts fend la voûte profonde.Odeur de saint se sentait à la ronde.Le farfadet dessus son chef avaitA deux pendants une mitre pointueD’or et d’argent, sur le sommet fendue ;Sa dalmatique au gré des vents flottait,Son front brillait d’une sainte auréole,Son cou penché laissait voir son étole,Sa main portait ce bâton pastoralQui fut jadis lituus augural.A cet objet qu’on discernait fort mal,Voilà d’abord monsieur de La Trimouille,Paillard dévot, qui prie et s’agenouille,Le Richemont, qui porte un cœur de fer,Blasphémateur, jureur impitoyable,Haussant la voix, dit que c’était le diableQui leur venait du fin fond de l’enfer ;Que ce serait chose très agréableSi l’on pouvait parler à Lucifer.Maître Louvet s’encourut au plus viteChercher un pot tout rempli d’eau bénite.Poton, La Hire et Dunois ébahis,Ouvrent tous trois de grands yeux ébaubis.Tous les valets sont couchés sur le ventre.L’objet approche, et le saint fantôme entreTout doucement porté sur son rayon,Puis donne à tous sa bénédiction.Soudain chacun se signe et se prosterne.
Il les relève avec un air paterne ;Puis il leur dit : « Ne faut vous effrayer ;Je suis Denys, et saint de mon métier.J’aime la Gaule, et l’ai catéchisée,Et ma bonne âme est très scandaliséeDe voir Charlot, mon filleul tant aimé,Dont le pays en cendre est consumé,Et qui s’amuse, au lieu de le défendre,A deux tétons qu’il ne cesse de prendre.J’ai résolu d’assister aujourd’huiLes bons Français qui combattent pour lui.Je veux finir leur peine et leur misère.Tout mal, dit-on, guérit par son contraire.Or si Charlot veut, pour une catin,Perdre la France et l’honneur avec elle,J’ai résolu, pour changer son destin,De me servir des mains d’une pucelle.Vous, si d’en haut vous désirez les biens,Si vos cœurs sont et français et chrétiens,Si vous aimez le roi, l’État, l’Église,Assistez-moi dans ma sainte entreprise ;Montrez le nid où nous devons chercherCe vrai phénix que je veux dénicher. »
Ainsi parla le vénérable sire.Quand il eut fait, chacun se prit à rire.Le Richemont, né plaisant et moqueur,Lui dit : « Ma foi, mon cher prédicateur,Monsieur le saint, ce n’était pas la peineD’abandonner le céleste domainePour demander à ce peuple méchantCe beau joyau que vous estimez tant.Quand il s’agit de sauver une ville,Un pucelage est une arme inutile.Pourquoi d’ailleurs le prendre en ce pays ?Vous en avez tant dans le paradis !Rome et Lorette ont cent fois moins de ciergesQue chez les saints il n’est là-haut de vierges.Chez les Français, hélas ! il n’en est plus.Tous nos moutiers sont à sec là-dessus.Nos francs archers, nos officiers, nos princes,Ont dès longtemps dégarni les provinces.Ils ont tous fait, en dépit de vos saints,Plus de bâtards encor que d’orphelins.Monsieur Denys, pour finir nos querelles,Cherchez ailleurs, s’il vous plaît, des pucelles. »Le saint rougit de ce discours brutal ;Puis aussitôt il remonte à chevalSur son rayon, sans dire une parole,Pique des deux, et par les airs s’envole,Pour déterrer, s’il peut, ce beau bijou,Qu’on tient si rare, et dont il semble fou.Laissons aller : et tandis qu’il se percheSur l’un des traits qui vont porter le jour,Ami lecteur, puissiez-vous en amourAvoir le bien de trouver ce qu’il cherche !
CHANT II
ArgumentJeanne, armée par saint Denys, va trouver Charles VII à Tours ; ce qu’elle fit en chemin, et comment elle eut son brevet de pucelle.
Heureux cent fois qui trouve un pucelage !C’est un grand bien ; mais de toucher un cœurEst, à mon sens, le plus cher avantage.Se voir aimé, c’est là le vrai bonheur.Qu’importe, hélas ! d’arracher une fleur ?C’est à l’amour à nous cueillir la rose.De très-grands clercs ont gâté par leur gloseUn si beau texte ; ils ont cru faire voirQue le plaisir n’est point dans le devoir.Je veux contre eux faire un jour un beau livre ;J’enseignerai le grand art de bien vivre ;Je montrerai qu’en réglant nos désirs,C’est du devoir que viennent nos plaisirs.Dans cette honnête et savante entreprise,Du haut des cieux saint Denys m’aidera ;Je l’ai chanté, sa main me soutiendra.En attendant, il faut que je vous diseQuel fut l’effet de sa sainte entremise.
Vers les confins du pays champenois,Où cent poteaux, marqués de trois merlettes,Disaient aux gens : « En Lorraine vous êtes, »Est un vieux bourg, peu fameux autrefois ;Mais il mérite un grand nom dans l’histoire,Car de lui vient le salut et la gloireDes fleurs de lis et du peuple gaulois.De Domremi chantons tous le village ;Faisons passer son beau nom d’âge en âge.
O Domremi ! tes pauvres environsN’ont ni muscats, ni pêches, ni citrons,Ni mine d’or, ni bon vin qui nous damne ;Mais c’est à toi que la France doit Jeanne.Jeanne y naquit : certain curé du lieu,Faisant partout des serviteurs à Dieu,Ardent au lit, à table, à la prière,Moine autrefois, de Jeanne fut le père ;Une robuste et grasse chambrièreFut l’heureux moule où ce pasteur jetaCette beauté, qui les Anglais dompta.Vers les seize ans, en une hôtellerieOn l’engagea pour servir l’écurie,A Vaucouleurs ; et déjà de son nomLa renommée remplissait le canton.Son air est fier, assuré, mais honnête ;Ses grands yeux noirs brillent à fleur de tête ;Trente-deux dents d’une égale blancheurSont l’ornement de sa bouche vermeille,Qui semble aller de l’une à l’autre oreille,Mais bien bordée et vive en sa couleur,Appétissante, et fraîche par merveille.Ses tétons bruns, mais fermes comme un roc,Tentent la robe, et le casque, et le froc.Elle est active, adroite, vigoureuse,Et d’une main potelée et nerveuseSoutient fardeaux, verse cent brocs de vin,Sert le bourgeois, le noble, et le robin ;Chemin faisant, vingt soufflets distribueAux étourdis dont l’indiscrète mainVa tâtonnant sa cuisse ou gorge nue ;Travaille et rit du soir jusqu’au matin,Conduit chevaux, les panse, abreuve, étrille ;Et les pressant de sa cuisse gentille,Les monte à cru comme un soldat romain.
O profondeur ! ô divine sagesse !Que tu confonds l’orgueilleuse faiblesseDe tous ces grands si petits à tes yeux !Que les petits sont grands quand tu le veux !Ton serviteur Denys le bienheureuxN’alla rôder au palais des princesses,N’alla chez vous, mesdames les duchesses ;Denys courut, amis, qui le croirait ?Chercher l’honneur, où ? dans un cabaret.
Il était temps que l’apôtre de FranceEnvers sa Jeanne usât de diligence.Le bien public était en grand hasard.De Satanas la malice est connue ;Et, si le saint fût arrivé plus tardD’un seul moment, la France était perdue.Un cordelier qu’on nommait Grisbourdon,Avec Chandos arrivé d’Albion,Était alors dans cette hôtellerie ;Il aimait Jeanne autant que sa patrie.C’était l’honneur de la pénaillerie ;De tous côtés allant en mission ;Prédicateur, confesseur, espion ;De plus, grand clerc en la sorcellerie,Savant dans l’art en Égypte sacré,Dans ce grand art cultivé chez les mages,Chez les Hébreux, chez les antiques sages,De nos savants dans nos jours ignoré.Jours malheureux ! tout est dégénéré.
En feuilletant ses livres de cabale,Il vit qu’aux siens Jeanne serait fatale,Qu’elle portait dessous son court juponTout le destin d’Angleterre et de France.Encouragé par la noble assistanceDe son génie, il jura son cordon,Son Dieu, son diable, et saint François d’AssiseQu’à ses vertus Jeanne serait soumise,Qu’il saisirait ce beau palladion.Il s’écriait en faisant l’oraison :« Je servirai ma patrie et l’Église ;Moine et Breton, je dois faire le bienDe mon pays, et plus encor le mien. »
Au même temps un ignorant, un rustre,Lui disputait cette conquête illustre :Cet ignorant valait un cordelier,Car vous saurez qu’il était muletier ;Le jour, la nuit, offrant sans fin, sans terme,Son lourd service et l’amour le plus ferme.L’occasion, la douce égalité,Faisaient pencher Jeanne de son côté ;Mais sa pudeur triomphait de la flammeQui par les yeux se glissait dans son âme.Le Grisbourdon vit sa naissante ardeur :Mieux qu’elle encore il lisait dans son cœur.Il vint trouver ce rival si terrible ;Puis il lui tint ce discours très-plausible :
« Puissant héros, qui passez au besoinTous les mulets commis à votre soin,Vous méritez, sans doute, la pucelle ;Elle a mon cœur comme elle a tous vos vœux ;Rivaux ardents, nous nous craignons tous deux,Et comme vous je suis amant fidèle.Çà, partageons, et, rivaux sans querelle,Tâtons tous deux de ce morceau friandQu’on pourrait perdre en se le disputant.Conduisez-moi vers le lit de la belle ;J’évoquerai le démon du dormir ;Ses doux pavots vont soudain l’assoupir ;Et tour à tour nous veillerons pour elle. »
Incontinent le père au grand cordonPrend son grimoire, évoque le démonQui de Morphée eut autrefois le nom.Ce pesant diable est maintenant en France :Vers le matin, lorsque nos avocatsVont s’enrouer à commenter Cujas,Avec messieurs il ronfle à l’audience ;L’après-dînée il assiste aux sermonsDes apprentis dans l’art de Massillon,A leur trois points, à leurs citationsAux lieux communs de leur belle éloquence ;Dans le parterre il vient bâiller le soir.
Aux cris du moine il monte en son char noir,Par deux hiboux traîné dans la nuit sombre.Dans l’air il glisse, et doucement fend l’ombre.Les yeux fermés, il arrive en bâillant,Se met sur Jeanne, et tâtonne, et s’étend ;Et secouant son pavot narcotique,Lui souffle au sein vapeur soporifique.Tel on nous dit que le moine Girard,En confessant la gentille Cadière,Insinuait de son souffle paillardDe diabloteaux une ample fourmilière.
Nos deux galants, pendant ce doux sommeil,Aiguillonnés du démon du réveil,Avaient de Jeanne ôté la couverture.Déjà trois dés, roulant sur son beau sein,Vont décider, au jeu de saint Guilain,Lequel des deux doit tenter l’aventure,Le moine gagne ; un sorcier est heureux :Le Grisbourdon se saisit des enjeux ;Il fond sur Jeanne. O soudaine merveille !Denys arrive, et Jeanne se réveille.O Dieu ! qu’un saint fait trembler tout pécheur !Nos deux rivaux se renversent de peur.Chacun d’eux fuit, emportant dans le cœurAvec la crainte un désir de mal faire.Vous avez vu, sans doute, un commissaireCherchant de nuit un couvent de Vénus ;Un jeune essaim de tendrons demi-nusSaute du lit, s’esquive, se dérobeAux yeux hagards du noir pédant en robe :Ainsi fuyaient mes paillards confondus.
Denys s’avance et réconforte Jeanne,Tremblante encor de l’attentat profane ;Puis il lui dit : « Vase d’élection,Le Dieu des rois, par tes mains innocentes,Veut des Français venger l’oppression,Et renvoyer dans les champs d’AlbionDes fiers Anglais les cohortes sanglantes.Dieu fait changer, d’un souffle tout-puissant,Le roseau frêle en cèdre du Liban,Sécher les mers, abaisser les collines,Du monde entier réparer les ruines.Devant tes pas la foudre grondera ;Autour de toi la terreur volera,Et tu verras l’ange de la victoireOuvrir pour toi les sentiers de la gloire.Suis-moi, renonce à tes humbles travaux ;Viens placer Jeanne au nombre des héros. »
A ce discours terrible et pathétique,Très-consolant et très-théologique,Jeanne étonnée, ouvrant un large bec,Crut quelque temps que l’on lui parlait grec.La grâce agit : cette augustine grâceDans son esprit porte un jour efficace.Jeanne sentit dans le fond de son cœurTous les élans d’une sublime ardeur.Non, ce n’est plus Jeanne la chambrière ;C’est un héros, c’est une âme guerrière.Tel un bourgeois humble, simple, grossier,Qu’un vieux richard a fait son héritier,En un palais fait changer sa chaumière :Son air honteux devient démarche fière ;Les grands surpris admirent sa hauteur,Et les petits l’appellent monseigneur.
Telle plutôt cette heureuse grisetteQue la nature ainsi que l’art formaPour le b ou bien pour l’Opéra,Qu’une maman avisée et discrèteAu noble lit d’un fermier éleva,Et que l’Amour, d’une main plus adrète,Sous un monarque entre deux draps plaça.Sa vive allure est un vrai port de reine,Ses yeux fripons s’arment de majesté,Sa voix a pris le ton de souveraine,Et sur son rang son esprit s’est monté.
Or pour hâter leur auguste entreprise,Jeanne et Denys s’en vont droit à l’église.Lors apparut dessus le maître autel(Fille de Jean ! quelle fut ta surprise !)Un beau harnois tout frais venu du ciel.Des arsenaux du terrible empyrée,En cet instant, par l’archange MichelLa noble armure avait été tirée.On y voyait l’armet de Débora ;Ce clou pointu, funeste à Sisara ;Le caillou rond, dont un berger fidèleDe Goliath entama la cervelle ;Cette mâchoire avec quoi combattitLe fier Samson qui ses cordes rompitLorsqu’il se vit vendu par sa donzelle ;Le coutelet de la belle Judith,Cette beauté si galamment perfide,Qui, pour le ciel saintement homicide,Son cher amant massacra dans son lit.A ces objets la sainte émerveillée,De cette armure est bientôt habillée ;Elle vous prend et casque et corselet,Brassards, cuissards, baudrier, gantelet,Lance, clou, dague, épieu, caillou, mâchoire,Marche, s’essaye, et brûle pour la gloire.
Toute héroïne a besoin d’un coursier ;Jeanne en demande au triste muletier :Mais aussitôt un âne se présente,Au beau poil gris, à la voix éclatante,Bien étrillé, sellé, bridé, ferré,Portant arçons avec chanfrein doré,Caracolant, du pied frappant la terre,Comme un coursier de Thrace ou d’Angleterre.
Ce beau grison deux ailes possédaitSur son échine, et souvent s’en servait.Ainsi Pégase, au haut des deux collines,Portait jadis neuf pucelles divines ;Et l’hippogriffe, à la lune volant,Portait Astolphe au pays de saint Jean.Mon cher lecteur veut connaître cet âne,Qui vint alors offrir sa croupe à Jeanne :Il le saura, mais dans un autre chant.Je l’avertis cependant qu’il révèreCet âne heureux qui n’est pas sans mystère.
Sur son grison Jeanne a déjà sauté ;Sur son rayon Denys est remonté :Tous deux s’en vont vers les rives de LoirePorter au roi l’espoir de la victoire.L’âne tantôt trotte d’un pied léger,Tantôt s’élève et fend les champs de l’air.Le cordelier, toujours plein de luxure,Un peu remis de sa triste aventure,Usant enfin de ses droits de sorcier,Change en mulet le pauvre muletier,Monte dessus, chevauche, pique et jureQu’il suivra Jeanne au bout de la nature.Le muletier, en son mulet caché,Bât sur le dos, crut gagner au marché ;Et du vilain l’âme terrestre et crasseA peine vit qu’elle eût changé de place.
Jeanne et Denys s’en allaient donc vers ToursChercher ce roi plongé dans les amours.Près d’Orléans comme ensemble ils passèrent,L’ost des Anglais de nuit ils traversèrent.Ces fiers Bretons, ayant bu tristement,Cuvaient leur vin, dormaient profondément.Tout était ivre, et goujats et vedettes ;On n’entendait ni tambours ni trompettes :L’un dans sa tente était couché tout nu,L’autre ronflait sur son page étendu.
Alors Denys, d’une voix paternelle,Tint ces propos tout bas à la pucelle :« Fille de bien, tu sauras que Nisus,Étant un soir aux tentes de Turnus,Bien secondé de son cher Euryale,Rendit la nuit aux Rutulois fatale.Le même advint au quartier de Rhésus,Quand la valeur du preux fils de Tydée,Par la nuit noire et par Ulysse aidée,Sut envoyer, sans danger, sans effort,Tant de Troyens du sommeil à la mort.Tu peux jouir de semblable victoire.Parle, dis-moi, veux-tu de cette gloire ? »Jeanne lui dit : » Je n’ai point lu l’histoire ;Mais je serais de courage bien bas,De tuer gens qui ne combattent pas. »Disant ces mots, elle avise une tenteQue les rayons de la lune brillanteFaisaient paraître à ses yeux éblouis